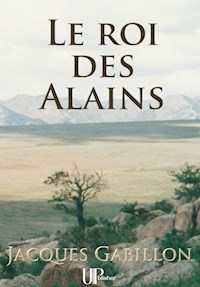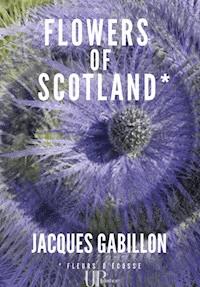
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Plongez dans la fin des années 70 aux côté de Jacques à la recherche de son idéal amoureux
Roman sur fond de rugby, entre Paris et Edimbourg, où le jeu à 15 et les amours difficiles se croisent,
Flowers of Scotland nous entraîne dans l’intimité du narrateur à la poursuite de l’idéal amoureux. De Mary l’écossaise à Angéla la danseuse du Moulin Rouge, le destin sera cruel pour ces jeunes femmes…
Écrites à la première personne, ces chroniques douces-amères sont l’occasion pour l’auteur d’un retour sur sa jeunesse. Tel le rebond imprévisible du ballon ovale, elles nous mènent à la rencontre de ceux et celles qui ont croisé son chemin à la fin des années 70. Personnalités du Paris de l’époque, femmes séduites, aimées et perdues, copains… peuplent un univers où langues et cultures se mêlent et s’emmêlent au nom d’une passion partagée.
« Flowers of Scotland », hymne écossais entonné par le public avant les matchs de rugby de l’Equipe d’Ecosse, est d’abord un hymne à la vie, une exhortation à ne jamais renoncer. Comme les Scots, le narrateur poursuit sa quête avec détermination, quoi qu’il lui arrive. Avec un humour distancié, Jacques Gabillon sait nous faire sourire et nous émouvoir jusqu’aux larmes. Une écriture sans fard, sereine et bouleversante.
Un nouveau talent, une œuvre à découvrir et à partager.
EXTRAIT
J’avais décidé de passer l’hiver avec Jules. Pas n’importe quel Jules, du genre César ou ceux de la république des Jules, non, le plus spirituel, le plus admirable, le plus naturel : Jules Renard ! Vingt ans passés j’avais lu son journal et ses mille deux cents pages, j’étais même allé, à Chitry les Mines dans la Nièvre. Je revoyais avec précision la dame roulant les ‘’R’’ comme un torrent de montagne, me montrant sa tombe simple et au loin la Gloriette où, disait-elle : « il avait écrit ses plus grrrrrands chefs-d’ œuvre ! »
Il faut bien un bon hiver pour lire son journal et prendre des notes, avec ses citations toutes plus justes, drôles, pleines de bon sens sur aussi bien : les hommes que les bêtes, la nature, Dieu, les sentiments, le théâtre, la littérature et une vie n’y suffirait pas à mémoriser le tiers du quart d’une sélection toute relative.
Malheureusement pour moi, ayant à peine commencé la lecture, une nouvelle sur le Web, me bouleversa. Jacky Bouquet venait de mourir.
L’ange blond du quinze de France, du début des années soixante, l’emblématique joueur du Club Sportif de Vienne avait quitté à jamais son Dauphiné natal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Flowers of Scotland Jacques Gabillon
UPblisher.com
« J’ai connu le bonheur mais cela ne m’a pas rendu heureux »
Jules Renard
J’avais décidé de passer l’hiver avec Jules. Pas n’importe quel Jules, du genre César ou ceux de la république des Jules, non, le plus spirituel, le plus admirable, le plus naturel : Jules Renard ! Vingt ans passés j’avais lu son journal et ses mille deux cents pages, j’étais même allé, à Chitry les Mines dans la Nièvre. Je revoyais avec précision la dame roulant les ‘’R’’ comme un torrent de montagne, me montrant sa tombe simple et au loin la Gloriette où, disait-elle : « il avait écrit ses plus grrrrrands chefs-d’ œuvre ! »
Il faut bien un bon hiver pour lire son journal et prendre des notes, avec ses citations toutes plus justes, drôles, pleines de bon sens sur aussi bien : les hommes que les bêtes, la nature, Dieu, les sentiments, le théâtre, la littérature et une vie n’y suffirait pas à mémoriser le tiers du quart d’une sélection toute relative.
Malheureusement pour moi, ayant à peine commencé la lecture, une nouvelle sur le Web, me bouleversa. Jacky Bouquet venait de mourir.
L’ange blond du quinze de France, du début des années soixante, l’emblématique joueur du Club Sportif de Vienne avait quitté à jamais son Dauphiné natal.
Qu’il était loin et si proche ce passé. J’abandonnais Jules pour un passé, composé de ballons ovales et de jeunesse.
Qu’il portait bien son nom : Jacky Bouquet. Une composition unique. Il était la beauté, la grâce, le talent. Vif comme l’éclair, tranchant comme une lame. Ses irrésistibles crochets, les cheveux blonds ondulés, flottant au vent d’Écosse ou d’Irlande nous emportaient avec les brumes de Murrayfield, vers une admiration émue de ce jeune homme au cadrage débordement parfaitement esthétique. Les yeux de Françoise Sagan comme ceux de beaucoup d’autres femmes brillaient d’amour pour ce magnifique joueur. Il tenait des dieux grecs, le mystère et la distance des hommes supérieurs. L’internat du vieux lycée Ponsard de Vienne, à cette époque, bruissait des conquêtes que nous lui prêtions.
Bien des années après, à Édimbourg, au bar de l’hôtel Balmoral, avec le vieux Mac Logan, aussi rigide qu’un lord anglais et portant dignement le saint flacon de whisky, nous poussions alternativement la jambe droite puis la gauche pour éviter des adversaires imaginaires que lui, Jacky Bouquet, avait su si bien effacer. « Biouquet », « The Angel of Colombes », disait-il. Nous évoquions successivement ces illustres français de l’ovalie, Boniface, Dupuis, Gachassin, l’élégant Maso. Puis c’était le tour des grands et forts du pack : de Lucien Mias à Jean Prat que les britanniques appelaient mister rugby. Au milieu de ces évocations, quelques grands joueurs écossais surgissaient, Mac Leod, Peter Stagg géant de 2,08, puis les français revenaient, Walter Spanghero colosse rural au fair-play tout britannique que Mc Logan admirait particulièrement. Il y avait un joueur, français, dont la photo jaunie dans un cadre argenté, oublié, entre deux vieilles revues du Scottish Daily Mail, le troublait encore ; c’était Michel Pomathios, décoré de la Légion d’Honneur et de la Croix de guerre, représentant toujours pour nos amis britanniques, l’excellence. Mac Logan avait quinze ans quand il découvrit ce trois-quart aile hors norme, le 24 janvier 1948 à Murrayfield pour ce mémorable Écosse France. Et lorsque les yeux dans le vague j’évoquais un autre Dieu des stades, écossais, Andy Irvine qui illumina à son tour la brume de Murrayfield, et restera à jamais, un des princes du Parc à Paris. Là, le vieux Mac Logan transformé et transporté de joie ouvrait enfin ce flacon de whisky de l’île d’Islay, le fameux Darkest de Bowmore si surprenant pour nous autres french, avec ses arômes de caoutchouc brûlé, de sherry et d’écorce d’orange.
Ah! Ce bouquet à jamais gravé dans ma mémoire !
Le chemin de l’oubli transforme, et parfois embellit les souvenirs. Ce souvenir-là n’avait nul besoin d’être embelli. Il était ma jeunesse.
C’était les débuts des matchs de rugby du tournoi des cinq nations à la télévision. Une chaîne unique en noir et blanc. Des samedis après-midi où fébrilement tous en bloc, voisins, copains, nous attendions sans respirer la musique de l’eurovision qui enfin allait nous libérer. Le samedi matin en rentrant de l’internat du lycée, entassés dans la Domaine (frégate commerciale Renault) de mon père, pendant le court trajet, les commentaires allaient bon train sur le match de l’équipe de France qui avait lieu l’après-midi.
Quand enfin à quinze heures, la voix si particulière et passionnée de Roger Couderc, chantre de ce rugby que découvrait la France, jusqu’alors réservé à quelques provinces du sud, entonnait : Ici Colombes, stade Yves-du-Manoir, ou : l’Arms Park de Cardiff, ou : Lansdowne Road à Dublin, ou bien : ici Twickenham. Nous frissonnions et la terre s’arrêtait de tourner.
Il y eut des matchs acharnés, et des envolées de trois quarts éblouissantes avec un ballon aussi lourd qu’une pastèque espagnole que les frères Boniface, Bouquet, Dupuis ou Rancoule se passaient sur une jambe, le torse droit, l’épaule opposée à la jambe d’appui s’effaçant dans un mouvement léger et pur que tout danseur de l’opéra de Paris n’aurait pas renié.
Chaque match gagné transformait l’ambiance, le vin rouge était meilleur, l’amitié plus joyeuse. Chaque match perdu contre l’Angleterre nous exaspérait, mon père citait en vrac, la guerre de cent ans, Mers el-Kébir, Jeanne d’Arc, Joffre le 25 août 14, implorant le Maréchal French commandant le B.E.F (British Expeditionary Force) de rester au combat.
En ce début de janvier mille neuf cent soixante-seize, je me retrouvais à embarquer seul à Roissy, pour Édimbourg, mon compagnon d’un prometteur week-end ayant déclaré forfait pour cause de mauvaise grippe. Il m’avait dit, au bord de l’apoplexie que son ami écossais, grand gaillard blond et très sympathique, m’attendrait à l’aéroport, que je passerais en sa compagnie un beautiful Saturday à Murrayfield et vraisemblablement une soirée joyeuse et bien arrosée à Édimbourg. Il se prénommait Édouard.
La Caravelle était bondée, bruyante. Pendant les deux heures de vol, les chants basques et béarnais, volèrent comme des bérets par grand vent au-dessus des Pyrénées.
Je dus goûter à plusieurs fiasques de vins rouges, tous âpres et durs, des vins de Navarre et du fameux Irouleguy qui aux dires de mon voisin de siège : « descend dans le gosier comme la Nive dans l’Adourrrrr…… » Les chants étaient harmonieux à plusieurs voix et les deux hôtesses attendaient avec anxiété la fin du vol.
Le tohu-bohu à l’arrivée à Édimbourg fut mémorable, je ne pouvais penser que cent supporters pouvaient faire autant de bruit. Les chants reprirent de plus belle et au milieu de drapeaux rouge et blanc, de bérets, d’immenses parapluies de berger fabriqués uniquement à Pau, au dire des béarnais, le cortège de l’ovalie pénétra dans le Hall.
Je cherchais mon grand gaillard blond.
Après dix minutes à rester pique planté à observer la foule de mes amis français qui évacuaient l’aéroport, nous étions plus que quelques-uns, un peu sonnés par l’ambiance et le vol, à attendre.
Une jeune femme, légèrement rousse, élancée, belle, un port de tête altier, avec un loden d’un bleu pétrole très british examinait les arrivants d’un air détaché avec une certaine roideur. Une étole verte et bleu foncé en laine cardée, recouvrait largement ses épaules sur lesquelles ses cheveux venaient flotter. Elle s’avança vers moi. Le regard sévère et interrogatif elle me demanda avec un accent volontairement incompréhensible, si j’étais bien « Djack ». Je crus comprendre que son frère avait été empêché. Sa voix avait un son particulier, doux et ferme, clair et rocailleux, elle me subjugua à l’instant.
Malgré mon sourire de circonstance, et mon air ravi, son beau visage aux yeux clairs marquait l’agacement. Elle me dit que son frère absent d’Édimbourg s’excusait et qu’elle allait me conduire dans un hôtel. Je la questionnais en anglais et en français sur ce problème avec son frère. Avec un peu plus d’attention, elle m’expliqua dans un anglais, cette fois scolaire, que la société de courtage en grains, qui employait son frère, l’avait envoyé d’urgence à Anvers pour réceptionner un bateau d’Australie avec une cargaison de malt. Ce qui l’avait mis dans une rage folle, manquer un Écosse France était, pour lui, un grand malheur.
Sa voiture, une mini Cooper vert foncé au toit noir, garée devant le hall, démarra en trombe. Je la regardais amusé et la questionnais sur l’hôtel, en français. Elle me répondit à ma grande surprise, dans un français parfait que c’était le Balmoral Hôtel. Que cela avait été difficile de trouver une chambre, son frère devant me laisser son appartement mais habitant la grande banlieue d’Édimbourg, cela me poserait des problèmes pour aller à Murrayfield.
Elle tourna enfin son visage légèrement moucheté de taches rousses de pure écossaise et j’admirai ses yeux d’un bleu pervenche qui adoucissaient son visage volontaire et déterminé. Elle remarqua l’effet de son regard sur mon expression déjà attentionnée.
Je lui répondis que je la remerciais de tant de sollicitude et qu’il me sera agréable d’être au cœur Édimbourg. La mini quitta brusquement la direction du centre-ville, elle me dit qu’elle devait absolument passer à l’université. Je lui demandai si elle était étudiante à cette célèbre université. Elle était chargée de cours, en histoire du 16ième au 19ième siècle et préparait son doctorat. Mes « congratulations » admiratives semblèrent lui faire plaisir. Un semblant de sourire et un virage brusque, me rappelèrent que j’étais pour elle certainement, dans son planning, un imprévu mal venu.
Je l’interrogeais sur son impeccable français. Elle me fit une réponse laconique sur plusieurs séjours en France. Elle se gara à la façon de la « rallye woman » Michèle Mouton, ma main crispée sur la poignée de porte, je sentis le support se déformer. Bondissante de la voiture, je compris qu’elle en avait pour dix minutes.
Je sortis à mon tour de la mini Cooper. Les bâtiments gris, défiant le temps, d’une des plus illustres universités du monde, étaient impressionnants.
Au loin on pouvait apercevoir le château et la vieille ville d’Édimbourg. L’Athènes du Nord pensais-je. Un pâle soleil d’hiver commençait à percer le ciel couleur ardoise. La température ne devait pas excéder deux degrés. Regardant le soleil, je ne sais pourquoi, la ritournelle de Georges Brassens : « j’ai rendez-vous avec vous » « l’astre solaire m’enlève son feu,… j’ai rendez-vous avec vous… La lumière que je préfère est celle de vos yeux… » tournait dans ma tête. Je fredonnais en marchant devant la voiture tout en imitant le son de la trompette qui ponctue cette joyeuse mélodie.
Elle me surprit entrain de chantonner, elle paraissait détendue. En souriant enfin, elle se présenta, tout en s’excusant pour cet oubli, certainement volontaire, elle se prénommait Mary. Mary Campbell.
Nous repartîmes sur les chapeaux de roues, elle maniait le levier de vitesse en pratiquant un rapide double débrayage, j’étais impressionné.
Elle me questionna sur les relations avec son frère. Lui répondis, que je regrettais, mais je ne le connaissais pas, il était ami et relation commerciale de mon ami, négociant en grains pour une importante société agroalimentaire champenoise. Puis elle voulut savoir si je travaillais aussi dans cette société et si j’habitais cette évocatrice région. Lui ayant dit que Parisien depuis cinq ans et fournisseur de packaging, le rugby nous avait réuni.
En moins de temps qu’il faut à un écossais pour descendre une pinte de bière, nous fûmes sur Princes Street, il était midi, le match avait lieu trois heures plus tard.
Le Balmoral Hôtel était majestueux. La mini vint se garer devant le hall, Mary ponctua par un : « voilà, nous y sommes ». Je la remerciai et lui demandai à quel nom était la réservation. Votre nom, « of course », et « good game ! ». Comment avait-elle eu mon nom, certainement en questionnant son frère. En descendant je lui dis que je serais heureux après le match de lui offrir un scotch au « lounge » de l’hôtel vers dix-neuf heures. Bien entendu, accompagnée ou non, je serais « delighted » de rencontrer des amis écossais pas trop déçus par la défaite. Mon plus beau sourire, changea son regard mi-enjoué mi-sévère, jeté par-dessus son épaule au moment où elle redémarrait dans un vrombissement du diable; sans m’avoir répondu. Je crus seulement entendre « perhaps ».
L’hôtel était typiquement d’époque Victoria, impressionnant et austère, le personnel en gilet noir rayé d’imperceptibles fils blancs, se croisait dans un ballet bien réglé. Le réceptionniste paru extrêmement contrit quand je lui demandais en présentant mon passeport si je pouvais payer avec un chèque sur une banque parisienne. Je laissais un chèque, il allait se renseigner, je lui dis qu’il pouvait téléphoner, l’agence fermait à treize heures. Il me remit la clé, je demandais comment se rendre à Murrayfield. Il m’indiqua la ligne de tramway à cinq minutes de l’hôtel. Cela ne prenait pas plus d’une demi-heure.
Un sandwich rapidement avalé au bar, et un passage au change, tout près de l’hôtel, j’étais en route pour ce mythique stade. Le tramway ressemblait à un Mathusalem de champagne, les couleurs vertes, bleues et or, dominaient. Il était plein à ras bord et il flottait comme un nuage alcoolisé au-dessus de têtes coiffées de bonnets bariolés. J’étais apparemment le seul français et vite repéré. Un voisin très proche, entonna, ce que je pensais être la marseillaise. Le silence se fit, en souriant je remerciais chaleureusement et à mon tour je commençai leur chant ancestral : « Flowers of Scotland ». Après quelques secondes de stupeur, tout le tram repris avec moi en tapant du pied, heureusement le tram de conception ancienne était robuste. Je vis l’émotion gagnée de proche en proche, un gaillard aussi haut que large, m’arrivant sous le menton, me serra dans ses bras. Il me mit son écharpe, écossaise bien sûr, autour du coup, au moment où nous arrivions à Murrayfield.
Je reçus moult claques dans le dos et propositions de whisky. Le stade était magnifique, un monstre d’acier et de béton, beaucoup plus impressionnant que le récent Parc des Princes à Paris.
Je reconnus dans la longue allée conduisant à l’entrée, mes compagnons de vol qui avaient attiré un groupe hilare de spectateurs. Ils exécutaient une danse basque de manière extrêmement gracieuse pour leurs tailles impressionnantes. Les foulards rouge et blanc faisant des volutes au-dessus de leurs bérets dans un chassé-croisé des danseurs, accompagnés par des joueurs de flûtiaux. Je questionnai un basque chanteur, qui me dit en redressant le torse : « c’est la Pamperruque! ''Mossieur'' ! »
Ah, alors si c’est la Pamperruque, on comprend la joie des spectateurs !
Et oui ! fit-il, avant d’entonner de plus belle.
Ma place était très favorable pour une bonne vision du match. Mais j’étais le seul french au beau milieu des supporters écossais.
Mes voisins très cordialement, engagèrent la conversation sur les joueurs des équipes. J’appris que Laidlaw, blessé ne jouait pas et que l’immense Gordon Brown, l’illustre deuxième ligne était bien seul pour contrer les monstres français, Palmié et Bastiat. La première ligne française avec l’ancien parachutiste Cholley, Paco et Paparemborde, faisait peur. Seul le blond et distingué troisième ligne, Jean Pierre Rives trouvait grâce auprès de mes voisins. Ils avaient raison, même les lignes arrières françaises étaient tristes, le demi de mêlée, Fouroux, petit caporal aboyant, le demi d’ouverture, Romeu, un peu voûté, au coup de pied de « mammouth », mais sans beaucoup d’inspiration ni génie.
Le match, fut à la hauteur de l’équipe française, ennuyeux, et les mêlées ouvertes confuses et rudes. Le coq français terrassa le chardon écossais par treize points à six.
Je quittai à regret les supporters écossais qui pendant tout le match avaient bu pas mal de bière et chanté. J’eus droit aux commentaires désabusés des déçus d’un si pâle jeu français. J’approuvai tout en étant quelque peu heureux de cette victoire en terre écossaise.
Le retour en bus, cette fois, fut beaucoup plus calme, j’échappai à un groupe de français qui offrait du cognac à qui avait soif ! En expliquant que ce n’était pas de l’alcool de grains mais de raisins. L’écossais pas sectaire, après une rasade à faire écrouler un bœuf, opinait du bonnet et continuait sa route. La nuit était venue.
Le Balmoral Hôtel bruissait de sons feutrés et d’exclamations d’amis se retrouvant.
Je m’enquis de mon chèque, auprès du réceptionniste en chef qui me confirma qu’il n’y avait pas de problème. Puis d’un air entendu m’informa que j’avais un message de Miss Nic Campbell, me disant qu’elle serait au Balmoral Hôtel vers dix-neuf heures trente. Je le remerciai vivement, j’avais un peu plus d’une heure pour être un vrai gentleman. Interrogatif, lui demandai pourquoi Nic et non Mac. C’était « very easy to understand » me dit-il, un peu condescendant. Mac, veut dire fils du fils de, alors que Nic signifie fille du fils de.
Il ajouta d’un ton entendu, que le clan Campbell était un très ancien et des plus réputés clans écossais des Lowlands. Je le questionnai sur les couleurs du clan, qui devaient à son avis, être le vert et le bleu, et que je pourrais vérifier à l’arrivée de Miss Nic Campbell, elle ne manquerait pas de porter son tartan aux couleurs du clan. Impressionné, étonné, j’avais invité une authentique « noble » écossaise. Le réceptionniste s’excusa, me demanda d’attendre et revint après une minute avec une riche documentation sur l’histoire d’Écosse. Il me dit en souriant, que j’avais juste le temps d’apprendre ce qu’il fallait savoir lorsqu’on avait le privilège d’inviter Miss Nic Campbell. De nouveau je le remerciai et filai dans ma chambre. Je n’avais jamais séjourné dans un Palace, même vieux et victorien. Quel luxe, mais quelle attention de tous les instants. Je ne pus tout lire, mais trouvai quelques renseignements utiles sur les Campbell et le duc d’Argyll, 13ème du nom et chef du clan.
Chemise blanche, cravate en soie, pochette assortie, rasé de près, je passai au bar et allai m’asseoir dans un de ces moelleux fauteuils cuir au lounge. J’étais anxieux, Mary était très belle, distinguée, sure d’elle, mais bien distante. Pourquoi avait-elle accepté mon invitation, j’espérais qu’elle ne fût pas accompagnée, mais ne lui avais-je pas dit que tout écossais était le bienvenu. Je pensais qu’elle devait avoir vingt-sept, vingt-huit ans, presque mon âge, j’avais 30 ans, mais elle pouvait être plus âgée. Perdu dans ces pensées, je fus surpris par un léger toussotement.
Me redressant d’un bond, elle était devant moi, admirablement belle. Une robe noire, longue décolletée, faisant deviner une anatomie parfaite, une épaule dénudée sur laquelle son tartan vert et bleu tombait sur le côté. Je remarquai ce qui semblait être un écusson brodé or, représentant une bête féroce avec une inscription qui me parue être du latin. Ses cheveux venaient effleurer ses yeux soulignés d’un léger maquillage, qui donnait à son regard des intensités de pierres précieuses. Elle tenait sur un bras ce qui me sembla être une cape, couvrant en partie une pochette dorée avec une chaîne, d’une prestigieuse marque parisienne. Le bruissement du lounge semblait suspendu, même le pianiste ralentit l’interprétation de « Feelings » puis dans la seconde suivante comme subjugué, augmenta l’intensité.
Je m’inclinai légèrement et lâchai : « vous êtes très belle » puis ne lui laissant pas le temps de répliquer : « Would you like Scotch or Champagne ? »
L’invitai à s’asseoir, et d’un petit signe au barman en m’avançant, lui commandai deux coupes de champagne Laurent-Perrier, ayant aperçu une bouteille au bar.
Je risquai, affirmatif :
– Vous aimez le Champagne
– Je n’ai pas le choix ! Mais rassurez-vous, j’aime. » Cela avait été dit d'une voix douce, avec une légère intonation chantante, en français. Je crus rougir.
– Suis désolé pour la victoire française, et le champagne
– Il ne faut pas, la France était plus forte, et pour le scotch, nous avons toute la soirée »
Les flûtes pétillantes étaient déjà sur notre petite table. L’or du vin de champagne, les bulles légères remontant lentement dans des flûtes de cristal épais me confortèrent dans ce choix. Je maîtrisai un léger tremblement en présentant une flûte à Mary, je proposai un toast à sa santé et à sa prestigieuse famille. Après avoir effleuré des lèvres l'illustre breuvage, son visage marqua un furtif contentement.
Un merci tout à fait discret suivit le toast.
Je poursuivis en lui avouant qu’ayant découvert son nom je souhaitais savoir si elle portait les couleurs du clan Campbell. Elle confirma, c’était donc bien le vert et le bleu. Et si l’écusson brodé or était bien celui du clan, elle acquiesça à nouveau. D’un geste gracieux elle présenta son étole à mon regard.
L’écusson représentait une bête féroce semblant être un sanglier aux crocs imposants, une devise circulaire au bas de l’écusson, en latin : « Ne obliviscaris ».
Que je répétais à haute voix, puis en français : « Gardez-vous d’oublier »
– Well, dit-elle !
– Votre devise qui je crois est aussi celle du Québec ? Non c’est « Je me souviens ! » pour le Québec, les plaques des voitures l’ont inscrite. Et sauf erreur, c’est par opposition à la devise du marquis de Lorne gouverneur général de la Nouvelle Écosse qui avait fait inscrire au parlement : « Ne obliviscaris » !
– Bien ! Vous avez étudié l’histoire du Canada ! Me dit-elle, mi-surprise, mi-ironique.
– Le Québec est notre chère province pour nous français. J’ai eu un arrière grand-oncle, prêtre missionnaire au Canada dans le Saskatchewan à proximité de Prince Albert. Vous avez certainement à me donner des éclaircissements sur ces devises ?
– Oh ! Oui dit-elle, en finissant sa flûte de champagne.
Un bref signe au barman tout proche, et deux nouvelles flûtes arrivèrent sur notre petite table art nouveau, aux pieds sculptés d’ombelles. Mary avait posé son tartan sur l’accoudoir du fauteuil et bien droite, sa beauté éclaboussant le lounge, elle se préparait à des explications qui, je compris, étaient importantes pour elle. Le pianiste jouait « Strangers in the night » et il n’avait d’yeux que pour Mary. Elle respira profondément et commença d’une voix devenue plus douce la leçon d’histoire canadienne.
– Vous connaissez donc le marquis de Lorne ?
– Depuis peu répondis-je en riant.
Elle poursuivit :