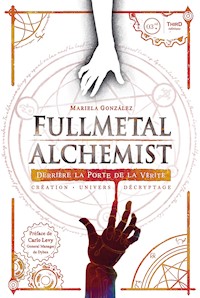
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Third Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Fullmetal Alchemist a une place bien particulière dans le shônen. Découvrez le décryptage de ses personnages et de son univers.
Fullmetal Alchemist est indéniablement un grand nom du manga en France. Grâce à sa version papier et ses deux séries d’animation, cette œuvre singulière est parvenue à charmer plusieurs générations d’amateurs de manga dans le monde entier.
Dans le genre shônen, l’œuvre d’Hiromu Arakawa fait figure d’exception. Loin de ne se cantonner qu’à l’habituel voyage initiatique et autres escalades vers la puissance, elle aborde des thématiques profondes et matures, comme la culpabilité, le stress post-traumatique, la solidarité, les relations familiales, ou encore l’horreur de la guerre et du totalitarisme. Par le biais de personnages hauts en couleur, Arakawa explore ces sujets avec subtilité, dans un monde inspiré de l’Europe de la révolution industrielle, où se côtoient technologie et alchimie.
Cet ouvrage revient sur la carrière d’Arakawa, détaille les processus de création du manga et des séries d’animation, puis décrypte en profondeur les personnages et thèmes du récit. Il aborde également les produits dérivés, dont les romans et les jeux vidéo.
Partez à la découverte de l’œuvre d’Hiromu Arakawa !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Couverture
Page de titre
PRÉFACE
C’ÉTAIT L’ÉTÉ 2003, il y a déjà pratiquement dix-sept ans. Une vie, pour bon nombre de spectateurs qui arrivent aujourd’hui dans l’univers de l’animation japonaise.
Tandis que nous venions à peine de nous séparer de notre partenaire historique, Dynamic Planning, l’un de nos fournisseurs privilégiés, Aniplex, nous approchait avec un nouveau projet en préparation. Il s’agissait de l’adaptation animée d’une série sur l’alchimie, publiée par Enix dans leur magazine mensuel Gangan. Le manga n’était pas encore sorti en France, l’auteur était un inconnu et Square Enix venait à peine de naître dans des circonstances mouvementées. C’est dans cet alignement cosmique un peu particulier, rempli d’incertitudes et de nouveaux départs, que Dybex, qui venait d’adopter son nouveau nom et ouvrait un nouveau chapitre de son histoire, plongea tête baissée dans le jeu de la concurrence pour l’obtention de ce nouvel animé, avec une offre qui restera sans doute la plus élevée dans l’histoire de l’entreprise.
Le reste fait désormais partie de l’histoire de la japanime. Après avoir obtenu les droits dans les premiers mois de 2004, Dybex parvint à susciter l’intérêt de Canal +, avec qui l’entreprise avait déjà collaboré à plusieurs reprises depuis la diffusion de Neon Genesis Evangelion en 1998. Pour donner toutes ses chances à la série, elle mit sur pied un casting exceptionnel, avec des acteurs dont le travail sur cette adaptation est resté dans les annales du doublage.
Fullmetal Alchemist trouva ainsi sa place dans La Kaz dès 2005, tandis que le manga se hissait inexorablement dans les meilleures ventes françaises (sans même parler des japonaises et américaines) et que le nom d’Hiromu Arakawa passait soudain de l’obscurité à la lumière. Petite anecdote désormais célèbre : c’est d’ailleurs la France qui dévoila que celle que les Japonais croyaient être un homme était en fait une femme, fait assez rare dans l’univers plutôt masculin du shônen. En effet, le public japonais était convaincu que l’auteur du manga était un homme, idée sans doute entretenue pour des raisons de marketing, et la surprise fut générale lorsque l’information remonta depuis la France.
Mais Fullmetal Alchemist, FMA pour les intimes, n’est pas vraiment un shônen.
C’est une œuvre à part, dans laquelle la profondeur des personnages et la nature des épreuves auxquelles ceux-ci sont confrontés dépassent, de loin, les repères habituels du genre, et qui fédère les lecteurs et spectateurs, sans jamais rester confinée dans une niche quelconque.
C’est en quelque sorte un retour aux sources de l’âge d’or du manga et de l’animé, lorsque, avant que l’action permanente et le manichéisme ne deviennent des marqueurs du genre, les personnages devaient faire face à la dureté du monde, au sacrifice, à la perte. Des confrontations qui, dans Fullmetal Alchemist, s’expriment jusque dans leur chair.
Et c’est surtout un message d’une autrice qui a elle-même traversé des épreuves difficiles. « Toute chose exige un sacrifice… pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une de même valeur. » Mais c’est un message d’espoir car… « lorsque l’être humain surmonte sa douleur, à laquelle aucun d’entre nous n’échappe, il devient imbattable : il obtient alors une âme plus puissante que tout. Une âme Fullmetal ! »
C’est ce que je nous souhaite à tous, en ce moment difficile dans lequel un peu de lecture sur cette série passionnante – que la très inspirée maison d’édition Third Éditions a mis entre vos mains sous la forme de cette analyse approfondie du phénomène FMA – vous fera un peu oublier les épreuves que nous traversons… Bonne lecture, et bon échange équivalent !
Carlo Levy,
General Manager DYBEX,
le 24 mars 2020.
AVANT-PROPOS
FULLMETAL ALCHEMIST ET SA PLACE DANS LE SHÔNEN
Imaginez-vous un instant dans n’importe quelle cafétéria. Ou alors dans une gare, à un arrêt de bus. Imaginez un lieu de passage où se rencontrent des gens d’âges et de genres différents. Vous y êtes ?
Si vous jetez un œil autour de vous, je suis sûre que vous trouverez au moins une personne avec un tee-shirt Marvel ou DC Comics. Il est probable que vous aperceviez aussi plusieurs références aux séries d’animation du moment, ou encore à cette fameuse série de fantasy remplie de célèbres maisons et de dragons, qui n’a pas besoin d’être présentée. Maintenant, si vous tendez un peu l’oreille, il est même possible que vous entendiez quelques conversations sur l’un de ces sujets. Enfin, il y aura sans doute, collé à un sac, un dessin ou un design un peu plus underground que les autres, qui vous fera reconnaître le véritable geek au milieu de cette foule.
Cette soi-disant « sous-culture », ce réseau de références pop qui permet de nous évader et nous donne une identité particulière, est désormais plus étendue et acceptée que jamais. Certes, il est parfois difficile de la promouvoir au sein de la critique, dans la recherche, ou dans tout type d’analyse culturelle, mais c’est heureusement un chemin de plus en plus ouvert et dégagé. Cependant, il existe un domaine qui échappe encore à cette ouverture. Le manga et l’animé se trouvent encore un peu à la marge. Pour un observateur lambda de notre cafétéria imaginaire, des tee-shirts One Piece et Captain America auront certainement des connotations très différentes. En effet, la bande dessinée et l’animation japonaises sont encore considérées comme une branche artistique immature destinée aux ados, ce qui fait que même certains enthousiastes décident, une fois passé un certain âge, de se dissocier de ces domaines culturels, ou du moins de ne pas avouer publiquement leur passion.
Nous connaissons bien sûr les exceptions. Certains auteurs ayant acquis une grande célébrité sont en quelque sorte « pardonnés » par l’opinion publique : Osamu Tezuka, Hayao Miyazaki, Satoshi Kon, Makoto Shinkai, pour ne citer que les principaux. Même dans le monde de la bande dessinée, les préjugés ne manquent pas. Je me souviens encore d’une conversation où, après avoir avoué aimer lire des mangas, mon interlocuteur a tout d’abord grimacé avant de vérifier si mes choix littéraires étaient raisonnables : « Mais du coup, tu lis Taniguchi ? » Nous pourrions continuer à chercher et trouver d’autres noms qui obtiennent la faveur du grand public, mais combien d’entre eux proviennent du shônen, le style de mangas associé aux jeunes garçons ? Très peu, assurément. Et lorsque c’est le cas, il reste forcément quelques réserves. Dans le shônen, comme cela arrive souvent dans certains styles littéraires, les stéréotypes et archétypes servent de points d’ancrage pour délimiter le contexte et faciliter l’immersion. Malheureusement, beaucoup de gens en restent à cette première lecture et négligent les qualités narratives qui confèrent à une œuvre sa valeur unique. La littérature jeunesse est généralement victime du même genre de préjugés.
Les bandes dessinées ont autant de choses à raconter que les romans ou les films. Cette affirmation – qui ne devrait même plus être discutée – se retrouve telle quelle dans l’ouvrage de référence Manga ! Manga ! The World of Japanese Comics de Frederik L. Schodt, dont la première édition remonte à 1983. Il ne s’agit donc pas d’un constat récent, mais du fruit d’une réflexion continue et ininterrompue au cours du XXe siècle. Il est indéniable que les particularités du Japon ont une influence sur sa production culturelle, et le manga ne fait pas exception. Dans le cas spécifique du shônen, Schodt explique que le système éducatif japonais impacte non seulement sa popularité, mais aussi la manière dont ce genre littéraire est consommé par les lecteurs. Même trente ans après cette étude, l’habitude nationale n’a pas beaucoup changé : la scolarité japonaise encourage un dévouement absolu envers les études. C’est ce qui permet à l’individu de se faire sa place au sein de la société. Le succès et les divertissements étant incompatibles, ces derniers se retrouvent très négligés, surtout quand se rapproche la fin de l’année scolaire, connue sous le sobriquet « enfer des examens ». Schodt cite un dicton populaire japonais assez inquiétant : « Dors quatre heures et tu réussiras, dors cinq heures et tu échoueras. » Quand les étudiants ont enfin du temps pour eux, qu’ils peuvent utiliser comme bon leur semble (et non pas à une autre classe « d’activités productives », comme les clubs scolaires), il n’est pas étonnant qu’ils choisissent des activités qui leur permettent de se relaxer rapidement et de s’évader de leur quotidien. La bande dessinée est moins fatigante pour les yeux – qui réclament désespérément une pause – et il est plus facile de dédier dix minutes à la lecture d’un manga qu’à une autre passion qui demanderait un investissement en temps plus important. Une conséquence directe de cette situation est l’impressionnante vitesse de lecture des Japonais : selon les calculs de Schodt, ceux-ci n’auraient besoin que d’une vingtaine de minutes pour lire un tome de 320 pages, soit environ 3,75 secondes par page. Ces faits sont bien sûr à prendre avec des pincettes car des décennies ont passé depuis l’écriture du livre de Schodt. Le manga a assimilé de nouvelles techniques narratives en s’inspirant notamment de diverses sources audiovisuelles, dont le jeu vidéo. De nos jours, il est donc possible que cette vitesse ait été dépassée.
De toute évidence, si nous considérons les mangas comme des objets de consommation expéditive, les séries spécifiquement dédiées aux adolescents et préadolescents devraient être encore plus rapides à lire. Cependant, il est nécessaire de bien faire la différence entre l’habitude de consommation et l’œuvre à proprement parler. Dans le cas du manga, établir une relation métonymique n’est pas forcément pertinent. Affirmer que ces lectures « légères » sont inconsistantes, immatures ou superficielles est une erreur qui ignore ce que le théoricien José Andrés Santiago identifie comme « les quatre grandes réussites narratives du médium » : surmonter l’infantilisme, définir un système de signes authentiques et facilement reconnaissables, établir une corrélation entre les mots et l’image, et enfin ce qu’il appelle « l’art de la pause ». Ce dernier point a d’ailleurs hérité de certaines influences de la tradition picturale, des haiku et du théâtre kabuki. Il s’agit d’un « jeu » dans lequel « c’est le vide lui-même ainsi que la représentation simultanée d’une même action sous plusieurs points de vue différents qui déterminent le développement de la narration, en lieu et place d’une seule séquence rapide » (Santiago, 2010). Ces quatre grandes réussites sont devenues des outils indispensables sur lesquels nous ne nous étendrons pas, mais que les consommateurs réguliers de mangas peuvent évoquer pour défendre leur passion.
Le fait que le shônen ait acquis une diffusion importante chez certains lecteurs ne faisant pas partie de son public cible lui a attiré quelques reproches. Par exemple, les mots « évasion » et « échappatoire » sont souvent connotés négativement. Il est vrai que le shônen, avec son dynamisme et son optimisme légendaires, propose une voie d’évasion. Le problème réside dans le fait de stigmatiser ce besoin d’explorer des mondes parallèles. Selon l’autrice américaine Ursula K. Le Guin, l’objectif d’une œuvre shônen n’est pas d’éloigner le lecteur de la réalité, mais au contraire de le guider vers la liberté. Il s’agit d’un aller-retour dans lequel le lecteur engrange des connaissances et des forces avant de pouvoir se confronter de nouveau à la réalité. Tout autre effet se doit d’être analysé selon d’autres critères, plutôt que d’être considéré comme inhérent au genre.
Il n’existe rien de plus caractéristique à ces idées d’apprentissage et de croissance par le biais de la fiction que les histoires initiatiques auxquelles tant de jeunes se sont identifiés au fil des siècles. Cette approche est indissociable du shônen.
La formation comme victoire personnelle
Le concept de voyage initiatique est extrêmement populaire. Nombre de récits de ce type doivent vous venir facilement à l’esprit. La plupart impliquent également un voyage vers la maturité au sens strict du terme. Nous rencontrons les personnages lorsqu’ils sont enfants et nous les accompagnons à mesure qu’ils grandissent, dans un processus d’apprentissage généralement douloureux et qui, bien souvent, se mélange avec le destin du héros. À première vue, le shônen incarne ce concept. Les personnages qui peuplent ces histoires peuvent, en raison des exigences du scénario, se comporter comme des enfants pendant plusieurs centaines de pages. Nous pouvons passer des décennies à leurs côtés sans noter de quelconque signe de croissance physique. Mais généralement le développement psychologique est bien plus évident. Les protagonistes apprennent peu à peu à se lier aux autres, à comprendre leur environnement, et nous nous séparons généralement d’eux quand ils ont enfin trouvé et assumé leur place dans le monde.
Nous pourrions voir cela comme une particularité de la mentalité japonaise, pour laquelle le voyage initiatique possède un objectif clair : celui de trouver sa place et sa fonction dans la société. Pour bien comprendre comment ces histoires s’articulent, il est essentiel de remonter à une source antérieure, qui bien que distincte de la bande dessinée, n’en est finalement pas si éloignée. Il s’agit du « roman d’apprentissage », connu sous le terme allemand Bildungsroman. Bien que les histoires initiatiques et le Bildungsroman puissent avoir en commun la création d’un héros, dans le second l’accent est mis sur le développement introspectif. La chercheuse María de los Ángeles Rodríguez Fontela explique que, dans ces œuvres, le concept de formation individuelle possède un caractère autoréflexif : « Le héros qui subit l’aventure l’assume dans sa propre personnalité et l’intègre à son projet de vie. » Pour le protagoniste, l’aventure n’est pas seulement un obstacle à surmonter, mais sert surtout d’autoformation pour conquérir son identité personnelle propre : « Par le biais de l’aventure et sa relation avec le monde, “l’âme” apprend à se connaître elle-même. » Le philosophe et historien Wilhelm Dilthey, qui a inventé le terme Bildungsroman, explique que le héros « s’engage dans une double tâche d’auto-exploration et d’intégration dans la société ».
Rodríguez Fontela ajoute également que le terme allemand Bildung détient une signification très spécifique puisqu’il se réfère aux étapes de formation qui suivent l’école primaire. Cela correspond donc parfaitement au public visé par le shônen : de jeunes pré-adolescents ou adolescents – bien que, comme nous l’avons mentionné précédemment, cette délimitation d’âge soit assez artificielle. Il est aisé de comprendre pourquoi autant de lecteurs d’âges et de styles différents finissent par s’intéresser au shônen, quand on considère ces œuvres sous l’angle de la recherche d’identité et du développement personnel. Nous y rencontrons des héros désorientés, incapables de trouver leur voie ou de gérer leurs relations avec les autres. Il est vrai que ce genre de dilemmes apparaît plus fréquemment lors des premières étapes de nos vies, mais finissons-nous vraiment par surmonter cette inquiétude un jour, cette angoisse de ne pas se reconnaître dans un miroir ? Nous apprenons à vivre avec, à nous servir de masques pour nous sentir à l’aise, mais le cercle vicieux de l’insatisfaction finit toujours par revenir, qu’on le veuille ou non. Nous nous demandons qui nous sommes et qui nous pourrions être, en imaginant des personnalités alternatives ou en nous projetant dans d’autres types de vie. Bien qu’il soit difficile d’accepter ce constat – puisque cela signifie reconnaître que nous ne serons jamais complets –, il s’agit d’un exercice de sincérité nécessaire. L’introspection ne s’arrête jamais et la fiction fait office de baume.
Le shônen prend donc les caractéristiques du Bildungsroman et y ajoute les siennes afin de créer des histoires capables de résonner chez de nombreuses personnes, pas seulement celles qui ont le même âge que les protagonistes. Il existe bien sûr des différences avec le « roman d’apprentissage » que l’on rencontre dans les classiques de la littérature. En général, les héros de ce style littéraire tendent vers l’introversion. Au contraire, ceux du shônen tombent plutôt dans la recherche constante d’attention et l’exaltation des sentiments. Le héros du Bildungsroman est comme une toile blanche : il est passif et accepte sans rechigner les indications de ceux qui le forment. La rébellion et le libre-arbitre sont propres au shônen. Les personnages qui entourent le héros d’un Bildungsroman sont généralement définis par leur fonction vis-à-vis du héros : maîtres, rivaux, etc. Dans le shônen, même s’ils tiennent aussi leurs propres rôles, les personnages secondaires vivent leur propre processus d’évolution. Finalement, le Bildungsroman s’adresse aux lecteurs avec une intention clairement didactique, tandis que le shônen est plus dialectique. Ce dernier fait confiance au lecteur pour en retirer des choses, mais il ne force jamais cet enseignement.
Fullmetal Alchemist : sa place dans le shônen
L’écrivain américain Norman Spinrad a un jour prononcé une de ces phrases lapidaires dont le sens est plus profond qu’il n’y paraît. Interrogé sur la nature de la science-fiction, sa réponse fut directe : « C’est tout ce qui est publié dans les magazines de science-fiction. » Loin d’être une boutade, cette déclaration devrait nous faire réfléchir à notre tendance à vouloir tout catégoriser. La classification limite souvent l’imagination. Ce qui fait réellement croître un média, c’est l’hybridation et l’ouverture d’esprit.
Fullmetal Alchemist (FMA), l’œuvre à laquelle l’autrice Hiromu Arakawa s’est consacrée corps et âme entre 2001 et 2010, fait partie de ces noms omniprésents sur les étagères shônen. Les héros principaux sont deux frères, les alchimistes Edward et Alphonse Elric, âgés respectivement de quinze et quatorze ans au début de l’histoire. Leur voyage initiatique commence par un événement traumatisant, la transgression du plus grand tabou de l’alchimie : essayer de redonner vie aux morts. Non seulement ils échouent à ressusciter leur mère, mais ils perdent également une partie ou la totalité de leur corps dans le processus. Au cours des cent-huit chapitres suivants, nous les accompagnerons dans leur quête pour tenter de redevenir « entiers ». Nous y rencontrerons tout un tas de personnages secondaires et nous observerons les deux frères s’efforcer de surpasser leurs rivaux. Les Elric essaieront toujours d’aller de l’avant et de se redresser face à l’adversité. Les scènes d’action et de combats épiques ne manqueront pas, et finalement, l’espoir et les efforts porteront leurs fruits. Le récit nous apprendra que le succès ne s’obtient pas forcément à travers la connaissance ou la consommation d’une vengeance, mais plutôt en acceptant nos propres erreurs, en faisant la paix avec notre passé et en faisant confiance à ceux qui nous tendent la main.
Si le shônen est « ce qui est publié en tant que shônen », il ne fait aucun doute que Fullmetal Alchemist s’accorde parfaitement à cette catégorie, pas seulement en termes de thématiques et de style narratif, mais aussi de dessin (sans même mentionner qu’il a été publié dans une revue appelée Shônen Gangan, propriété de l’éditeur Square Enix). En effet, le style artistique d’Arakawa possède cette touche et cette puissance visuelle caractéristique du shônen. Nous pourrions nous contenter d’attribuer cette étiquette à FMA sans chercher plus loin. Mais si nous avons fait un petit historique sur les caractéristiques générales du manga et du Bildungsroman, c’est bien pour en tirer une conclusion : aucune œuvre ne correspond totalement à un genre ou un style littéraire. Il ne s’agit pas de catégories totalement étanches, et ce, malgré les nécessités de classification commerciale.
José Andrés Santiago, dans Manga : del cuadro flotante a la viñeta japonesa1, explique clairement que parler du shônen comme entité autonome a plus de sens en dehors du marché éditorial japonais lui-même, en particulier si on le compare au shôjo, le genre de mangas destinés au public féminin du même âge. Ce sont des étiquettes sur lesquelles nous pourrions faire beaucoup de commentaires, mais heureusement, les lecteurs eux-mêmes se sont chargés de les invalider lors des dernières décennies ; de nombreuses personnes (hommes ou femmes) se plongent dans l’un ou l’autre sans distinction. Il arrive quelque chose de similaire au seinen (que nous pourrions considérer comme « l’étape supérieure du shônen »). En Occident, on identifie généralement le seinen aux séries consacrées aux adultes à partir de vingt ans. C’est un groupe d’âge avec lequel il est possible d’aborder des sujets plus durs et de laisser de côté l’optimisme si caractéristique du shônen. Les déceptions et frustrations du marché du travail, les problèmes politiques et sociaux, les charges familiales et les scènes sexuelles font partie intégrante du seinen, pour ne citer que ces thèmes évidents pour lesquels les adolescents ne sont, en théorie, pas encore préparés. Cependant, Santiago lui-même nous explique que la délimitation entre les deux n’est en vérité pas si claire.
Nous considérons que le shônen est fait pour ceux qui ont besoin de s’évader de temps à autre ou de recharger les batteries. Mais Fullmetal Alchemist, malgré son ton positif, s’articule souvent autour de thèmes sérieux et pesants : les traces laissées par les événements traumatiques et le fait de devoir apprendre à vivre avec, la culpabilité qui pèse sur nos épaules, l’épée de Damoclès qui nous menace en permanence. Notre impuissance, aussi, un autre fantôme qui nous hante ; à la fin de l’histoire, Edward doit accepter qu’il n’est « rien d’autre » qu’un être humain même pas capable de sauver une petite fille de son propre père. Évidemment, le besoin de se dépasser fait partie de l’intrigue, tout comme la bataille contre l’adversité. Arakawa nous offre néanmoins une fin heureuse ; l’autrice n’a jamais caché que son but était de divertir et de faire croire en la rédemption et la possibilité d’un monde meilleur. Peu importe l’âge du lecteur, celui-ci peut tirer des enseignements de tous les personnages du récit, qu’ils soient adolescents ou adultes, et se sentir concerné par les différentes thématiques de l’histoire, qui ne paraissent finalement pas si éloignées de notre réalité. Fullmetal Alchemist ne correspond pas totalement à ce que l’on attend d’un shônen, mais il serait incorrect de le décrire comme un seinen en laissant de côté sa valeur de Bildungsroman.
S’il y a bien une chose qui sépare Fullmetal Alchemist des autres séries juvéniles d’action et d’aventure, c’est sa manière de nous présenter son héros. Le protagoniste classique du shônen est généralement le cliché du « jeune élu », quelqu’un qui possède un don particulier ou un talent hors du commun, qui se révèle à un moment de l’histoire comme le seul être capable d’affronter les menaces de son monde. Dans le cas d’Edward, cette idée n’est jamais mise en évidence. Nous savons qu’il a un talent inné pour l’alchimie et une volonté tellement forte qu’il lui est presque aussi simple d’apprendre le fonctionnement d’une transmutation humaine que de s’adapter à une prothèse auto mail en moins de temps qu’un adulte. Son don principal, la possibilité de transmuter sans utiliser de cercle, laisse tout de même un arrière-goût amer : c’est la marque de son péché. Certes, cette capacité le rend spécial, mais elle fait aussi de lui une sorte d’anathème. Malgré son talent et son ingéniosité qui lui permettent de se sortir plusieurs fois de situations délicates, on ne nous le présente pas comme quelqu’un d’unique à cet égard. On le voit régulièrement entouré de personnes tout aussi douées que lui, et dans beaucoup de moments critiques, ou au cours de conversations privées, son masque de confiance finit par s’effriter. On l’observe alors tel qu’il est réellement : un jeune garçon apeuré qui ne sait pas comment trouver sa place. Un jeune homme forcé de grandir, qui déteste « se sentir ignorant » face à un monde d’adultes rempli de souffrance. Cette dualité, la façon dont Edward est tour à tour présenté comme un héros et comme un enfant sans défense à la recherche de soutien est une autre réussite d’Arakawa. Que nous soyons adolescent ou adulte, le monde peut paraître incompréhensible et cruel.
Le développement des frères Elric ne suit pas « l’escalade vers la puissance » habituelle du shônen. Leur but n’est pas de devenir plus forts pour surpasser leurs ennemis dans des combats interminables : la maturité qu’ils acquièrent, leur processus de formation, tout cela est surtout moral. Bien que Fullmetal Alchemist ne lésine pas sur les scènes d’action spectaculaires, la véritable confrontation des Elric se joue contre leurs propres convictions. Lorsque les deux frères découvrent les véritables ingrédients de la pierre philosophale – sur laquelle ils comptaient pour récupérer leur corps –, un dilemme éthique se présente à eux : malgré leur désir de revenir à la normale, ils ne peuvent pas employer une méthode qui implique le sacrifice humain. Il ne s’agit pas là d’une reddition, mais plutôt de la recherche d’une autre voie. Il arrive la même chose quand Edward décide de ne plus tuer – décision qui paraît assez absurde sachant qu’il fait toujours partie de l’armée – ou, ce moment où Alphonse se retrouve tiraillé entre se sauver lui-même et sauver les autres, alors qu’il est mis au défi par ce héraut du chaos qu’est Kimblee. Son choix se porte sur une troisième option, qui sera déterminante pour la fin de la série : pourquoi devrait-il y avoir seulement deux voies ? Chaque moment clé de l’histoire fissure un peu plus les postulats moraux qui ont été imposés aux deux frères. Edward et Alphonse grandissent réellement grâce à la création de leur propre code éthique, un code qui les aide à comprendre le monde et à s’y intégrer, sans se sentir obligés de se plier à ce qu’ils considèrent comme inacceptable ou injuste. Le but final de leur odyssée est de se comprendre et de s’accepter eux-mêmes.
Le voyage des frères Elric dans Fullmetal Alchemist est aussi une découverte constante pour nous, les lecteurs. Il s’agit d’une histoire riche de sens et de personnages complexes dont les ambiguïtés fascinent. En plus du manga, nous pouvons aussi retrouver cette histoire retranscrite presque mot pour mot dans les soixante-quatre épisodes de l’animé Fullmetal Alchemist : Brotherhood (2009). Sans oublier la version précédente, celle de 2003, qui s’éloigne de la version originale pour adopter une perspective différente. Elle présente une vision complémentaire très utile pour comprendre les thèmes traités par Arakawa.
Et c’est ainsi que nous commençons notre voyage : avec une valise remplie d’éléments à explorer. Ready, steady, go !
1. Manga : du cadre flottant à la vignette japonaise en français.
PARTIE I Arakawa et son œuvre
CHAPITRE 1 : HIROMU ARAKAWA, D’HOKKAIDO À AMESTRIS
Souvent, les histoires de dessinateurs devenus célèbres cachent un aspect quelque peu mélodramatique : l’auteur est bloqué dans un travail sans passion, avant de trouver sa véritable voie ; il lutte pour survivre dans une industrie déjà saturée… Mais des histoires de dessinateurs qui débutent leur carrière en travaillant dans une ferme, c’est déjà beaucoup moins commun !
Comme de nombreux autres artistes, Hiromu Arakawa se souvient avoir passé son enfance un crayon à la main, à dessiner dès qu’elle en avait l’occasion. C’est à cette époque que naît chez elle l’envie d’exercer son futur métier. Dans un entretien donné au magazine Animeland, Arakawa révèle cependant un autre rêve d’enfance, celui de devenir « vétérinaire dans un zoo ». Pourtant, au début de sa vie, ni les crayons, ni le zoo ne semblent constituer des destins probables pour la quatrième fille d’une famille paysanne de la sous-préfecture de Tokachi, sur l’île d’Hokkaido. Dans cette région, l’usage est plutôt de se préparer dès son plus jeune âge à reprendre l’affaire familiale. Sans négliger ses obligations à la ferme, Arakawa continue néanmoins de perfectionner son hobby, qui se révélera progressivement bien plus qu’un simple passe-temps.
Suiho Tagawa (Norakuro), Shigeru Mizuki (Kitaro le repoussant), le duo Yudetamago (Muscleman) ou encore l’Américain Mike Mignola (Hellboy) constituent quelques-uns des auteurs cités comme influences fondamentales par Arakawa elle-même. Toutefois, la série dont la dessinatrice se souvient le plus est Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi. Son tome 16 est d’ailleurs la première bande dessinée qu’Arakawa s’achète avec son propre argent, après avoir regardé l’animé à la télévision. Son village ne disposant pas de librairie aux alentours, la dessinatrice doit se procurer le manga dans un magasin dont la spécialité est la vente de riz, et qui propose également une petite section littérature. « Je suis bien consciente que j’écris mes mangas de cette façon aujourd’hui grâce à Urusei Yatsura », confie-t-elle dans un entretien donné à la chaîne Tokyo MX. « En relisant l’œuvre une fois adulte, je me suis rendu compte à quel point ce manga est fantastique. Je dois vraiment remercier Maître Takahashi ! ». Entre quelques dôjinshi (revues de mangas autopubliées) et de petits travaux d’illustrations (bandes dessinées pour une revue locale de courses de chevaux, cartes de fin d’année, etc.), son envie de gagner sa vie en tant qu’artiste devient de plus en plus urgente.
C’est alors qu’aurait dû arriver ce moment tragique et décisif où les parents d’Arakawa lui interdisent de poursuivre ses rêves. Heureusement pour elle (et pour nous), cela ne s’est pas passé ainsi. En effet, l’autrice nous explique que sa famille a toujours été très compréhensive et l’a constamment soutenue dans ses projets. Elle parvient donc à un accord avec ses parents : elle passera sept ans à travailler à la ferme, jusqu’à ce que son petit frère ait l’âge de décider s’il veut se charger lui-même de l’entreprise familiale ou pas, après quoi elle pourra s’en aller. La jeune femme respecte consciencieusement l’accord passé jusqu’en 1999, date à laquelle elle quitte finalement son Hokkaido natal pour aller vivre à Saitama, une grande ville proche de Tokyo – destination plutôt logique pour commencer sa nouvelle vie de mangaka.
Tout artiste s’inspire plus ou moins directement de sa propre vie ; Arakawa a évidemment de quoi faire avec son passé si particulier. Hyakushô Kizoku (2006), publié en France sous le nom de Nobles paysans (aux éditions Kurokawa), est une série comique dans laquelle elle raconte son quotidien à la ferme, ainsi que quelques anecdotes de son passage de la campagne à la ville. Arakawa y apparaît sous la forme de son alter ego habituel, une vache à lunettes (toute sa famille est représentée dans le même style « bovin »). La dessinatrice n’aime pas beaucoup les apparitions publiques ; on ne trouve d’ailleurs que peu de photos d’elle sur Internet (la majorité des photos qui lui sont attribuées sont en réalité celles de Romi Paku, l’actrice qui donne sa voix à Edward Elric), mais grâce à Nobles paysans nous pouvons deviner quelques traits de sa personnalité et comprendre un peu mieux la suite de son œuvre. Elle y confirme par exemple que boire quotidiennement du lait « peut rendre plus grand », thématique que l’on retrouve (à la limite de l’obsession) chez Edward Elric, le héros de Fullmetal Alchemist. Elle déclare également qu’elle avait tout d’abord prévu de suivre des études de vétérinaire (avec une spécialisation dans les animaux de la ferme) avant de tenter sa chance dans la bande dessinée, un plan auquel elle doit renoncer lorsqu’elle se rend compte que les études nécessaires sont bien plus longues que ce qu’elle imaginait.
Le dilemme de rompre ou non avec la tradition familiale pour poursuivre ses rêves revient sous différentes formes dans Silver Spoon (Gin no Saji, 2011, et publié en France depuis 2013, toujours par Kurokawa) – son œuvre la plus connue après Fullmetal Alchemist –, où l’on retrouve aussi de nombreuses références autobiographiques. Si dans Nobles paysans elle nous explique comment faire face à une grande métropole, dans Silver Spoon le héros Hachiken effectue le chemin inverse : il décide de s’inscrire dans une école agricole pour fuir les problèmes personnels et familiaux auxquels il fait face dans la grande ville. Il ne connaît absolument rien de la vie à la campagne et doit donc passer par une période d’adaptation un peu longue. Seul un auteur tel qu’Arakawa pouvait écrire une œuvre de ce type, en mélangeant son talent naturel de narratrice à sa connaissance du monde rural.





























