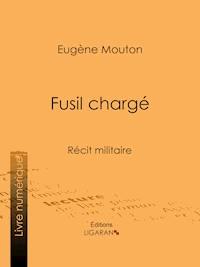
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il est dans le midi de la France quelques contrées où les travaux des champs gardent encore la majesté de l'agriculture primitive. Là, de toutes les scènes rustiques que le retour des saisons ramène, il en est peu d'aussi belles que le dépiquage du blé. Sur une des collines charmantes qui bordent la plaine du Lauraguais, une famille de paysans battait sa récolte. Les gerbes répandues formaient un grand cercle d'un jaune d'or éblouissant".
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il est dans le midi de la France quelques contrées où les travaux des champs gardent encore la majesté de l’agriculture primitive. Là, de toutes les scènes rustiques que le retour des saisons ramène, il en est peu d’aussi belles que le dépiquage du blé.
Sur une de ces collines charmantes qui bordent la plaine du Lauraguais, une famille de paysans battait sa récolte. Les gerbes répandues formaient un grand cercle d’un jaune d’or éblouissant, où les tiges polies de la paille, les feuilles aiguës, les épis hérissés, réfléchissaient en milliers d’éclairs les rayons du soleil.
Maintenu dans le contour de l’aire par une corde allant du joug à un piquet planté au centre du cercle, un attelage de quatre bœufs tirait un énorme rouleau de granit. Derrière, une sorte de traîneau chargé de pierres suivait, attaché par une chaîne, le sillage du rouleau à travers le blé, tandis qu’à l’intérieur du cercle, dans un espace demeuré libre, des hommes armés de fourches étaient occupés à ramener continuellement vers le bord la paille que le rouleau en avait écartée.
Une paysanne en chemise blanche et en jupe rouge, les cheveux soulevés par le grand air et nimbés d’or par le soleil, était assise sur le timon, tricotant d’un mouvement rapide un bas de laine et tournant de temps à autre la tête pour surveiller une petite fille placée à côté d’elle, et qui, comme ivre de vie et de lumière, battait des bras et des jambes en chantant. Sur le traîneau qui suivait, deux petits paysans, ébouriffés, les cheveux pleins de pailles, noirs comme des singes, perdant des bouts de chemise par tous les trous et par toutes les fentes de leurs culottes, avaient enjambé les grosses pierres, et tantôt se faisant face, tantôt se tournant le dos, se secouaient l’un l’autre en échangeant des caresses et des coups de poing, l’un riant à gorge déployée tandis que l’autre pleurnichait, et tous deux paraissaient prendre à ce jeu un plaisir insatiable.
Élevé comme un promontoire au flanc d’un coteau couvert de vignes et de maïs, le cercle doré de l’aire se détachait sur une vaste perspective de plaines, de vallons et de collines. Les arbres et les haies découpaient de leur réseau sombre les champs bariolés de mille couleurs. À mesure de leur éloignement, tous les traits de ce tableau semblaient se presser et se confondre pour aller s’effacer enfin dans la brume, au pied de la Montagne-Noire, qui borne l’horizon. Ainsi développée sur l’espace sans bornes de la terre et du ciel, ainsi enflammée de la lumière éclatante d’un soleil du Midi, cette scène avait l’air d’une fête triomphale.
Dans leur marche à travers la moisson opulente qu’ils broyaient sous leurs pieds, les bœufs, baissant le front, raidissant l’échine, fouettant de la queue, avançant leurs épaules et leurs cuisses tour à tour, présentaient la vivante image de la domination de l’homme sur la nature.
Par un effet du mouvement continu qui leur faisait parcourir tous les points de la vaste circonférence, on les voyait d’abord diminuer de grandeur et devenir plus sombres jusqu’à ce que, passant au point le plus éloigné, ils ne parussent, sur le fond éblouissant de l’air, que comme des silhouettes noires où leurs cornes, les nœuds et les angles de leurs os, tranchaient sur la lumière en pointes vives ; puis, à mesure qu’ils revenaient en se rapprochant, leur figure tournait sur elle-même, grandissant, s’éclairant par degrés, reprenant ses couleurs, ses reliefs, et ils repassaient énormes, noueux, gonflés de vie, craquant de force.
Tout ce cortège était mené par un jeune homme qui, pieds nus, les manches de sa chemise retroussées, marchait à pas comptés en avant de l’attelage. C’était un beau garçon de vingt ans, vigoureux, bien découplé ; le rythme de sa marche, le balancement de ses reins et de ses épaules, le geste qu’il développait en renversant en arrière son aiguillon pour piquer ses bœufs, lui donnaient une désinvolture superbe. Sous l’ombre de son chapeau de paille, on voyait briller ses yeux animés par le travail, et ses dents que découvrait un sourire. C’était la joie, la force, la jeunesse, la liberté, dans tout leur éclat, dans toute leur insolence.
Les poètes et les philosophes n’ont jamais pu nous dire au juste si les habitants des campagnes se rendent compte de leur bonheur : mais ce qu’ils discutent encore, l’homme naturel le sent. À travers la matière brutale de sa vie, certainement l’âme de la nature pénètre dans son cœur ; certainement, en lui comme dans tous les êtres animés, la joie de vivre, immense et profonde, circule dans ses veines, embaumant de sa puissante ivresse tout l’air qu’il respire. Et pourrait-il en être autrement, quand nous voyons les animaux mêmes, et jusqu’aux arbres, jusqu’aux plus humbles fleurs des prairies, nous manifester cette joie par les signes les plus évidents, et mener sous nos yeux, depuis le commencement du monde, la fête éternelle de la vie ?
Ah ! le bonheur ! Quand, à force de sagesse, de travail, de hasards heureux, les pauvres humains sont enfin parvenus à en élever le laborieux édifice, à peine est-il debout qu’un souffle passe, et tout est renversé.
À la crête d’un petit chemin qui descendait du village, on voyait pointer le chapeau galonné, puis grandir la figure entière, d’un gendarme qui se dirigeait vers le groupe des dépiqueurs de blé. Il arriva au bord de l’aire au moment où l’attelage allait passer devant lui. Il porta la main à son chapeau, ramena son sac à dépêches, et en tirant un papier, le montra au jeune homme en lui disant :
– Fiammet, voilà votre ordre de départ. Il faut que vous soyez demain à Toulouse, à la disposition de l’autorité militaire, qui vous donnera une feuille de route pour rejoindre votre régiment.
Le jeune homme arrêta ses bœufs. Il prit le papier, le tourna et le retourna un instant sans le lire, puis, ôtant son chapeau de paille et le laissant tomber à terre, il essuya du bras son front baigné de sueur, jeta un long regard autour de lui, renversa la tête, entrouvrit ses lèvres, comme s’il eût voulu baiser une dernière fois les rayons du soleil de son pays.
Là, dans cet instant rapide, il lui sembla que sa vie tout entière s’envolait comme un rêve… qu’une bête inconnue lui serrait la gorge de ses griffes… Il ne comprenait pas : le pauvre enfant ne connaissait pas encore la douleur.
Il serra le papier dans sa ceinture, ramassa son chapeau, mit un des moissonneurs à la tête de l’attelage, et ayant dit adieu à tout ce monde qui, à partir de ce moment, allait travailler sans lui, il s’en retourna au village pour annoncer la nouvelle à sa famille.
C’était dur, mais enfin on s’y attendait ; un jour ou l’autre, il fallait bien que cela arrivât. Il n’y eut ni gémissements ni larmes : le chagrin des gens de campagne est simple comme leur vie. On soupa sans dire grand-chose. Après souper, le père et le fils allèrent s’asseoir sous le figuier, au bout du jardin, et causèrent, la main sur la bouche, jusqu’au coucher du soleil.
Le lendemain au petit jour, Fiammet se leva sans faire de bruit. Tout le monde dormait ou faisait semblant de dormir. Il s’en alla sur la pointe des pieds, ouvrit doucement la porte, et ayant franchi le seuil, fit son premier pas dans la vie inconnue qui s’ouvrait devant lui.
Le surlendemain, muni de la feuille de route qu’on lui avait donnée à Toulouse, il débarquait, en compagnie des autres recrues, à la gare de C…, pour être incorporé au 32e dragons. Engourdi par vingt-quatre heures d’immobilité, ahuri par les milliers d’objets qu’il venait de voir passer sous ses yeux dans la rapidité vertigineuse du voyage, Fiammet, faisant comme ses camarades, erra pendant une grande heure à travers la ville, tantôt traînant ses jambes d’un bout à l’autre des rues, tantôt se plantant, le nez en l’air, pour considérer les maisons, et finissant par revenir toujours au même endroit, comme il arrive dans ces petites villes qui n’ont qu’une seule place à laquelle conduisent toutes les rues.
Au bout de ce temps, ne sachant plus où aller ni quoi regarder, sentant d’ailleurs l’appétit lui venir, il se décida à s’enquérir de l’adresse du capitaine trésorier, premier personnage auquel il eût à se présenter.
Lorsqu’il sortit de chez le capitaine trésorier, Fiammet était immatriculé comme cavalier au 2e escadron du 32e régiment de dragons, en garnison à C… Alors commença l’interminable série des démarches et formalités par lesquelles il avait à passer avant de prendre son rang, d’abord dans l’escadron, puis dans le peloton. Il se rendit à la porte du quartier, où le maréchal des logis commandant la garde de police le fit conduire par un homme au bureau de l’escadron. Là il trouva des comptables qui prirent son nom, lui donnèrent son livret, lui demandèrent s’il savait lire, écrire, nager ; s’il voulait compléter sa masse ; après quoi on le conduisit à sa chambrée, où on le remit aux mains de son camarade de lit, qui devait l’initier à tous les détails du service.
Quand il se vit en présence de ce camarade avec lequel il allait vivre côte à côte, Fiammet eut un soupir de soulagement comme un homme qui, précipité pendant plusieurs jours de chute, tomberait entre les bras d’un ami. Il trouva tout de suite que son camarade avait une bonne figure. Il regarda autour de lui dans la chambrée, et tout lui parut très propre et très gai. C’était plein de monde jeune ; les uns riaient, se faisaient des farces, les autres nettoyaient leurs armes, ciraient leurs bottes ou leurs basanes, sifflant de jolis airs ou chantant des chansons drôles. De l’autre côté de la chambre, deux dragons prêts à sortir en permission, revêtus de leur uniforme bien sanglé, bouclaient leur ceinturon et se coiffaient de leur casque, dont la crinière se renversait sur la nuque en décrivant une fière parabole ; ils partirent, traînant à grand bruit leurs sabres et faisant résonner leurs éperons.
Fiammet les regardait avec une immense admiration ; ils lui paraissaient comme des rois, et un éblouissement lui passa devant les yeux à l’idée que lui-même allait être revêtu d’un uniforme pareil. Mais quand l’aurait-il ? Il n’osait pas le demander ; certainement on ne le lui donnerait pas ainsi du jour au lendemain ; il faudrait sans doute passer par de longues épreuves avant de l’obtenir. Un casque ! un sabre ! des éperons ! Lui, Fiammet !
À ce moment on entendit une sonnerie de trompette. Aussitôt, poussant des cris et laissant là ce qu’ils faisaient, tous les hommes se précipitèrent, et le quartier trembla sous une dégringolade générale roulant par les escaliers. Le camarade était parti avec les autres, Fiammet se trouva à peu près seul avec les hommes qui étaient restés. Quelques minutes se passèrent, un nouveau roulement de talons de bottes s’éleva de l’escalier, les hommes de la chambrée rentrèrent en masse, chacun portant une ou deux gamelles remplies. Une odeur de bonne soupe chaude embauma toute la chambrée. On déposa les gamelles à terre ; chacun, dépliant son époussette de pansage, carré de laine qui sert à lustrer et à essuyer le poil du cheval, l’étendit au pied de son lit et mit sa gamelle sur l’époussette, le couvercle à côté. La nappe était posée, il ne restait plus qu’à se mettre à table. Chaque cavalier enjamba son lit, et le repas commença, agrémenté de cris, d’éclats de rire, de propos plus ou moins épicés.
Fiammet, qui mourait de faim, assistait à ce banquet avec l’intérêt le plus sympathique. La soupe avait une odeur délicieuse. Son camarade, après en avoir avalé trois ou quatre cuillerées, se tourna tout à coup vers lui en lui disant :
Eh bien ! et ta soupe ? T’as donc pas faim, toi ?
– Moi ! pas faim ? Il y en a donc pour moi ?
– Eh oui ! bêta, j’en ai chipé une gamelle pour toi, quoique tu n’y aies pas droit avant ce soir. Tiens, la voilà au pied du lit. Mets-la sur mon époussette. Te gêne pas, je t’invite.
– Attention ! cria une voix, y a dans la chambre un bleu qui se prépare à payer une tournée à la chambrée ! Je propose une fanfare en son honneur !
Aussitôt, poussé par toutes les bouches et par tous les nez, un charivari indescriptible, accompagné de piétinements, de sifflets, de cris d’animaux, éclata dans la chambre, après quoi un groupe d’hommes, frappant en cadence sur leurs gamelles avec le couvercle, se mirent en file, et ayant fait quelques évolutions d’un pas solennel, vinrent se ranger en demi-cercle au pied du lit de Fiammet et lui donnèrent l’aubade jusqu’à ce qu’il eût fini de manger sa soupe.
Fiammet n’était pas timide, c’était le plus déluré des garçons de sa commune : il continua gravement de manger sa soupe jusqu’à la dernière cuillerée, puis fit signe qu’il allait parler. La fanfare s’arrêta. Fiammet commença par s’essuyer proprement les lèvres aux draps de son lit, se campa sur ses hanches, écarta les bras, et ayant renversé la tête, poussa un braiement d’âne si étourdissant, si prodigieux, que les vitres de la chambre en grincèrent. À cette révélation d’une puissance pulmonaire aussi remarquable, des hurlements d’enthousiasme éclatèrent, mêlés d’applaudissements frénétiques. Fiammet, encouragé par ce succès, se mit alors à imiter le canard, puis l’oie de Toulouse, puis le chien, puis le chat, et finalement mit le comble au délire de son auditoire en exécutant le « beuglement de la vache qui a perdu son veau à la foire de Montgiscard ».
La glace était rompue. Fiammet fut empoigné par les jambes, juché à cheval sur les épaules de deux camarades, et la troupe, après lui avoir fait faire trois fois le tour de la chambre, le descendit en triomphe jusqu’au bas de l’escalier. Là on le mit à terre, et faisant la haie à droite et à gauche de lui, on le conduisit au pas accéléré dans la direction de la cantine.
Chemin faisant on rencontra un brigadier : c’était justement le sien.
– Où allez-vous tous comme ça ? dit-il d’un ton sévère.
– À la cantine, brigadier ; c’est ce bleu-là qui paye une tournée.
– Une tournée ? Ah ! c’est différent : puisque c’est une tournée, j’en suis, j’espère ? dit le brigadier à Fiammet.
Et prenant la tête de la troupe, il emboîta le pas.
Un peu plus loin passait un maréchal des logis qui s’en allait d’un air très pressé. Mais ayant jeté un regard sur la colonne en marche, en ayant peut-être deviné la direction, il fit demi-tour et se trouva « au contact », comme on dit en style militaire. Naturellement, il demanda où on allait : non moins naturellement, on lui répondit, en désignant Fiammet, que c’était « un bleu » arrivé le matin, qui payait une tournée à la chambrée. Naturellement, on poussa du coude Fiammet en lui disant d’inviter son supérieur, et le supérieur, se plaçant en avant du brigadier, emboîta à son tour le pas, naturellement.
Ce sous-officier était son maréchal des logis de peloton. On entra à la cantine, on versa le vin ; le même hasard qui avait présidé à ces rencontres amena coup sur coup le fourrier et le brigadier-fourrier du peloton, qui se trouvèrent à point nommé flâner par là.
Les « supérieurs », tout en gardant avec les autres soldats la tenue que des chefs ne doivent jamais oublier devant leurs subordonnés, acceptèrent de Fiammet, avec beaucoup de condescendance, les alcooliques égards que « le bleu » leur témoignait sous les espèces du cassis ou de la fine champagne ; le maréchal des logis surtout, qui malgré ses habitudes invétérées d’intempérance, était renommé pour sa belle tenue et pour le prestige qu’il avait sur ses hommes, jeta sur Fiammet un regard de protection très marquée en sifflant d’une seule gorgée un verre de curaçao « pour faire passer le goût du cassis ».
Dans les quelques minutes qu’avait duré cette manifestation sympathique, il semblait que le sort de Fiammet fût fixé. Tout le monde lui serrait la main, tout le monde lui souriait ; il avait de l’argent, il n’en était pas avare, il payerait la goutte aux sous-officiers, aux brigadiers, aux camarades : c’était un ami. Il était farceur, il savait imiter le cri des animaux, il n’avait pas froid aux yeux, celui-là ! Joli garçon, gai comme pinson, et allez donc !
– Mon garçon, lui dit le maréchal des logis en le prenant sous le bras et en l’attirant dans un coin de la salle, j’ai pu accepter votre politesse parce que vous êtes encore en civil et que vous ne comptez pas, censé, encore à l’escadron. Mais, vous savez, un supérieur ne doit rien accepter de son inférieur. Rien à la cantine. Je ne dis pas, vous auriez, supposé, une bonne bouteille de fine ou de curaçao, supposé, vous la déposeriez dans ma chambre pour ne pas être puni, supposé, et pour pas qu’on vous la vole, et de temps en temps, quand vous auriez à me parler pour le service, je vous en ferais boire, supposé, un coup, là, en ami, pas en supérieur… Vous savez, je vois ça tout de suite, moi, y a pas à dire, vous irez loin, c’est moi qui vous le dis, oui je vous le dis et je ne m’en dédis pas, vous pouvez dire que je serai : votre ami si vous êtes mon ami. Ah ! mais, par exemple, dans le service, y a pas d’ami ! Au doigt et à l’œil, la main sur la couture de la culotte, les yeux fixés droit devant soi, fixe ! Vous verrez, vous verrez, quand on a un ami dans son peloton, le service, laissez-moi donc tranquille avec votre service, le service, quand on a un ami, on s’en… Si quelque chose vous embête, venez me voir dans ma chambre, je ne vous dis que ça, nous arrangerons ça, s… n. . d. D… !
Et portant son pouce à ses lèvres, il hocha de la tête et s’en alla en répétant à plusieurs reprises :
– Je ne vous dis que ça, je ne vous dis que ça, moi !
Toute la bande joyeuse, entourant Fiammet, le ramena à la chambrée, où chacun se mit à astiquer, à brosser, à cirer ses armes et ses effets, tandis que quelques-uns, qui avaient de l’avance, se mettaient en tenue pour aller faire un tour en ville.
– Vois-tu, dit le camarade de Fiammet, on n’a pas de service avant midi, nous pouvons causer.
– Ah ! répliqua Fiammet, dis-moi d’abord ton nom, je ne le sais pas encore.
– Moi ? Je m’appelle Perrotin. Je suis de la Ferté-sous-Jouarre. Mon père est meunier. Nous avons deux grands moulins. Ah ! c’est beau ! Nous faisons deux mille sacs de farine par an. On nous connaît dans tout le pays. Mon père est un brave homme, ma mère est une brave femme. J’ai un frère et une sœur.
– Jolie, ta sœur ?
– Jolie comme un cœur. Elle porte un sac de farine sans se gêner. Ah ! c’est qu’on a de la poigne, chez nous, tout le monde jusqu’aux plus petits !
– Ah ! dit Fiammet, ah ! Eh ben, eh ben… à la bonne heure. C’est-il un bon pays, chez vous ?
– Le pays n’est pas mauvais.
– C’est tout comme chez nous. Eh ben, Perrotin, sois tranquille, nous serons amis ; tu me vas.
– Toi aussi. Ah ! tu vas voir de la misère, peut-être.
– De la misère ? Et pourquoi ?
– Dame, le métier de soldat, c’est dur !
– Est-ce que c’est plus dur que le travail de la terre ?
– Je ne dis pas, mais il faut savoir le prendre, sans quoi, si on a le malheur de buter, on vous relève, et plus vite que ça !
– Est-ce que les chefs sont méchants ?
– Y en a de bons, y en a de méchants. Faut se méfier, Fiammet, faut se méfier.
Y a le brigadier, celui-là est une grosse bête, craintif, craintif, toujours peur d’être puni : il cherche à vous mettre tout sur le dos pour vous faire tomber ses punitions dessus. Le maréchal des logis de peloton, celui-là, tu l’as vu, c’est un soûlard ; avec des petits verres tu en feras tout ce que tu voudras, mais ne t’y fie pas, c’est le dernier verre d’eau-de-vie, avec lui, qui a raison. Le lieutenant, c’est un monsieur. Lui, c’est l’argent qui lui manque ; il a des dettes, et les jours que ses créanciers ont réclamé quelque chose, il est comme un crin, et gare à qui tombe sous sa patte. Mais c’est un bon officier. Avec lui, si tu te conduis bien, tu auras des permissions à volonté. Mais faut qu’on soit un joli soldat, faut être bien à cheval. Alors il est content. Il veut que son peloton soit le mieux tenu de l’escadron, et c’est vrai que notre peloton est le mieux tenu de l’escadron, tout le monde ici te le dira.
– Et les autres officiers ?
– Les autres officiers ? C’est pas fini. Et l’adjudant ! Ah ! l’adjudant ! Non, non, non, non, mon pauvre Fiammet, c’est comme un chien enragé, quoi ! On ne peut pas faire un pas sans qu’il vous tombe dessus. Jamais content. Toujours en colère. Quand il ne vous punit pas, il vous menace. Pour rien, là, vous ne faites rien, vous ne pouvez pas le faire mal, hein ? Qu’est-ce que vous faites là, vous ? qu’il dit. Rien, mon lieutenant, que vous répondez. Rien, qu’il dit, ah ! rien ! Est-ce qu’un cavalier doit rester à rien faire ? Est-ce qu’un cavalier n’a pas toujours quelque chose à faire ? Et le crottin, qu’est-ce qui le ramassera ? Moi, n’est-ce pas ? Allons, allons, à l’écurie pour ramasser le crottin, et vivement ! Le v’là, l’adjudant. Celui-là, si on faisait campagne, aux premiers coups de fusil… je ne voudrais pas être dans sa peau !
– Ah ! malheur ! Mais les officiers ?
– Oh ! les officiers, c’est les officiers. Ceux-là on les craint mais on les respecte. Y en a qu’on aime, y en a qu’on n’aime pas. Le sous-lieutenant, il arrive de Saint-Cyr. Tout feu, tout flamme. Ah ! sapristi, qu’il monte bien à cheval ! Le capitaine en second, un grand sec, qui s’en va comme ça, comme ça, raide comme un pieu. Mais faut voir comme il sait sa théorie sur le bout du doigt ! Cet homme-là ne s’est pas trompé une fois en commandant depuis qu’il est capitaine. Voilà ce qui s’appelle un bon officier. Maintenant, quant au capitaine-commandant, c’est la crème. Toujours à surveiller son escadron. Il connaît tous les hommes et tous les chevaux par leur nom. Pourvu qu’on ne lui mente pas, ah ! ça, si on cherche à lui mentir, il se met en rage. Faut voir, quand il y a un cheval malade ou un homme : il va toujours le voir, et lui dit : Eh ben, mon brave, ça va-t-il mieux ? Allons, allons, ce ne sera rien. Et puis il s’en va. Mais enfin on est content, on voit qu’on ne vous laisse pas crever ici comme un chien. C’est pas comme dans les autres escadrons, au moins. Le colonel, ça n’empêche pas, c’est le meilleur colonel de toute la cavalerie française. Il a vingt campagnes et six blessures. Il était à Reichschoffen et à Gravelotte. Il est resté huit jours à cheval sans dormir, et il n’a eu qu’un pain pour manger avec deux pommes vertes que son ordonnance avait attrapées. Enfin c’est le colonel du 32e dragons, le plus beau régiment de la cavalerie française, quoi !
– Ah ! Perrotin, j’en ai déjà la colique, de tant de chefs à qui j’aurai à obéir. Rien que pour me rappeler leurs noms et leurs grades, j’en perdrai la tête !
– T’inquiète pas, Fiammet, fais pas attention à ça : tu t’y feras petit à petit. D’abord, tout à l’heure, quand on va partir à la manœuvre, je te les ferai voir. Et puis à l’appel de trois heures. Ça viendra peu à peu.
– Ah ! mon Dieu ! moi qui ne sais rien de rien, je vais être puni à tout coup, bien sûr.
– Allons donc ! tu feras comme les autres. Ils ne sont pas plus malins que toi, dis, hein ?
– Pour ça…, dit Fiammet.
– Tu vois bien ! C’est pas si difficile que ça. D’abord, tu es sûr qu’on ne te commandera rien avant de t’avoir appris à le faire.
– Si on me l’apprend, pardi ! je ne serai pas embarrassé.
– Tu vois bien ! Maintenant, tu n’as qu’à te croiser les bras. Sois tranquille, on ne te les laissera pas moisir. Tout ce qu’il y aura à faire, on te le commandera. Sitôt commandé, tu t’y mets jusqu’à ce que ce soit fini. Alors on te commande autre chose, tu le fais, et comme ça pendant quarante-cinq mois. Et alors, sitôt tes quarante-cinq mois finis, tu n’auras plus de service à faire ; ça sera bien agréable, et tu pourras t’en retourner chez toi sans avoir eu une seule punition. Y en a qui n’en ont jamais.
Et toi, Perrotin, tu n’en as pas eu ?
– Si, j’en ai eu, mais c’est ce b… de maréchal des logis qui me les a données, par injustice, parce que je ne lui paye pas assez de petits verres, quoique ça soit bien défendu d’accepter des consommations d’un inférieur, pourtant. Mais pas grand-chose, deux ou trois consignes. Je n’ai jamais été à la salle de police. J’en ai pas envie. Il paraît que ce n’est pas gai.





























