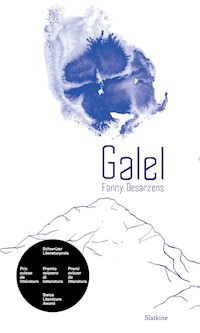
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Slatkine Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Paul, Jonas et Galel aiment la montagne. L’hiver, chacun mène sa vie en plaine ; l’été, Jonas et Galel exercent comme guides. Ils se retrouvent une fois par an à la Baïta, le refuge tenu par Paul. Un endroit de passage où ils vivent des moments aussi attendus que précieux. Où leur amitié est née.
Dans un monde de rocaille et de silence, Galel déploie le talent brut de son auteure, étoile montante de la littérature romande.
Ce titre a reçu le prix suisse de la littérature.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Née en 1993, Fanny Desarzens est diplômée en arts visuels de la HEAD-Genève. En 2020, sa nouvelle Lignine est lauréate du concours littéraire organisé à l’occasion des 60 ans de la revue choisir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À mes parents
Galel
Ce matin le ciel est apparu très lourd. De longues traînées bleues et grises étaient suspendues là-haut et c’était comme un grand miroir de ce qu’il y avait au-dessous. Parce que dans le dessous c’est bleu et gris, sauf si on descend encore. Si on descend il y a le vert de l’herbe et des buissons et des aiguilles des arbres, avec un peu le brun des écorces. Mais sinon c’est bleu et gris, mais c’est tous les bleus et tous les gris qui sont là. On pourrait dire que c’est un paysage un peu désolé. Mais il semble éclore tandis que le ciel se dégage lentement. Ça scintille. C’est le grand soleil qui jaillit. Et il s’étale tout entier dans la vallée. À ce moment-là ils sont dehors depuis un moment déjà. C’est un cortège de gens qui sont les uns derrière les autres. Certains avancent côte à côte et ils parlent ensemble. Leurs voix font un petit bruit dans toute l’étendue, leurs voix parcourent l’endroit où ils se trouvent. Ils sont douze et il y en a un treizième qui est plus devant. Tous, ils vont d’un bon pas et celui qui est devant marche mieux que tous les autres. C’est comme si les douze personnes étaient reliées à lui par une corde, et lui, le treizième, il tire sur la corde pour les faire avancer. Il a tout leur poids sur lui et pourtant c’est lui qui avance le plus légèrement.
De là où ils sont partis, du bas, on les voit qui montent et qui lentement disparaissent. Ils s’effacent entre les petits mélèzes et les touffes d’herbe un peu jaune, entre les buissons et leurs baies rouges ou blanches. Et tandis qu’ils disparaissent on ne les entend plus du tout. Mais pourtant ils parlent toujours, ils sont de bonne humeur et des fois ils rient. Ils ne se rendent pas compte qu’ils sont en train de monter. Parce qu’ici tout n’est que dénivelés. Le sol est rarement plat. Là, ça monte sans qu’on le ressente parce que ce n’est pas encore difficile. C’est un chemin de terre et sur cette terre il y a quelques amoncellements de pierres. Il y a eu un éboulis, longtemps avant. Maintenant on marche sur ces blocs et quelques-uns bougent un peu mais pas trop.
À un moment celui qui est tout devant s’arrête et il montre quelque chose du doigt, là-haut. Alors on regarde mais on ne voit rien encore parce qu’il faut d’abord franchir une grande côte. Ça fait que tout à coup tout le monde se tait. On se concentre. On n’entend plus que le bruit de la marche et rien d’autre. C’est que cette pente qu’ils apercevaient de loin, ils la voient maintenant qui se dévoile de tout son long. Elle est faite avec plein de petits niveaux. C’est le relief de la roche qui trompe un peu. Parce que la pente est un gros tas de cailloux. C’est un amas de différents gris et de différents bleus. Comme ça on dirait une espèce de grande cascade et juste avant on était sur le rivage. Ça fait qu’ils quittent lentement l’étendue de vert, le parterre de roses des Alpes et les buissons de myrtilles. Ils s’éloignent de l’herbe et surtout des arbres. Là, plus on avance et moins on trouve d’arolles, de sapins ou de mélèzes. Alors c’est comme si on entre dans un autre territoire et cette contrée c’est celle de la rocaille. Ils s’étonnent de ce sol qui s’érige devant eux. Ils basculent en avant, ils s’inclinent eux aussi. Et ils avancent. Ils sont tout entiers dans le versant et ce versant s’ouvre sous les pieds. Ils marchent, ils grimpent, et celui tout devant tire plus fort sur les cordes. Ils font glisser des cailloux, les cailloux roulent plus bas. Ça fait un bruit de pluie et alors ils pensent : si je tombe je ne peux me raccrocher à rien. Et déjà ils oublient cette pensée, ils continuent. Personne ne tombe.
La semelle s’accroche aux pierres, et quand on lève la jambe on a plutôt l’impression de devoir la soulever. En fait c’est le corps entier qu’on soulève, qu’on hisse au long du chemin.
Parce qu’il y en a un, de chemin. Un fil qui navigue entre les pierres, il est presque blanc dans le gris. On laisse une empreinte dans l’espèce de poussière blanche, mais l’instant d’après elle a disparu. On ne laisse pas de trace. On se perd parmi toute cette roche. D’en bas on ne distingue presque pas qu’il y a des gens, là. On ne remarque pas qu’il y a des gens qui vont là-haut. Et ces gens ont la tête baissée, ils regardent leurs pieds. Ils s’ébranlent au rythme de leur pas. Certains se retournent pour voir tout ce qu’ils ont déjà fait. Et puis ils regardent tout ce qui reste. Ils ne se sont arrêtés qu’un instant mais ça a semblé long. Ils se disent : ça n’en finit pas. Alors ils font un effort pour se remettre dedans, dans la pente. Ils se jettent en avant. Ils s’abattent dans le mouvement. Ils rattrapent les autres qui, eux, n’ont pas cessé de continuer. Les uns derrière les autres, ils grimpent. Ceux qui sont les plus lents sont devant, ceux qui sont les plus rapides ferment la marche. Mais tout devant encore, celui qui marche mieux que tous les autres. Lui il ne s’arrête jamais, parfois simplement il se retourne pour voir si on le suit bien. Des fois on le voit qui rebrousse chemin, il va tout derrière. Il court à la fin du cortège et il encourage ceux qui peinent, ceux qui en ont marre. Après il remonte pour reprendre la tête de la troupe. Alors elle s’encourage, et de toute façon il n’y a que ça à faire : s’encourager. Et lui devant, il fait avancer sa troupe. Il les emmène en haut.
Soudain on sait qu’on y est bientôt. C’est le vent. Ils ont su qu’ils allaient arriver à cause du vent. Il souffle tout le temps mais il semble se lever quand on arrive là, quand on traverse cette espèce de frontière et on ne savait pas qu’elle existait, cette frontière. On entend ce vent avant de le sentir et on a froid quand enfin on le sent. Il s’abat, léger et lourd en même temps, puisqu’à ce moment même lui a un poids. Il soulève la poussière et il glisse entre les cailloux, et les pierres ne bougent pas. Et c’est dans ce froid qu’on finit de basculer. Avec de nouveaux efforts on verse dans la route qui n’est en fait pas tellement une route. C’est un passage. On lève la tête et on voit qu’il ne reste plus que quelques mètres, mais ces mètres durent tellement qu’on dirait qu’ils se multiplient. À chaque fois ça semble s’éloigner, toujours. Et le vent n’en finit pas de dévaler. Encore quelques pas et tout à coup on sait qu’on y est bientôt. On appuie de tout notre poids sur la pente, pour la faire reculer, pour se soulever. Et en fait on ne fait que céder au mouvement. On appuie sur les jambes, tantôt sur la gauche et tantôt sur la droite. Et elles vont presque sans nous, à ce moment. Maintenant il n’y a plus que les jambes, et l’esprit des marcheurs n’est plus là mais il n’est pas vraiment ailleurs non plus. Et tandis qu’on croyait que le vent tombait, il hurle davantage. Ça fait qu’on ne se rend pas compte tout de suite qu’on est là, qu’on est à la fin de la pente. Alors on ressent une espèce d’écroulement : on est au bout, on est en haut. D’en bas on ne voit pas ceux qui sont en haut alors qu’eux ils voient tout. Ils peuvent voir le bas mais aussi le haut. Ils voient le chemin qui se déplie en sens inverse, ce fil blanc qui les a amenés jusqu’au col. Celui-là se nomme le col Lavorar.
* * *
D’un côté il y a le val du Tesor et de l’autre, le val de Lesiùn. Ce matin ils sont partis de la cabane du Rec qui est dans le val du Tesor. On est juste au milieu, sur un terrain plat parmi les sommets. Il y a là une plaque en cuivre avec le nom de l’endroit et puis l’altitude. Un peu plus loin, une autre plaque avec des dessins qui expliquent que ça c’est la Dent Bleue, là l’aiguille Suleg et puis elle c’est l’Orsinal. Et ce qu’on voit là-bas, c’est l’Uvarose et ça c’est le massif des Sœurs Atular. Tout autour il y a des coulées de neige. Elle est blanche et solide, elle ne fond pas. Et il y a toujours ce vent immense. C’est une grande rafale qui jaillit des montagnes. Ça tire sur le visage, si on ouvre la bouche ça fait mal aux dents. Pourtant on reste. Juste un instant on reste, on s’attarde. Même si on sait que c’est un de ces lieux qu’il faut quitter. C’est qu’on se sent à l’abri ici, comme enveloppé dans le ciel. Et on regarde à gauche et on voit le val du Tesor, puis on tourne la tête pour observer le val de Lesiùn. On ne les verra jamais comme ça : de si haut. C’est difficile d’imaginer qu’il y a des choses qui se passent dans ce bas, alors que là-haut on se sent tellement seul au monde. Si haut qu’on est au-dessus de nous-même. Sur toutes les frontières à la fois mais au centre de tout, là où la roche est noire par endroits. C’est que la paroi est dans l’ombre, à ce moment du jour. Alors on profite, on reste dans la montagne. On lève la tête pour voir les sommets, la cime qui se découpe dans la lumière. Le vent souffle toujours et alors on comprend, on se dit qu’on n’est qu’un simple passager. C’est à ce moment-là que le treizième fait signe : il faut y aller.
Alors on tourne le dos à la pente qu’on vient de gravir. Il est temps de redescendre. Parce que c’est de l’autre côté qu’on va. On traverse le col pour aller du côté de Lesiùn. Et tandis qu’on descend, on cesse d’entendre le vent. Brusquement il s’arrête, ou plutôt on quitte l’endroit où il souffle. Alors il n’y a plus que du silence, et le bruit des pas.
Et eux ils sont toujours derrière le treizième. C’est comme s’il glisse sur la montagne tellement il va bien, tellement il connaît là où il faut poser le pied. Quelqu’un lui fait la remarque, il dit : tu vas tellement mieux que nous. Alors ce treizième hausse les épaules et puis il dit simplement : c’est mon métier. Et ce métier, c’est marcher. C’est délier des chemins.
Ils redescendent depuis le col Lavorar et découvrent le val de Lesiùn. Ça fait trois jours qu’ils ont commencé. C’est une boucle qu’on fait, c’est le tour de Saingal. Ils sont arrivés au village de Laster qui est au fond du Tesor, et là on les attendait. C’est le guide qui les attendait, pour les emmener faire le tour. Ils sont partis de Laster et le premier jour était un jour tranquille. Ils sont montés mais pas trop, juste assez pour atteindre la cabane de la Pierre Rose. C’était le premier jour et la première nuit, c’est à ce moment qu’on fait connaissance et qu’on s’acclimate à l’environnement. Le deuxième jour ils ont quitté la cabane et ils ont marché à flanc de coteau presque toute la journée. Ils ont vu des marmottes et ils ont croisé des vaches et ici elles sont petites et noires, elles ont une cloche autour du cou. Ils ont rendu visite à un paysan qui leur a vendu du fromage d’alpage. Le soir ils ont dormi à l’auberge Selzior et c’était toujours dans le val du Tesor.
Là, c’est le troisième jour, c’est celui du col. Ça fait qu’on quitte la vallée et son herbe, ses arbres et le son des cloches de vache. On a quitté le sol de terre pour entamer celui de pierre.
C’est à ce moment du tour qu’on comprend ce que c’est, la montagne. C’est du minéral, c’est du vent et de la pente. C’est du bleu et du gris et un froid ancien. Quand on redescend du col Lavorar c’est pour aller se réfugier à la cabane d’Estùn. C’est drôle parce que ce n’est pas pareil des deux côtés : de l’un c’est du vert et beaucoup de petites rivières qui font un joli bleu sombre dans ce vert. De l’autre, c’est toute cette caillasse qui dégringole si on pose mal le pied. Dans un paysage aride, on avance. On est contre la paroi de la montagne, celle qui s’appelle Ermoval et qui ressemble à un bec d’oiseau. On est presque dans son ventre et alors on s’éloigne en faisant attention. On pose d’abord le talon puis le reste du pied. On fait ça pour ne pas avoir mal au genou, pour ne pas que ça tire. C’est le guide qui a expliqué ça, au début. Et on descend lentement, les uns derrière les autres. Quelquefois il y en a un qui dérape et tout le monde demande : ça va ? On se relève ensemble parce que si on tombe, on le fait ensemble aussi. Et pendant ce temps le guide attend. Il n’a pas eu peur parce qu’il reconnaît les chutes. Il sait que celle-ci c’était simplement un affaiblissement et pas quelque chose de grave. Simplement un pied qui a glissé sur un caillou et tout le corps s’est affaissé sur le chemin, sur d’autres cailloux. Ça fait un peu mal mais ce n’est pas grave. Il sourit et il dit : on y va ? Et ils y vont, ils suivent. Ils longent une rivière qui ne ressemble pas à celles du val du Tesor. Elle est très claire, presque transparente. On voit tout au travers. Elle glisse du haut et on ne peut pas voir la source. Elle est très froide mais c’est comme ça pour toutes les eaux de montagne.
Là aussi la route se fait longue. C’est tout le poids qui s’incline lourdement sur les jambes. Ça fatigue et les douze vont plus vite pour que ça s’arrête plus vite. Alors celui tout devant ralentit, seulement un peu. Si on est pressé dans ce genre de chemin, dans un pierrier en pente, on peut glisser ou alors s’abîmer le dos ou les genoux. Alors il va lentement et aucun des douze ne s’en rend compte. Mais ils sont étonnés quand ils sont en bas. Là il y a de nouveau du vert, mais il est écorché contre la roche. La rivière s’est répandue un peu partout et ça fait une espèce de marécage. D’en haut on voyait ces différents cours d’eau mais on croyait que c’était des routes. Et là on a la vue sur tout le val de Lesiùn et ses montagnes qui le surplombent, et alors c’est beau.
Dans la journée on croise des vieux troncs qui sont blancs d’être tellement vieux. Déracinés, ils ont perdu leurs couleurs et ressemblent maintenant à des bouts d’os qui reluisent au grand soleil. Ils sont laissés là et on peut s’asseoir dessus. Et aujourd’hui on ne descendra pas plus : on dort à Estùn.
Le lendemain on devra remonter et on s’encourage pendant la soirée. On boit de la bière et on mange un repas chaud. Le guide dit : demain nous dormirons à la Baïta. Et sans qu’on sache pourquoi on sait que la Baïta est un endroit spécial. Ça s’est vu sur le visage du guide.
La Baïta c’est une cabane tenue par un ami du guide et il paraît qu’avant il était guide lui aussi. Maintenant il ne marche plus du tout, ou presque plus et pas beaucoup de monde ne sait pourquoi. Les douze personnes, en tout cas, ne sauront jamais. Parce que ce n’est pas le genre de choses qu’on partage avec n’importe qui et ces douze personnes, pour un guide et un tenancier, sont n’importe qui. Ce soir le guide explique : on partira à sept heures du matin parce qu’on a une longue route. C’est bien d’arriver tôt à la Baïta parce que les nuits sont plus froides qu’ailleurs mais avant, pendant le soir, c’est mieux que n’importe où. Alors vous pourrez profiter.
Vous verrez comme tout est mieux là-bas qu’ailleurs. On arrivera vers seize heures si tout se passe bien, mais tout se passera bien. Le patron nous accueillera. C’est une ancienne bergerie et on y dort très bien. On se lèvera tôt et on mangera bien, là-bas le pain est vraiment bon. Ensuite on passera la nuit et il y aura le dernier jour. Ce sera long mais on arrivera tôt à la dernière auberge. On sera encore haut mais ce sera moins haut qu’à la Baïta. Là ce sera la dernière nuit et elle sera plus longue que les autres. Vous pourrez dormir plus longtemps le matin. Parce qu’ensuite ce sera le dernier jour et là on ne se pressera pas du tout.
* * *
Il est six heures et lui est déjà debout. C’est que tous les matins, pendant que tout le monde dort encore, il marche déjà. Il s’éloigne un instant, juste un instant. Il s’éloigne alors qu’il y a encore la nuit qui est comme si on avait tout peint en noir, même les montagnes. Il s’écarte de tout, à ce moment. Ce moment est le sien dans la journée, rien qu’à lui. Et, privé de lumière, c’est comme si c’est lui qui l’invitait. Parce qu’à un moment elle arrive doucement. Avant de le voir on sent ce soleil déjà chaud, on sent que ça va être une journée de canicule. Et ce chaud, cette tiédeur atteint le lieu où on se trouve, et seulement après la lumière apparaît et découvre ce qui se trouvait dans le noir. Le guide aime ces moments. Parce qu’avant il ne pouvait pas dire où il était. Il était nulle part et c’est avec le jour qu’il est quelque part. Et même s’il connaît très bien tous les environs de toutes les cabanes, à chaque fois il se trouve étonné. Là, ce matin, il est sur une petite colline qui est près d’Estùn. En haut de cette colline il y a une croix qui est plantée. Pour monter jusqu’à elle on suit un chemin tapissé de gentianes, de silènes et de ces petites fleurs blanches qu’on a nommées céraistes des Alpes. Et alors il se trouve là, en haut de la colline près de la grande croix, et il observe le chemin qu’ils vont faire aujourd’hui. Il est son préféré parce qu’il l’amène à la Baïta. Il descend de l’autre versant de la colline pour retrouver sa troupe.
Le soleil a monté quand les douze sont dehors, prêts à partir. Il est sept heures et ils attendent le guide. C’est qu’avant, en rentrant à la cabane pendant qu’elle s’éveillait, il prend du temps pour se préparer à la journée. D’abord il se nettoie le visage à l’eau froide, il laisse ses poings appuyer sur ses yeux pendant quelques secondes. Il prépare son sac. C’est un gros sac à dos en cuir brun, râpé sur le dessous et avec des lanières qui se sont affinées avec le temps, parce que ça fait longtemps que ce sac c’est le sien, et ses épaules l’usent dans la montagne. Dans son sac il y a un gros pull de laine marron, une paire de chaussettes de rechange, un mouchoir, un T-shirt en coton blanc. Il en a deux pareils ; l’autre c’est celui qu’il porte maintenant. Ça c’est ce qui est au fond du sac, qui est agencé en couches. Au milieu il y a un réchaud à gaz, des petits bols en fer-blanc, des cuillères et des sachets de soupe. Parce que tous les midis il sert de la soupe à sa troupe. Il dit que c’est pour les sels minéraux. À l’auberge d’Estùn on lui a donné une miche de pain noir. On distribue toujours du pain aux marcheurs. Il a aussi des paquets de fruits secs et de noix. Dans la dernière couche, deux grandes bouteilles d’eau. Il ferme son sac. Sur un côté il y a une grosse louche qui est harnachée.
Sur l’autre côté il a attaché la casserole dans laquelle il fera la soupe. Et au-dessus du sac, son chapeau. Il est en cuir aussi, de la même couleur que le sac. Quand il a fini de vérifier ses affaires, il commence à lacer ses chaussures. Ce sont de grosses chaussures qui sont aussi en cuir et qui montent jusqu’à la cheville. La semelle est très épaisse et les lacets sont comme des petites cordes. Elles sont les siennes depuis longtemps, depuis le début. Il n’en a jamais changé, elles ne s’usent pas. Il peut y glisser le pied sans difficulté parce qu’elles sont parfaitement à sa taille. Il les a sculptées à son pied, après tant de trajets. Le pied est dedans et alors il commence à nouer les lacets. Il prend du temps pour se chausser. Il tire fort sur ces petites cordes, pareil des deux mains. Il glisse la lanière sous le petit clou de métal et il entrecroise, il recommence de l’autre côté. Il va jusqu’en haut de la chaussure, il tire fort une dernière fois. Il fait le nœud. Il est prêt, il sort dans le jour qui a fini de s’installer.
Sa troupe l’accueille joyeusement. Ils pensent qu’il vient de se lever, ils rigolent entre eux et ils sont heureux de le voir. Il leur dit bonjour à tous et après il dit : on y va. Et ils y vont. Ils quittent Estùn.





























