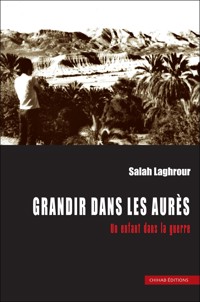
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
« Dans sa tournée à travers la classe, arrivant à mon niveau, l’instituteur s’est figé. Scrutant mon dessin, il s’est tourné vers moi, les yeux écarquillés, le regard furieux, le visage rouge de colère et m’a ordonné : Efface-moi ça ! Efface-moi ça tout de suite ! Je l’ai regardé, surpris de sa réaction, m’attendant aux compliments habituels sur mes dessins ; il reprit de plus belle : Efface-moi ça ! Efface-moi ça ! Profondément troublé, je ne comprenais toujours pas ce que je devais effacer jusqu’au moment où il a pointé du bout de sa règle sur le drapeau algérien ! »
Dans ce récit mémoriel, Salah Laghrour revient avec force détails sur son enfance dans les Aurès, pendant la guerre. Des premiers pas d’apprentissage à l’école coranique jusqu’au départ au Caire pour des études secondaires, il déroule l’écheveau des souvenirs et nous raconte, sans fards, le quotidien de sa famille (de révolutionnaires) prise dans les affres de l’Histoire, déportée dans le camp de M’toussa, déracinée, décimée. Il rend égalment un très bel hommage aux femmes, à leur résistance, à leur résilience.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Salah Laghrour a été informaticien, ancien cadre au ministère de l’Hydraulique, puis professeur de mathématiques. Il est l’auteur de deux ouvrages : "Abbès Laghrour. Du militantisme au combat, Wilaya I, Aurès-Nemamchas", (Ed. Chihab, 2014) et "Histoire intérieure de la Wilaya I, Aurès-Nemamchas", (Ed. Elkhaldounia, 2018). Il est également l’auteur de nombreuses contributions techniques et sur l’histoire de la guerre de libération dans la presse nationale en arabe et en français.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GRANDIR DANS LES AURÈSUn enfant dans la guerre
SALAH LAGHROUR
GRANDIR DANS LES AURÈSUn enfant dans la guerre
CHIHAB EDITIONS
Tous les textes, en début de chapitre, sont extraits de l'ouvrage de François Maspero, Les enfants d'Algérie, récits et dessins, paru en 1962, aux éditions François Maspero.
© Éditions Chihab, 2024.
www.chihab.com
Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91
ISBN : 978-9947-39-700-8
Dépôt légal : février 2024
À ma mère Zaâra et Nanna Lâatra,
À toutes les femmes pour ce qu’elles incarnent : non seulement matrices et gardiennes de la cellule familiale et sociale, mais également pour leur contribution fondamentale à la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, souvent peu évoquée...
Aux graines d’espoir pour un monde juste:
Massyl, Malya, Nil et Luna.
Aux enfants de Gaza victimes de l’impitoyable barbarie
humaine... sombre page de notre humanité.
INTRODUCTION
L’idée d’écrire ce livre me taraudait depuis que j’ai pris conscience de ce que ma famille et les Algériens avaient enduré durant la révolution. Ce fut mon plus ardent souhait.
En Algérie, pour ma génération, il n’existait pas de discussions en famille ou en dehors de la famille qui n’évoquât la guerre de libération. Chaque personne, femme, homme, ou même enfant, avait des souvenirs directs ou indirects à raconter. J’en avais. J’attendais l’opportunité pour leur redonner vie.
Les choses de la vie, de tous les jours m’occupaient. Je reportais mon projet pour le mois, l’année et les années suivantes, jusqu’à l’âge de ma retraite où j’ai compris que le temps s’était écoulé trop vite.
Avant d’écrire ce qui a échappé à l’érosion de ma mémoire, j’ai considéré que le parcours de Abbès Laghrour, qui a sacrifié sa vie pour notre pays, aux côtés de notre frère Chaabane et de celui de mon père, mérite d’être relaté. Je me suis alors engagé à écrire son parcours, couronné par un livre, suivi d’un autre livre sur la Wilaya I historique. Depuis, la mémoire a vieilli, rétréci, les souvenirs se confondent, se tassent, certains s’amenuisent ou disparaissent. Les connexions entre les neurones deviennent lentes, très lentes, inversement proportionnelles à la vitesse de celles des générations de la wifi !
J’ai décidé malgré tout d’écrire pour moi, pour ma famille et mes petits-enfants Massyl, Malya, Nil et Luna : « graines d’espoir ».
C’est ainsi que j’ai commencé à récupérer des notes, des témoignages écrits ou enregistrés des décennies auparavant, et surtout à ouvrir ma mallette contenant de vieux courriers, des agendas et des photos datant de plus d’un demi-siècle.
Je me suis retrouvé immergé dans un temps révolu, la mémoire soudain ravivée par des photos, chatouillée par des mots… Je me suis replongé dans de lointains souvenirs. Ces contacts retrouvés avec mes amis d’enfance, d’adolescence et certains membres de ma famille furent pour moi un soutien fort stimulant.
J’ai réussi peu à peu à rassembler tous ces mots, ces phrases, ces textes, mot par mot, phrase par phrase, comme si je composais une mosaïque ou peignais un tableau touche après touche. Sans plan préalable. Je me suis laissé guider par mes souvenirs.
Certains événements, lieux et personnages évoqués et décrits ici peuvent apparaître fragmentaires. Ils sont décrits suivant ma perception et celle de témoins des époques évoquées.Ils ont donné cette suite de textes. Des tranches de ma vie, ce livre.
Il retrace le parcours singulier d’un enfant à travers des périodes de guerre, de paix, des cultures et des langues différentes. Entre espoir et désespoir. Une véritable tourmente de souffrance et de joie, une quête incessante d’équilibre dans ce tumulte, jusqu’au crépuscule de ma vie.
Je ne sais pas ce que sera le sort de mes petits-enfants. Celui de mes enfants me semble équilibré : ils ont acquis une double culture, plutôt universaliste. Un universalisme cependant incertain.
CHAPITRE ILE DOUAR
« Plus tard en Algérie, ce que je voudrais faire, c’est de rendre aux gens ce qu’on leur a pris et punir celui qui a fait du mal. Maintenant je vais vous raconter mon histoire. Nous étions en train de dîner, et puis les soldats sont arrivés, ils ont mangé, mangé, mangé ! Et puis ils ont cherché après mon frère et ils n’ont pas trouvé le revolver que mon frère avait caché. Alors, ils ont cherché, cherché, et ils ont rien trouvé. Le lendemain, on a tout remis en ordre et on s’est sauvé en Tunisie. Voilà. »
Mohamed Lakdar Ben Ali Hamadi
11 ans, enregistré en arabe.
Bulles d’air
Les images de ma première enfance que je garde en mémoire sont celles de mon douar.
Je vivais en pleine campagne, entouré de montagnes, de collines et de plaines. Mon douar est situé entre deux montagnes, Djahfa qui a abrité un des refuges de la reine berbère chaouie, la Kahina, et celle de Tamza, qui signifie l’ogresse en chaoui, dont les sommets étaient enneigés à longueur d’année en ce temps-là, et qui fut un haut lieu de combats meurtriers, pendant la guerre de libération. Un oued dit Oued Laghrour le traverse, l’eau y coule surtout l’hiver. Nous étions un groupe de familles regroupées en fractions formant elles-mêmes une tribu. J’appartiens à celle des Ath Bousskath – Ouled Boussaka – de la sous-tribu N’Sigha, tribu des Ammara, chacun de ces éléments ayant son représentant au sein de cette organisation sociale parfaitement structurée que l’Etat-civil colonial a remaniée par l’attribution de noms de famille, plus conformes à sa vision. Même s’il est ancré dans la société, ce modèle social est devenu obsolète depuis la citadinisation massive, le brassage de la société et les différents mouvements de populations opérés à travers le pays depuis l’indépendance.
Mon douar est donc le lieu de mes premières bulles d’air, celui où j’ai passé ma prime enfance.
Nous vivions du produit de nos terres et de l’élevage de nos moutons, chèvres, vaches et quelques bœufs et chevaux utilisés essentiellement pour le labour. L’hiver, mon père louait des terres de parcours pour pâturage sur le versant sud des Aurès, ces voies de transhumance étant empruntées durant l’hiver par un nombreux cheptel.
Depuis notre maison située sur un monticule, j’apercevais au loin, à des kilomètres à la ronde, les riches collines et plaines de blé et d’orge parcourues par un cheptel varié, essentiellement de moutons. Notre maison se trouvait à proximité d’un chemin emprunté par les habitants du douar pour leurs déplacements à la ville, spécialement les jours de marché où ils se rendaient et rentraient à pied, à dos d’ânes, de mulets ou à cheval, chargés de gros sacs de farine de blé. Parfois, ils menaient un petit troupeau au marché à bestiaux. Il nous arrivait, enfants, de surveiller leur retour, allant à leur rencontre, dans l’espoir d’être gratifiés d’un bonbon ou de quelques dattes par l’un des voyageurs. Nous retournions chez nous souvent bredouilles !
Nous allions également à la rencontre du Aqbayli ou Abeddel, terme qui signifie “troqueur” en chaoui et désignait un personnage qui, la plupart du temps seul, sillonnait les douars, surchargé de divers objets et menant cette activité de troc développée surtout en Kabylie, d’où son nom. Nous le reconnaissions à l’énorme charge qu’il portait sur son dos, parfois accompagné d’un âne encore plus chargé que lui : foulards, barrettes, bagues, miroirs, bracelets, henné, encens, loubane (résine naturelle de l’arbre d’acacia), souak (écorces de noyer), clous de girofle, aiguilles, épingles, fils, bonbons etc… Il échangeait aussi touffes de laine, frik (blé vert grillé concassé), œufs, volaille, peaux de moutons… Dès qu’il approchait d’une maison, il brandissait deux longs bâtons pour se défendre contre la meute des chiens qui fonçaient à sa rencontre pour l’empêcher d’approcher des maisons. Avec un sang-froid et une impressionnante technique qui consistait à dessiner autour de lui des circonvolutions avec ses bâtons de la manière qu’aucun chien ne pouvait plus franchir, il se protégeait de leurs morsures. Seuls les enfants et les vieilles femmes pouvaient l’approcher, particulièrement nous les enfants qui servions d’intermédiaires entre les femmes et l’Aqbayli dans les longues transactions qu’occasionnait sa visite. S’il considérait qu’il avait réalisé une bonne affaire, il nous récompensait alors d’un bonbon. Certains de ces colporteurs ont connu une bonne fortune, et se sont installés à la ville.
J’ai peu de souvenirs de mon père. Je garde quelques images furtives dans ma mémoire, me rappelant son allure, quelques gestes et certains moments passés avec lui. À dos de mulet lors d’une première expédition hors du douar, je découvris avec lui ce qui se cachait derrière la montagne. C’est aussi en sa compagnie, au fond d’un véhicule, que je découvris pour la première fois la vitesse et les bruits du moteur.
Il aimait bricoler et me fabriquait des jouets de fortune. Derrière la maison, je le voyais assis du côté ouest, en train de pilonner soigneusement une botte d’alfa posée sur une grosse pierre plate et lisse. Une partie de cette pierre émerge aujourd’hui encore, de la terre, résistant toujours à l’éternelle force du temps. Je le revois tapoter tendrement l’alpha ou l’asperger légèrement d’eau quand elle était un peu sèche, pour l’assouplir et mieux la tresser, afin d’en fabriquer des nattes, des cordes et des couffins.
La pierre lisse
Des années après, à chacune de mes visites, ma mère me montrait encore la pierre et m’en racontait l’histoire, comme si c’était la première fois. À mon tour, à chaque occasion, je ne peux m’empêcher de la caresser en la montrant à mes enfants, et plus récemment à mes petits-enfants, gestes apaisants, d’attachement perpétuel à ce lieu.
C’est ainsi que, bien plus tard, lors de la construction de ma maison à Alger, j’ai prélevé des pierres de la clôture de la maison qui m’a vu naître, alors en ruines, afin de les couler, en présence de mes deux enfants dans le béton des fondations de notre future demeure.
De mon père, j’ai gardé aussi le souvenir d’une dépouille emmaillotée dans un drap blanc au milieu de la grande pièce de la maison à Khenchela, où, enfant, je fus, pour la première fois, confronté à la mort.
En revanche, je n’ai aucun souvenir de ma mère en rapport à ma petite enfance. Elle devait être plus occupée par le travail domestique que par moi. J’étais tout le temps pris en charge par ses belles-sœurs qui avaient des enfants de mon âge. Ma mère m’a rapporté qu’elle m’avait donné le sein jusqu’à l’âge de trois ans, et que pour calmer ma faim, lors de ses absences, quelques femmes de nos proches étaient à ma disposition pour me nourrir. Je garde cependant de ma mère des images impérissables liées à la période de la Guerre de libération où j’étais, m’a-t-elle rappelé, tout le temps accroché aux pans de sa gandoura.
C’est de mon cousin Ali que j’ai le plus de souvenirs d’enfance, de nos virées, jouant au ballon, courant derrière les troupeaux de moutons et de chèvres, nous introduisant dans les champs pour chercher des nids d’oiseaux, leur poser des pièges ou leur lancer des pierres, et cueillir et déguster ces plantes sauvages que sont tefgha, telma, telghouda, tifeth. Nous traquions spécialement les coquilles d’escargots, reconnaissables à leur couleur verte, où se réfugiaient les abeilles sauvages pour y fabriquer leur miel. Nous aimions jouer, Ali et moi, à Achcharath, cet amas de pierres superposées sur lequel, tel une cible, nous lancions de petites pierres pour le faire tomber. Jeu similaire au bowling. Avec la sève des tiges de telma, nous nous amusions à reproduire sur nos bras ou sur le visage des filles les tatouages de nos grand-mères, mères et sœurs.
Enfants, Ali et moi, entendions au loin les mélodies enjouées des flûtes des bergers et les appels qu’échangeaient à distance les familles pour entrer en contact, passer des messages, et au besoin donner l’alerte. Parfois d’étranges reflets de fragments de miroirs, dont nous percevions les éclats scintillants suivant la position du soleil, nous éblouissaient. J’ai compris plus tard que ces jeux de lumière dissimulaient un langage codé au service des amoureux. L’ingéniosité des gens du pays les poussait aussi à inventer un vocabulaire consistant à inverser les syllabes de certains mots ou à en rajouter : un verlan en chaoui, avant l’heure, pour brouiller les messages, préserver l’intimité des échanges, et éviter souvent de déclencher des conflits.
Nous avons appris, Ali et moi, à reconnaître le feu, visible à des kilomètres à la ronde, que déclenchait l’un parmi les rares habitants du douar à posséder une montre ou qui pouvait entendre, pendant le mois du ramadhan le coup de canon tiré en ville, pour annoncer l’heure du f’tour. Nous guettions les flammes et allions en courant avertir nos parents. En cas de brouillard, c’est par la voix que le signal était donné, à la manière des appels à la prière. Le temps à l’époque s’appréhendait en fonction des déplacements du soleil et de la lune, ainsi que du chant du coq.
De mon père, nous n’avons gardé aucune photo. Ma mère et mes sœurs ne savaient pas lire. Pendant la révolution, par peur des soldats français, elles avaient tout brûlé : documents, photos et le peu de livres qui existaient. Seul le livre saint fut épargné. Je conserve de lui, malgré cela, l’image d’un homme grand de taille, arborant une barbe aux poils roux, noirs et blancs, bien taillée, ni longue, ni courte. Il portait un chèche autour de la tête, qui ne le quittait jamais. Jamais, je ne l’ai vu tête nue. Il revêtait une gandoura blanche, dont l’encolure était brodée d’une cordelette tissée de fils de soie, des sarouels gris ou blancs, d’une chemise sans col. Il portait souvent un burnous blanc sur les épaules.
Il était d’un tempérament calme et serein. Mesuré, il prenait beaucoup de temps avant de répondre à une question. Il n’était jamais pressé, jamais violent, parlant à voix basse. Les gens et la famille disaient de lui qu’il était un homme sage, « capable d’éteindre le feu sans eau ! », selon l’expression consacrée des Chaouis pour qualifier un homme avisé et bon réconciliateur.
Je l’accompagnais souvent dans ses déplacements, toujours accroché à son burnous ou à sa gandoura. Dans les champs, il m’expliquait comment reconnaître les traces des pattes des lévriers, des renards, ou des sangliers, ainsi que leurs déjections. J’apprenais avec lui à distinguer les odeurs de certains animaux, le nom des fleurs, des oiseaux, des plantes et des insectes. Parfois, il prenait son fusil de chasse. Bon tireur, il aimait chasser et visait juste. Il enseignait le tir à mon frère Abbès qui possédait une carabine dans l’un de nos champs, à côté d’une maison en ruine dite Idder n’sekiou. Afin de répondre à mes recherches sur le passé, interrogations d’enfant curieux, je revois ma mère m’indiquant l’endroit exact et pour confirmer son témoignage, elle s’allongeait par terre dans la position que prenait mon père pour tirer.
Nous possédions de nombreux chiens, mais c’est Lilou, le petit chien terrier au poil noir et blanc qui l’accompagnait le plus souvent : un chien renifleur, au flair sûr, qui débusquait les animaux sauvages et les poursuivait jusque dans leurs terriers. Lilou était notre chien préféré, le seul à être autorisé à entrer dans les pièces de la maison. Sa mort mystérieuse, lors de la fête de ma circoncision, fut un drame pour moi. J’en avais versé des larmes. Mon père aussi fut très attristé car il était devenu pour lui un vrai compagnon.
La circoncision
La pratique de la circoncision remonte à l’antiquité ; elle se perpétue de nos jours chez nombre de sociétés à travers le monde pour des motifs religieux ou culturels. Dans mon enfance, le cérémonial était peu religieux : nous fûmes trois à être circoncis le même jour, un cousin de sept ans, un adolescent, sourd-muet et moi, âgé de six ans.
Généralement, la circoncision a lieu à un âge variant entre un et six ans, souvent au vingt-septième jour du mois de Ramadan, qui correspond à la Nuit du destin, où l’ange Gabriel transmit au prophète (saaws) les premières paroles de Dieu, le premier verset du Coran, Iqra’, « Lis ! ». Cette journée bénie est de nos jours propice à des circoncisions collectives pour des raisons économiques. Les légendes populaires rapportent que lors de cette nuit particulière, soudain, les étoiles se dispersent et le ciel s’ouvre, laissant apparaître des lumières de différentes couleurs. Ceux qui ont la chance d’observer cet événement céleste verront leurs souhaits exaucés. C’est ainsi que beaucoup passent la nuit entière à attendre l’ouverture du ciel, pour demander richesse, fertilité, santé ou pardon pour les péchés commis. Cette nuit porte chance aux enfants à circoncire et le coût de la fête, du fait d’être collective, est peu onéreux.
Les familles disposant de moyens substantiels la pratiquent à d’autres moments de l’année. Ils organisent une véritable fête, aussi importante que celle d’un mariage, même si la circoncision est collective. Ce fut notre cas, pour mes cousins et moi. La cérémonie s’est déroulée dans notre maison et celle mitoyenne du cousin Omar.
Quelques jours avant la fête, un émissaire se rend à cheval vers les maisons voisines pour inviter les familles. Plusieurs moutons, dont certains offerts par des proches parents ou amis, sont sacrifiés pour la circonstance. Quant aux familles démunies, elles se cotisent pour l’achat du mouton.
Des mois auparavant, les préparatifs vont bon train : de grands sacs de semoule sont déjà roulés pour la préparation du couscous, mis à sécher et en réserve ; les femmes s’organisent en groupes se répartissant les tâches : regroupement des ustensiles et plats, passage à la vapeur de la semoule, découpage de la viande, nettoyage des tripes, alimentation du feu, préparation de la sauce, des épices et pois chiche. Très peu ou pas de légumes pour agrémenter le couscous à cette époque. Un véritable chantier donc dans une formidable ambiance où fusent les chants entrecoupés d’anecdotes. Un élan de solidarité extraordinaire où chacun n’hésite pas à mettre à disposition, qui son couscoussier, qui sa gassaa, qui ses assiettes…
Le jour venu, une grande tente est dressée pour accueillir les invités. La nuit, elle est réservée aux femmes. Elle leur sert de « tribune » pour le spectacle du soir. Les hommes sont séparés des femmes par une sorte d’arène dédiée aux musiciens et aux danseuses et danseurs. Pas de fantasia. En revanche, deux groupes de musiciens : les rahaba et les flûtistes. La rahbia est une forme de chant a capella accompagné d’une danse pratiquée essentiellement par des hommes, très rarement accompagnée de flûte ou de bendir. Les femmes les rejoignent seulement pour danser. Cette danse chantée est typiquement chaouie, de la région des Aurès-Nememchas. Elle n’existe nulle part ailleurs en Algérie et se transmet oralement de génération en génération. Aucune fête dans la région ne pouvait avoir lieu jusqu’à nos jours, sans ce chant dansé. Le mot rahaba est probablement issu de l’arabe marhaba, (bienvenue). Les rahaba souhaitent la bienvenue, puis entonnent d’autres chants.
Le groupe, composé d’au moins quatre personnes, chantent et dansent en frappant le sol avec leurs pieds en suivant le rythme de la mélodie. Ils s’alignent, croisant les bras les uns des autres, se tenant par la main, rapprochant leurs épaules et frappant de concert des pieds avec une telle énergie qu’il leur arrive de soulever la poussière ! À d’autres moments, leurs pieds frôlent le sol par un élégant mouvement donnant au spectacle une tout autre scénographie tout aussi féerique. Face à eux, une ou plusieurs femmes dansent également au même rythme, en y mettant beaucoup de grâce et d’élégance, teintées de réserve et de discrétion. Les jeunes filles non mariées sont rarement autorisées à danser en public. Ce groupe de danseurs est ensuite relayé par les flûtistes.
La cérémonie débute après le repas du soir par le chant de bienvenue, suivi par les flûtistes qu’accompagnent les chanteurs et les danseuses. Celles-ci, aux visages couverts d’un foulard légèrement transparent portent leurs plus beaux bijoux, khelkhels, ou anneaux en argent autour de chaque cheville dont le tintement rythme leurs danses. Elles sont parées de grandes boucles d’oreilles, de bracelets, de bagues et de colliers, dont le skheb qui orne leur poitrine. Ce dernier est confectionné de sorte à être serti de motifs en argent, de perles de corail et d’autres motifs ciselés manuellement avec des écorces d’oranges, taillées soigneusement en petits triangles, losanges et carrés.
Les femmes entrent en piste, vêtues d’un l’haf, habit traditionnel formé d’une seule bande de tissu, fichu sur le dos, têtes coiffées de foulards. Les bras couverts par des k’meme, manches en tissus transparents, sur lesquelles sont brodés des motifs dorés ou argentés, leurs mains agitant des foulards de couleurs. Autour de la taille, elles ont une ceinture en argent ou un abeggess, autre ceinture d’environ deux mètres, faite de dizaines de fils de laine colorés, roulés ou tressés, sur laquelle sont brodés des motifs traditionnels argentés et dorés. Elles entrent en scène, la tête couverte d’un grand voile, plus ou moins transparent. Elles sillonnent l’espace ovale qui sépare les femmes des hommes, se relayant par petits groupes.
Seul le côté des hommes est éclairé par des lampes à carbure. Les femmes peuvent donc voir les hommes, mais, elles, ne peuvent être observées. Au début de la soirée, tant que les invités étrangers sont présents, seules les femmes âgées et les femmes mariées dansent. Plus tard, dans la seconde partie de la nuit, quand les étrangers sont rentrés chez eux, apparaissent alors les jeunes filles. Une fois la fête restreinte au cercle familial, la scène est envahie par tous, hommes, femmes, jeunes et vieux qui, sans contrainte, enflamment la soirée d’interminables coups de feu et de youyous stridents.
Au début de la soirée, l’entrée en scène se fait avec les flûtistes par un istikhbar-prélude ; ensuite ils ravivent le public par des airs plus réjouissants. Le berrah fait alors son entrée, échangeant avec les spectateurs, s’attardant avec l’un des invités, allant et venant sur la scène.
Soudain, à un moment précis, il interrompt la mélodie et le spectacle par la formule : Stop, Stop, Stop mon flûtiste ! Ceci est une somme de la part d’Untel ! lançant ainsi à la cantonade ses éloges pour le généreux donateur, félicitant l’organisateur de la fête, annonçant des cadeaux pour les circoncis, le tout sous forme de strophes, de dits populaires ou de poèmes. Il taquine aussi certains par des dits et des vers satiriques. Les réactions des pris à parti font le bonheur des spectateurs… Un véritable divertissement collectif.
Les spectateurs à leur tour, toujours par l’entremise du berrah s’échangent des “dits” connus ou improvisés, des dictons populaires, des vœux, des plaisanteries, qui provoquent l’hilarité générale du public. Parfois même, fusent des paroles sous forme de messages amoureux à peine voilés, adressés à une aimante qui est présente dans le public ou sinon à son éventuelle messagère.
Pendant ce temps, le berrah s’agite autour de la scène, scrutant le public, en quête d’un appel.
Une fois interpellé par un spectateur, il fait le tour de la scène, le billet dans la main attendant le moment propice pour interrompre le spectacle : généralement, il choisit une mélodie émouvante, nostalgique, puis lance à nouveau son cri :
« Stop, Stop, Stop mon flûtiste ! Ceci est une somme de la part d’Untel… »
Pour égayer encore plus la soirée, le berrah reprend des citations, des dictons populaires et des vœux dont voici quelques extraits scandés :
- Ne te plaisent, les fleurs du laurier, que si leur ombre recouvre l’oued.
- Ne te plaise, la beauté de la fille que si tu connais ses actes.
- Si un homme te menace, dors en paix ; si une femme te menace, passe la nuit éveillé.
- Garde ton cœur serein, ferme la porte du passé, perds-en les clés et vis ta vie d’aujourd’hui.
Plus récents :
- Viendra le temps où la parole sera dans les fils et l’eau dans les murs.
- Viendra un temps où les frères se chamailleront comme des serpents,
- La pluie tombe et la terre ne se rassasie pas.
- Les médecins soignent et les gens ne guérissent pas.
- Le pouvoir revient aux bergers et les avis aux femmes.
- Viendra le temps où les pèlerins, le commerce des poulets, les femmes célibataires se multiplieront.
La parole est de mots, sa signification est un océan.
C’est généralement le mot de la fin de chaque appel. Son objectif est de faire réfléchir les auditeurs au sens des mots qu’il vient d’énoncer.
La soirée se poursuit ainsi toute la nuit jusqu’au lendemain, tard dans la matinée.
Pour nous, les trois enfants et le cousin Mahboubi, ce fut une soirée magique dont nous avons été les vedettes. En plus de la grande considération dont nous avons joui, nous avons reçu beaucoup de cadeaux. En particulier quelques pièces d’argent, que l’on offrait rarement et exceptionnellement aux enfants à cette époque. Nous ignorions tout de leur nom et de leur valeur.
La cérémonie de circoncision se déroule le lendemain. Un groupe d’une douzaine de femmes, dit el mahfel en chaoui, habillées pour la circonstance ont pour mission d’aller remplir la gassaa avec de la terre. Elles partent en procession, au milieu de la matinée, la plus âgée en avant et la gassaa sur la tête, jusqu’à un lieu situé à quelques centaines de mètres de la maison, en élevant un chant spécifique pour cette fête : Purifié, Ô toi le purificateur, ne blesse pas mon fils, je ne me fâcherai pas contre toi, tu ne te fâcheras pas contre moi… Ô toi purificateur, que Dieu protège tes mains, ne blesse pas mon fils…
El mahfel suivie de nombreux enfants qui forment un cortège en arrière, quelques hommes en gandoura et chèche blancs comme neige tirent des coups de feu en l’air au-dessus des têtes du groupe de femmes. Pendant ce temps, debout devant la maison, habillé pour la circonstance, j’observe le spectacle avec mes cousins, les yeux figés, confus, balançant entre la peur et la joie. Même ambiance au retour.
Toujours au son des chants, youyous d’allégresse et des tirs, la gassaa à présent emplie de terre et couverte d’un foulard bariolé est remise à un homme à qui incombe le rôle de la déposer à l’intérieur de la maison devant le tahar, le purificateur, qui doit alors procéder à l’opération de circoncision. Restées à l’extérieur, sur le pas de la porte, les femmes ne cessent de faire retentir leurs chants.
Vêtu d’une gandoura blanche, un foulard vert autour du cou, une chéchia de type osmanli d’origine ottomane, la paume de ma main rougie de henné posé soigneusement la veille, je suis installé par mon père et un proche, jambes écartées, à même la gassaa posée sur une maïda (table basse circulaire). Le tahar prépare ses ciseaux, sa poudre de pénicilline et son mercurochrome. Au moment où tout est prêt, mon père et plusieurs personnes assises autour me demandent de regarder vers le plafond, tandis qu’on m’incline le buste vers l’arrière en me tenant bras et jambes bien écartées. Tandis que je hurle, scrutant fiévreusement les gestes du purificateur, on lance en l’air un objet et quelques bonbons qui retombent sur ma tête afin de détourner mon attention. En quelques très longues et pénibles secondes, le prépuce se retrouve entre les mains du tahar. Gigotant, je pousse des cris de douleur stridents, pendant qu’il procède aux soins. À l’extérieur de la pièce, les chants incessants, les coups de feu et les youyous assourdissants redoublent d’intensité. Ce fut un cauchemar, une explosion, un feu d’artifice. Un peu de tout cela !
Même purgatoire pour mes cousins, que l’on avait éloignés le temps de ma circoncision. L’opération terminée pour chacun de nous, les femmes ramènent la gassaa d’où elles l’avaient remplie et dans la même ambiance, y procèdent à l’ensevelissement des prépuces.
La mort de Lilou
La convalescence dura quelques jours. Nous la vécûmes dans nos gandouras, tachées de sang et de mercurochrome et ayant adopté cette démarche bancale, les jambes écartées, caractéristique des enfants circoncis. Les moments les plus difficiles étaient ceux où nous devions uriner, en plus de ceux du nettoyage de la plaie maculée de sang séché, croûtes et coton collés autour la verge.
Dans cette ambiance de fête, préoccupé par les cadeaux que j’avais reçus et les douleurs de la blessure, j’avais oublié Lilou, mon fidèle compagnon, pourtant toujours dans mes pattes. Nous avions plusieurs chiens : Lilou, Messaoud, Merzoug, Beguel et Faxa. Faxa est probablement la déformation de fox-terrier. Elle fut notre dernière chienne, nous l’appelions Faxa. Ces chiens assuraient nuit et jour la garde de la maison et des troupeaux de moutons. Nous avions également un sloughi qui avait toujours l’air de s’ennuyer, n’ayant pas grand-chose à faire, sauf lorsque mon père l’emmenait à la chasse aux lièvres qui se cachaient dans les plants d’alfa qui couvraient les collines dispersées autour de notre douar. Parfois, en hiver, lorsque la neige était abondante, nous les attrapions à la main, bien vivants mais ne parvenant pas à se déplacer à cause de la neige.
C’est au troisième jour de la circoncision que mes parents m’annoncèrent la mort de Lilou. Ils l’avaient retrouvé mort dans une des pièces de la maison. Aussi triste que mes parents eux aussi très affectés, je ne parvenais pas à retenir mes larmes. De pelage noir et blanc, de petite taille, les yeux pétillants, le museau humide toujours en l’air, il manifestait sa joie d’être à mes côtés en agitant vivement la queue. L’été, haletant, la gueule ouverte et la langue pendante, il me faisait comprendre sa soif. Je m’occupais quotidiennement de le nourrir. Sa mort qui surprit tout le monde, nous plongea dans une grande perplexité : après avoir écarté l’éventualité de l’empoisonnement alimentaire, de la piqûre d’insecte ou la morsure de vipère, c’est la thèse de la frayeur due aux fortes détonations qui a emporté tous les avis. Les coups de feu nourris, lors de la soirée festive, ont entraîné sa mort. Mort de frayeur, pauvre Lilou !
Quelques jours après, ayant eu écho de commentaires satiriques sur la taille du prépuce du cousin adolescent, nous décidâmes de déterrer nos trois prépuces afin de comparer leur taille respective : celui du cousin était plus grand, de la taille d’une bague, tel que le décrivaient les commentaires ! Nous fûmes vigoureusement réprimandés par nos tantes et cousines pour notre acte, qui, nous menacèrent-elles, nous attirerait le mauvais sort.
Soixante-douze ans plus tard, pour la circoncision de mon petit-fils, Massyl, nous avons organisé une cérémonie familiale au même endroit, avec les mêmes chants et les mêmes pratiques traditionnelles, mais sans les coups de feu. Excepté aussi que la circoncision a été pratiquée par un chirurgien pédiatre, notre ami le Dr Hanouz. Je ne sais pas ce qu’il a fait du prépuce, j’ai oublié de lui poser la question.
L’espace
Pour ses déplacements, mon père partait à cheval ou à dos de mulet. Pour les longues distances, il voyageait en car, par exemple, lorsqu’il allait inspecter ses troupeaux qu’il acheminait l’hiver jusqu’aux pâturages qu’il louait dans la zone saharienne, à une cinquantaine de kilomètres de chez nous.
Je me souviens d’un voyage que nous avons fait ensemble à dos de mulet ; nous nous rendions chez un de ses amis dont il m’avait dit qu’il habitait de l’autre côté de la montagne Djehfa. J’étais curieux de découvrir ce qui s’y cachait.
Nous nous étions levés tôt le matin, par une matinée de fin de printemps. Il faisait déjà jour. Mon père chargea le mulet de différents cadeaux destinés à son ami, dattes, frik (blé vert grillé, séché et concassé)… Le mulet était de couleur grise, à l’instar de notre jument et de notre âne appelé « âne égyptien » pour sa grande taille. Le mulet était très docile, il baissait sa tête dès qu’on l’approchait, comme s’il voulait, par cette révérence, nous saluer et nous inviter à le monter. Afin de faciliter le chargement des objets pesants, mon père, par de petits coups lui faisait plier les rotules et rabaisser ainsi la hauteur de son dos.
Mon père monta le premier, puis me tendit la main et m’enjoignit de mettre le pied à l’étrier. C’était la première fois que je montais comme une grande personne. Je m’agrippai tranquillement des deux mains à son burnous. Après une distance sur un terrain relativement plat, nous arrivâmes au pied du mont Djehfa. Le mulet commença à escalader la montagne. Accroché à mon père, je ne cessais de me retourner pour regarder au loin notre maison qui s’éloignait tandis que lentement autour de moi, les paysages s’élargissaient à mesure que nous montions. Le mulet avançait, pas à pas, zigzaguant sur les sentiers sinueux. Nous atteignîmes le point culminant au milieu de la matinée, au pied du refuge de la Kahina, et nous y marquâmes une pause. De ce sommet, je découvris l’autre versant de la montagne : une étendue qui me sembla infinie : un autre horizon m’apparaissait, une plaine et au-delà, des collines. Je commençais à distinguer des maisons, des jardins. Quelle ne fut ma surprise, moi qui pensais que derrière les montagnes qui entouraient notre douar, c’était le néant et que le ciel était posé dessus ! Après cette halte, nous entamâmes la descente sur l’autre versant par une pente très inclinée, difficile et sur laquelle il fallait redoubler de vigilance pour ne pas tomber.
Nous arrivâmes chez notre hôte, une grande ferme entourée de jardins où poussaient différents légumes et quelques arbres fruitiers. Après force embrassades et après avoir ôté nos chaussures, on nous installa sous un arbre, sur une natte en alfa, adossés à des coussins. Informé par un messager rencontré au marché du village quelques jours auparavant, l’ami de mon père attendait notre visite. Un copieux repas nous fut servi : un couscous garni de légumes et de viande sèche que nous nommons khli‘ ou gueddid. Plus tard, avant notre départ, on nous servit, accompagné de l’ben (petit lait), un plat de r’fiss, une galette émiettée et mélangée à de la pâte de dattes, le tout malaxé avec du beurre fondu. Entre les deux repas, nous avons visité le jardin où nos hôtes avaient préparé à notre intention des couffins chargés de fruits et de légumes. Notre mulet, attaché à un arbre, ruminait tranquillement un mélange d’orge et d’avoine contenu dans une muselière qu’il secouait de temps à autre avec sa tête, signe qu’il avait fini sa ration et qu’il en réclamait une autre.
Le retour en fin de journée me fit prendre conscience des distances et surtout, fit naître en moi le désir de découvrir d’autres lieux. Pour le mulet, encore plus chargé qu’à l’aller, le chemin fut encore plus rude. Le soleil frôlait la chaîne des montagnes de Tamza, au moment où nous entamâmes la descente en direction de notre maison.
Mon père était un homme fidèle en amitié, c’est dire qu’il avait de nombreux amis. Nous, les enfants de la génération suivante, sommes restés très longtemps en contact avec leurs enfants, et ce en dépit des huit années de guerre. Malheureusement, les récents bouleversements sociologiques et économiques ont relâché nos relations ; quant aux générations actuelles, elles ne perpétuent plus ce lien entretenu par nos aïeux.
Après ce voyage, je n’eus de cesse d’imaginer le monde au-delà des montagnes ; il avait définitivement écarté le mythe selon lequel derrière elles, ne régnait que le vide et qu’il n’était pas posé au-dessus d’elles ainsi que je me l’imaginais jusque-là.
La vitesse et le temps
Je me souviens, mon père m’emmena dans la tournée d’inspection de ses troupeaux ; nous montâmes à bord d’un car que l’on appelait « Lambroze », du nom du propriétaire de la compagnie, ou de la marque du fabricant. C’était mon premier grand déplacement motorisé. Mon père connaissait l’heure du passage du car. Nous nous étions levés tôt et après avoir consommé un morceau de galette chaude tout juste préparée par ma mère et un verre de lait froid conservé dans thagchoulte (outre), nous rejoignîmes à pied, en longeant l’oued Laghrour, la route goudronnée qui passait à environ un kilomètre de chez nous : abrith n’el mitra, littéralement « la route du mètre », sans doute en référence aux bornes kilométriques qui la longeaient. Mon impatience de monter dans le car était telle que l’attente me sembla interminable, ma tête raidie dans la direction par laquelle il devait arriver, ne voulant rien rater de cette vision !
Enfin, il apparut. Un car bleu, et tellement chargé qu’il penchait de côté ! Mon père lui fit un signe de la main pour l’arrêter. Plus il approchait, plus le bruit du moteur emplissait l’air et m’émerveillait. J’aimais jusqu’à l’odeur des gaz d’échappement, pour moi signes de modernité !
Le porte-bagage du car croulait littéralement sous les couffins, sacs, et même tentes, déposés pêle-mêle mais solidement arrimés. À l’intérieur, le car était plein, hommes en burnous, femmes et enfants assis au sol au milieu de paniers de toutes sortes, sacs de semoule, ustensiles de cuisine, poules ligotées, le tout enchevêtré sur le plancher. Il n’y avait plus de places assises, mon père réussit à se coincer à l’arrière du côté de la fenêtre et m’installa sur ses genoux. J’étais impressionné par le bruit du moteur et surtout par la vitesse. Les paysages défilaient à une allure saisissante. À travers la vitre, je distinguais les maisons, les caravanes des nomades, les paysans à dos d’ânes ou à pieds, les bergers et les bergères. Certains accouraient pour voir passer le véhicule de près et nous faire des signes de la main, tandis que je me sentais fier d’être dans le car et ne voulais rien perdre du spectacle.





























