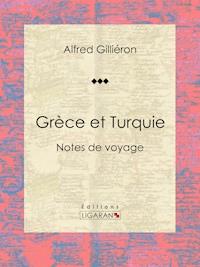
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "J'arrive de bon matin à Trieste, le 3 juillet 1876, moulu par quarante-huit heures de chemin de fer et complètement épuisé par la chaleur et l'insomnie. Deux heures me suffisent à grand-peine pour rejoindre mon compagnon de voyage, prendre mon billet et faire visiter mon passe-port au consulat turc..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076042
©Ligaran 2015
Et dans l’informe bloc des sombres multitudes, La pensée, en rêvant, sculpte des nations.
V. HUGO.
Après quarante-cinq années d’un développement lent, mais sûr, interrompu seulement par ces agitations intérieures qui sont le lot de la Grèce moderne aussi bien que de la Grèce antique, le royaume hellénique semble se préparer à tenter la fortune des combats et à reprendre vigoureusement le glorieux programme de l’unité nationale, ébauché en 1821 par l’épée des Mavromichalis, des Colocotronis, des Karaiskakis et les brûlots vengeurs de Canaris. La lutte des Slaves et des Turcs va se compliquer à bref délai d’une lutte tout aussi ardente des Grecs contre les Turcs. Quelle que soit l’issue de la guerre qui ensanglante dès maintenant la péninsule du Balkan, il serait chimérique d’espérer qu’elle tranche définitivement la question d’Orient, ou plutôt les mille problèmes politiques et sociaux qui se cachent sous ce terme de convention. Quand même les Turcs seraient expulsés du continent européen, des îles de l’Archipel et peut-être de l’Asie antérieure, quand même l’obstacle qui arrête l’essor de la civilisation serait définitivement brisé, il resterait encore à accomplir la partie la plus laborieuse de la tâche, je veux dire la reconstitution matérielle, morale et intellectuelle des nationalités roumaine, serbe, bulgare, grecque, albanaise et arménienne, qui font de la presqu’île hellénique une véritable Babel et préparent tant de mécomptes aux diplomates présents et à venir. La solution politique, c’est-à-dire l’affaiblissement graduel ou la suppression de la suprématie turque, peut être obtenue à coups de canon, elle viendra à son heure, plutôt trop tôt que trop tard ; mais, pour avoir toute sa signification, elle devra être suivie d’un lent travail de reconstruction et d’une lente évolution qui rendront peu à peu aux peuples de l’Orient émancipé l’activité matérielle et les qualités morales des peuples vraiment libres. Tout fait donc prévoir que longtemps encore l’axe du monde politique restera penché vers l’Orient, et que notre génération et celle qui nous suivra verront se passer bien des années avant que les déserts turcs, où le corps, l’esprit et l’âme se meurent d’inanition, soient redevenus des pays libres, riches et forts. En un mot, la question d’Orient n’est pas une question purement politique, comme l’étaient jadis la question italienne et la question allemande : c’est une question qui intéresse avant tout la civilisation et l’avenir de l’Europe ; à ce titre, elle relève plus directement que toute autre de l’opinion publique, qui a elle-même le devoir de s’éclairer et de se former sur tous les points en discussion des vues nettes et libres de parti-pris. Toutes ces raisons nous encouragent à présenter au public nos notes de voyage sur la Grèce et la Turquie ; il y trouvera, croyons-nous, des renseignements utiles sur la situation des Grecs soumis à la Turquie et sur les progrès accomplis par la Grèce indépendante ; peut-être aussi la fidélité scrupuleuse des descriptions et des récits compensera-t-elle ce qui pourrait manquer du côté de l’art à nos tableaux.
Quiconque voyage dans les pays qui furent jadis la Grèce, est nécessairement sous le charme des souvenirs antiques ; parti deux fois pour ces contrées avec un de mes frères pour compagnon de voyage, dans le but exclusif d’étudier sur place le passé, j’ai nécessairement accordé dans mes études et dans mes descriptions la place d’honneur à la poésie des souvenirs. Qu’on ne s’y trompe point pourtant : cette poésie est bien souvent la poésie de la désolation ; la civilisation hellénique, une fois disparue, il n’y a eu d’autre œuvre accomplie sur cette terre que celle de la mort et de la destruction.
La Thessalie n’a pas gardé une seule colonne debout ; l’Épire n’a que de vieilles forteresses sans nom et sans histoire, la Grèce proprement dite n’a conservé, de ces milliers de sanctuaires qui la peuplaient encore au temps de l’empereur Adrien, que les débris mutilés de l’Acropole, de Sunium, de Corinthe, d’Egine et de Phigalie. Mais qu’importe ! si la pierre et le bronze ont péri, l’immortelle nature, elle, n’a point trop souffert des injures du temps : les siècles n’ont point renversé ces montagnes de fière tournure sur lesquelles se promène encore silencieusement le soleil de la Grèce, ils n’ont point flétri la beauté immaculée et le sourire éternel de cette mer féconde qui a engendré les immortels Amours et les premiers héros de la poésie ; enfin ils n’ont point désappris leurs murmures à ces sources où les nymphes ondoyaient au soleil, et, aujourd’hui, comme il y a vingt siècles, le pâtre entend retentir, la nuit, sur l’acropole solitaire, la voix libre et fière de ceux qui furent ses ancêtres. Pour qui sait voir et entendre, la Grèce antique n’est pas morte, et sous chacun de ses pas le voyageur voit refleurir, avec leurs fraîches couleurs et leur suave parfum, ces mythes, ces légendes, ces grands paysages et ces grands faits qu’il ne connaissait que pour les avoir vus desséchés et sans vie dans le grand herbier de l’histoire.
Heureusement la Grèce n’est pas seulement une nécropole où les morts pensifs reprennent pour un instant l’attitude des vivants aux lueurs enchantées de la poésie et de la science. Tandis que les temples en ruines, les montagnes fauves et blêmes semblent porter sur leur front attristé l’arrêt suprême du destin : Tout est fini, dans les bourgades, dans les villages et dans les villes on entend au contraire retentir une clameur toujours plus claire et toujours plus distincte, et cette clameur nous dit : Tout recommence. La Grèce assez longtemps a pleuré le myriologue des veuves ; son glorieux époux, le génie de la liberté, va lui être enfin rendu ; si les dieux antiques sont impuissants, elle implorera les divinités nouvelles, et si les Parques ont épuisé la trame de ses jours, Dieu lui-même lui filera un nouveau destin.
Nous avons essayé de prêter l’oreille aux deux voix et de recueillir, à côté des complaintes que l’âme mélancolique de notre siècle aime à redire sur les morts illustres, quelques effusions de cette âme ardente, à peine formée, qui palpite dans le sein des multitudes confuses. Dans les longues heures de chevauchées solitaires, nous aimions à oublier notre prosaïque Occident, où tout se flétrit, où tout vieillit, pour redevenir un fils de l’Orient, sentir monter à notre cœur tout ce flux audacieux de sentiments généreux, de lointaines aspirations, de vastes pensées qui font battre l’âme rajeunie de tant de peuples nouveaux. Peut-être le lecteur nous reprochera-t-il d’avoir trop écouté les sourdes clameurs des prochaines révolutions et de nous être ainsi exposé à montrer trop de complaisance pour les revendications des peuples de l’Orient et trop peu de respect pour les droits historiques et pour les convenances de la diplomatie ; on nous traitera sans doute d’idéologue et on nous accusera de faire de la politique de sentiment. Nous ne croyons pas devoir nous préoccuper, outre mesure, de ce reproche, puisque les révolutions politiques de notre siècle ont presque constamment donné raison aux prétendus rêveurs, et nous nous contenterons de donner au lecteur quelques courtes explications sur notre façon de juger la question grecque.
Sans aller aussi loin que l’honorable M. Gladstone, qui ne veut voir dans les Turcs qu’un spécimen antihumain de l’humanité, nous sommes néanmoins fermement convaincu que l’islamisme, très suffisant pour les besoins religieux d’une demi-civilisation et d’une société patriarcale, ne saurait s’accommoder de la vie moderne ni par conséquent garder longtemps la suprématie sur cet Orient chrétien que l’Occident attire chaque jour davantage dans le cycle de sa civilisation ; mais si l’Orient ne doit pas rester turc, il ne doit pas non plus devenir russe : pour nous, les véritables héritiers des Turcs sont les anciens possesseurs du sol, les Slaves au nord, les Gréco-Albanais au sud. Établie en masses compactes dans l’Épire, où elle s’assimile sans peine les Albanais ou Chkipétars chrétiens, dans la Thessalie, sur l’île de Crète et dans tout l’Archipel, la race grecque a jeté, en outre, des colons nombreux sur les côtes de la Macédoine et de la Thrace, de l’Asie-Mineure, de la Mer de Marmara et de la Mer Noire ; c’est à elle qu’appartient, sans contestation possible, le bassin de la Mer Égée ou de l’Archipel, qu’elle remplit depuis plus de trois mille ans du bruit de son activité, de ses chants et de sa gloire. Restée fidèle à sa foi et à sa langue, en dépit des Goths, des Bulgares, des Francs, des Albanais et des Turcs, elle a montré une vitalité et une ténacité dans l’espérance, qui sont peut-être uniques dans l’histoire, et elle peut à bon droit espérer une seconde vie. Maîtresse des mers et du commerce de l’Orient, comme au temps de Cimon et de Périclès, la race grecque a su garder jusqu’à nos jours la plupart des qualités qui firent jadis sa fortune. Encore aujourd’hui le Grec l’emporte sur tous les Orientaux par la finesse et la subtilité de l’intelligence, par le goût des entreprises commerciales et le génie industrieux avec lequel il se joue de toutes les difficultés ; il a de plus le vif sentiment de l’égalité et le goût de ces associations où chacun apporte sa part de travail ou d’argent ; il n’a que de la répulsion pour les plaisirs grossiers et l’intempérance, qui font tant de ravages chez les peuples du nord ; enfin il s’honore par la pratique des vertus domestiques et se distingue presque toujours par un patriotisme ardent qui court au-devant de tous les sacrifices et corrige souvent ce qu’il y a d’égoïsme et d’instinct par trop individualiste dans le caractère national. Il nous semble qu’un peuple qui a gardé dans le malheur une confiance si inébranlable dans ses destinées et qui se montre encore aujourd’hui doué d’aptitudes si diverses, mérite de vivre et ne saurait périr à l’heure où l’Orient s’ouvre à la vie ; telle est la conviction qui anime ces études, même dans les pages où nous avons dû, pour rester fidèle à l’esprit d’impartialité, qui est notre règle absolue, parler sans ménagement des gouvernants actuels de la Grèce et de tout ce qui retarde l’affranchissement des Hellènes de l’Épire, de la Thessalie et de l’Archipel.
Il nous reste encore quelques mots à dire sur les lacunes volontaires que l’on pourra constater dans les pages que nous consacrons à la Grèce. Si nous n’avions pas tenu à rester fidèle à notre qualité d’auteur itinérant, et si nous n’avions pas eu pour unique ambition de peindre rapidement la Grèce telle que la voit, et, si possible, telle que la sent le voyageur qui la parcourt au pas de son cheval, nous aurions aimé nous étendre davantage sur l’histoire des Grecs modernes, parce qu’elle aurait pu servir à justifier, plus que nous ne l’avons fait, nos espérances. Notre génération est décidément dure aux faibles, elle se pique de plus d’être positive et regarderait presque comme une honte tout accès d’enthousiasme. Aussi n’est-il plus guère de mise aujourd’hui d’être ami des Grecs ; notre génération a depuis longtemps oublié que tous ses pères étaient philhellènes ; elle n’a plus que de l’indifférence pour le sort des Grecs esclaves et elle professe un mépris de grand seigneur pour le microscopique royaume que l’opinion publique de l’Europe a jadis créé. Nous croyons avoir montré, dans le cours de nos récits, que si le royaume grec n’est point encore ce qu’il devrait être, il n’en a pas moins fait de grands progrès ; quant à la vitalité de la race elle-même, elle nous semble surabondamment prouvée par tout ce que nous disons de son activité commerciale et intellectuelle, et surtout par ce que nous aurions pu dire de son histoire, si nous avions eu un autre plan et plus d’espace. À la fin du siècle passé, la race grecque passait pour morte, mais elle vivait toujours, subissant avec une héroïque résignation sa passion vingt fois séculaire et perdant à chaque pas de son chemin de douleur quelques gouttes de son sang le plus généreux ; noble captive, elle eût pu alléger son sort en reniant sa race et sa foi ; mais le parjure lui eût plus pesé que la couronne d’épines. Enfin, fortifiée par les lointains ressouvenirs du temps où elle était libre, enflammée par les chants qu’elle se redisait depuis longtemps tout bas, elle brise ses chaînes et fait pâlir celui qui l’insultait ; au mois d’avril 1821, elle sort de la nuit de l’oubli, comme Pallas jaillit des nuages noirs, une épée dans une main, une lyre dans l’autre. Alors se déroule une épopée grandiose, qui a la Grèce entière pour théâtre et le peuple tout entier pour héros ; cette épopée, écrite en traits flamboyants sur les rochers et les mers de la Grèce par les épées des Klephtes et les brûlots des croiseurs, a trouvé son Homère, Homère plus naïf encore et plus fidèle que ne le fut le chantre d’Achille ; cet Homère, c’est la muse populaire qui, après avoir pendant longtemps nourri dans l’âme de la nation le culte silencieux de la patrie absente, a enfin, au jour de la victoire, fidèlement posé sur la tête des héros la couronne des vainqueurs. On le voit, aux preuves directes et positives que nous avons recueillies sur notre chemin, il serait facile d’ajouter des preuves morales tout aussi frappantes, que nous trouverions dans les hauts faits des héros des guerres d’indépendance et dans la mâle simplicité des chants qui les illustrent. Niebuhr avait raison de prophétiser au peuple grec un grand avenir, sur la simple lecture de ses chants nationaux : un peuple ne saurait avoir tant d’ardeur patriotique et tant de sensibilité poétique, une âme si profonde et une lyre si sonore, s’il n’était point réservé d’ores et déjà à de grandes destinées.
L’AUTEUR.
Neuchâtel, le 15 août 1877.
J’arrive de bon matin à Trieste, le 3 juillet 1876, moulu par quarante-huit heures de chemin de fer et complètement épuisé par la chaleur et l’insomnie. Deux heures me suffisent à grand-peine pour rejoindre mon compagnon de voyage, prendre mon billet et faire visiter mon passeport au consulat turc. À dix heures, la Naïade levait l’ancre et nous emportait au travers du beau golfe de Trieste. L’air de la mer opère vraiment des merveilles : au bout d’une heure j’étais remis et j’aspirais avec une volupté tranquille la brise de l’Adriatique.
J’ai beau avoir pris la volée et dit adieu pour longtemps aux salles de cours, les souvenirs classiques me poursuivent. En face de cette mer si pure et si belle, j’ai peine à comprendre ces vers où le poète Horace chante le vrai sage, impassible devant les fureurs de l’Adriatique et du vent d’Afrique qui soulève et rasseoit à son gré les flots ; l’amour des contrastes me fait retrouver ces monts Acrocérauniens du poète, tristement fameux par tant de naufrages, et ces époux retenus par les tempêtes sur les rivages illyriques pendant tout l’hiver. Aujourd’hui la vapeur a dompté l’Adriatique aussi bien que l’Océan ; les Acrocérauniens ont perdu leur sinistre renommée et Amphitrite est, comme nous, soumise à la loi inexorable des horaires.
Mais c’est en vain, semble-t-il, que les flots de cette mer ont été enchaînés par les hommes ; l’Adriatique reste orageuse ; le jeu désordonné des éléments y a été remplacé par le jeu non moins terrible des énergies nationales, liguées les unes contre les autres et luttant pour l’existence et pour la suprématie. Le sceptre romain, qui domptait plus facilement les peuples que les flots et qui pesait avec une égale autorité sur l’Istrie, la Liburnie et l’Illyrie, semble un instant avoir passé dans les griffes du lion de saint Marc. Mais Venise, comme une nouvelle Carthage, se contente d’exploiter ces rivages et refuse d’y laisser croître des peuples. Au XVe siècle, les Turcs viennent s’asseoir en vainqueurs au milieu des Slaves, des Albanais et des comptoirs de Venise, tandis qu’au commencement de notre siècle les Habsbourg étendaient la puissante envergure de leur aigle sur les rivages du nord. Aujourd’hui, plus que jamais, l’équilibre historique est rompu ; les aspirations nationales, brisées d’abord par la lutte, puis ensommeillées par de dures oppressions, secouent en se réveillant les assises des vieux empires ; ce qui était la faiblesse hier, devient aujourd’hui peut-être la force, et la Némésis de l’histoire semble vouloir reprendre son jeu sinistre qui fait et défait les empires.
À partir de Trieste et de son sévère encadrement de montagnes, la côte se déploie vers le sud en larges rubans verts, légèrement ondulés et d’un dessin gracieux ; c’est l’Istrie, semée de jolies villes à physionomie italienne. Voici, au bout du triangle istrique et au fond d’un golfe bien dissimulé, la rade de Pola avec son amphithéâtre romain, rival dédaigneux des grandes casernes qui l’entourent. Sa haute façade grise, percée de grandes baies ornées de fines moulures, est d’une conservation admirable. Le Colisée est sans rival pour la fierté de sa grande silhouette rougeâtre et la poésie de ses gradins rompus et chargés de fleurs ; l’arène de Vérone a pour elle la beauté de sa cavée intacte, celles de Capoue et de Pouzzoles l’heureuse conservation de leur structure interne ; l’amphithéâtre de Pola l’emporte sur tous pour la légèreté et la hardiesse avec laquelle se découpe dans le ciel bleu son vaisseau immense. À côté de ce monument funèbre, où revivent les pompes sanglantes de l’ancienne Rome, l’industrie moderne a élevé d’immenses officines de canons qui peuvent consoler la Mort de la perte des amphithéâtres romains.
Au sortir du quartier où l’amphithéâtre s’étonne de voir grandir autour de lui tant de sinistres arsenaux, vous n’avez qu’à suivre le rivage dans la direction du sud-ouest pour vous trouver dans l’antique Pola, dont la grande place ménage au voyageur une autre surprise presque aussi rare ; on y voit deux temples romains, dont l’un, presque intact, a un portique qui est du temps et du style du grand Panthéon de Rome. Quant à l’importance de la cité, elle est restée ce qu’elle était au siècle des temples et des amphithéâtres ; dans cette ville de fonctionnaires et de soldats, l’Autrichien ou Tedesco a remplacé le légionnaire romain d’autrefois. Ici l’Italien, fils ou colon de Venise, est l’intermédiaire entre l’Autrichien et le Slave indigène. Tandis que l’Autrichien gouverne et commande avec une certaine bonhomie germanique, l’Italien peuple les villes et cherche à leur conserver la culture latine ; peut-être même, prévoyant la suprématie prochaine du Slave, rêve-t-il l’annexion à l’Italie pour un jour plus ou moins lointain. Quant à l’homme du pays, au Slave des campagnes, il est en général du parti autonome et membre des citoniskas ou clubs pour la propagation des idées et de la langue slaves ; Agram est son Athènes, et un royaume tri-unitaire slavo-croato-dalmate, au sein ou mieux encore en dehors de l’Autriche, est le passé qu’il rêve pour son avenir.
J’ai longé presque tous les rivages de la Méditerranée, de Beyrouth à Gênes ; mais je ne connais pas de plus charmante navigation que celle de Trieste à Corfou par le bateau de la ligne d’Albanie et par les journées d’été comme celle que nous voyons se lever aujourd’hui. Vous avez beau être en plein juillet ; le soleil et la brise marient si bien leurs influences contraires, que vous êtes mieux à l’abri du chaud que dans nos montagnes suisses. Et puis, quelle variété de tableaux successivement déroulés devant vos yeux, grâce à cette sage lenteur du vapeur autrichien qui salue en passant chaque bourgade et dépose dans chaque crique quelques voyageurs et quelques dépêches ! Nulle part on ne perd de vue ni les hommes, ni la terre, et l’on n’est jamais saisi de ce vague ennui et de cet incurable désœuvrement qui sont inséparables des grandes traversées.
À partir de Pola, la côte se dérobe derrière plusieurs rangées d’îles tortueuses qui n’ont pas la finesse de contours ni la plastique structure des îles grecques, mais qui n’en donnent pas moins une grande variété aux paysages. Zara, l’antique colonie romaine d’Iadéra, reconnaissable de loin à ses campaniles romans coiffés de clochers pointus, est le lieu de destination d’une dizaine de fonctionnaires et d’officiers qui font route avec nous depuis Trieste. Le vapeur touche à la côte, et l’on n’a que la peine de passer sous la vieille porte qui a vu les croisés de l’Occident, pour se trouver dans une des plus pittoresques cités de l’empire autrichien. Les rues, assez propres et pavées de larges dalles, sont émaillées des costumes les plus bizarres ; les carrures slaves des jeunes filles sont encadrées dans des chemises bouffantes et de courts corsets noirs qui rappellent les costumes bernois, tandis que les campagnardes des environs se distinguent par l’épaisseur de leurs tabliers bariolés et le pourpre un peu défraîchi de leurs gros bas. Les hommes, qui ont la taille robuste mais sans élégance, portent déjà des pantalons bleus serrés au-dessus de la cheville, des vestes de couleur et un fez rouge mais plat. Nous remontons à bord après avoir goûté le fameux maraschino, qui donne à la moderne Zara une célébrité que lui conféraient autrefois les nombreux savants nés dans ses murs. Le port présente depuis quelques minutes une animation extraordinaire ; bientôt les harmonieux accords du Kaiser Frantz ébranlent l’air ; deux compagnies de honveds hongrois, aux uniformes bleus et aux pantalons rétrécis vers le bas, défilent prestement devant le général croate Rodich, gouverneur de la Dalmatie. Rodich est, comme l’on sait, un fougueux ami des Slaves, et bien qu’on l’accuse maintenant d’avoir compromis l’Autriche par l’appui qu’il a donné aux insurgés, Vienne le maintient à son poste pour donner un gage de sa bonne volonté au parti slave ou autonome. Les chapeaux empanachés de plumes vertes disparaissent avec le général, la musique nous envoie ses derniers accords au moment où nous voguons déjà du côté de Sébénico avec deux compagnies de soldats et douze officiers.
Un regard complaisant discerne dans le lointain les montagnes de l’Herzégovine ; aussi les conversations prennent-elles un tour de plus en plus guerrier, à mesure que nous avançons vers le sud. À part un prudent officier autrichien plongé dans la lecture des Folies de jeunesse, de Belot, tout le monde cause de la guerre qui vient d’éclater comme une bombe. L’équipage, qui est dalmate, est du parti des omladines ou des jeunes Slaves ; tout ce qui tient au gouvernement louvoie, les correspondants de journaux sont partagés d’avis, suivant qu’ils s’en vont au camp turc ou au camp monténégrin ; enfin les belligérants eux-mêmes ont deux représentants au milieu de nous, un colonel serbe, qui a été, il y a peu de temps, ministre de la guerre et s’en va en mission à Cettinje, et, à côté de lui, un médecin turc de haut grade, qui revient de Trieste, où il a acheté des farines pour l’administration militaire de Scutari ; tous deux sont polyglottes et sont assez hommes du monde pour ne point s’éviter et pour causer sans embarras de sujets neutres.
De temps en temps, quand la conversation languit ou que la présence d’un des belligérants nous force à fuir les actualités, je me penche sur le parapet, je suis de l’œil les larges sillons neigeux que laisse derrière elle la poupe du navire ; je contemple avec je ne sais quelle émotion tragique cette mer infortunée et rugissante que laboure sans relâche le soc implacable de l’hélice ; mon imagination fascinée évoque devant elle les fantômes des héros antiques, et je finis par tirer une sorte de vague jouissance des triomphes de la jeune Naïade qui nous emporte au travers des mers vaincues.
Sébénico, où nous touchons le soir du second jour, est en tout le portrait vivant d’une ville du XVIe siècle. Les lettres arrivées avec notre bateau s’y distribuent en plein vent au pied de la cathédrale ; les rues sont toutes pavées de grosses dalles, tortueuses, mais assez propres, du moins le dimanche ; les maisons, bâties avec un calcaire jaune, sont bordées de balcons grillés, criblées d’écussons et encore emprisonnées dans la carapace qui enserre la ville ; la plupart de ces cités dalmates semblent avoir été arrêtées tout à coup dans leur développement par la décadence de Venise, et c’est à peine si le XIXe siècle commence aujourd’hui à les toucher.
Spalato, notre seule station du troisième jour, est, en tout l’opposé de Sébénico. Si Sébénico a le cachet d’une ville du moyen-âge, Spalato a des ruines romaines et une activité toute moderne. Les thermes de Caracalla eux-mêmes pâliraient devant ce grand palais de Dioclétien, vaste ruche humaine où s’abritent quatre mille personnes, immense conglomérat de maisons dont les fenêtres vulgaires s’étalent insolemment au milieu de la magnificence dégradée des pilastres romains. Non loin de là, les innovations modernes sont représentées par un très grand hôtel, encore en construction, et par de grands chantiers ; grâce au podestat Bajamonte, chef du parti italien, qui est pour la ville un vrai Haussmann, mais un Haussmann désintéressé, Spalato, qui a déjà son journal et son musée, aura bientôt un grand port, un hôtel-de-ville, une gare et une voie ferrée qui la reliera avec l’intérieur.
Le lendemain, mardi, nous jouissons, dès le matin, du coup d’œil de Raguse et de sa rade de Gravesa, qui est un des plus surprenants que présentent les rivages de l’Adriatique. Comme sur les côtes du Bosphore, la mer s’enfourche dans les terres et y dessine des cornes d’or que dominent les imposantes masses des rochers herzégoviniens : plus l’on s’avance, plus l’enchantement grandit. Les oliviers, qui tapissent partout les piédestaux des monts, font place sur les pentes aux sombres caroubiers, aux plantureux mûriers, aux vignobles gracieux et aux charmantes villas qu’ont illustrées des poètes slaves comme Gondolich. Plus haut, hélas ! il n’y a plus que la guerre, le désespoir, la maladie et l’isolement : en effet, sur les croupes aérées des monts, l’œil découvre de véritables camps retranchés, où les filles et les femmes de l’Herzégovine attendent en vain la fin de l’exil et le retour d’un frère ou d’un époux. Bien que le présent, avec ses spectacles tragiques et ses angoissants problèmes, fasse nécessairement tort au passé, souvenons-nous pourtant que nous sommes ici en face d’une grande destinée historique, unique sur cette côte, où une puissante vie nationale a toujours fait défaut. Raguse (qui le croirait !) a été la rivale de Venise ; elle a armé des flottes et conquis le prestige plus rare d’une puissante culture littéraire ; enfin, elle a péri à la même heure et par les mêmes causes que Venise. Aujourd’hui, acculée qu’elle est au pied des déserts turcs, elle semble y pleurer sa grandeur passée.
D’alertes landaus conduisent le voyageur à travers un petit col de montagne de Gravesa dans la Venise slave ; la route court parmi des bois d’oliviers, au pied de rochers fleuris et au-dessus d’une mer de saphir. Avant d’entrer dans la ville, vous mettez pied à terre sous de magnifiques arbres ; vous franchissez un pont-levis et une double ligne de remparts, et vous embrassez tout à coup et d’un seul coup d’œil ce qui reste aujourd’hui de la Raguse d’autrefois. La rue principale ou stradone est longue de six cents pas, large et dallée, bordée de hautes constructions en pierres de taille jaunes. Spectacle bizarre dans une ville à demi turque ! c’est à peine si l’on rencontre çà et là quelques hommes isolés, tandis que les femmes, coiffées de grands mouchoirs, forment à tous les coins de rue des groupes pittoresques. En somme, la ville est assez animée, mais elle le serait davantage si la guerre ne s’était pas déplacée vers le sud, et si le typhus n’étendait pas sur la cité son voile funèbre. Nous sommes aux portes de la Turquie : aussi faisons-nous fondre des balles pour nos revolvers ; mais nous négligeons de prendre avec nous un engin tout aussi meurtrier et tout aussi indispensable : la poudre insecticide qui se tire d’une fleur jaune, commune dans les champs d’alentour. Au sortir de la ville, où nous n’avons pu visiter en détail ni le palais des doges, ni les églises qui y sont aussi nombreuses que dans les villes italiennes, un vieillard octogénaire nous accoste et nous demande si nous sommes Français ; les Français, nous dit-il, sont restés chers à plus d’un Ragusain ; pour moi qui les ai vus, ce sont mes amis ; mais j’ai oublié leur langue que je ne parle plus depuis soixante ans.
La Naïade est sans pitié ; son sifflet aigu nous rappelle, au moment où nous nous disposions à visiter la belle route de Trébigné et le camp des réfugiés herzégoviniens, ou plutôt encore les rives charmantes de l’Ombla et l’îlot rocheux de Croma. Il ne nous reste plus qu’à adresser un adieu plein de regrets aux fiords de Gravesa et à laisser errer nos regards émus sur ces tristes sommets derrière lesquels tant de Slaves combattent aujourd’hui pour le sol de leurs montagnes, en attendant que le jour vienne où ils pourront s’asseoir sur la côte et faire de Raguse leur Ancône.
L’intérêt du voyage grandit à mesure que nous pénétrons plus avant dans le champ de bataille où se débattent depuis tant de siècles les destinées de l’Orient ; déjà les sons slaves résonnent de tous côtés à nos oreilles, tandis que les longues redingotes blanches et les vestes brodées des Monténégrins font leur apparition à côté des costumes plus simples et plus pacifiques du Canalese.
Vers quatre heures du soir, nous entrons dans ces fameuses Bouches-de-Cattaro qui baignent à la fois les arsenaux turcs de la Sutorina, les castels autrichiens de Castel-Nuovo et de Cattaro, et les grands piédestaux des chaînes monténégrines. Nous savions que les Bocche étaient pittoresques, mais notre attente est singulièrement dépassée. Une fois les passes d’entrée franchies, les Bouches se présentent comme un dédale de fiords, ou plutôt comme un véritable lac suisse, divisé, comme celui des Waldstætten, en cinq bassins, mais avec quelque chose de plus âpre dans les sommets dénudés et quelque chose de plus doux et de plus clair dans les teintes du rivage. Ici, comme sur notre lac, la gradation du pittoresque est continue ; le dernier bassin, celui de Cattaro, est de beaucoup le plus saisissant. Immédiatement au-dessus de nos têtes se dresse la première chaîne monténégrine ; c’est une véritable Gemmi suspendue sur la mer et sillonnée par un chemin aussi audacieux que celui qui va de Louëche au Schwarenbach. Au-delà se déploient les cirques alpestres du Monténégro, qu’on a pu appeler avec raison la Suisse de l’Orient, Suisse plus montagneuse encore que la nôtre, puisqu’elle est barricadée en tous sens par des cloisons complètement fermées, et surtout plus isolée et plus inattaquable encore, puisqu’elle n’a absolument aucune issue sur la mer dont la séparent des glacis hauts de mille mètres. Les Monténégrins disent qu’au jour de la création, Dieu passa dans les cieux en tenant par la main un sac plein de montagnes et que le sac tomba par un fâcheux hasard et se vida sur la Montagne noire. Comme la Suisse, le Monténégro a été un boulevard de liberté, une aire imprenable pour les fils indomptés de la montagne. Son histoire débute comme celle de la Suisse et juste un demi-siècle plus tard, soit en 1391. Les Monténégrins ont été moins heureux que nos pères ; malgré leur vaillance, ils sont encore, après cinq siècles, confinés dans leurs montagnes, et leurs guerres offensives contre leur ennemi héréditaire n’ont été, jusqu’à présent, que des tchétas ou razzias. Tandis que nos pères n’avaient à combattre qu’un suzerain lointain, faiblement appuyé par ses vassaux, les Monténégrins ont eu affaire à de puissants pachas établis à leurs portes et servis par le fanatisme musulman et albanais. Les guerriers de la Tzernagora réussiront-ils aujourd’hui à briser le cercle de fer qui les étreint et à conquérir enfin un port et des champs ?
Après avoir jeté un coup d’œil rapide dans les rues tortueuses de Cattaro et sur ses palais vénitiens un peu défraîchis, nous nous attablons dans une bonne locanda pour faire un dernier repas à l’européenne avant d’entrer en Turquie. J’entame une discussion sur ces vaillants Monténégrins, que leurs adversaires appellent avec mépris des coupeurs de nez, et je romps bravement une lance en leur faveur avec le capitaine Pizziferra, correspondant de la Gazette de Turin. L’excellent capitaine est un ancien réfugié de Modène, un reduce de Novare, d’Inkermann et de Solférino ; il a suivi, l’an passé, les insurgés de l’Herzégovine, et se dirige maintenant vers le camp turc de Podgoritza ; pour lui, l’insurrection est uniquement le fait des Russes ; or, les Russes sont restés ses ennemis depuis la guerre de Crimée. J’essaie en vain de le gagner à la cause slave par tous les arguments que me fournit sa propre histoire, qui se confond avec celle de l’ltalie. Je lui rappelle les souffrances et les témérités des premiers patriotes italiens, conspués par toute l’Europe, l’héroïque folie de Novare, puis, dix ans plus tard, la soi-disant démence de quelques-uns devenant le cri de guerre de la nation et le programme des souverains étrangers. Les Serbes et les Monténégrins vont peut-être au-devant d’un Novare ; mais qu’importe ! après Novare vient Solférino ! – Comme à Raguse, je retourne à bord avec d’amers regrets ; si j’avais trois jours, je courrais à Cettinje et j’y verrais un peuple se levant en masse, comme on se levait chez nous aux jours de Morgarten et de Morat ; malheureusement mon itinéraire est irrévocablement fixé, et le bateau part dès l’aube du lendemain. Sur le port, nous heurtons du pied de pauvres pèlerins monténégrins qui dorment à la belle étoile ; ils iront le lendemain dans une grotte voisine implorer l’appui de la Vierge toute-puissante contre le Croissant détesté ; pour eux, comme pour les Grecs de 1821, la guerre contre les Turcs est une guerre de religion. Longtemps encore la grue du navire poursuit dans la nuit son bruyant travail ; pour nous, tandis que les étoiles scintillent dans le ciel et que la lune éclaire vaguement les escarpements perpendiculaires du golfe, nous songeons à ceux qui veillent là-haut dans la montagne, l’arme au poing, en attendant que le soleil de la victoire et de l’indépendance se lève enfin sur eux.
Le mercredi matin, à notre réveil, nous trouvons le navire dépeuplé comme par enchantement ; c’est le voisinage de la Turquie qui se fait déjà sentir. Nous n’avons guère pour compagnons de voyage que quelques volontaires autrichiens qui rentrent dans leur province, c’est-à-dire à Budua, à l’appel de leur gouvernement. Leur physionomie est intéressante et leurs pittoresques costumes n’ont pas eu le temps de se défraîchir en Herzégovine, dans une campagne qui n’a duré que quelques jours. Leur chef excite dès l’abord notre sympathie par l’énergique beauté de ses traits et la douceur de son regard, où se lisent de patriotiques angoisses. Nous passons bientôt devant les villages qui forment le port de Spizza, tant convoité par la Montagne noire : Spizza ou une pauvreté et une barbarie éternelles, tel est le dilemme qui se pose pour le Monténégro. Si les Russes, un moment maîtres de Cattaro, l’avaient donné à leurs amis les Monténégrins, il y a quelque soixante ans, la Montagne noire serait aujourd’hui civilisée par le commerce et par l’industrie. Nous stoppons assez loin de la côte, dans le voisinage d’un grand bâtiment du Lloyd arrivant de Constantinople avec plus de mille Monténégrins, jardiniers et maçons, qui reviennent dans leur patrie pour lui prêter le secours de leurs bras.
Non loin de là, la chaîne côtière projette dans la mer un cap légèrement arqué, le cap de Volvitza. À l’endroit où les contreforts des montagnes vont rejoindre les hauteurs qui enferment la baie, quelques toits rouges, perchés sur un étranglement de montagnes, annoncent une bourgade. Beaucoup plus près de nous, quelques bâtiments délabrés font tache sur la rive ; c’est l’échelle d’Antivari, le port le plus rapproché de Scutari. Nous sommes en Turquie : le fez rouge des soldats et des douaniers nous le dirait assez, s’il fallait d’autres preuves que le silence et l’air abandonné de la côte. Notre embarcation vient toucher à un méchant pont de bois ; comme nous avons eu soin de dîner sur le bateau et d’y laisser nos effets, nous passons d’un œil fier et dédaigneux devant les douaniers qui attendent en vain une proie facile, et devant une soi-disant locanda italienne, dont un soleil étincelant fait ressortir la repoussante saleté. Notre compagnon de voyage, le correspondant italien, descend définitivement ici ; l’infortuné a peine à se tirer d’affaire avec ses Turcs, et je crois qu’il ferait plus longue mine encore s’il n’espérait pas faire route jusqu’à Scutari, et peut-être plus loin, avec le médecin ottoman qui rejoint directement l’armée.
Pour nous, enfermés depuis six jours dans des wagons ou des cabines de navire, nous nous élançons sur la bruyère, joyeux comme des oiseaux auxquels on a donné la volée. Le sentier, indécis et mal tracé, court d’abord du côté de la montagne, au milieu de groupes de câpriers et d’agnus-castus ; la cigale nous jette son cri nasillard du sein des fourrés, tandis que de bruyantes tribus de libellules se balancent dans les airs. Point de cultures, un ciel sans nuages ; sans ces toits effrontément rouges qui se rapprochent de plus en plus, nous serions tout entiers aux harmonies du désert. Bientôt le chemin ou plutôt la piste fleurie que nous suivons se change en une route pavée que coupent çà et là d’humides fondrières ; à gauche, des oliviers séculaires se pressent sur un large coteau pierreux ; à droite, la forteresse délabrée d’Antivari accuse dans le ciel ses contours gris ; le long de la rampe pierreuse s’étale un cimetière dont les tombes à moitié ruinées semblent pleurer elles-mêmes sur les morts.
J’avais vu en détail, l’année précédente, Constantinople et l’Asie-Mineure, et cependant, à mon arrivée à Antivari, je suis presque aussi stupéfait que le jour où je vis pour la première fois la Turquie, tant il est difficile de s’accoutumer à cette brusque transition de la civilisation aux choses turques. Quant à mon compagnon, il en croit à peine ses yeux : je m’imagine même que le cœur lui bat. La saleté pittoresque des maisons et des rues, la morbidezza apathique des habitants, les voiles et les grands féredjés ou manteaux dans lesquels se pelotonnent les femmes, la fierté sauvage de l’Osmanli, l’humilité canine du raïa, tous ces contrastes de langues, de mœurs, de coutumes et de religions ne laissent pas que de donner aux villes turques un grand intérêt ; mais attendez quelques semaines, et vous n’éprouverez plus guère qu’un sentiment d’impatience en face de cette décrépitude d’une civilisation vieillie et vouée au recul, de cette incurable insouciance d’un peuple qui ne sait ni grandir ni mourir. Quelques minutes après notre entrée dans la ville, nous avions gravi péniblement la rue montante et malaisée du quartier musulman, non sans provoquer sur notre passage des exclamations plus ou moins flatteuses, et nous étions tranquillement assis sur le rocher de la citadelle, à l’endroit où le fort plonge sur les vallons dénudés qui forment derrière la ville les frontières de la Montagne noire. Des Albanais nous avaient suivis à notre insu et nous épiaient pendant que nous considérions le paysage.
Au moment où nous nous levons pour aller plus loin, ils nous ordonnent de les suivre et de rebrousser chemin avec eux. Nous marchons derrière eux jusqu’à un corps de garde où stationnent deux sentinelles, le fusil au bras. J’ai toujours eu une répulsion instinctive pour les corps de garde et je leur préfère encore une salle d’école ; mais le geste de nos singuliers guides ne souffre guère de réplique ; d’ailleurs nous apercevons au fond de la chambre l’obèse majesté d’un bairaktar ou colonel turc, qui trône sur un long divan et nous fait signe d’avancer. Nous entrons ; on nous fait asseoir, puis le drogman nous traduit en mauvais italien les questions de l’officier ; on nous demande quel métier nous faisons, pourquoi nous regardions avec tant d’attention la ville, d’où nous venons et comment nous sommes arrivés. Nous répondons que nous sommes des touristes venus par le paquebot autrichien ; l’officier objectant qu’il n’est point encore arrivé, je le lui montre par la croisée ; un fonctionnaire en turban et en robe verte sort du bureau télégraphique qui est contigu au sélamlick ou salle de réception et présente une dépêche. L’interrogatoire s’interrompt, puis reprend ; pendant ce temps notre imagination trotte au loin sur les ailes de l’incertitude. Sommes-nous libres ou prisonniers ? Un retard de quelques heures nous forcera-t-il à perdre une semaine ici ? Nous ne sommes rassurés que lorsque le colonel a donné l’ordre de nous offrir une tasse de café et une cigarette. Je demande la permission de me retirer pour continuer notre promenade si brusquement interrompue, mais le colonel nous invite à laisser passer la chaleur ! Enfin un léger signe de sa grosse figure réjouie nous autorise à prendre le large et nous en profitons pour aller nous remettre de nos émotions et absorber quelques tasses de café turc en compagnie des taciturnes soldats du nizam qui peuplent les camps des environs. Une heure après, nous étions installés à quelques minutes de la ville sur un mur de pierres sèches, tout près du cimetière où pleuraient quelques femmes empaquetées dans leurs féredjés blancs ; mon compagnon s’essayait à croquer la ville qui emprunte à ses masures de bois coiffées de toits rouges et à ses minarets aigus un cachet foncièrement albanais ; pour moi je griffonnais une lettre dans une posture qui eût paru excessivement incommode même à un kodja ou docteur turc habitué à écrire sans autre appui que son genou, lorsque tout-à-coup un cri sauvage me fait lever la tête ; j’aperçois alors devant moi non pas un soldat régulier, mais un vrai bachi-bouzouk avec la figure sèche et la veste de flanelle blanche de l’Albanais ; le barbare nous foudroie de son regard et de sa bouche s’échappe un tonnerre de sons gutturaux et celtiques qui m’auraient fort intéressé à tout autre moment : Marche Frandji ! marche ! et en même temps il frappait de la main sur son long fusil annelé. Nous ne pouvions guère songer à résister ; d’un autre côté, la ville était haut perchée et nous ne tenions guère à faire au corps de garde une visite plus involontaire encore que la première ; je prends un biais et je parlemente, ou plutôt j’étourdis mon sauvage en lui criant dans deux ou trois langues diverses que je connais le bairaktar, que j’ai sa permission d’écrire et de dessiner, qu’il n’a d’ailleurs qu’à monter à la ville pour s’informer. Le bachi-bouzouk, abasourdi, mais non convaincu, finit par tourner le dos, non sans couvrir les Frandjis d’épithètes plus que mal sonnantes. Nous nous remettons à écrire et à dessiner ; mais le bachi-bouzouk avait décidément coupé le fil de nos idées et en le voyant disparaître derrière les premières maisons de la ville, nous jugeons plus prudent de rejoindre au plus vite l’échelle et le pacifique vapeur du Lloyd. Toutefois les tribulations de cette première journée chez les Turcs n’étaient point finies ; nous étions prêts à faire rame vers le vapeur lorsqu’un douanier nous hèle, pénètre dans notre barque, nous fouille sans autre forme de procès et s’empare de notre Guide des voyageurs en Orient ; heureusement le trop zélé fonctionnaire fait un effort un peu laborieux pour se hisser sur le pont de débarquement et laisse tomber à l’eau sa tabatière que nous gardons à titre d’otage pour le livre. Enfin, après dix minutes, il revient, et je le paie de sa sollicitude en le plaisantant sur son flair de douanier et en lui rendant généreusement sa tabatière.
À partir d’Antivari on entre dans un monde nouveau. La côte semble vouloir se soustraire aux regards ; elle se fait basse, plate et fuyante. Les hautes falaises tachetées de villages et de bois profonds font place à des plaines vulgaires, sur lesquelles plane le silence de la mort : notre œil interroge en vain la ligne effacée du rivage ; une grève, des mamelons d’argile, et dans le lointain une vague ligne bleue, voilà tout ce que nous apercevons de cette Albanie qui est comme une mystérieuse épave d’un monde disparu. Antivari, comme son nom l’indique, est située en face de la ville italienne de Bari, dont elle est séparée par un détroit de quarante lieues ; la distance d’Antivari à Corfou n’est pas beaucoup plus considérable ; mais qu’on ne se laisse point tromper par la proximité des pays classiques et les teintes chaudes des montagnes, et qu’on ne vienne pas chercher sur cette côte sauvage de grandes ruines ou de glorieux souvenirs. Tandis qu’en pays grec on sent revivre une âme sous la poussière des morts, ici on prête en vain l’oreille aux grandes voix de la mer et de la montagne ; rien qui résonne du bruissement des siècles écoulés ! Quelques ports ensablés par les alluvions des fleuves, quelques châteaux vénitiens, sur lesquels le lion de St. Marc a laissé en passant les marques de ses griffes, quelque citadelle turque, illustrée par la rébellion d’un Mahmoud ou d’un Ibraïm Pacha, voilà, avec les débris de la colonie romaine de Dyrrachium, tout ce qu’offre, en fait de souvenirs historiques, la côte albanaise d’Antivari aux Acrocérauniens.
Le pays que nous appelons Albanie est à peine un tout géographique ; long de cent lieues d’Antivari à Prévéza, il en a trente à quarante de large et va en se rétrécissant quelque peu vers le sud. Assez bien défendue contre les invasions du dehors par la mer et à l’est par de hautes chaînes de montagnes percées de rares ouvertures, l’Albanie manque absolument d’unité et renferme les territoires les plus hétérogènes ; au nord le bassin et le lac de Scodra avec les massifs alpestres du Bor et de Schalja, puis une région de contreforts alpins autour du lac d’Ochida jusqu’à la Drina noire, au centre la région du Grammos ou de Bérat, traversée par l’Arçén et le Scoumbi ; enfin au sud la région du Pinde, formée par une quantité de bassins fluviaux qui descendent en éventail du plateau de Janina. Cette dernière contrée porte spécialement le nom d’Épire, et gravite depuis 3 000 ans dans l’orbite de la Grèce.
Coupée à l’intérieur par des fleuves et des chaînes de montagnes bizarrement contournées, l’Albanie ne pourrait être unie que par la mer ; mais jusqu’à Avlona la côte ne présente que des lagunes malsaines et des plaines d’alluvions qui gagnent sans cesse sur les eaux, tandis que depuis Avlona à Prévéza le rivage épirote oppose au navigateur la muraille des Acrocérauniens battue par de perpétuels orages.
Cette configuration tourmentée explique pourquoi l’Albanie n’est jamais entrée que par son extrémité méridionale dans le mouvement du monde grec. Corcyre, qui régnait sur ces parages, y avait jeté deux colonies, Epidamne (Durazzo) et Apollonia, qui n’eurent aucune influence sur les indigènes de l’intérieur, de race probablement pélasgique, et ne brillèrent de quelque éclat que sous les Romains ; aujourd’hui il ne reste de l’Epidamne grecque qu’une stèle funéraire. Pour les Grecs, la porte extrême des pays helléniques ne s’ouvrait qu’aux Acrocérauniens, à la frontière septentrionale de l’Épire ; tout ce qui était plus au nord était compris sous la vague dénomination d’Illyrie.
Les légions romaines n’étaient pas loin de la Grèce, lorsque l’Épire, cette Suisse de l’antiquité, eut enfin un moment de gloire sous son chef Pyrrhus, le type accompli du condottiere. Une fois maîtres de ces régions, les Romains ne pouvaient guère traiter avec dédain la terre illyrienne, qui se trouvait sur le chemin de la Thessalie et de la Macédoine ; ils réprimèrent la piraterie, domptèrent, non sans peine, l’héroïque reine Teuta, et firent d’Epidamne, devenu Dyrrachium, le point de départ de leur grande voie Egnatia, qui traversait de part en part la péninsule à sa racine même, et suivait probablement la même direction que le chemin actuel d’Elbassan à Monastir par Ochrida.
S’il faut en croire Strabon, cette route devint la frontière méridionale de la province de Macédoine : tout ce qui était au sud s’appelait du nom d’Épire, tandis que, pour Ptolémée, l’Épire ne commence qu’aux Acrocérauniens, au-delà d’Avlona. Si l’Albanie du nord fut durement traitée, c’est-à-dire pacifiée, comme disaient les Romains, l’Épire grecque fut anéantie. Paul Émile, après avoir battu Persée à Pydna, promena le fer et la flamme dans la montueuse patrie de Pyrrhus, détruisit, en une seule campagne, soixante-quinze citadelles épirotes et fit 150 000 prisonniers. Les noms périrent avec les villes, et si un géographe ancien se plaint déjà de l’absence de documents sur l’Épire, comment pourrions-nous espérer retrouver, avec leurs noms authentiques, les soixante-quinze cités du pays épirote ? Les empereurs se montrèrent plus cléments ; l’Épire vit s’élever sous Auguste, sur l’isthme de Prévéza, la ville romaine de Nicopolis, orgueilleux souvenir d’Actium ; sous Adrien, la patrie de Pyrrhus fut même traitée comme une province particulière. En somme, abstraction faite de l’antique oracle de Dodone, de Pyrrhus, et de la lutte glorieuse contre les Romains, on peut dire que l’Albanie, surtout la partie nord, est toujours restée dans l’antiquité comme noyée dans la pénombre de l’histoire.





























