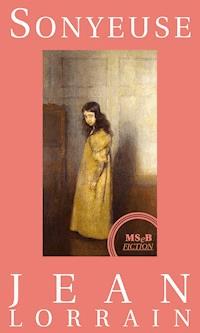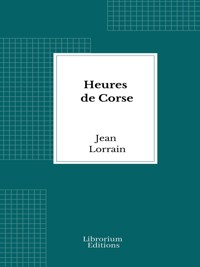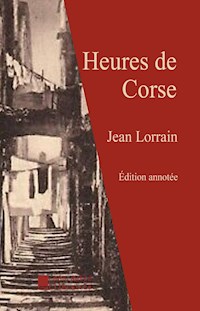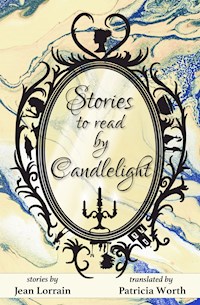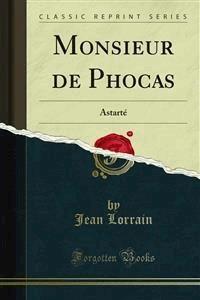Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Quand un Parisien du beau monde, esthète et ami des plaisirs, part à la découverte de contrées évidemment sauvages et peu civilisées, forcées à la discipline par une France sûre de son bon droit, il emmène avec lui nombre de préjugés rassurants. De l'Algérie à la Tunisie, en passant par la Libye, le voyageur oscille entre le rejet et l'approbation gourmande, le regret de Paris et l'amour triste d'un pays qu'on sait ne jamais revoir. Un texte volontiers provocateur, à ne pas mettre en toutes les mains. (Édition annotée)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heures d’Afrique
Jean Lorrain
(Édition annotée)
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Eugène Fasquelle, 1899, Paris.
Les notes entre crochets ont été ajoutées pour la présente édition.
Couverture : Frederick Arthur Bridgman
Avertissement :
Certains passages de ce texte reflètent des habitudes de vie et de pensée autrefois communément acceptées, mais qui ne sont plus tolérables aujourd’hui. Elles n’en font pas moins partie de l’Histoire, et doivent à ce titre rester accessibles. Notre ligne éditoriale est autant attachée à des valeurs humaines intouchables, qu’à une totale liberté d’information.
__________
© 2020, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-491445-39-3
Table des matières
Frutti di mare – Marseille
La ville
Les bas quartiers
Nuit de Noël
Oran
En Alger – Tlemcen
Les enfants
Les cafés
Les villes mortes
Le champ des iris
Sidi Bel Abbès
Diligences d’Afrique
Mostaganem
La route
La ville
Femmes d’officiers
Symphonie en bleu, fauve et argent
Les chemins de fer
Alger sous la neige
Blida
Blida Ourida
Le cimetière
La nouba
Les amandiers
Fathma – Printemps d’Alger
Divertissements arabes
Banlieues d’Alger
Mustapha supérieur
Le Ruisseau
Notre-Dame d’Afrique
Les Tournants Rovigo
Un an après – D’Alger à Constantine
Notes de voyage
Constantine
La ville des tanneurs
La rue des Échelles
El Kantara
Timgad
Types de Biskra
Printemps de Tunis
Quatre ans après
À bord de l’Abd-el-Kader
Quartiers de Tunis
La Porte de France
Les souks
Tunis sous la pluie
Halfaouine
Le quartier juif
Comment elles voyagent
Madame Baringhel à Carthage
Tunis mystérieuse
Sousse
Comment elles voyagent
Le 30 janvier, de madame Baringhel
Sfax
À bord du Tell
Tripoli de Barbarie
Comment elles voyagent
Madame Baringhel chez les Teurs
Frutti di mare – Marseille
La ville
Marseille, le brouhaha de sons et de couleurs de sa Cannebière, la flânerie heureuse de ses négociants déambulant de cafés en cafés, l’air de commis voyageurs en vins et en huile, l’exubérance de leurs gestes, leur assent et la gaieté comique de leurs grands yeux noirs, la mimique expressive de leurs belles faces d'hommes, té, tout ce tumulte et cette joie changeant presque en ville d’Orient, mi-italienne et mi-espagnole, ce coin animé des rues Paradis et Saint-Ferréol et jusqu’à ce cours Belzunce, avec son grouillement de Nervi en chemises molles et pantalons à la hussarde et de petits cireurs, se disputant la chaussure du promeneur.
Et là-dessus du soleil, un ciel d’un bleu profond, à souhait pour découper l’arête vive des montagnes, et des étals de fleuristes encombrés de narcisses et de branches d’arbousiers en fleurs ; et des rires à dents blanches de belles filles un peu sales, et des paroles qui sentent l’ail, et à tous les coins de rue des marchands de coquillages, et des attroupements d’hommes du peuple et d’hommes bien mis, pêle-mêle autour de la moule, de l’huître, de l’oursin. Oh ! ces rues fourmillantes, odorantes et rieuses, dont trois corps de métiers semblent avoir accaparé les boutiques : les confiseurs, les lieux d’aisance et les coiffeurs.
Et c’est, dans l’atmosphère, une odeur d’aïoli, de brandade et de vanille qui s’exaspère au bon soleil.
Et dire qu’à Paris il gèle, il vente et qu’on patine… Ah ! qu’il est doux de s’y laisser vivre, dans ces pays enfantins et roublards, compromis par Daudet et réhabilités, té, par Paul Arène, loin du Paris boueux, haineux et tout-à-l’égout des brasseurs d’affaires, de délations et de toutes les besognes, poussés, comme les helminthes de la charogne, autour du cercueil du colonel Henry.
Oh ! l’invitation aux voyages de Charles Baudelaire :
Oh ! viens, ô ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble.
Comme elle la chante, cette invitation, la Méditerranée, dans chacune de ses vagues d’une transparence si bleue que le fond de roches de ses bords resplendit à travers comme une pâleur entrevue de naïade, et jusque dans l’eau croupie du vieux port, dans cette eau huileuse et figée, aux reflets et aux senteurs de plomb. Elle la chante encore, la nostalgique invitation pour ailleurs, la Méditerranée des Roucas Blancs, et de Mayrargues, et de la Corniche, à travers les drisses, les vergues et les mâtures, dressées, telle une forêt, entre le fort Saint-Jean et les bastions du Faro, sous l’œil de la Bonne Mère, Notre Dame de la Garde, dont la gigantesque statue dorée, hissée haut dans le ciel, au fin sommet de son clocher de pierre, surveille et protège la ville et ses deux ports.
Ici la Joliette, avec le môle de son interminable jetée, ses bassins bondés de navires, la coque noire des transatlantiques perpétuellement en partance pour des destinations enivrantes, ces villes d’or et d’azur dont la sonorité chante et frémit avec un bruit de soie à travers les poèmes de Victor Hugo : Oran, Alger, Tunis, Messine et Barcelone ; et voilà que des sons de guitare, aigres et perçants, égratignent l’air…
Messine, Barcelone ! Nous revoici dans le vieux port, sur ces vieux quais de la Marine, obstrués de bateaux, de barques et de barquettes, sur ces quais poussiéreux aux hautes maisons étroites d’un autre siècle, rongées par le mistral, le soleil et la mer, avec leur enfilade de ruelles en escaliers, tortueuses et puantes, où chaque embrasure de porte encadre une silhouette de fille en peignoir ; et c’est bien Messine et Barcelone, en effet, que promènent de bar en bar et de maison en maison le farniente tout italien et le rut à coups de couteau de tous ces matelots de race latine, Génois, Corses, Espagnols, Maltais et Levantins, débarqués de la veille qui se rembarqueront demain, descendus là gaspiller, en une journée de bordée et de crapule, leur gain de trois à six mois, en une escale entre Trieste et Malaga ou entre Smyrne et Rotterdam.
Et des nasillements d’accordéon grincent et se mêlent à des refrains de beuglant parisien ; couplets de l’avant-veille lancés dans la journée par quelque étoile de troisième ordre à la répétition du Palais de Cristal, « Pa-na-ma-boum-de-là-haut », blague française et gigue anglo-saxonne, pot-pourri imprévu d’une musique de paquebot anglais donnant aubade à quelque patron de bar mal famé de chiqueurs (souteneurs marseillais). Les chiqueurs, les hommes à grands feutres gris et à pantalons trop larges qui flânent, cravatés de rouge, de midi à minuit, sur le port, pendant qu’aux bords des quais, dans une lumineuse poussière d’or, halètent et se démènent, les bras et les reins nus, comme moirés de sueur, les portefaix déchargeurs de farine, de blé, d’alfa ou de pains d’huile, ceux-là même dont Puget a immortalisé, dans ses cariatides, les profils de médailles et les pectoraux musclés de gladiateurs.
Marseille !
Les bas quartiers
Marseille !
Au fond d’un bouge obscur où boivent des marins,
Bathyle, le beau Thrace aux bras sveltes et pâles,
Danse au son de la flûte et des gais tambourins.
Dans le quartier du vieux port, au cœur même des rues chaudes où la prostitution bat son quart au milieu des écorces d’orange et des détritus de toutes sortes, un bar de matelots : devanture étroite aux carreaux dépolis, où s’encadrent de faux vitraux.
C’est la nuit de Noël ; des trôlées d’hommes en ribote dévalent par les escaliers glissants des hautes rues montantes ; des injures et des chansons font balle, vomies dans tous les idiomes de la Méditerranée et de l’Océan. Ce sont des voix enrouées, qui sont des voix du Nord et des voix du Midi, qui sont toutes zézayantes. Vareuses et tricots rayés, bérets et bonnets de laine descendent, qui par deux, qui par groupes, jamais seuls, les yeux riants et la bouche tordue par la chique, avec des gestes de grands enfants échappés de l’école. Il y en a de toutes les nationalités, de toutes les tailles ; et, la démarche titubante, quoique encore solides sur leurs reins sanglés de tayolles, ils avancent par grandes poussées ; leurs saccades vont heurter dans la porte de quelque bouge, où toute la bande tout à coup s’engouffre ; puis d’autres suivent, et c’est, dans le clair-obscur des ruelles, taché çà et là, par la flambée d’un numéro géant, une lente promenade de mathurins en bordée, plus préoccupés de beuveries que d’amoureuses lippées, et que les filles lasses invectivent au passage.
Et pourtant, dans tout ce quartier empestant l’anis, le blanc gras et l’alcool, c’est le défilé de toutes les rues célèbres dans les annales de la prostitution, la rue de la Bouterie, celle de la Prison, la rue des Bassins, la rue Ventomagy, enfin, où Pranzini, encore tout chaud de l’égorgement de Madame de Montille, alla si bêtement s’échouer et se faire prendre avec sa passivité d’aventurier gras et jouisseur, en bon Levantin qu’il était, cet assassin à peau fine dont le cadavre, adoré des femmes, étonna même les carabins ; puis, autour de la place Neuve, la rue de la Rose (cette antithèse) et toutes les via puantes affectées aux Italiens ; et sur chaque trottoir, au rez-de-chaussée de chaque maison toute noire dans la nuit, s’ouvre, violemment éclairée, la chambre avec le lit, la chaise longue et la table de toilette d’une fille attifée et fardée, telle la cella d’une courtisane antique, sa boutique installée à même sur la rue avec la marchandise debout sur le seuil. D’autres, rassemblées en commandite, apparaissent haut perchées sous le linteau d’une grande baie lumineuse, murée à mi-hauteur.
Les cheveux tire-bouchonnés piqués de fleurs en papier ou de papillons métalliques, elles se tiennent accoudées, les seins et les bras nus, dans les percales claires des prostituées d’Espagne… et, sous le maquillage rose qu’aiment les hommes du Midi, c’est, à la lueur crue des lampes à pétrole, comme une vision de grandes marionnettes appuyées au rebord de quelque fantastique guignol ; et les : mon pétit ! eh, joli bébé ! belle face d’homme ! et tous les appels, toutes les sollicitations, toutes les promesses gazouillées par des voix d’Anglaises ou comme arrachées par de rauques gosiers d’Espagnoles, tombent et s’effeuillent, fleurs d’amour pourries, de ces masques de carmin et de plâtre, étrangement pareils les uns aux autres sous l’identique coloriage brutal.
Parfois un homme se détache d’un groupe et, comme honteux, s’esquive et se glisse chez ces dames ; une porte vitrée se ferme, un rideau se tire et Vénus compte un sacrifice de plus à son autel, une victime de plus à l’hôpital. Aussi un marin qui se débauche et quitte sa bande est l’exception ; en général, qu’ils soient Maltais ou Italiens, Espagnols ou Grecs, les matelots stationnent, s’attroupent devant un seuil, goguenardent la fille et puis passent : tous vont et disparaissent dans le petit bar aux carreaux dépolis garnis de faux vitraux.
Une curiosité m’emporte, je les suis. Dans un couloir en boyau, aux murs peints de fresques grossières, boivent, entassés, des matelots de tous pays. On a peine à se frayer un passage entre les rangs de tables et le comptoir en zinc encombré de liqueurs ; au fond, l’étroit corridor s’ouvre, comme un théâtre, sur une salle carrée où courent, peints à la détrempe, d’exotiques paysages de cascades et de palmiers ; de la gaze verte s’y fronce en manière de rideaux et, dans cette espèce d’Eldorado pour imaginations naïves, des matelots génois et napolitains valsent en se tenant par la taille ; l’orchestre est un accordéon. Pas une seule femme dans l’assistance, hors la musicienne, une vieille niçoise en marmotte, écroulée sur une chaise à l’entrée du bal. L’accordéon chevrote une valse de Métra et les Italiens, les yeux en extase, tournent éperdument aux bras les uns des autres, et la fumée des pipes et la buée des vins chauds tendent comme un voile sur leurs faces brunies, éclairées de dents blanches.
Nuit de Noël
Et cette joyeuse nuit de Noël, commencée en flâneries à travers les mauvaises rues de la ville, en visites aux filles et en stations devant le comptoir nickelé des bars, pendant que les cloches sonnaient à toute volée des allées de Meilhan à la placette de Saint-Augustin, qui aurait dit qu’elle se terminerait dans le sang, les couteaux catalans et navajas tirés entre Maltais et Mahonnais, Italiens et Grecs, dans une de ces rixes entre Marseillais et Corses qui prennent feu pour une fille, pour un verre ou pour une chaise, animés qu’ils sont les uns contre les autres par une vieille haine séculaire : rixes qui, une fois les couteaux au clair, entraînent tout un quartier, toute une ville, jetant toutes les nations aux prises et taillant, à travers les ruisseaux des rues, de la besogne pour les croque-morts et les internes de l’Hôpital.
Et ce joli petit matelot espagnol, d’une joliesse grimaçante et dégingandée, avec deux grands yeux brasillant dans une face de cire ! Ce svelte et fin gabier de Malaga qui, la veille encore, dansait si furieusement les danses de son pays dans ce bar de matelots ! qui eût dit, alors qu’il mimait avec une verve si endiablée le boléro de Séville et la Jota catalane, aux applaudissements de tout son équipage entassé là pêle-mêle avec des Grecs, des Yankees, des Anglo-Saxons, qui eût dit qu’on le ramasserait, le lendemain, au coin de la poissonnerie, échoué, le crâne ouvert contre une borne, avec trois trous béants entre les deux épaules et une lame d’acier dans la région du cœur ?
Il l’avait dansée gaiement, fiévreusement, avec l’espèce d’ivresse frénétique et funèbre d’un condamné à mort (ou du moins, les événements voulaient qu’il l’eût dansée ainsi), le crâne assassiné de la nuit, sa dernière cachucha, fière comme un défi, lascive et déhanchée comme une danse gitane !
Au fond d’un bouge obscur où boivent des marins,
Bathyle, le beau Thrace, aux bras sveltes et pâles,
Danse au son de la flûte et des gais tambourins.
Ses pieds fins et nerveux font claquer sur les dalles
Leurs talons pleins de pourpre où sonnent des crotales
Et, tandis qu’il effeuille en fuyant brins à brins
Des roses, comme un lys entrouvrant ses pétales
Sa tunique s’écarte…
…
Bathyle alors s’arrête et, d’un œil inhumain
Fixant les matelots rouges de convoitise,
Il partage à chacun son bouquet de cytise
Et tend à leurs baisers la paume de sa main.
Malgré sa vareuse de laine et sa face camuse bien espagnole de jeune forçat, ses larges maxillaires et sa grande bouche aux lèvres presque noires, cette réminiscence grecque m’était soudain venue quand, souple et fin, il s’était levé de son banc pour venir se camper droit au milieu de la salle, et là, tordant son buste ceinturonné de jaune, et rythmant avec ses bras levés de frénétiques appels, il s’était mis à trépigner sur place, secoué du haut en bas par je ne sais quels tressaillements convulsifs.
C’était hardi, pimenté et d’autant plus imprévu qu’aux valses molles des Génois et des Napolitains, tournant langoureusement ensemble, avait succédé une sorte de tarentelle canaille, mi de ruisseau, mi de beuglant, grivoiserie soulignée par un Niçois bellâtre en chemise de flanelle rose ouverte sur le poitrail.
Là-dessus, un Anglais blond était venu, au cou rugueux et au teint de brique, qui s’était posé au milieu du couloir et, d’une voix trouée par le gin et les noces, s’était mis à gueuler un an happy fellow quelconque, en trémoussant à chaque refrain un automatique et stupide pas de gigue, qu’accompagnaient de leurs gros souliers à clous tous les mâles aux yeux de faïence attablés dans le bar.
Oh ! La pesanteur et la maladresse de ces danses saxonnes, leur côté clownesque et spleenétique, et la grossièreté de ces chansons d’Oyster maid reprises et beuglées en chœur ! Comme il venait bien après ce divertissement de brutes et ces lourdes saouleries de brandy, le svelte et fier petit matelot de Malaga, joli comme un Goya et comme un Goya un peu macabre, avec sa pâleur verte et son profil absent ; et comme elle nous reposait de leurs danses épileptiques et lourdes, cette cachucha suprême où toute la grâce et la gaieté latines se gracieusaient de langueur orientale et d’audace espagnole ! Et dire qu’il dansait les deux pieds dans la tombe, et que c’est son âme inconsciente d’enfant, sûrement, et de forban, peut-être, qui flambait en dernier adieu cette nuit-là dans ses prunelles humides et noires.
Oran
Pour Georges d’Esparbès
La promenade de Létang, à l’heure de la musique des zouaves. Tout Oran est là, faisant les cent pas sous les eucalyptus des allées, tout l’Oran du quartier français et du quartier espagnol ; femmes d’officiers en toilette d’été sous des ombrelles claires, juives oranaises aux faces mortes sous l’affreux serre-tête noir, informes et larveuses dans leur robe de satin violet et de velours pisseux et l’entortillement des châles ; étrangères des hôtels vêtues de draps anglais et chaussées de souliers jaunes ; bonnes d’enfants mahonnaises coiffées d’écharpes de dentelle, et toute la pouillerie d’Espagne en loques éclatantes et sordides. Tout cela grouille, jase et chatoie aux sons des cuivres de l’orchestre, groupé, qui sur des chaises, qui debout et formant cercle autour des vestes sombres à hautes ceintures bleues et des nuques hâlées et ras-tondues des musiciens.
Çà et là, l’uniforme bleu de ciel d’un turco ou la tenue fine d’un officier de zouaves pique comme d’une floraison guerrière la remuante palette qu’est cette foule ; quelques rares indigènes en burnous y promènent leurs silhouettes bibliques aux jambes sales, pendant qu’accoudé à la rampe de bois des terrasses, tout un régiment de légionnaires regarde, avec des yeux perdus, le ciel pur et la mer.
La mer de soie et de lumière qu’est la Méditerranée de cette côte et sur laquelle va les emporter, dans deux heures, le bâtiment de l’État à l’ancre dans le port.
Hier encore à Sidi-Bel-Abbès, demain en pleine mer, en route pour le Tonkin et les climats meurtriers de l’Extrême-Asie ; au pays jaune après le pays noir.
La légion étrangère, ce régiment d’épaves de tous les mondes et de tous les pays, cette espèce d’ordre guerrier ouvert, comme les anciens lieux d’asile, à tous les déclassés, à toutes les vies brisées, tous les avenirs manqués, à toutes les tares et à tous les désespoirs !
Pendant que le 2e zouaves attaquait je ne sais quelle polka sautillante, je ne pouvais m’empêcher de regarder ces hommes, tous dans la force de l’âge et tous marqués du sceau de l’épreuve, têtes pour la plupart passionnées et passionnantes par l’expression hardie de l’œil et le renoncement d’un sourire désormais résigné à tout ; tristes et crânes visages d’aventuriers ayant chacun son mystère, son passé, passé d’amour ou d’ambition, passé d’infamie peut-être ; et, songeant en moi-même dans quel pays la France les envoyait dans une heure combattre et mourir, je sentais sourdre en moi une tristesse immense, et, devant leur muette attitude en face de cette mer caressante et perfide comme une maîtresse, et qui devait rappeler à plus d’un quelque exécrable et adorée créature, toute la nostalgie de ces regards interrogeant l’horizon pénétrait insensiblement mon âme et la noyait d’une infinie tristesse ; car, tout en les plaignant, c’est sur moi-même que je pleurais, moi qui me trouvais seul ici, comme eux, abandonné loin de la France et des miens, par lâcheté, par peur de la souffrance, parce que, moi aussi, j’avais fui pour mettre des centaines de lieues, la mer et l’inconnu, le non – déjà – vu d’un voyage, entre une femme et moi.
Nous avons tous dans la mémoire
Un rêve ingrat et cher, un seul,
Songe défunt, amour ou gloire,
Espoir tombé dans un linceul.
Nul autour de nous ne s’en doute :
On le croit mort, le pauvre ami ;
Seul au guet notre cœur l’écoute,
Le cher ingrat n’est qu’endormi.
Nous restons là, l’âme effrayée,
Frissonnant s’il a frissonné,
Et nous lui faisons la veillée,
Dans une tombe emprisonné.
Et voilà que la foule s’écoulait lentement, confusément, avec un bruit d’armée en marche ; la musique du 2e zouaves regagnait la caserne, le ciel et la mer avaient changé de nuances, ils étaient devenus d’un bleu gris et voilé, presque mauve. Indistincte maintenant la ligne de l’horizon ; à un seul point au-dessus des montagnes, une bande d’or vert d’une délicatesse infinie découpait en brun rougeâtre la vieille citadelle aux murs carrés et bas, et le frêle campanile de Notre-Dame-de-Santa-Cruz, au sommet de Mers-el-Kébir.
Les allées de promenade, tournantes et ombragées, leurs grands eucalyptus et leurs roses rouges en fleurs, tout s’est décoloré ; un réverbère s’allume au pied des hauts remparts, la promenade de Létang est maintenant déserte. Ces points grisâtres là-bas, sur le quai, ce grouillement confus d’ombres incertaines, cette rumeur de voix, ce sont les légionnaires qu’on embarque. Au loin, très loin, un lourd chariot se traîne avec un bruit de sonnailles ; c’est la nuit, c’est le soir.
En Alger – Tlemcen
Les enfants
Le paradis de l’éternité ne se trouve, ô Tlemceniens ! que dans votre patrie, et s’il m’était donné de choisir, je n’en voudrais pas d’autre que celui-là
Ibn Khafadja1
Le charme de Tlemcen, ce sont ses enfants : ses enfants indigènes aux membres nus et ronds, jolis comme des terres cuites qu’un caprice de modeleur aurait coiffées de chechias. Avec leurs grands yeux d’animaux intelligents et doux, leurs faces rondes un peu brunes, éclairées de petites dents transparentes : leurs dents, autant de grains de riz ! avec leurs cheveux roux, teints au henné, s’éparpillant en boucles d’acajou, il faut les voir courir en bandes à travers les ruelles étroites, coupées çà et là d’escaliers, de cette ville bien plus marocaine qu’arabe.
Petits garçons turbulents, râblés et souples dans de longues gandouras qui traînent sur leurs pieds nus, fillettes de dix à douze ans, déjà graves dans les percales jaunes et roses à fleurs voyantes des Espagnoles, leur poitrine déjà naissante serrée dans la veste arabe, et leurs fines chevilles et leurs poignets menus cerclés de lourds bijoux, tout cela va et vient aux seuils des portes basses ouvertes sur la rue, apparaît à l’angle d’un mur éblouissant de chaux, et, dans un jargon gazouillant à la fois mélodieux et rauque, enveloppe brusquement de gestes quêteurs et de petits bras tendus le promeneur égaré, à cent pas de l’hôtel, où commence et finit le quartier français, aussitôt submergé par la ville indigène.
Ville étrange, silencieuse et comme déserte avec ses demeures basses accroupies le long des ruelles ensoleillées, et dont la porte ouverte dérobe, par un coude brusque dès l’entrée, le mystère des intérieurs.
C’est le matin : le pas d’un rare turco se rendant du Méchouar à la place, les bourricots chargés de couffes remplies d’argile de quelque ânier de la plaine, ou la mélopée criarde d’un tisseur, installé dans le clair-obscur de sa boutique, voilà les seules rumeurs matinales de Tlemcen. Au-dessus des terrasses étagées s’escaladant les unes les autres, avec, çà et là, le dôme blanchi à la chaux d’une mosquée ou le minaret d’onyx d’El-Haloui ou d’Agadir, c’est un ciel d’outre-mer profond et bleu comme la Méditerranée même, la Méditerranée déjà si lointaine dans ce coin du Sud oranais, c’est l’azur brûlant des pays d’Afrique avec, au nord de la ville, la dominant de toute la hauteur de ses contreforts rougeâtres, l’âpre chaîne en muraille du Djebel Térim.
Dans l’intervalle des maisons indigènes apparaissent les créneaux des remparts et, dévalant à leurs pieds en massifs de verdure, les vergers de figuiers et les jardins entourés de cactus de la vallée de l’Isser convertie en cultures ; au loin, très loin, à des cinquantaines de lieues, ces lieues lumineuses des pays de soleil où l’œil semble atteindre des distances impossibles, des ondulations bleues qui sont d’autres montagnes et que vous, étranger, vous prenez pour la mer.
Et c’est une sensation étrange, sous cet azur accablant, au milieu de cette fertilité, que cette ville silencieuse et blanche, comme endormie depuis des siècles dans son enceinte de murailles, et sommeillant là, au cœur même des verdures, avec ses minarets et ses mosquées, son sommeil de ville enchantée dans l’abandon et la chaleur.
Mais ses enfants sont là, marmaille grouillante et colorée, tenant à la fois du joujou et de l’objet d’art. Tanagras imprévus échappés à la fois de la sellette du sculpteur et des blancs cirés de l’école, adorable animalité faite d’inconscience et de malice, ils mettent au coin de chaque rue des ébats de jeunes chats et des attitudes de jeunes dieux à la fois nimbés de beauté grecque et de grâce orientale.
Oh ! les grands yeux pensifs, vindicatifs et noirs des fillettes déjà femmes ! Il faut les voir passer droites sur les hanches, leurs pieds nus bien appuyés au sol, et défiler, impassibles, sous les yeux curieux de l’étranger, en tenant par la main le marmot confié à leur garde. Oh ! leur fierté de petites princesses dédaigneuses des roumis, en posant leur grande cruche de cuivre sur la margelle de la fontaine, et la souplesse élastique de leur pas en se retournant, la taille campée sous le fardeau, parce qu’elles se savent regardées, toute cette dignité presque insolente de la femme d’Orient pour le chrétien, à côté de la servilité mendiante et des caresses dans la voix et dans l’œil des petits garçons se bousculant, futurs Chaouks d’Alger ou interprètes d’hôtel, autour du petit sou du promeneur ! Oh ! les enfants joujoux aux cheveux d’acajou, aux doigts teints de henné, avec des anneaux aux chevilles, des ruelles de Tlemcen !
Les cafés
C’est vendredi, le dimanche arabe. L’accès des mosquées, où durant toute la semaine le touriste peut se hasarder en laissant toutefois ses chaussures à la porte, est, ce jour-là, sévèrement interdit aux roumis. Dans la Djemaa-el-Kébir, comme sous les colonnes d’onyx d’El-Haloui, les indigènes, prosternés sur les nattes ou accroupis par groupes dans les cours intérieures, égrènent de longs chapelets rapportés de la Mecque ou dépêchent en extase des syllabes gutturales, qui sont autant de versets du Coran. Dehors, par les rues ensoleillées et blanches, c’est, le long des échoppes des tisserands et des brodeurs, la plupart silencieuses et closes, une atmosphère de fête et de repos ; la ville est sillonnée de promeneurs : nomades encapuchonnés de laine fauve, Marocains laissant entrevoir des ceintures de soie claire sur de bouffantes grègues de drap mauve ou vert tendre, toutes soutachées d’argent ; jeunes indigènes sveltes et musclés dans des burnous d’une blancheur insolite avec, au coin de l’oreille, la branche de narcisse ou la rose piquée sous le foulard du turban.
Avec la joie en dedans, qui est le propre de l’Arabe, toutes ces silhouettes élégantes et racées, chevilles fines et torses minces, vont et viennent, se croisent à travers les rues montantes avec à peine un sourire au passage pour l’ami rencontré ou la connaissance saluée du bout des doigts posés sur la bouche et sur l’œil ; et le silence de cette gaieté étonne, cette gaieté majestueuse et hautaine, sans un geste et sans une parole au milieu des derboukas et des glapissements de flûtes, bourdonnant au fond des cafés maures.
Ils sont bondés, encombrés aujourd’hui à ne point y jeter une épingle. Un grouillement de cabans et de loques vermineuses y prend le thé et le kaoua, vautré sur l’estrade tendue de nattes qui sert ici de lit et de divan. De hâves visages d’ascètes y stupéfient, reculés dans le clair-obscur des capuchons, à côté de grands yeux noirs à paupières lourdes et de faces souriantes d’Arabes de la Kabylie ; des uniformes de turcos mettent au milieu de ces grisailles d’éclatantes taches bleu de ciel, car c’est aujourd’hui jour de sortie pour eux ; les autorités françaises ont égard à la piété musulmane et toutes les casernes du Méchouar sont dehors.
Depuis dix heures du matin, l’ancienne caserne d’Abd-el-Kader vomit par son unique porte en plein cintre un flot ininterrompu de tiraillours. Astiqués, guêtrés de blanc, le crâne tondu et la face éclairée d’un sourire à dents blanches sous le turban de Mahomet, ils se répandent joyeux à travers la ville, abordent les indigènes, disparaissent à des coins de ruelles, sous de mystérieuses portes basses, logis de parents ou d’amis, entrent gravement dans les mosquées, stationnent un moment devant les marchands d’oranges, de jujubes et de figues de Barbarie, puis vont s’échouer au café maure, où ils prennent place, graves, au milieu des joueurs, et, tandis que les burnous, allongés dans un indescriptible enchevêtrement de bras et de pieds nus, remuent les dés, les échecs et les cartes, eux, extatiques et muets, les braves petits tirailleurs algériens, vident avec recueillement l’imperceptible tasse de kaoua, hypnotisés par les aigres grincements de quelque joueur de mandoline.
Quelques-uns, en vrais fils de l’Orient, au lieu de l’éternelle cigarette roulée au bout des doigts, fument silencieusement le kief. Un enfant dressé à cet usage bourre le narghilé et le tend aux fumeurs ; et, tandis que le maître du café s’agite et va et vient autour de son petit fourneau de faïence, dans les étincellements d’émail et de porcelaine de ses innombrables petites tasses, le fumeur, déjà engourdi par l’opium, laisse tomber d’un geste las le bec du narghilé et s’assoupit, les yeux au plafond, immobile.
Dans des embrasures équivoques, des visages de mauresques fardées apparaissent. Les pommettes sont d’un rose inquiétant de vin nouveau, des tatouages en étoiles nimbent leurs tempes ou trouent leurs joues d’invraisemblables mouches ; la nuit tombe, d’autres portes s’entrebâillent au coin de ruelles infâmes, et des intérieurs d’une nudité et d’une saleté de tanières s’entrevoient à la lueur d’une chandelle fichée dans un goulot de bouteille, ou à même le suif égoutté sur une table ; des robes de percales claires et des bustes entortillés de châles se hasardent sur des seuils, des appels et des provocations en idiomes d’Espagne harcèlent des zouaves et des chasseurs d’Afrique qui ricanent et passent ; un groupe de turcos entre en se bousculant sous une voûte ornée de colonnettes à chapiteaux de marbre, une odeur d’aromates et de suint s’en échappe ; il est six heures, on ouvre les bains maures.
Les villes mortes
Une haute muraille d’argile et de basalte dressant pendant des lieues des contreforts rougeâtres, avec çà et là des taches vertes, qui sont des vignes et parfois des lentisques ; crêtes déchirées où des flocons de nuages s’accrochent comme des lambeaux de toisons, car la muraille est haute et se perd dans le ciel : la chaîne du Djebel-Térim.
Au pied, d’interminables vignes, des vergers d’oliviers séculaires, des bosquets de figuiers convulsés et trapus, des haies bleuâtres de cactus, cerclant l’orge et le blé des cultures indigènes, et, le long des sentiers bordés de petits murs, des irrigations d’eau vive débordant d’étroits caniveaux creusés à profondeur de bêche, qui vont porter la fraîcheur et la fécondité à travers cinquante lieues de labours et de jardins : la vallée de l’Isser.
Derrière vous, ce mamelon couronné de murs blancs, que chacun de vos pas en avant abaisse et efface, Tlemcen, la cité des Émirs : Tlemcen déjà lointaine et dont les sonneries de casernes, claironnant depuis cinq heures du matin, n’arrivent plus maintenant qu’en modulations vagues, confondues avec les grincements de guitare d’un colon espagnol, rencontré tout à l’heure au tournant d’un chemin.
Et dans cette solitude cultivée, au passant rare, où nul toit de métairie n’apparaît, tout à coup surgissent devant vous des tours, hautes tours ruinées, éventrées, et pourtant se tenant encore. De croulantes murailles les relient ; c’est l’ancienne enceinte d’une ville disparue, s’ouvrant en cirque sur cent hectares jadis bâtis de luxueuses demeures, de palais, de mosquées, de koubas et de bains : Mansourah.
Mansourah, la ville guerrière, dont la splendeur rivale tint huit ans en échec la prospérité menacée de Tlemcen ; Mansourah, la ville assiégeante bâtie à une lieue de la ville assiégée ; Mansourah, dont l’enceinte, aujourd’hui démantelée, éparpille à mi-flanc du Djebel-Térim jusqu’à travers les vallées de l’Isser les moellons de ses tours et les briques vernissées de ses portes, les monuments, les maisons et les rues ayant été rasés par les vainqueurs avec défense à tous les habitants de la plaine de prononcer jamais le nom de la ville détruite et de tenter de bâtir sur son emplacement.
Un siège de huit ans, que soutint la cité des Émirs, s’éveillant un matin, après trois assauts successifs, enveloppée d’une épaisse muraille en pisé dont on admire encore les restes, et, du coup, bloquée, sans communication, privée de vivres et de renforts, et comme ce n’était pas assez, voilà qu’au milieu du camp ennemi s’élevait en même temps une ville. La mosquée surgissait la première, une des plus grandes qui aient jamais existé, ensuite le minaret poste-vigie d’où l’on pouvait, à trente mètres de hauteur, surveiller les allées et venues des assiégés, puis des maisons se groupèrent autour des monuments : palais des grands chefs environnés de jardins, cafés et bains maures, et enfin des demeures plus humbles, abris de fantassins ou des simples cavaliers.
Et ce fut Mansourah, la cité assiégeante, grandie comme dans un rêve menaçant et terrible sous les remparts même de Tlemcen, Tlemcen, la ville investie, affamée et déjà réduite à composition.
Qu’advint-il ? Les indigènes ont voué aux sultans Yacoub et Youcef, qui mirent autrefois, dans la nuit des temps, la cité des Émirs en péril, une si fanatique et si vivace haine qu’il est presque impossible de se faire raconter la légende, et c’est à peine si l’Arabe interrogé sur l’histoire de ces ruines consent à vous en dire le nom, comme à regret : Mansourah.
Singulière destinée des choses humaines ! Tlemcen vouée à la destruction subsiste encore, bien plus, est demeurée la reine du Maghreb, et, toute hérissée de minarets et de mosquées, a conservé intactes les richesses de sa merveilleuse architecture. De Mansourah-la-Victorieuse, il ne reste que des débris de murailles, des tours en ruine ; sur les cent hectares jadis couverts de palais et de luxueuses demeures, colons et indigènes ont planté de la vigne. En vain son minaret de briques roses et vertes se dresse-t-il encore orgueilleusement auprès de sa pauvre mosquée. Vaincue par la Djéma-el-Kébir, le croyant fidèle n’en franchit plus jamais le seuil ; seuls les roumis troublent parfois l’abandon et la solitude de ses salles à ciel ouvert, car les plafonds ont croulé avec l’arceau des voûtes ; et des fissures des anciennes mosaïques ont jailli çà et là des pieds noueux et tordus d’amandiers, dont l’arabe nomade dédaigne même la fleur.
Le champ des iris
Il faisait ce jour-là un ciel pâle et blanc, un ciel d’hiver ouaté de légers nuages, dont la mélancolie nous donnait pour la première fois, avec la sensation de l’exil, le regret de la France ; et, fatigués de monter et descendre les éternelles petites rues étroites aux maisons crépies à la chaux, plus las encore de haltes et de marchandages devant les échoppes en tanières des ciseleurs de filigranes et des tisseurs de tapis, nous avions pris le parti d’aller promener notre ennui en dehors de la ville, dans cette campagne à la fois verdoyante et morne, que le Djebel-Térim et ses hauts contreforts crénelés et droits attristent encore de leur ombre.
Je ne sais plus quel officier de la place nous avait parlé, la veille, du tombeau d’un marabout fameux, bâti à mi-côte, à quelques lieues de Tlemcen, et dormant là, depuis déjà des siècles, auprès de la mosquée, toute de mosaïque et de bronze, d’une petite ville en ruine, cité mourante du fatalisme de ses habitants, Bou-Médine ; et il nous avait plu à nous, qui l’avant-veille avions visité Mansourah, la ville morte, d’aller contempler de près ce grand village arabe, s’émiettant pierre à pierre autour de sa mosquée par obéissance au marabout enterré là ; car l’arabe de Bou-Médine ne relève jamais, n’étaye même pas sa maison qui s’écroule. Il laisse s’accomplir la volonté d’en haut ; et quand son toit est effondré et la porte de son seuil pourrie, il se lève et va ailleurs ; et c’est peut-être en vérité le secret du charme enveloppant, un peu triste et berceur, de Tlemcen et de son paysage, que cette antique ville arabe renaissant sous la domination européenne entre Mansourah, la ville morte, et Bou-Médine, la ville mourante, qui va s’effritant d’heure en heure et se dépeuplant de jour en jour.