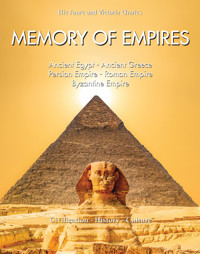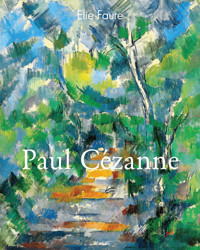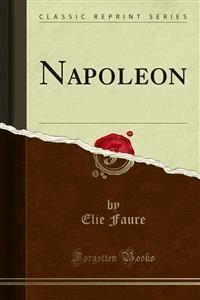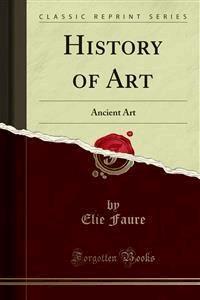1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L'ouvrage 'Histoire de l'Art: L'Esprit des formes' d'Élie Faure constitue une exploration magistrale des mouvements artistiques depuis la préhistoire jusqu'à son époque. Avec un style synthétique et poétique, Faure allie rigueur historique et sensibilité esthétique, révélant l'âme des œuvres à travers leurs formes et leurs contextes culturels. Son approche humaniste et philosophique s'inscrit dans une période où l'art commence à être appréhendé non seulement comme une pratique technique mais également comme un reflet de l'esprit et de la sensibilité d'une époque. À travers des analyses minutieuses, il explore comment les formes artistiques traduisent les émotions et les pensées des sociétés qui les ont engendrées. Élie Faure, médecin de formation, était également passionné par l'art et la culture. Cette dualité de formation l'a mené à une réflexion profonde sur la beauté et son rôle dans la vie humaine. En tant que critique d'art influent et historien, Faure a su tirer parti de ses connaissances scientifiques pour apporter un éclairage original sur la création artistique. Il a été un fervent défenseur de l'importance de l'art dans l'éducation et la compréhension de l'homme, mettant en lumière l'interconnexion entre l'art et la société. Ce livre est vivement recommandé à toute personne désireuse d'approfondir sa compréhension de l'art. Faure parvient à captiver ses lecteurs par son érudition et sa passion, offrant une lecture enrichissante tant pour les amateurs d'art que pour les néophytes. Son analyse transcende les simples dates et mouvements artistiques, incitant le lecteur à percevoir l'art comme un dialogue continu entre l'humanité et ses formes d'expression créatives. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction succincte situe l'attrait intemporel de l'œuvre et en expose les thèmes. - Le Synopsis présente l'intrigue centrale, en soulignant les développements clés sans révéler les rebondissements critiques. - Un Contexte historique détaillé vous plonge dans les événements et les influences de l'époque qui ont façonné l'écriture. - Une Analyse approfondie examine symboles, motifs et arcs des personnages afin de révéler les significations sous-jacentes. - Des questions de réflexion vous invitent à vous engager personnellement dans les messages de l'œuvre, en les reliant à la vie moderne. - Des Citations mémorables soigneusement sélectionnées soulignent des moments de pure virtuosité littéraire. - Des notes de bas de page interactives clarifient les références inhabituelles, les allusions historiques et les expressions archaïques pour une lecture plus aisée et mieux informée.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Histoire de l'Art: L'Esprit des formes
Table des matières
Introduction
Dans la tension entre le flux vivant des sociétés et la fixité apparente des œuvres, L’Esprit des formes suit la manière dont l’art métamorphose l’énergie collective en structures sensibles, faisant de la forme un souffle qui se prolonge d’époque en époque, de lieu en lieu, et révélant, au-delà des styles, un mouvement continu où les architectures, les corps et les images se répondent, s’opposent, se renouvellent, de sorte que regarder une peinture, une pierre ou une silhouette revient à éprouver la poussée de l’histoire elle-même et la logique secrète qui ordonne ses retours, ses ruptures, ses recommencements.
Histoire de l’Art: L’Esprit des formes d’Élie Faure est un ouvrage d’histoire de l’art à visée synthétique, rédigé en France dans la première moitié du XXe siècle, au moment où s’affirment de nouvelles pensées de la culture et de la modernité. S’inscrivant dans le vaste cycle Histoire de l’Art de son auteur, le livre propose un cadre où l’évolution des formes est envisagée à l’échelle longue des civilisations. Ni traité technique ni simple catalogue, il se présente comme un essai ample, destiné à donner des repères intelligibles aux lecteurs face à la profusion des images et des héritages.
La prémisse n’est pas narrative au sens romanesque, mais elle installe un parcours: suivre les formes comme on suit un courant, avec des remous, des accélérations et des confluences. La voix est assurée, méditative, parfois lyrique, cherchant l’alliance du regard et de la pensée. Le style adopte un rythme ample, qui préfère la continuité des transitions aux ruptures abruptes, et qui fait naître des rapprochements sans forcer la démonstration. Le ton demeure ferme, mais hospitalier, invitant le lecteur autant à ressentir qu’à comprendre, et à se tenir à hauteur d’œuvre plutôt qu’à hauteur d’archives.
Les thèmes centraux apparaissent progressivement: la forme comme énergie condensée, l’œuvre comme nœud de forces historiques, le dialogue incessant entre traditions et inventions. Faure insiste sur la dynamique plutôt que sur le détail descriptif, faisant valoir que l’art témoigne d’une manière d’habiter le monde. Il interroge la puissance de synthèse des grandes architectures, la gravité des corps sculptés, la vibration propre aux images, pour y lire des attitudes face au temps, au sacré, à l’espace social. Loin des écoles closes, le livre explore des correspondances qui relient des époques éloignées par des ressemblances de souffle et de structure.
Sa méthode tient de la synthèse: il assemble des vues générales, propose des constellations de formes et met en évidence des rythmes communs. Plutôt que d’accumuler des données, l’ouvrage s’attache à la logique des ensembles, à la courbe d’un style et à la pesée des milieux qui le conditionnent. On y perçoit une attention constante aux rapports d’échelle, aux masses et aux directions, aux tensions entre technique et vision. L’approche, critique sans être polémique, vise une intelligibilité qui demeure sensible, afin que l’argument historique ne dessèche jamais l’émotion ni la force d’évidence des œuvres.
Pour les lecteurs d’aujourd’hui, sa pertinence tient à cette capacité de relier: relier les arts entre eux, relier les formes à des expériences humaines partagées, relier l’histoire à notre présent saturé d’images. À l’heure des lectures fragmentaires, ce regard de grande amplitude apprend à discerner des continuités, à situer un geste, à mesurer le poids d’une solution plastique. Il suggère des manières de voir qui se convertissent en outils d’analyse, mais aussi en ressources d’attention. Lire ce livre, c’est aussi éprouver qu’une réflexion sur la forme éclaire des questions de mémoire, de communauté et de devenir.
Entrer dans L’Esprit des formes, c’est accepter une boussole plutôt qu’un itinéraire, une orientation plutôt qu’un inventaire. Le lecteur y trouvera moins des réponses closes que des lignes de force, propres à susciter la curiosité, à ouvrir des comparaisons, à multiplier les points de vue. Cette introduction à la lecture lente des œuvres ne sépare jamais l’idée de la sensation. Elle propose un compagnonnage critique qui n’impose pas, mais qui accompagne, et qui, ce faisant, laisse à chacun le soin d’éprouver la continuité d’un mouvement, du passé vers l’à-venir, où les formes servent de passerelles.
Synopsis
Élie Faure propose, dans Histoire de l’Art: L’Esprit des formes, une lecture morphologique de la création artistique qui dépasse les classements scolaires. Plutôt que d’aligner des dates ou des écoles, il suit l’énergie qui donne naissance aux formes, envisagées comme expressions organiques de la vie des sociétés. L’ouvrage articule une méthode où l’art n’est pas séparé de l’histoire, de la technique et des croyances, mais en constitue l’empreinte sensible. Faure décrit un mouvement continu, fait de tensions et de résolutions, où chaque style répond à des nécessités collectives et transforme, par son langage propre, l’espace, le temps et la matière.
Partant des sociétés les plus anciennes, Faure s’intéresse aux conditions matérielles et spirituelles qui façonnent la naissance des formes. L’architecture occupe une place motrice: elle ordonne l’espace, concentre les forces sociales et fixe des rapports de masse, de rythme et de lumière que les autres arts relaient. Les techniques, les outils et les matériaux ne sont pas de simples moyens, mais des matrices qui orientent la vision. Les premières images s’attachent à stabiliser la peur, célébrer la durée, négocier avec le sacré. Ainsi se met en place une grammaire où structure et symbole s’interpénètrent et impriment aux œuvres une nécessité collective.
Faure décrit ensuite des bascules où la priorité accordée à l’ordre, à la mesure ou à l’élévation intérieure redistribue les formes. Il ne fige pas l’Antique et le Médiéval en oppositions simplistes; il montre comment, selon les milieux, l’espace se clarifie ou s’ouvre à l’infini, comment le poids, la poussée, la lumière se recomposent. Les édifices, la sculpture et la peinture traduisent des conceptions du monde: stabilité terrestre, tension vers l’invisible, articulation des communautés. Des solutions structurelles entraînent des conséquences plastiques: proportions, axes, vides actifs. Chaque ensemble formel condense un horizon de croyances et de pratiques, plutôt qu’une formule esthétique isolée.
Avec la redéfinition de l’homme et du savoir, les formes se reconfigurent autour du corps, de la perspective et de la scène publique. La recherche d’un espace mesurable, le déploiement de la narration et la circulation des regards déplacent l’équilibre entre structure et apparition. Faure insiste sur la manière dont la peinture, la sculpture et les arts de la représentation prolongent l’architecture en modulant volumes, lumières et mouvements. Les forces politiques et religieuses orientent les solutions baroques ou classiques, sans en épuiser l’inventivité. Les œuvres orchestrent alors des champs de tensions: gravité et élan, mesure et débordement, continuité et rupture.
À l’époque industrielle, l’irruption des machines, de la ville et des flux transforme la sensibilité. Les formes se fragmentent, se simplifient ou s’agrègent en synthèses inédites, tandis que les matériaux nouveaux et les procédés mécaniques redistribuent le travail de l’artiste. Faure s’attache aux problèmes qui reviennent sous d’autres modalités: la conquête de l’espace, l’inscription du temps, la dynamique des masses. Les arts visuels explorent l’abstraction, la vitesse, la discontinuité; de nouveaux médiums, dont l’image animée, déplacent l’échelle de l’expérience et regroupent les foules. Cette modernité n’abolit pas le passé: elle le réinterprète en systèmes ouverts, adaptatifs.
Tout au long de l’ouvrage, Faure conteste les taxinomies figées et privilégie des lignées d’énergie qui traversent les périodes. Il suit des problèmes fondamentaux — masse, rythme, lumière, surface, profondeur, mouvement — et montre comment chaque époque les travaille selon ses besoins. La notion de forme ne désigne pas un contour décoratif, mais une organisation vivante qui relie techniques, institutions et imaginaires. L’artiste n’est pas isolé: il cristallise des forces collectives, parfois contradictoires, et leur donne une nécessité lisible. Les styles apparaissent ainsi comme des réponses cohérentes, non comme des accidents ou des caprices individuels.
L’Esprit des formes se présente alors comme une histoire générale attentive aux continuités et aux métamorphoses plutôt qu’aux ruptures spectaculaires. En reliant images, édifices et gestes techniques à leur milieu, Faure propose une intelligence des arts comme systèmes de relations. Cette perspective invite à percevoir dans chaque œuvre un nœud de forces sociales, sensibles et symboliques, sans dissocier l’analyse plastique de l’expérience humaine. La portée de l’ouvrage réside dans cette méthode: elle offre un cadre durable pour penser les déplacements de l’art, des traditions anciennes aux médiums modernes, et stimule une lecture active des formes en devenir.
Contexte historique
Élie Faure (1873-1937), médecin et essayiste français, compose son Histoire de l’art entre 1909 et 1921, avant de la remanier à plusieurs reprises. L’Esprit des formes désigne le noyau théorique de cette entreprise, où il cherche à dégager des lois de transformation des styles à l’échelle des civilisations. Le projet naît dans la France de la Troisième République, alors que l’histoire de l’art se professionnalise et gagne le grand public. En articulant médecine, observation et critique, Faure installe une perspective synthétique rare. L’ouvrage reflète une ambition typiquement moderniste: comprendre globalement le devenir des formes au-delà des frontières académiques.
Au tournant des XIXe et XXe siècles, Paris concentre musées, écoles et salons qui structurent la vie artistique: Louvre, École des Beaux-Arts, Salon des Indépendants (1884) et Salon d’Automne (1903). Les marchands comme Vollard et Kahnweiler promeuvent des modernités encore contestées. Le Musée d’ethnographie du Trocadéro, ouvert en 1878, expose des objets extra-européens qui nourrissent débats et comparaisons. Cette infrastructure crée un terreau pour une histoire de l’art ambitieuse et transversale. L’Esprit des formes s’y inscrit en contestant les cloisonnements institutionnels, en lisant les styles à travers leurs dynamiques internes plutôt que par les seules hiérarchies académiques du temps.
Le début du XXe siècle est marqué par de grandes fouilles et mises au jour qui renouvellent les chronologies: les chantiers d’Ur (dès 1922), les découvertes de la vallée de l’Indus publiées en 1924, ou encore la tombe de Toutânkhamon (1922). La photographie et l’édition illustrée diffusent ces images dans les métropoles européennes. Parallèlement, les collections publiques s’enrichissent d’antiques et d’arts dits « primitif » selon la terminologie d’alors. Cette expansion documentaire alimente la visée comparative de Faure. L’Esprit des formes reflète ce moment en embrassant un horizon civilisationnel large, tout en critiquant les classements rigides et ethnocentrés.
Sur le plan des idées, la période voit s’affirmer des méthodes formelles et historiques: Alois Riegl théorise le « Kunstwollen » (1901), Heinrich Wölfflin oppose « linéaire » et « pictural » (1915), tandis que la France discute l’héritage de Taine et les intuitions de Bergson. Les revues spécialisées et universitaires installent l’histoire de l’art comme discipline. Faure, sans appartenir à l’université, dialogue avec ce climat en privilégiant une lecture organique des styles et leur énergie collective. L’Esprit des formes reflète cette scène polémique en proposant une synthèse mobile, critique des déterminismes étroits comme des classifications purement érudites.
La France de Faure est traversée par l’Affaire Dreyfus (1894-1906), l’industrialisation et la guerre totale de 1914-1918, où il sert comme médecin. Les sociétés européennes prennent la mesure de la violence technologique et des recompositions politiques de l’après-guerre. Les arts sont sommés de se positionner entre tradition nationale et internationalisme. Dans ce contexte, L’Esprit des formes insiste sur la continuité des forces créatrices à travers les crises et refuse de réduire l’art à un instrument de propagande. L’ouvrage reflète l’aspiration à une histoire longue et transnationale, critique des usages idéologiques qui fragmentent ou instrumentalisent les styles.
Entre 1900 et 1930, les avant-gardes transforment les codes: fauvisme (1905), cubisme (dès 1907), futurisme (1909), dada (1916) et surréalisme (1924) déplacent le regard. La critique se recompose entre partisans et adversaires de ces ruptures. Le cinéma s’impose comme art de masse; Faure lui consacre un essai en 1919, signalant l’importance des formes industrielles. Dans L’Esprit des formes, la modernité n’est pas isolée: elle est reliée aux dynamiques anciennes des volumes et des rythmes. L’ouvrage reflète une époque d’expérimentations, tout en critiquant la fascination pour la nouveauté qui oublierait la profondeur historique des transformations.
La Troisième République étend l’instruction publique avec les lois Ferry (1881-1882) et développe une culture muséale et éditoriale. Les maisons parisiennes multiplient les synthèses illustrées et les collections accessibles, tandis que la Nouvelle Revue Française et d’autres périodiques façonnent les débats. Faure publie dans la presse et cherche une langue claire, nourrie d’images, pour un large lectorat cultivé. L’Esprit des formes s’inscrit dans cette médiation entre savoir spécialisé et public élargi. L’ouvrage reflète l’idéal pédagogique de son temps, tout en critiquant la vulgarisation qui simplifie à l’excès la complexité des filiations et des mutations stylistiques.
Les expositions universelles et coloniales, de Paris 1900 à l’Exposition coloniale internationale de 1931, mettent en scène une hiérarchie des cultures et une foi dans le progrès technique. Les artistes et critiques débattent de l’« art nègre », des arts d’Asie et d’Islam, souvent à travers des filtres exotiques. Faure s’efforce d’intégrer ces formes au récit général sans les réduire au pittoresque. Dans L’Esprit des formes, l’histoire devient comparative et organique, moins centrée sur les nations que sur des forces de composition. L’ouvrage reflète ce contexte globalisé tout en critiquant les présupposés eurocentriques de son époque.
Histoire de l'Art: L'Esprit des formes
INTRODUCTION
Faut-il s’en réjouir? Faut-il le regretter? Nous voici parvenus à un point critique de l’Histoire où il nous devient impossible de penser en profondeur — et de créer, j’imagine — si nous nous isolons dans l’aventure de notre race et refusons de demander aux expressions verbales ou figurées que les autres races ont donné d’elles, une confirmation de nos propres pressentiments. Je dis «une confirmation», bien qu’au premier abord ce soient les contradictions, ou du moins les différences qui nous frappent. En apparence, un abîme sépare de l’idole nègre ou polynésienne, par exemple, la sculpture grecque à son apogée ou la grande peinture européenne dont l’école de Venise nous a révélé les moyens et les possibilités. Cependant, l’un des miracles de ce temps est qu’un nombre croissant d’esprits soient devenus capables non seulement de goûter, avec une égale ivresse, la délicate ou violente saveur de ces œuvres réputées antinomiques, mais même de saisir dans les caractères opposés qu’elles paraissent offrir, des accords intérieurs qui nous conduisent à l’homme et nous le montrent partout animé de passions dont toutes les idoles, en accusant l’accent, révèlent les analogies.
Je n’ignore pas le danger de ces reconnaissances-là. A certaines époques — l’époque classique grecque ou française, par exemple, — il était bon que le poète ignorât qu’il représentait seulement un aspect de l’âme divine, et qu’il poussât toutes les puissances diffuses déposées en lui par la culture, ses intuitions et ses besoins dans le sens unilatéral d’une perfection étroite et très arrêté à atteindre pour exprimer le moment pathétique où sa race prétendait enfermer ces puissances dans les cadres de la raison. Cependant, nous n’en sommes plus là. Une attitude pareille, aujourd’hui, risque de rendre impuissants ceux qui l’adoptent. Pour le moment, du moins, limiter son effort à l’idéal historique d’une race, ou d’un peuple — idéal d’ailleurs transformé, ou déplacé, — refuser d’apercevoir le visage unique de l’homme sous les masques qui le couvrent, n’est plus un signe de force, mais bien de sénilité. Il est arrivé plusieurs fois dans l’Histoire à l’esprit critique, vers la fin du vieux monde par exemple, ou après l’efflorescence chrétienne du moyen âge occidental, de se trouver devant un tel amoncellement d’inconnu après avoir inventorié ses prodigieuses connaissances, qu’il a dû faire appel à tous les groupes d’hommes sollicités par les mêmes problèmes, pour en chercher avec eux la solution. De nos jours, toutefois, ce n’est plus seulement autour du bassin de la Méditerranée orientale ou dans l’Europe de l’Ouest que nous devons rassembler les éléments d’une mystique seule capable de mettre fin, du moins momentanément, à l’espèce de désarroi enivrant qui nous transporte. L’esprit critique est devenu un poète universel. Il faut élargir démesurément, et sans cesse, le cercle de son horizon.
Je ne dis pas que nous touchions à l’unification spirituelle du monde. Nous en sommes encore loin, si toutefois nous la réalisons jamais, et si même il est désirable que nous la réalisions. Mais si l’architecture industrielle, par exemple, qui cherche, avant de plaire, à poursuivre ses fins, ce qui est peut-être, après tout, le moyen de ne pas déplaire, ébauche déjà devant nous un langage universel, je ne crois pas qu’elle puisse jamais imprimer un accent uniforme à ce langage, et je ne le lui souhaite pas. La mobilité de l’esprit, favorisée par les exigences des milieux et le brassage des espèces, doit à mon sens continuer à accepter toutes les variétés vivantes de ses expressions figurées se prêtant d’ailleurs, par une intelligence grandissante des conditions universelles de sa propre conservation, à être comprises d’un nombre d’hommes de plus en plus étendu. Il ne faut pas que le désir d’unité spirituelle qui croît au sein des élites, devienne, dans les multitudes, un besoin d’uniformité. Ceux qui ne sont pas capables de saisir les balbutiements de cette unité dans les idoles innombrables dont toutes les races de la terre ont jalonné leur chemin, sont aussi les moins capables d’apporter à leur propre race une contribution assez puissante pour lui permettre de marquer encore l’avenir.
Quand vous avez compris les mobiles profonds d’une tendance opposée à la vôtre — ou paraissant opposée à la vôtre — vous êtes pris pour elle d’une tendresse étrange, qui vient de ce que vous y retrouvez vos doutes et vos combats. Vous choisissez dès lors la route qui était instinctivement et devient logiquement la vôtre, avec d’autant plus de décision et d’allégresse que vous vous savez moins compris des hommes qui ont traversé les mêmes luttes que vous. Le jour où ceux qui aiment la paix comprendront la grandeur que peut revêtir la guerre, peut-être seront-ils plus près de la paix universelle dont ils veulent nous doter. Le jour où telle religion pénétrera les symboles ésotériques de telle autre, elle ne sera pas loin d’admettre les rites les plus éloignés des siens. L’académicien que révolte une idole hindoue sera plus près de Raphaël le jour où il sentira la puissance spirituelle que l’idole hindoue représente. Qu’on le sente ou non, qu’on le veuille ou non, une solidarité universelle unit tous les gestes et toutes les images des hommes, non seulement dans l’espace, mais aussi et surtout dans le temps. La notion intuitive, intime, toujours vivante et présente du temps, est d’ailleurs le meilleur moyen dont nous disposions pour saisir le sens intérieur de toutes les figures de l’espace, qu’il a déposées sur sa route comme un fleuve ses alluvions. On comprend tout, dès qu’on remonte aux sources. Un bois nègre et un marbre grec ne sont pas si loin qu’on le pense. Qu’on regarde une œuvre pure du moyen empire égyptien si l’on tient à saisir, dans l’équilibre rythmique de ses surfaces ondulantes, le passage des plans ingénus et frustes du premier aux mouvements libres, mais concentriques du second.
En fait, l’affirmation de cette solidarité n’est point le fruit d’une intuition mystique. Cette solidarité existe réellement. Elle appartient au développement de l’histoire universelle dont elle fut l’un des ressorts, peut-être le plus dense et le plus souple de tous. L’art de tout temps, l’art de tout lieu se pénètre de proche en proche. Sans doute est-ce l’art nègre immémorial qui, par la vallée du Nil, s’est répandu sur les deux mondes alors que l’art polynésien, l’un de ses rameaux peut-être, heurtait l’Amérique pour s’y épanouir, ou rencontrait dans les îles malaises les courants qui portaient, par le Gange et l’Iraouaddi, l’esprit de la Grèce et de l’Egypte transformés au passage en Assyrie, en Perse, aux Indes, en Indo-Chine, celle-ci imprégnée de l’âme chinoise d’ailleurs fécondée par l’Inde et la Perse grâce aux trouées du Brahmapoutre et du Tarim. Que la Perse, d’autre part, répande en Asie l’art arabe sorti de l’art romain et de l’art byzantin, eux-mêmes rameaux de l’art grec. que la chevauchée de l’Islam rencontre en Italie, en Espagne, en France, les formes abâtardies de cet art grec jetées par les navigateurs sur les rivages méditerranéens en remontant le Danube et le Rhône pour s’y confronter dans la cathédrale avec l’esprit musical descendu par la vallée de l’Oise des plaines du Nord, le cercle de l’art universel achève de se fermer. D’autant plus que même quand ses grandes expressions s’ignorent et que leurs sources communes se perdent dans la nuit, l’évolution de l’intelligence semble passer partout par des phases presque pareilles d’intégration organique, d’équilibre harmonique et de dissolution critique qui donnent à ses apparences des analogies surprenantes de structure, de rythme et d’accent. Qu’en suive, si l’on en doute, la marche parallèle des statues grecque et française, là des Orantes[1] de l’Acropole aux athlètes de Lysippe et au mausolée de Scopas, ici des vierges et des saints des porches de Chartres à aux des porches de Bourges en passant là par les frontons du Parthénon et d’Olympie, ici par les rois d’Amiens et les prophètes de Reims. Ou, si l’on préfère puiser au hasard dans le répertoire des formes, sans s’inquiéter des écoles et des techniques, des dates, du prétexte mythique, du caractère local, qu’on compare telle terre cuite grecque trouvée dans les tombes de Tanagra à telle terre cuite chinoise trouvée dans les tombes des Tang, tel bas-relief de Moissac ou d’Arles à tel bas-relief d’Angkor- Vat, tel rinceau d’une église d’Ile-de-France à tel rinceau d’une stupa de l’Inde, telle peinture japonaise du XVe siècle à telle peinture siennoise, et les fresques des chasseurs de rennes aux fresques des Boshimens. On y retrouvera de ces parentés émouvantes qui évoquent l’identité des origines, et font comprendre que des haches de silex ou des ossements humains ne se puissent qu’à peine distinguer les uns des autres, qu’on les découvre sous les alluvions du Missouri ou du Niger ou roulant parmi les galets d’une rivière de France ou d’un torrent de l’Alaska.
Il est dès lors naturel que l’intelligence, après avoir, par la grâce des archéologues, classé rigoureusement les formes figurées qui l’expriment en tous lieux et depuis toujours, tende à retrouver sous leurs divergences une sorte d’unité de plan, suivant un travail analogue à celui qu’effectua Lamarck vis-à-vis des formes naturelles différenciées par ses prédécesseurs. L’esprit des formes est un[1q]. Il circule au dedans d’elles comme le feu central qui roule au centre des planètes et détermine la hauteur et le profil de leurs montagnes selon le degré de résistance et la constitution du sol. Les images des dieux sont aussi instables que possible, même s’il s’agit des dieux d’un même peuple, précisément parce qu’elles représentent, dans le monde des apparences, la circulation invisible d’une force permanente, et décidée à briser ou à dé former les obstacles, qui parcourt ses artères, anime ses nerfs, soude et sale ses os depuis l’origine de l’homme. C’est la permanence de cette force qu’il s’agit de retrouver et de mettre en lumière sous la diversité et la variabilité des symboles qui la dissimulent. Je ne demande pas mieux qu’on la qualifie de Dieu, à condition qu’elle reste insaisissable en son essence et ne laisse apercevoir de temps à autre qu’un aspect plus ou moins essentiel, plus ou moins profond de son être, que la tâche du poète est précisément de révéler avant qu’il s’évanouisse pour toujours. Un mythe fort émouvant de la cosmogénie polynésienne nous apprend qu’un dieu ne devient dieu qu’au moment où il devient forme. C’est vrai. Mais il est vrai, aussi, qu’au moment où il devient forme, il commence de mourir.
Ainsi, l’œuvre exprimant l’unanime drame Plastique est pour nous d’autant plus poignante qu’elle s’efforce de donner plus de stabilité et d’imposer des lois statiques plus durables à une image de la vie qu’elle sent plus instable et plus entraînée dans le devenir par un dynamisme plus impérieux. Toute l’histoire d’un artiste, toute l’histoire d’une école, toute l’histoire de l’art est dominée et conditionnée par ce drame, — par l’impérissable désir de retenir la vie universelle qui nous échappe à tout instant, dans l’image capable de la définir pour toujours. Si l’on ne conçoit pas cela, aucune forme d’art n’est intelligible en dehors du naturalisme le plus étroit. Si l’on conçoit cela, les formes les plus éloignées des apparences de la vie, — l’art aztéque, par exemple, qui est à peu près illisible au premier coup d’œil et réunit, dans ses équilibres de masses, les objets et les organes les plus hétéroclites et souvent les moins définis, — deviennent immédiatement et pleinement intelligibles. Elles conquièrent cette vertu de viabilité surnaturelle où communient les plus hautes expressions du lyrisme, ivresse de la vie montante prenant conscience de son ascension. Le modeleur de dieux, au fond, c’est l’univers spirituel courant sans cesse à la poursuite de son centre de gravité qui s’offre et se dérobe tour à tour à son étreinte. Il n’est que l’humble et merveilleuse image de l’ordre cosmique lui-même, cet état d’équilibre provisoire entre deux chaos. Ceux qui nient que l’art soit utile voudront bien se représenter ce qu’il adviendrait de l’homme, si la force qui maintient les planètes dans leur orbite cessait tout d’un coup d’agir.
Ce sont là de bien grands mots peut-être, si l’on songe à telle fable de La Fontaine, à telle figurine béotienne, à telle enluminure persane, à telle folle jeune femme de Fragonard offrant entre deux doigts la fraise de son sein. Cependant pourrions-nous saisir la grâce la plus furtive, goûter l’accord discret des tons les plus délicats, pénétrer l’angoisse ou la douceur de ces yeux qui nous regardent, si des antennes subtiles, parties des centres secrets de notre sensibilité, ne l’unissaient infailliblement à leurs attractions mystérieuses, si impondérables soient-elles, par des lignes de force assurant la solidarité physique, et biologique, et spirituelle de leur structure et de la nôtre, et affirmant la présence, en elles comme en nous, de deux besoins d’harmonie analogues que leur accord inattendu enivre de sécurité ? Il n’y a rien d’incompatible entre cette certitude mathématique que nous cherchons confusément dans l’œuvre d’art et sa vie toujours fuyante et toujours attirante que nous ne pouvons y surprendre que par éclairs. Nous goûtons, bien au contraire, dans cette fuite perpétuelle, une obscure consolation, sitôt du moins que nous savons qu’elle tourne sans lassitude autour d’un centre qui existe en nous comme en elle, bien que nous soyons incapables de le situer et de le fixer pour toujours. Ainsi le drame reste ouvert, et cette angoisse indéfinie de l’homme qui lui offre, jusqu’à ce que l’univers ait cessé d’exister pour lui d’abord, pour son espèce ensuite, un champ sans limite visible d’émotion et d’activité. Je pense que c’est le caractère à la fois logique et flottant, tragique et consolant de l’art qui veut que toutes les définitions qu’on en a données et en donnera soient restées et doivent rester incomplètes. L’art, qui est notre raison d’être, ne périra qu’avec nous. C’est lui qui nourrit et maintient notre énergie spirituelle. C’est lui qui nous livre le secret de l’effort sans espoir mais nécessaire de Sisyphe. L’homme sort des cendres de l’homme et revoit la face divine dès qu’il surprend des germes dans les cendres de l’autel qu’il a renversé.
Je crains de ne pas être parvenu à maintenir, entre les pages de ce livre, cette circulation grandiose d’énergie qui rend aussi sûrement solidaire la moindre image d’oiseau trouvée dans les sables d’Egypte d’un aéroplane actuel, que la plus effacée des silhouettes de mammouth gravée sur les parois du Fond de Gaume de la pagode de Sriringam ou dit Parthénon de Périclès. J’aurais aussi voulu montrer comment la statue arrachée d’un temple quelconque reproduit les profils mêmes de ce temple entre ses plans dont les ondes mouvantes vont saisir dans l’espace, pour les incorporer à elles, les passages et les reflets qui déterminent la peinture et font naître de la peinture, par leurs rythmes enchevêtrés, des harmonies invisibles d’où la musique jaillira. J’aurais voulu, enfin, réduire à quelques rapports évidents l’innombrable complexité des relations révélées par la variété innombrable des images, et la profondeur des abîmes que leur étude creuse en nous. Il me semble en effet probable que les rapports exprimés par Phidias, par exemple, bien qu’ils nous paraissent simples, n’en restent pas moins essentiels, et que si l’ébranlement qu’inflige une cathédrale ou une symphonie de Beethoven à notre sensibilité est plus nombreux et plus intense, c’est que les éléments analytiques exprimés par elles ne font pas encore aussi intimement partie de nous que les idées où l’esprit de Phidias reconnut autrefois ses sources. Ce que nous appelons «profondeur» est peut-être au commencement de chacune de nos enquêtes. On retrouve, chez les penseurs d’avant la venue de Phidias, des intuitions aussi complexes que celles des philosophes de l’Inde ou de l’Allemagne, intuitions qui contribuent toutes à former l’harmonie intellectuelle en apparence très épurée de Platon. Une courbe unique exprime un jour ce qu’évoquaient confusément jusqu’alors cent courbes enchevêtrées. La simplicité est une incessante conquête que des embûches attendent à tous les tournants de la route et qu’il n’appartient qu’aux poètes d’arracher à la somme immense et toujours renouvelée de l’inconnu.
Je n’ai donc pas pu, je n’ai pas su être plus simple. Et peut-être, après tout, n’est-ce point là ma fonction. Je regarde danser, hélas! je ne suis point un danseur. L’être le plus candide peut sentir, ou même exprimer le plus admirable poème que l’être le plus compliqué se montrera toujours incapable de comprendre et d’expliquer. Tant qui créent ou agissent avec leur puissance directe alors que moi je souffre et doute de saisir une solution qui ne cesse de me fuir. On peut trouver dans le moindre croquis d’un maître — ou peut-être bien d’un petit garçon qui dessine en tirant la langue — de quoi ruiner l’édifice que j’ai tenté de bâtir et qui représente trente années de méditation. Dieu est un enfant qui s’amuse, passe du rire aux larmes sans motifs et invente chaque jour le monde pour le tourment des abstracteurs de quintessence, des cuistres et des prédicants qui prétendent lui apprendre son métier de créateur.
(Daumier.)
.
(Tple roman France-Bretagne. )
.
Cl. M. H.
LE GRAND RYTHME
I
Plus j’avance, plus j’observe, plus je me regarde vivre, moins je conçois qu’il soit possible de considérer l’histoire des peuples et l’histoire de l’esprit autrement que comme une série d’alternances tantôt rapides et tantôt précipitées, de désintégrations par la connaissance et d’intégrations par l’amour. C’est le rythme que Laplace, Lamarck, Spencer surprennent dans l’évolution du drame universel même, partant de la phase originelle où la nébuleuse se forme, pour aboutir à la phase terminale où les soleils brisés et les planètes mortes rentrent dans la poussière des cieux, en passant par les étapes successives qui vont de la matière à la vie, de la vie à l’esprit, de l’esprit à la matière où il se perd et se retrempe, après qu’il l’a conçue et ordonnée un moment. C’est le rythme du drame chimique où la synthèse et l’analyse s’engendrent alternativement. C’est le rythme du drame physiologique où la systole et la diastole tour à tour lancent la vie à la périphérie et l’y reprennent, empoisonnée et engourdie, pour la refaire. C’est le rythme du drame biologique où, de la cellule sexuelle, surgit l’aventure de l’organisme supérieur que la faim et l’amour portent à recréer la cellule sexuelle pour se précipiter, par elle, dans un organisme nouveau.
Cl. Giraudon.
.
GRÈCE (VIIe s.)
Ce que nous savons de l’Histoire est encore et sera probablement toujours peu de chose. Peut-être, et sans doute, ne fait-elle que commencer. Mais il faut se résigner à ne rien apprendre d’elle si l’on ne se décide à chercher dans son déroulement une action, confuse à coup sûr, dont on puisse saisir l’aspect quand on la regarde de loin et qu’au lieu de la considérer selon ses soi-disant progrès, ses soi-disant reculs, ses prétendues intentions ou nos prétendus intérêts, on y cherche résolument ce rythme où l’esprit tantôt déterminé par ses événements, tantôt réagissant pour les organiser, ne joue qu’un rôle de régulateur, mais de régulateur unique. Déjà, dans ce qui reste d’elle, ce résidu d’intelligence qui persiste à la surface de ses mouvements intérieurs et y persiste seul quand tout a disparu de ces mouvements mêmes — le poème verbal qui s’inscrit dans le livre, le poème plastique qui s’inscrit dans le monument, le poème scientifique qui s’inscrit dans la formule, — il semble qu’une courbe assez nette apparaisse, dont les ascensions représentent des périodes d’association, et les descentes des périodes de dissociation morale entre les hommes, avec un maximum de cohésion aux sommets de la courbe, un maximum d’anarchie à ses points les moins élevés. Les saint-simoniens[2] qualifiaient d’ «organique» et de «critique» ces périodes alternantes. Mais ils n’ont pas cherché à en saisir le témoignage, à mon sens irréfutable, dans les idoles, les temples, les habitations, les tombeaux. Si l’on parvient à découvrir ce caractère dans ces formes, je crois qu’on est autorisé à l’étendre à l’Histoire entière dont elles constituent pour ainsi dire la cristallisation spirituelle, la vie la plus haute de l’âme arrêtée en lettres de pierre au moment où elle se contredit et se déchire dans le drame des événements.
A coup sûr, dans les faits étudiés de trop près, ce rythme n’apparaît pas aussi simple. Il y a des brisures, des bavures, des empiétements. Il y a, dans le bronze, une paille. Une fissure zèbre l’architrave. Un sentiment nouveau s’éveille, qui fait trembler la pyramide ou trébucher le danseur. Il arrive, par exemple, que chez un peuple en pleine et régulière évolution, une invasion pacifique ou guerrière rompe, disloque, ou simplement dévie la courbe de cette évolution. Sur les thèmes essentiels de la symphonie historique, qui sont tantôt l’accord de tous les éléments spirituels introduits par la multitude dans le monument, tantôt la définition, dans les œuvres individuelles, de ces éléments dispersés à la recherche d’une communion nouvelle, d’autres thèmes s’enchevêtrent, des synthèses provisoires, des recherches d’équilibre embryonnaire aussitôt brisées, des essais qui s’ébauchent, ou avortent, ou ne durent pas. Au sein de l’analyse intellectuelle qui caractérise l’esprit hellénique décidément en dissolution à partir de Socrate, la synthèse morale qui définira le christianisme balbutie déjà, même dans la forme plastique, groupes gesticulants, yeux qui s’enfoncent sous l’orbite, jeux équivoques de lumière à la surface des statues. Au sein de l’analyse occidentale, d’autre part, quand la cathédrale se disloque en France, quand le palais florentin ou siennois lui-même perd la pureté de ses profils et s’encombre d’ornements, l’organisme moral du protestantisme tente, sur les débris de l’organisme esthétique du catholicisme, d’édifier un monument nouveau. Cependant, malgré ces accidents, ces sursauts, ces reculs, ces contradictions apparentes, l’alternance grandiose de l’illusion religieuse qui dresse les temples dans une fureur d’amour et de la connaissance critique qui les renverse pour ouvrir, par une enquête minutieuse, d’autres chemins à l’esprit, reste une réalité permanente, et décisive à mon sens.
Cl. Giraudon.
.
FRANCE (XIe s.)
.
Cl. Mansell.
GRÈCE (Commencement VIe s.)
Voici l’affirmation dorique, l’unité architecturale coïncidant partout avec une unité mythique indiscutée, le monument austère où la piété unanime des foules inscrit, sur les frontons et les métopes, la danse immobile des formes, la certitude rude et saine que trahit la pureté des profils. Voici les chapiteaux ornés, la colonne frêle et cannelée, la statue isolée et de plus en plus remuante, l’artiste hors du chantier commun, dans l’atelier privé et dans le monde, le drame arraché aux conventions collectives du théâtre pour entrer dans les méandres individuels de la sophistique et du roman, la religion rongée par l’analyse, la sensualité tournant à l’érotisme pour corrompre le sentiment, l’intelligence instituant l’expérience pour substituer une vérité fragmentaire à une vérité universelle. Voici, après Eschyle, Aristote. Voici l’affirmation chrétienne, le dogme catholique bloqué dans le temple roman dont l’épaisseur et la continuité expriment sa cohérence, le rythme rigoureux des figures étirées qui peuplent ses chapiteaux et ses tympans, plus tard l’essor des piliers, le planement des voûtes, l’élan du peuple entier vers l’espoir invincible que l’univers n’est que le symbole sensible d’un monde merveilleux promis à l’unanimité, à l’ingénuité de la foi. Voici, dans les arêtes mêmes de ces voûtes, dans ces figures qui s’amenuisent et se compliquent peu à peu, une curiosité qui naît, grandit, s’affirme conquérante et tyrannique, et le symbole disparu et l’objet scruté pour lui-même, la fleur naissant du germe, l’amoureuse étudiée dans la vierge-mère, l’homme jaillissant du dieu. Voici le caractère d’imprimerie remplaçant la pierre ouvragée, l’esprit rué à la conquête du bonheur terrestre, devenant cruel pour l’atteindre et découvrant, derrière le seuil paradisiaque de la connaissance où il entrait tout ébloui, l’enfer du doute et du remords. Voici Montaigne, puis Pascal, après Dante et saint Thomas. Hier, ici comme là, l’homme allait au-devant du monde, cherchant à s’y incorporer en une vaste unité religieuse où son panthéisme intuitif s’affirmait dans son instinct à concevoir le monument selon le plan universel. Aujourd’hui, ici comme là, il rétrécit le monde jusqu’à lui, cherchant à l’incorporer à son être dans une étroite unité personnelle où son anthropocentrisme raisonné s’affirme dans son application à exprimer ses sentiments. Socrate songeant, vers la fin de ses jours, à réapprendre la musique, est le symbole conscient de cette oscillation géante qui balance sans arrêt notre histoire spirituelle des cimes de l’ivresse mystique aux cimes de la raison. Quand on a parcouru en tous sens le territoire clair, mais limité de l’intelligence, on se retrouve un jour ou l’autre au bord du gouffre de l’inconnaissable où le besoin enivrant d’une illusion nouvelle reparaît.
FIG. 7.
Cl. Giraudon.
FRANCE (Première moitié XIIe s.)
II
Si cette ébauche vous semble un peu trop schématique, imaginez l’évolution d’une statue grecque qui serait née vers le milieu du VIIe siècle pour arriver au terme de sa croissance vers le milieu du IIIe, soit pendant quatre cents ans. Et suivez du même regard la marche du corps politique qui vous livrera, si les formes ont quelque logique, la signification du rythme auquel elle doit obéir.
.
Cl. Alinari.
GRÈCE (Seconde moitié VIe s.)
FIG. 9.
Cl. Houvet.
FRANCE (Seconde moitié XIIe s.)
Dans la société hellénique telle que nous la connaissons, vers le VIIIe siècle de l’ère ancienne, par exemple, le mythe règne sans conteste[2q]. Il atteint même sa phase de pleine cristallisation. Il est, pour les hommes de la tribu, l’unique raison de naître, d’aimer, de souffrir, de mourir. Commune, universellement admise, du moins dans la même tribu, la croyance ne laisse au doute aucune prise. Certes, Dieu n’est pas un. Il est au contraire multiple. Mais la croyance est une. Et c’est cela qui est divin. C’est sur cette croyance seule que repose le principe moral unitaire sans qui ni la cité ni la famille ne seraient. Le mariage est saint, donc indissoluble. Le célibat interdit. Moralement, l’enfant n’existe qu’en fonction du père, qui lui-même n’existe qu’en fonction des ancêtres morts dont les sépultures sanctifient — et même légitiment — la propriété. Non seulement l’individu n’existe pas, mais son existence serait contraire à la conception même du foyer qui est peut-être le noyau, peut-être la contraction de la cité , en tout cas fait avec elle un organisme indissoluble dont rien, sans ruiner l’une ou l’autre, ne saurait être retranché. La liberté de l’être humain n’est ni conçue, ni concevable hors le groupement familial qui ne conçoit pas non plus la sienne hors de son enclos et de ses dieux, le groupement familial voisin la limitant de toute part. La société humaine entière plonge dans la divinité diffuse de la nature personnifiée par les dieux qui la rattachent à elle par les mille liens du rite où la loi prend son appui. La sainteté du sol est une réalité d’autant plus inexorable qu’elle représente un style spirituel plus menacé par la tribu rivale, et plus difficile à maintenir. L’univers moral est un bloc.
Or, à ce moment-là, la Xoana[3], l’idole primitive taillée dans du bois d’olivier, n’est qu’un embryon presque informe, une poupée pauvrement équarrie où les formes sont indiquées par le procédé symbolique de l’enfant qui dessine sans regarder et fait un grand rectangle pour le corps, un rectangle plus petit pour la tête, deux rectangles plus étroits et plus allongés pour les bras . Elle est, aux statues du siècle suivant, ce que sont aux plus vieux sanctuaires de marbre ces maisons de paysan qu’on voit encore de nos jours dans certaines campagnes grecques: quatre poteaux verticaux qui deviendront le péristyle, quatre poteaux horizontaux qui deviendront l’architrave . Elle satisfait au plus fruste des besoins spirituels, comme cette cabane au plus fruste des besoins matériels. Presque aucune différenciation n’existe encore, dans l’esprit de qui les a faites, entre les éléments naturels que l’une et l’autre utilisent pour la croyance ou l’abri et le sens de cette croyance et le confort de cet abri. La gangue qui l’étreint, c’est la croyance commune. Les membres en sont prisonniers, comme l’individu du principe social dont il n’ose, et ne peut, et ne veut pas s’affranchir, dont il ne songe même pas à s’affranchir, parce que cet affranchissement prématuré entraînerait tout de suite sa perte. Il ignore les rapports qui le rivent à ce principe, le régime des castes les lui imposant pour son bien. La société, comme l’idole, est impersonnelle, figée, pour ainsi dire symétrique. Les écrivains du temps sont des légistes que l’esprit des dieux inspire quand ils psalmodient, en prose rythmée, les versets de la sainte loi.
Un demi-siècle. Grâce aux frictions des familles entre elles, la famille, encore aussi ferme, est pourtant devenue moins rigide que la cité. Elle lui infuse une vie de plus en plus organique. La multiplication des cellules sociales élargit leur horizon, cependaut qu’une aristocratie étayée sur une morale intacte, et croyante dans l’intérêt de sa propre conservation, rappelle le ciseau qui tranche dans le marbre les plans les plus sommaires et les plus rigides profils. L’idole est devenue plus dense. Elle tend vaguement à la forme circulaire, comme pour assouvir un besoin primitif de continuité et d’unité. Un instinct architectonique aussi confus qu’essentiel s’affirme dans les bras pendants, les jambes parallèles, les épaules horizontales, le torse presque conique où les têtes des os et les masses musculaires ondulent déjà faiblement, tout un ensemble raide et dur dont les éléments symétriques accusent le souci d’un rythme élémentaire comme de deux pieds frappant en cadence le sol ou de deux mains se heurtant l’une l’autre à intervalles réguliers . Aucune individualité. Bien qu’on la dise tel athlète, elle est un monument impersonnel qui représente n’importe quel athlète, m’importe quel homme nu. Elle n’offre avec la statue ionienne, qui vient des îles de l’Egée à sa rencontre vers le même temps, qu’une différence de qualité ethnique, l’esprit restant le même et dégageant des rapports identiques des mêmes éléments interrogés. Les statues doriques sont des hommes, les statues ioniques sont des femmes, celles-là dures, tout d’une pièce, celles-ci sensuelles, équivoques, soumises à des plans plus furtifs, avec une tendance à la sphéricité plus insinuante, des membres plus emprisonnés . Mais, ici comme là, c’est toujours de l’architecture: rien ne sort, rien ne peut sortir de ce cylindre vertical où tous les mouvements et toutes les saillies se perdent, comme les nœuds de l’arbre, avant la naissance des branches, dans la masse du tronc rugueux. Serrée, tendue, gonflée dans cette gaine, la vie profonde y prend un caractère engourdi, somnolent encore, mais d’une impressionnante et irréductible unité.
FIG. 10.
Cl. Alinari.
GRÈCE (Première moitié Ve s.)
Un demi - siècle. L’antagonisme croissant des intérêts, les abus de l’aristocratie créent dans les masses populaires des courants sourds, qui secouent l’édifice faiblement d’abord, mais assez pour y éveiller des besoins nouveaux, des idées nouvelles. Si la solidité des castes semble encore inébranlée et peut paraître même accrue, car elles sentent menacée leur intégrité première, leur hermétisme est moins complet. Voici les héros, les chevaux de Delphes, les Cariatides de Cnide, les Orantes du vieux Parthénon. Dans ces statues émouvantes, où le mâle dorien et la femelle ionienne s’observent, mais refusent de s’unir, le plan s’affirme, dès l’abord, comme une idée plus définie, un peu moins noyée dans l’ensemble, parcouru d’un large frisson. Il s’efforce de sortir d’une formule architectonique anonyme pour édifier, dans l’argile qu’il sculpte, une idole autonome bougeant un peu, un étrange sourire aux lèvres, un pied ou un bras en avant. Le passage, encore rugueux, anime un peu les profils, fait onduler sourdement les surfaces. L’équilibre des masses s’ébauche, succédant à leur symétrie, et c’est au mouvement des puissances profondes parcourant la forme en dedans que les plans doivent leur vigueur . Le cylindre est vivant, les nœuds et les bourgeons affleurent, les branches vont pousser du tronc. Les écrivains du temps sont des poètes philosophes qui créent un système du monde, un appareil monumental à peine ébauché, mais grandiose et circulaire, qui émerge péniblement du mythe sans vouloir ni pouvoir se séparer de lui. En pensée, en politique, comme dans l’idole elle-même, l’individu s’esquisse dans quelques cerveaux monstrueux.
.
Cl. Houvet.
FRANCE (Première moitié du XIIIe s.)
Un demi-siècle. Par tribus, par partis, par classes, des groupes ardents s’organisent, encore raides, presque mécaniques, où, si l’instinct des intérêts et des besoins antagonistes s’affirme déjà puissant, les consciences individuelles de chacun de leurs éléments ne savent pas encore se définir. Le drame naît sur le théâtre parce qu’il naît dans le corps social. Si Eschyle fait peser sur l’homme les lois impitoyables de la coutume et du destin, une lueur grandit en lui, dont Prométhée a pris à Dieu l’étincelle animatrice. C’est elle, désormais, qui constitue le centre unique autour duquel, dans l’idole de ce temps-là, les masses gravitent, comme s’il s’agissait pour l’homme qui tente de se définir, de ne pas quitter encore le cercle profondément creusé autour de son action par les ancêtres, afin qu’il puisse approfondir et unifier cette action. Rude encore, mais moins tendu, le plan recueille la lumière qui l’unit aux plans voisins par des passages saccadés, mais continus, et de toutes parts orientés à construire, ou plutôt à suggérer la même surface tournante. On voit l’Aurige[4] et les guerriers d’Egine émerger du moule uniforme dont la rondeur presque absolue enfermait leurs mouvements . Dégagée de l’architecture, monument complet elle-même, pleine, définie, circulaire, la statue trouve ses rapports avec la vie universelle et reconnaît sa place au milieu de tout ce qui est. Le mythe est presque intact encore, mais son sens symbolique affleure aux cimes de l’esprit.
.
Cl. Giraudon.
GRÈCE (Première moitié Ve s.)
FIG. 13.
Cl. Houvet.
FRANCE (Première moitié XIIIe s.)
Un demi-siècle. Et nous touchons au point d’oscillation suprême où, dans un instant imperceptible et peut-être irréalisé, à mi-chemin de la sculpture qui raconte, aux frontons d’Olympie, la lutte antithétique entre les puissances de l’âme et les puissances de l’instinct, et des frontons déjà moins poignants de Phidias, l’hellénisme va définir le drame moral essentiel qui justifie l’existence de l’homme. Le choix s’impose à lui, un choix décisif. L’enivrement d’appartenir à un corps social cohérent qui oriente tous ses gestes, à une croyance commune qui lui indique sûrement ceux qui plaisent aux dieux et ceux qui ne leur plaisent pas, de provoquer, par tous ses actes, l’approbation unanime des morts, et d’autre part le désir d’explorer les nouvelles régions morales que la curiosité, l’intérêt, un désir vague mais ardent allume et développe dans son âme, son âme à lui, cet être personnel et sans doute unique dont les exigences s’accroissent, sont en présence dans son cœur. Entre les partis politiques à peu près d’égale force, une lutte incertaine et furieuse commence, marquée par des victoires, des défaites alternatives, parfois un accord d’une heure qu’impose un puissant esprit. La famille, solide encore, est devenue le foyer d’une autre lutte, plus sourde, où la personnalité des enfants, des femmes, qui grandit en conscience, en appétits, en dignité, ne trouvera plus ses limites que si la dignité, et la conscience, et les appétits de son chef demeurent dans le cadre de ses devoirs et de ses droits. La poursuite de la richesse, des jouissances et des honneurs publics qui s’y attachent, développent le caractère, l’audace, l’adresse, la fourberie de l’homme qui la veut. Le pouvoir de résoudre ces conflits universels qui appartient dans la famille au père, et au maître dans la cité, trouve son expression dans la fermeté héroïque qui permet à Sophocle d’introduire, face à l’ivresse confuse de la vieille unité morale représentée par le chœur, la volonté de l’homme noble où l’intelligence s’éveille pour combattre l’univers fatidique tout entier ligué contre lui, comme elle permet au sculpteur de la même époque d’établir, entre les masses contrastées et les gestes antagonistes, un équilibre victorieux du désordre et du chaos qui les force à rentrer dans un même ensemble et à les lancer du même élan dans un mouvement continu. La statue, où le mâle dorien et la femme d’Ionie se pénètrent dans une étreinte que la souplesse de Myron et la vigueur de Polyclète nouent et dénouent tour à tour, agit, marche, combat, repose dans une auguste liberté. Elle n’est plus seulement architecture par elle-même. Elle entre, avec ses voisines, dans un organisme plus complexe, ondulations monumentales combinées où les formes, pourtant séparées, réalisent, par leur succession, une mélodie plastique dont les courbes se balancent . C’est comme les rameaux déployés du même arbre — hier l’Aurige — qui se tordent et s’enchevêtrent, mais que la sève parcourt jusqu’à leur extrémité. On retrouve, dans la statue, toute l’harmonie de l’ensemble qui lui-même emprunte à la statue la loi de son autonomie. Ce sont des plans larges et nus dont toute la surface vibre, de longs passages silencieux qui les unissent et les animent dans un bercement sans fin. La poursuite ininterrompue des grandes houles expressives s’exerce avec l’énergie même qui lance le sang dans les veines et bande les aponévroses et les muscles sous la peau. La flamme spirituelle court dans les intervalles de silence, pour solidariser les formes d’un bout à l’autre du fronton.
.
Cl. Buloz.
GRÈCE (Milieu Ve s.)
A cet instant, et de haut et de loin, si on se refuse à voir les accidents de la route, une harmonie puissante règne. Les partis sont animés d’une vie telle que leur nécessité respective s’engendre réciproquement. L’homme est face à face avec l’homme. Il appartient avec lui à une société dont le principe est accepté de tous si ses antagonismes et ses contradictions se vivent. Le plan, dans la technique sculpturale, n’est que la persistance nécessaire des lois religieuses et sociales que l’éveil décisif de la conscience individuelle unit au plan voisin par l’ondulation du passage et la ligne du profil. La tragédie et la sculpture vivent dans la forme harmonique de leurs éléments contrastés parce que, si l’homme s’affirme, le dieu n’a pas quitté l’homme et se confronte à lui par l’instinct et la conscience, par la sensualité et la raison, par l’idée et la réalité dans le cœur même du héros.
Un demi-siècle encore. Et voici l’homme libre, tout au moins de se définir. Il l’a voulu. Il n’a pas le droit de se plaindre si progressivement le doute, l’inquiétude, l’angoisse l’envahissent à mesure que la famille se disloque, que la loi fléchit ou change, que la cité devient tantôt trop indulgente, tantôt trop exigeante à son égard, que les mythes sont discutés et que le besoin de jouir grandit avec l’oisiveté, le célibat, la fortune, l’introduction au foyer de femmes étrangères, l’introduction sur l’agora d’esclaves affranchis, de métèques naturalisés, l’introduction dans l’esprit, qui s’effémine et se complique, d’idées, d’images inconnues inventées par les philosophes, importées par les voyageurs. Les grandes synthèses cosmiques sont oubliées ou négligées, l’homme étant rentré en lui-même et y entraînant avec lui le dieu diffus qui hier peuplait le monde et vivait sous tous ses visages où le poète primitif les cherchait ingénument. Au légiste a succédé le moraliste, au théologien le psychologue, au philosophe le sophiste. Euripide, sur le théâtre, oublie ou provoque les dieux, fouille l’être réel pour lui ravir son secret. Socrate prétend apprendre à l’homme à se connaître et n’aperçoit rien dans le monde, hors de cette connaissance, qui le puisse intéresser. Aristophane a beau livrer Socrate et Euripide aux rires de la foule, il marche du même pas qu’eux, puisque la critique sociale monte sur les planches avec lui. La dialectique de Platon ramène à l’intérieur de l’être le principe de l’unité. Ce n’est pas par hasard que la démocratie triomphe à cause du besoin croissant d’égalité politique dont le citoyen émancipé réclame l’assouvissement. Voici que devient tyrannique l’arme qu’il a réclamée — pénétration des projets et des intérêts d’autrui, ruse pour les déjouer, attention toujours en éveil pour profiter des circonstances, pour provoquer le drame ou en tirer parti, esprit critique grandissant aux dépens de l’intelligence constructive — et qu’elle isole de l’ensemble l’objet poursuivi et traqué avec une attention trop méticuleuse et le souci trop mesquin du détail. L’enquête d’Aristote disperse à l’infini l’observation la connaissance, le caractère de cet objet. Ce n’est pas non plus par hasard qu’il est le contemporain de Lysippe et que la science anatomique, qu’il fonde, apparaît à l’heure même où le modelé musculaire se substitue peu à peu au plan architectural.
.
Cl. Houvet.
FRANCE (Milieu XIIIe s.)
.
Cl. Anderson.
GRÈCE (Fin_Ve s.)
Non seulement, en ce temps-là, la statue est dégagée de la gangue originelle, mais elle oublie que cette gangue fut. L’inquiétude obstinée, la sensualité l’environnent. Considérée, puis caressée avec un amour insistant, elle laisse tomber les voiles qui faisaient couler sur elle des transparences et des méandres de ruisseaux . La forme gagne en sensibilité ce qu’elle perd en énergie. En outre, la statue qui, un siècle plus tôt, ayant ramassé sa puissance, aspirait à se plonger dans les groupes décoratifs, aspire à s’en isoler de nouveau et n’y reste qu’à contre-cœur. Individualisée, elle s’essaie aux gestes inédits, aux attitudes pensives. Au risque de la disloquer, ses éléments constitutifs étudient leur propre structure. Elle ne tardera pas à rencontrer Praxitèle qui éveillera tendrement en elle les centres de la volupté. Après lui le passage psychologique va profiter de l’hésitation du plan et du flottement du profil pour empiéter sur leur domaine, brouiller, dans un confusionisme grandissant, les rapports essentiels et simples qu’ils révélèrent dans l’objet, et par là s’éloigner des contacts vivifiants de cet objet avec le monde. L’individu n’est plus fonction du monde. C’est le monde qui devient fonction de l’individu. Et comme l’individu n’est pas forcément un démiurge, il ne va plus réinventer le monde qu’au hasard de ses impulsions.
FIG. 17.
Cl. Giraudon
FRANCE (Fin XIIIe s.)
.
Cl. Alinari.
GRÈCE (Première moitié IVe s.)
Un demi-siècle plus tard, on saisira facilement les causes sociales profondes de la dernière étape de l’esprit. Les mythes, effondrés, ne soulèvent plus guère, hors les tout à fait humbles gens, que des révoltes, ou des risées. Les stoïciens et les cyniques poussent logiquement, en sens opposé, les tendances morales de l’homme jusqu’aux impasses spirituelles d’où il ne pourra s’évader qu’en renouvelant sa mystique. Tantôt sensuels, tantôt abstraits, les cultes de l’Est s’insinuent pour se substituer partout à la religion locale, écartelant chaque jour un peu plus l’ancienne unité de l’esprit. La croyance en l’égalité que tous proclament, en le disant ou sans le dire, puisque l’homme est l’égal de l’homme dès qu’il se considère comme gravitant exclusivement autour de l’un de ses deux pôles, — soit ses instincts dans leur bestialité la plus intransigeante, soit son esprit dans sa pureté idéale dégagée de tout lien charnel —, s’exaspère en raison directe de l’inégalité croissante des conditions. L’individu veut avoir raison contre la cité, contre la famille, bientôt contre l’individu. Son propre individualisme le désagrège peu à peu. L’idole est maintenant une image fantaisiste que le génie d’un isolé peut rendre fréquemment vivante, mais que la diffusion du métier et la vulgarisation de la culture condamnent le plus souvent à n’exprimer que les soucis médiocres de l’anecdote et de la mode aimés des âmes «libérées » cherchant à y tromper leur inquiétude, à y satisfaire leur niaiserie, à y frotter leur suffisance, à y guérir leur ennui.
FIG. 19.
Cl. Giraudon.
FRANCE (Première moitié XIVe s.)
La statue jouit désormais d’une indépendance égoïste qui vient accroître son tourment. Trop isolée, maintenant, elle appelle à son secours les éléments pittoresques. Son geste commence à briser le cercle idéal dans lequel elle s’inscrivait naguère presque machinalement. Le passage inonde le plan qui s’aveulit, hésite, contient mal la vie intérieure éparpillée dans le détail. L’étoffe drapée en tous sens en masque l’insuffisance . Le pinceau de l’ombre joue sur lui, l’efface, le rend équivoque ou menteur. Une ondulation imprécise enveloppe, comme une brume, la structure intérieure qui se dissimule et fléchit. Des parallélismes trop étroits, ou bien des mouvements trop excentriques raidissent ou désorbitent l’ensemble monumental. L’unité divague, ou se brise. Trop chargées, les branches cassent. Les rapports flottent et commencent à se nouer au hasard.
Quand règnent Rhodes et Pergame, un demi-siècle plus tard, l’organisme est décomposé. Dans l’anarchie sociale et politique grandissante, le brassage constant, sur tous les rivages d’Orient, des mystiques qui se confrontent, des sophistiques qui s’énervent, des intérêts privés qui se détruisent, des appels à la tyrannie bienfaisante et au barbare purificateur, les frontières plastiques sont forcées de toute part. L’architecture de l’idole n’est même plus un souvenir. Le modelé, ayant perdu le plan, tente de suivre pas à pas les incidents anatomiques qui brisent les profils et peuplent le silence naguère expressif des surfaces au profit de l’historiette pittoresque et du sentiment le plus banal. La gesticulation hagarde, complètement désorbitée, exprime un désordre moral d’où toute continuité de raisonnement et d’action, toute logique structurale, tout équilibre ont disparu. L’esprit qui, disloquant le plan, puis jouant avec le passage, avait quitté depuis un siècle les régions intérieures de la statue, se disperse aujourd’hui dans les mains qui se tordent, les jambes qui se tendent, les muscles qui se tétanisent, les visages qui se convulsent, les attributs envahissants et les cheveux éparpillés . Le centre d’attraction des masses n’est pas seulement perdu. Le sculpteur ne sait plus que ce centre existait jadis et qu’il déterminait la forme entière dont les mouvements et les surfaces gravitaient autour de lui. Dispersées à tous les incidents, à toutes les saillies de la statue, la petite sensibilité et la sensation médiocre tentent de substituer leurs cris et leur emphase au puissant sentiment global qui unissait, dans la forme monumentale, la connaissance et l’amour de l’objet à la croyance que l’objet fait partie d’un ensemble saint dont la religion, la cité, la famille, la guerre, la paix, l’aliment, la naissance et la mort sont des manifestations solidaires. On dirait que les gesticulations et les grimaces de l’idole clament son unité perdue. Ce n’est d’ailleurs plus une idole. C’est un article de bazar.