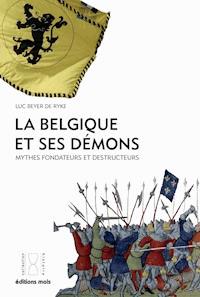Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mols
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Enquête et témoignages en milieux flamands
Toute la Flandre, ainsi s’intitule l’une des plus belles œuvres d’Émile Verhaeren. Celle dont parle Luc Beyer de Ryke est divisée. Le Mouvement flamand est en quête d’une nation. La langue, à ses yeux, est « tout le peuple ». Pour réaliser son dessein, ses protagonistes collaboreront avec l’Allemagne impériale en 14-18, avec le Reich en 40-45.
À la différence de la Wallonie, où la collaboration est réelle également, en Flandre, l’héritage, sans être revendiqué, est assumé par le plus grand nombre.
En témoigne l’enquête de terrain menée par l’auteur. Pour la réaliser, il s’est immergé dans un univers trop peu connu – parfois même totalement inconnu – des francophones.
Découvrez l'ouvrage du célèbre journaliste Luc Beyer de Ryke qui explique les causes de la collaboration en Flandre lors des deux guerres mondiales !
EXTRAIT
Oswald, lui, n’a pas attendu l’athénée et des textes d’Henri Conscience ou des poésies de Guido Gezelle pour sentir battre dans sa poitrine « le cœur de la Mère Flandre ».
C’était de naissance. Son père, Flamand, avait épousé une Allemande. À l’époque la femme suivait son mari. Gabi Guenter n’eut besoin ni du Code Civil ni des usages pour le faire. Elle embrasse avec amour et ardeur les convictions d’Herman et ses sentiments « thiois » et « orangistes ». Pour les époux Van Ooteghem la Belgique de 1830 était née d’une illégalité. « Notre roi était Willem I. » Celui que les francophones appellent Guillaume I. Des francophones qui, en particulier à Gand, étaient Orangistes et le demeurèrent jusqu’en 1840 et plus… Mais cet « Orangisme » ressemble peu à celui qui animait les parents d’Oswald.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ancien présentateur du Journal télévisé de la RTBF, à deux reprises parlementaire européen dans le groupe libéral présidé par Simone Veil,
Luc Beyer de Ryke, francophone des Flandres, fut élu au conseil provincial et au conseil communal de Gand.
Observateur de la vie politique, amoureux de l’Histoire, il cherche à comprendre « les raisons » qui ont porté une partie des Flamands à collaborer avec l’envahisseur – par deux fois –, et auxquelles un vice-Premier ministre et Ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, faisait récemment allusion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Françoise qui a partagé l’élaboration de ce livrecomme nous partageons notre vie.
Introduction
« Ils avaient leurs raisons… » Ces mots de Jan Jambon, le ministre de l’Intérieur, lorsqu’ils furent prononcés, ont rallumé plus qu’un brandon de discorde.
La braise toujours incandescente est celle de la collaboration.
Le ministre, comme le chef de son parti la N-VA Bart De Wever, la tiennent pour une erreur. Conversion tardive ou non, ils en ont fait l’aveu. Mais les propos s’accompagnaient de circonstances atténuantes dans lesquels beaucoup de francophones ont vu – à tort ou à raison – une indulgence plénière.
Tant d’années après la guerre, il subsiste une incompréhension profonde entre francophones et néerlandophones. Sans vouloir généraliser et en caricaturant quelque peu, nombre de Wallons voient une Flandre « embochée » et une Wallonie « résistante ». La question royale fut nourrie de ces stéréotypes et de ces préjugés.
Il y eut des résistants et des collaborateurs partout.
Léon Degrelle et sa légion wallonne, ceux que l’on appelait « les SS de la Toison d’Or » ou les « Bourguignons », furent là pour en témoigner.
Mais, il est vrai, le rexisme n’a pas laissé d’héritage.
Il n’en est pas de même en Flandre. L’héritage est présent. Il est partagé par une bonne partie du monde politique. À des degrés divers. Une minorité l’assume ou le revendique. Beaucoup plus nombreux sont ceux qui, émotionnellement, en sont proches.
Les francophones, lorsqu’on évoque le passé, ont les nerfs à vif. Mais ils le connaissent mal.
Aussi les propos de Jan Jambon m’ont paru l’occasion de mieux comprendre l’histoire de nos fractures et de nos déchirements.
J’entends me présenter pour ce que je suis. Un francophone des Flandres. Au fil des ans, mes fidélités sont devenues contradictoires. L’attachement à la Belgique est un enseignement qui m’a été donné dans ma famille et à l’école. Il n’a pas été oublié.
La Flandre est la terre de ma naissance. Là sont mes racines. En elles coule la sève ; ma langue, ma culture ; le français.
Ce sont là autant de complémentarités. Elles se sont muées en exclusions. Je le regrette et m’en afflige. Ce n’est pas une raison pour refuser de comprendre ce qui a conduit à cet écartèlement.
Les deux guerres mondiales ont agrandi la faille.
Nous sommes un des rares – sinon le seul – pays d’Europe à avoir connu une collaboration dès la Grande Guerre.
Quelles en furent les raisons ?
Compréhension n’implique pas adhésion.
Mais, interpellé par l’affirmation de Jan Jambon, j’ai souhaité, sans esprit polémique, m’attacher à étudier « les raisons ».
À travers l’Histoire, à travers les faits, à travers les rares survivants et leurs familles. J’ai ainsi enclenché la machine à remonter le temps. Ce qui n’est pas sans risque. Celui d’aller à la rencontre d’un monde qui n’est pas le vôtre et dont vous ne partagez ni le passé ni le présent. Celui d’être incompris par les vôtres, souvent murés dans la condamnation sans appel d’un passé haï et rejeté. Parce que le journalisme a été ma vie. Donc la curiosité. Curiosité des êtres et des événements. Ce qui implique le rejet du manichéisme. Le monde ne se résume pas aux Bons et aux Mauvais. Il y en a dans tous les camps.
Nous croyons tous dans « les Justes Causes » pour citer le titre d’un livre attachant de Jean-Louis Curtis, prix Goncourt en 1947. « Les Justes Causes ». Les nôtres. La famille, l’école, la classe sociale, des rencontres, des amitiés forgent nos convictions. Pour nombre de francophones, l’adhésion d’une partie de la Flandre à la collaboration équivaut à une plongée dans les Abysses.
Revêtons donc l’uniforme du capitaine Nemo et plongeons-y.
Chapitre I
« Ich hatte einen Kameraden »
L’Humanité est régie par plus de morts que de vivants.
La Grande Guerre, celle de 14-18, ne compte plus aucun survivant. J’ai rencontré et recueilli les souvenirs du dernier combattant de la guerre des Boers. C’était un Néerlandais qui vivait à Uccle. Il avait cent ans. Il est mort cinq ans plus tard.
Les acteurs de la Deuxième Guerre mondiale se raréfient. Le sablier du temps s’égrène. J’ai retrouvé un des protagonistes du passé trouble qui fait l’objet de mon enquête et de cet ouvrage.
Il s’appelle Oswald Van Ooteghem. Il a 90 ans et les porte bien. C’est un ancien de la Waffen SS, un ancien de la « Freiwillige Legion Flandern ». Nous avons siégé sur des bancs différents, opposés, dans les mêmes institutions lorsqu’il s’agit du Conseil communal de Gand. Lui comme représentant de la Volksunie, moi sur les bancs libéraux. Je venais du Conseil provincial où il entra à l’élection suivante en 1965. De 1974 à 1987, il occupa un siège de sénateur alors que j’étais moi-même au Parlement européen.
Lorsqu’il arriva au Conseil communal, le fait qu’il ait été dans la Waffen SS suscitait parmi nous réprobation et interrogation.
Sans renier l’idéal et les valeurs qui sont les miennes, le temps de l’interrogation est venu. Pourquoi ce chemin de vie si éloigné de celui qui m’a été enseigné, prodigué, tracé ?
J’ai demandé à mon ancien collègue de le rencontrer pour qu’il se raconte et se confie. Il a accepté et m’a reçu chez lui à Gentbrugge, ce quartier jadis commune qui depuis des années fait partie de Gand, à tel point qu’il abrite « La Gantoise », nom connu par tous les amateurs de football.
Un visage peu marqué par les atteintes de l’âge, vêtu d’un pantalon gris et d’un pull-over bleu pâle, il me reçoit avec amabilité.
L’ameublement allie harmonieusement un style moderne aux lignes épurées et un beau secrétaire en marqueterie que l’expert que je ne suis pas datera du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Deux belles amphores japonaises aux couleurs vieil or complètent le tableau. Aux murs sont accrochés quelques portraits de famille, toiles un peu sombres datant du XIXe.
L’entretien se déroulera en néerlandais, émaillé de passages en français. Réminiscences de l’époque, la mienne, la sienne, où en Flandre il n’était pas rare que l’enseignement fut prodigué en français.
Bien qu’il soit plus âgé que moi, nous avons partagé les mêmes écoles sinon les mêmes enseignants. Oswald fit ses primaires en français à Saint-Amand chez les Frères. J’y passais moi-même un an avant d’aller à l’école moyenne que rejoignit Oswald, lui en section néerlandaise, moi en section française. Ce fut ensuite l’Athénée. Il m’y précéda de dix ans.
Le souvenir qu’il en garda fut sûrement très différent du mien. De toutes mes écoles ce fut la seule que je ne regretterai pas. Elle a marqué la fracture communautaire qui fit que nos destinées à lui et à moi furent diamétralement opposées.
À l’athénée, l’enseignement était flamand. Dans ma classe nous étions une poignée de petits francophones. Lors d’un cours de littérature flamande le professeur, excellent d’ailleurs, nous fit lire un texte sur la Bataille des Éperons d’or.
Il nous enfiévra et nous divisa. Nous nous jetâmes, à la récréation, les uns sur les autres aux cris de « Vlaanderen die Leeuw ! » et « Montjoie ! Saint-Denis ! ». Le directeur dut intervenir pour y mettre fin.
Oswald, lui, n’a pas attendu l’athénée et des textes d’Henri Conscience ou des poésies de Guido Gezelle pour sentir battre dans sa poitrine « le cœur de la Mère Flandre ».
C’était de naissance. Son père, Flamand, avait épousé une Allemande. À l’époque la femme suivait son mari. Gabi Guenter n’eut besoin ni du Code Civil ni des usages pour le faire. Elle embrasse avec amour et ardeur les convictions d’Herman et ses sentiments « thiois » et « orangistes ». Pour les époux Van Ooteghem la Belgique de 1830 était née d’une illégalité. « Notre roi était Willem I. » Celui que les francophones appellent Guillaume I. Des francophones qui, en particulier à Gand, étaient Orangistes et le demeurèrent jusqu’en 1840 et plus… Mais cet « Orangisme » ressemble peu à celui qui animait les parents d’Oswald.
À l’époque il s’agissait des patrons de l’industrie textile, ceux que l’on appelait les « Katoenen Baronnen ». La Révolution belge les avait privés des tissus importés de Java et Sumatra. Manufacturés à Gand, ils contribuaient à la prospérité de la ville.
Guillaume I avait doté Gand d’une Université, d’une École Normale et avait fait creuser le Canal de Terneuzen. Un héritage que l’on a fait fructifier puisqu’aujourd’hui la construction d’écluses permet à des navires de cent mille tonnes de décharger dans le port de Gand.
Ce qui explique qu’il ne faut pas être « Thiois » comme le sont une partie des nationalistes flamands pour saluer l’œuvre accomplie.
Un comité s’est constitué, dont font partie l’ancien gouverneur socialiste Balthazar et l’échevin libéral Sas de Rouveroy, qui œuvre pour que soit édifiée une statue à la mémoire du monarque néerlandais. Sur le socle on lira ces mots de gratitude : « Dank u Willem » (Merci Guillaume). Tout est affaire de contexte.
Celui dans lequel évoluaient les parents d’Oswald était différent.
Ce qu’ils souhaitaient c’était de voir les Pays-Bas réunis. « Hollands Glorie », pour reprendre un titre célèbre. À leurs yeux, cela ne pouvait que renforcer la langue, la culture. Il fallait, pensaient-ils, suivre l’exemple donné par l’Anschluss et les Sudètes. Pour eux, il ne s’agissait pas d’annexion mais de populations « allemandes » qui s’étaient données au Reich.
Le petit Oswald est éveillé. Il écoute ses parents lui raconter l’Histoire. Une Histoire où la Belgique fait figure de « marâtre ».
1830 a détruit l’idée même de la Néerlande. La Révolution a fait perdre à la Flandre son Université. Il faudra attendre la Grande Guerre pour que le Gouverneur von Bissing la lui fasse retrouver.
Et, s’indignent-ils, les professeurs qui y ont officié furent arrêtés après la guerre ou se sont exilés aux Pays-Bas. Quant aux étudiants on leur enlève leurs diplômes ! Refonder une université flamande en Flandre, à Gand, devint l’objectif fédérateur du Mouvement flamand.
Parmi les noms liés à cette cause, il en est un très proche du couple Van Ooteghem. Il s’agit de Frans Daels.
Anversois comme sa femme – tous deux étaient francophones de Flandre –, cet éminent gynécologue en 14 fut volontaire de guerre. Il accomplit avec honneur ses obligations et fut décoré. Mais la guerre transforma l’homme. Les humiliations infligées aux soldats flamands l’indignèrent. 14-18 fut une guerre de classes et de castes. Un corps des officiers francophone, une piétaille flamande et patoisante.
Côté wallon, il en était de même. Mais pour la troupe les patois étaient romans. La ligne de démarcation sociale était moins prononcée. On s’en souvient moins et le nationalisme flamand s’ingénia à fourrager les braises.
Toujours est-il que libéré et revenu de la guerre, Frans Daels retrouva les siens à Gand où ils avaient déménagé rue Neuve-Saint-Pierre. Sa femme croyant bien faire avait fait arborer les couleurs nationales au balcon.
Son mari débarque. Avant même de l’embrasser il lui enjoint « d’enlever ce chiffon ! »
On ne s’étonnera pas que ce geste lui valut de devenir, lui le « fransquillon » repenti, une figure emblématique du Mouvement flamand.
À tel point que, l’université flamande s’annonçant, on le tenait déjà pour son premier recteur. Il fut évincé pour August Vermeylen. La protestation fut vive.
Herman Van Ooteghem organise une marche des indignés. Elle partait du Roeland, le « Stamcafé » des nationalistes. Il l’est toujours…
À l’université, les gendarmes attendaient le cortège.
Il y eut des heurts.
Le lendemain à l’aube, avant même le laitier, la police vient tirer le père d’Oswald du lit pour le conduire en prison, à la Nouvelle Promenade. « Il y eut un jugement et mon père écopa de six mois d’internement. J’avais 8 ans », raconte Oswald.
Cela marque un enfant. D’autant plus que son père allait peu de temps après en reprendre pour trois mois.
Cette fois, c’est une autre marche qui en est à l’origine. La « Grijze Brigade » (la brigade grise) des militants du « VNV » (Vlaams National Verbond) se rend à Enghien pour exiger que « Edingen » demeure flamand. La marche a lieu à l’initiative de Staf De Clercq, leader du VNV Herman Van Ooteghem y a donc conduit « ses » Gantois en uniforme.
La vérité oblige à dire qu’entre les deux guerres tous les mouvements avaient leurs jeunesses en uniforme. C’était « l’Europe en chemise », pour reprendre le titre bienvenu de Pol Vandromme.
Dans le registre des amitiés d’Herman Van Ooteghem, Staf De Clercq tenait sa place. Enfant, Oswald accompagnait son père à Sint-Kwintens-Lennik. « Je me trouvais devant un homme lippu et barbu que j’appelais Bompa. »
Pour épauler Staf De Clercq il y avait aussi Florimond Grammens. On l’appelait le barbouilleur parce qu’il noircissait les plaques de signalisation en français. Il fut élu à la Chambre comme indépendant sur une liste VNV. Il y faisait la terreur des constitutionnels… et des huissiers par l’observance sourcilleuse et tatillonne des lois et règlements linguistiques.
Après la guerre, on ne le revit plus au Parlement… mais bien à Enghien : Edingen. Je l’y ai rencontré lors d’un reportage pour le Journal Télévisé de la RTB. Il y distribuait des médailles enrubannées destinées à récompenser les gardes-frontière linguistique.
Voilà l’ambiance des enfances d’Oswald.
Mais du nationalisme flamand on va monter d’un gradin. Davantage même car il s’agira des estrades du national-socialisme. Le jeune Oswald accompagne son père à une grande exposition à Düsseldorf au titre et au thème évocateurs : « Un peuple créateur ». Nous étions bluffés par la « Nouvelle Allemagne », rapporte Oswald. Le contraste était étonnant. Gand était une ville où l’on trouvait dans certains quartiers nombre de taudis. Les fosses d’aisance au milieu de la cour. Le Bourgmestre libéral Alfred Vanderstegen se distingua par ses travaux d’assainissement et de modernisation. La tâche était immense.
« Arrivés à Düsseldorf, nous découvrions une ville riante. Des quartiers construits pour les travailleurs leur offraient des villas coquettes coiffées de toits rouges. Nous avions gagné Düsseldorf en roulant sur des autostrades. Ce qui était parfaitement inconnu en Belgique. Chez nous régnait le chômage. En 1933, à l’arrivée d’Hitler, l’Allemagne comptait 6 millions de chômeurs. Nous étions en 1937. Il n’y en avait plus ! Mieux encore, l’organisation “Kraftesfreude” assurait aux travailleurs la possibilité avec leurs salaires de se rendre en croisière en Norvège ou en Égypte. »
La vitrine est attrayante. Elle masque tout ce que l’on ne sait pas ou ce que l’on pressent à peine du nazisme. En Belgique, on connaît des scandales financiers. Degrelle ne se prive pas, le verbe haut et fleuri de s’en prendre aux « Banksters ». L’expression fait fortune pour décrire ceux qui s’y vautraient et la dilapidaient frauduleusement.
Ce tableau se complète par le contexte international.
Les Van Ooteghem sont Flamands. La Flandre est catholique. Vatican II est à des années-lumière de la foi enracinée, de l’observance des rites et des pratiques, de l’obéissance exigée et reçue par les curés et les vicaires. Une Flandre rurale où le catholicisme emprunte parfois sa ferveur à l’Espagne qui la gouverna.
Précisément, nous sommes en pleine Guerre d’Espagne. Une guerre civile, la plus terrible de toutes. Franquistes et républicains rivalisent d’atrocités. Bernanos écrit Les Grands Cimetières sous la lune et Malraux L’Espoir.
Les familles se divisent et se déchirent. Un fils Nothomb part rejoindre les Brigades Internationales, un autre les Phalanges.
Chez les Van Ooteghem, on est catholique. « Nous fûmes horrifiés d’apprendre l’assassinat de milliers de prêtres et de religieuses. Les Rouges massacraient le clergé et brûlaient les églises ! Nous étions avec Franco. »
Ce fut ensuite la Finlande. 2 millions de Finlandais attaqués et envahis par 200 millions de Russes !
« Et, rapporte Oswald, je me souviens de l’image répandue d’un gigantesque ours soviétique s’en prenant à un bébé finnois. »
La Finlande connut aussi, de manière éphémère, ses Brigades Internationales. Une légion de volontaires internationaux et une légion suédoise se portèrent au secours des Finlandais. Parmi eux, il y eut des Flamands. Un des amis d’Oswald en fut. Il n’arriva pas à temps. La Finlande avait été écrasée. Il remit cela lorsqu’ensemble Allemands et Finlandais attaquèrent l’Union Soviétique. Après la guerre, il fut fusillé…
Autant de souvenirs douloureux, tragiques qui marquent les consciences. Ils recoupent en demi-teinte une mémoire enfantine.
Je n’avais pas 6 ans et pourtant je me souviens de la tragédie finlandaise.
Parmi les figurines de petits soldats avec lesquelles je jouais, il y avait des skieurs tout de blanc vêtus. Des Finlandais. Même si l’Allemagne nous faisait peur et si le nazisme conquérant nous angoissait, chacun compatissait aux malheurs de la Finlande.
Que dire alors du pacte germano-soviétique, cette alliance – circonstancielle – entre ces deux fléaux qui avaient pour noms Hitler et Staline.
Refermons la parenthèse pour revenir aux états d’âme et au comportement des Van Ooteghem.
Finlande mise à part, l’option de ma famille et la leur n’avaient rien en commun. Chez les Van Ooteghem, le choix est fait. Celui du Reich.
Le 10 mai 40, les Allemands entrent en Belgique.
Herman, le père d’Oswald, est averti par un policier du quartier qu’il va être arrêté. Il demande à son fils de lui apporter du linge dans la demeure de l’ami chez lequel il va se réfugier. « J’enfourche ma bicyclette et m’y rends. Pour y trouver la police qui veut se saisir de moi. Je lui échappe. L’ami est arrêté. Pas mon père. Avec mon père, nous gagnons Laethem-Saint-Martin et nous réfugions chez la belle-fille du peintre Servaes. De là, nous poursuivons notre route et trouvons abri chez un instituteur des environs de Maldegem. Cet homme, inventif, avait placé sur le toit de sa maison un moulin générateur d’électricité. Des voisins le dénoncèrent prétendant que le moulin servait à émettre des signaux à l’ennemi. Des soldats belges firent irruption et le malmenèrent avec une telle brutalité qu’il en mourut deux ans plus tard !
Enfin, nous partîmes pour Bruges. C’est là que nous vîmes arriver nos libérateurs. Les Allemands ! »
Du combat idéologique, même entaché de l’admiration éperdue pour le IIIe Reich et son Führer, on passe désormais à la collaboration. C’est un autre registre, même s’il s’inscrit en droite ligne dans la foulée d’un quotidien vécu militant. Frans Daels, le « repenti », le converti à la cause flamande, le gynécologue qui fait profession de pacifisme cède à l’esprit du temps. Ce catholique convaincu, une fois que les panzers allemands ont franchi la frontière soviétique, se sent animé par le devoir de lutter contre le bolchevisme.
C’est lui qui menace l’Europe en prêchant la Révolution Mondiale. Alors, lui, l’antimilitariste, lance un appel aux jeunes Flamands. « Engagez-vous ! »
Frans Daels est un ami des Van Ooteghem. « Il devient mon parrain », rappelle Oswald. Le 21 janvier 42, le jeune homme écoute l’appel et s’engage. « Ma première raison, c’est mon aspiration à voir se réaliser l’indépendance de la Flandre. Pour cela, il faut participer. Répondre à l’Allemagne qui nous dit : “Si vous voulez l’indépendance après la guerre, il faut nous aider à gagner la guerre.”
Cette part-là de mon idéal je ne l’ai pas abandonnée. C’était mon rêve. Il le demeure ! Une Flandre libre dans une nouvelle Europe. »
Oswald et ses camarades nouvellement engagés partent pour la Pologne. Ils y trouvent des Hollandais et la Waffen SS. Mais pas la Vlaams Legioen attendue et annoncée. Sur les 1 000 Flamands, 500 rejoignent les volontaires hollandais et autant la Waffen SS.
Staf De Clercq, le chef du VNV, se fâche. D’où « un compromis à la belge »… Il y aura une légion flamande intégrée à la Waffen SS. Les hommes porteront sur la manche un lion de Flandre et les mots « Frei Legioen Flandern » (légion volontaire flamande).
Cette fois, c’est le départ. Le vrai. Adieu Pologne, adieu Tilsit et la Prusse Orientale ; les voici en Union Soviétique aux alentours de Leningrad. Nous sommes en novembre 1942. Les volontaires ont encore dans les yeux et dans leur esprit les clameurs de joie lorsqu’à Koenigsberg et en Lettonie ils furent acclamés comme des héros. Les guirlandes se sont éteintes. Ils affrontent désormais deux généraux. Le premier, c’est Vlassov à Novgorod. Lors de ce baptême du feu, beaucoup des leurs tomberont ou seront blessés. Vlassov, lui, après la bataille, passera du côté allemand. Il formera sa fameuse légion et lui aussi luttera contre le bolchevisme.
Le second général auquel les volontaires seront confrontés est plus redoutable et personne ne peut en venir à bout. Celui-là, c’est le Général Hiver. Celui qui déjà avait vaincu Napoléon et la Grande Armée. Autour de Leningrad, le thermomètre affiche -30° et peut aller jusqu’à -42°.
Blessé au pied, Oswald est envoyé à Berlin pour y suivre des cours de correspondant de guerre (kriegskor-respondant).
On le renvoie au front où cette fois il est blessé au bras droit. Jamais deux sans trois. L’aphorisme se vérifie lorsqu’à Krasni Bor, lors de l’encerclement de Leningrad, il est touché par des éclats de grenade au bras gauche. Blessure légère et pourtant un cauchemar. Trois compagnies flamandes et deux lettones avaient été précipitées dans la fournaise. Elles avaient pour mission de combler la brèche ouverte par la division Azul. Les Espagnols avaient été enfoncés. Les combats furent terribles.
« Lorsque j’ai été atteint par la grenade et ses éclats, j’étais aux côtés de mon camarade Harry De Booy. Je le vis tomber. Il était touché mortellement. Jusqu’à son dernier soupir il m’a appelé. “Oswald, Oswald”, je l’entends encore. » C’est un reporter suédois qui sauve Oswald et l’entraîne hors de la fournaise. Une fois rétabli, il est envoyé à Bad Tölz, la célèbre école des cadres de la SS.
Tant d’années après, Oswald en a conservé « un souvenir inoubliable » : « Nous nous retrouvions toutes nationalités confondues. L’idée de race en prenait un coup. Entre nous, les discussions étaient très libres. Nous bénéficiions des meilleurs conférenciers et applaudissions la Philharmonique de Munich. On amenait à Bad Tölz des officiers américains prisonniers. Plus tard, Patton en fit son Quartier Général. Il disait à qui voulait l’entendre l’admiration éprouvée pour cette école militaire. »
« Par la suite, notre commandant fut invité aux États-Unis pour en parler. Plus étonnant encore, lors de notre séjour à Bad Tölz, nous y côtoyions des prisonniers politiques. Des Allemands communistes ou homosexuels. Ce sont eux qui gardaient nos armes… Ils nous disaient : “Vous avez étés bons pour nous. Nous le serons pour vous après la guerre.” »
La guerre se terminait. En apocalypse. Oswald est sous-lieutenant. Il quitte Bad Tölz pour être dirigé sur l’Oder où il commande une compagnie du « Jeugd bataillon Flandern ».
« Nous affrontions les Russes. Beaucoup des nôtres meurent. Ils nous encerclent. C’est le sauve-qui-peut. Je réussis à franchir leurs lignes. En Westphalie, la famille d’un fermier me cache. Je parviens jusqu’à la Forêt Noire. J’y trouve un refuge… et ma femme. C’est là que je l’ai rencontrée. Nous y avons vécu jusqu’en 1949.
Sur l’insistance de ma mère, j’ai demandé un visa aux autorités belges à Baden-Baden. On me l’accorde. Mais c’est la gendarmerie française qui vint me chercher pour me reconduire au pays. Là, jugé, condamné, j’ai écopé de 3 ans de prison. Je n’en ai fait qu’un et je me suis retrouvé dans la même cellule qu’Elias. Bourgmestre de Gand de 41 à 44, en prison il était respecté. Les gardiens de « La Nouvelle Promenade », nom de la prison gantoise où nous nous trouvions, s’adressaient à lui avec des égards. Ils ne disaient jamais Elias mais Mijnheer de Burgemeester, Dokter ou simplement Mijnheer Elias. »
À la mort de Staf De Clercq, il lui avait succédé à la tête du VNV.
Elias a collaboré jusqu’à la fin, mais était déçu des Allemands. Il en était venu à juger que nazisme et catholicisme étaient incompatibles. Devant ses juges, il plaida « la générosité que nous aurions eue pour vous en cas de victoire. Nous avions décidé d’amnistier les résistants » !