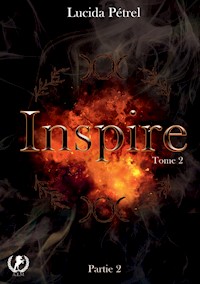Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Art en Mots Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Urban Fantasy
- Sprache: Französisch
Alex ne croit pas au hasard. Il croit en la magie, et plus encore, il croit pouvoir tuer Baalzephon. Quant à Bella, elle ne croit en pas grand-chose, surtout depuis qu’elle a rejoint l’Institut De La Haute Maison. Si elle connaît sa valeur, elle peine à savoir qui elle est vraiment.
Que se passe-t-il quand un esprit passionné et rêveur croise la route d’une âme profondément terre à terre ? D’abord, ils désertent. Ensuite, poussés par la force des choses, ils pourraient bien réfléchir à la meilleure façon de compromettre les plans de Baalzephon… Peut-être. Car Alex et Bella sont en guerre, et les ennemis sont partout.
Plongez dans une aventure captivante où magie, guerre et destin s’entremêlent.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Lucida Pétrel n’a pas d’âge mais possède de multiples voix. Elle pourrait vivre n’importe où sur Terre, en bonne compagnie des livres et des êtres qui l’inspirent. Libre comme le vent, son univers est vaste, changeant, et empli d’émotions. Là-bas, on sourit, on pleure, on ressent. Lucida n’a pas de rêve, elle préfère imaginer...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lucida Pétrel
Inspire
Tome 2
Partie 1
Urban Fantasy
Éditions « Arts En Mots »
Illustration graphique : © Graph’L
Prologue
Amalia avait regretté son choix aussitôt un premier pied dans les Terres lointaines. Personne ne s’y rendait jamais seul, pas même les Alchimistes. Et voilà qu’Amalia se précipitait entre les arbres de la forêt mondialement connue.
La Traqueuse était incapable de sentir la matière crépiter autour d’elle. La Sorcière qui la poursuivait le sentait, elle ; ce basculement dans l’atmosphère. Les arbres s’étaient agités un instant, l’herbe avait longuement soufflé : puis l’air s’était alourdi. La lumière de la lune frappait.
Amalia serra plus fort le Livre des Ombres contre elle. Plus question de le lâcher, pas après tous ces efforts pour parvenir à l’emporter. Elle serait pourtant bientôt à bout de force, et il lui faudrait bien alors remettre le grimoire entre les mains de sa propriétaire si elle voulait avoir la vie sauve. C’était à n’y rien comprendre. Amalia filait au travers du froid. Elle courait si vite qu’un mur seul n’aurait pas su l’arrêter, et pourtant : Ondolindë la rattrapait toujours. Elle était là chaque fois qu’Amalia regardait en arrière, juste là, et marchait presque paisiblement, la foudre à la place des yeux.
Amalia n’y arriverait pas. Tout était perdu. Le peregrinator était encore loin. Elle ferma les yeux et pensa à son compagnon, resté à l’Institut, et auquel elle avait promis de ne pas écouter son instinct. Il savait, tout comme elle, combien les Terres lointaines peuvent être meurtrières. Cela n’avait pas empêché Amalia de trahir sa parole. Et maintenant, son fils n’aurait plus de mère pour veiller le sommeil dans lequel l’avaient plongé les esprits des Anciennes peuplant les Catacombes de Digvix. L’enfant avait défié la tranquillité de la mort en y pénétrant ; il en avait donc payé le prix. Amalia n’était pourtant pas très loin lorsque l’accident était survenu… un enfant qui maîtrise la marche à quatre pattes est pire que tout. Elle le savait, mais elle lui avait tourné le dos, rien que quelques petites secondes. L’enfant avait à peine franchi l’entrée quand l’enchantement l’avait frappé. L’unique recours était ce vieux tas de sortilèges dénommé Livre des Ombres et dont Ondolindë ne pouvait se séparer. Sans ce grimoire antique, il était impossible pour son peuple de survivre aux Terres lointaines.
Quelle idiote prétentieuse, pensait Ondolindë. Personne d’autre qu’elle-même ne pouvait user des pouvoirs de ce grimoire. Qu’espérait donc cette Traqueuse en le lui dérobant de la sorte ?
Amalia manqua de s’affaler en pleine course. Tenir le Livre. C’était le plus important. Garder ce fichu grimoire. Même si tout lui semblait finalement perdu d’avance. Lorsqu’elle lança un regard en arrière, elle en eut la certitude : la Sorcière se rapprochait de plus en plus, elle finirait tôt ou tard par la rattraper, quand Amalia n’aurait plus l’énergie de lutter ; et alors, la Prêtresse des Terres lointaines ne ferait preuve d’aucune sorte de pitié. Elle tuerait Amalia pour protéger ses Sœurs, car dans une confrérie de Sorcières, rien ne doit pouvoir mettre en péril la sororité.
La Fée prit un virage serré et fit le tour d’Amalia. Elle irradiait et semblait à la recherche de quelque chose. Elle s’agrippa au poignet de la Traqueuse, voltigea jusqu’à son cou, s’accrocha à ses cheveux. Amalia ralentissait. À cet instant, une autre Fée apparut. Puis une autre. Et d’autres encore.
Impossible. C’était impossible. Ondolindë garda ses distances. Les Fées n’emportaient que les créatures magiques. Que mijotaient-elles en papillonnant de cette façon autour de la Traqueuse ? Amalia n’y comprenait rien non plus, mais elle y vit un signe. Celui d’une Magie débonnaire, prête à protéger une Traqueuse malgré le vol de l’un de ses grimoires.
Amalia se jeta dans les marécages. Les Fées y plongèrent à leur tour et celles qui y reposaient s’éveillèrent.
— Impossible, c’est impossible, formula à haute voix Ondolindë.
L’arbre se mouvait tranquillement. Ses branches flottaient parmi les autres têtes feuillues et épineuses, mais l’envergure de son tronc tortueux était magistrale. Personne ne l’avait plus aperçu depuis des siècles. Cet arbre, tout le monde le connaissait. L’un des premiers points de repère magique à être sorti de terre.
L’Aulne des Terres lointaines.
Amalia non plus n’y croyait pas. À vrai dire, elle ne pouvait pas rêver mieux.
— Fais demi-tour avant que je ne rende ce foutu bouquin à la Magie ! menaça la Traqueuse.
Dos au Grand Aulne, elle suspendit le Livre des Ombres au-dessus du marécage dans lequel elle baignait presque. La Magie était décidée à la protéger, elle en était maintenant certaine ; pour quelle autre raison cet arbre aurait-il choisi de pointer sa cime à ce moment précis ?
— Te rends-tu compte de ce à quoi tu nous condamnes ?
Ondolindë n’en revenait pas. Elle se souvint alors pourquoi son peuple ne s’était jamais asservi à aucun Institut : parce que tous ceux qui prétendent apporter la paix aux Ombres sont ceux qui ont auparavant provoqué la guerre.
L’Aulne étendit étrangement ses branches les plus basses.
— Maudite Traqueuse, vociféra Ondolindë, vaincue. Tu m’arraches ce que je possède de plus précieux, je ne peux que te rendre la pareille.
Un geste du menton accompagna ses dernières paroles :
— L’enfant que tu portes ne sera pas le tien, mais celui de la Magie la plus impure qui soit. Le feu te consumera.
Amalia sourit, vaillante. Elle savait pertinemment qu’Ondolindë se trouvait dépourvue de ses pouvoirs, puisque c’était la Traqueuse qui portait son grimoire. Et puis, elle n’était même pas enceinte. Toutes les flammes de l’univers pouvaient bien l’encercler, elles ne l’empêcheraient pas d’aller porter secours à son fils.
Un grincement hurla à travers les Terres lointaines. Amalia n’eut pas le temps de sentir le Grand Aulne s’abattre sur elle. Ondolindë s’éloignait ; l’écorce progressait et avalait la Traqueuse. Les branches s’enroulèrent autour de leur tronc comme des tentacules tandis que les Fées s’échauffaient de part et d’autre. La forêt entendit le cri perçant d’une femme, puis le Grand Aulne, replié sur lui-même, s’enflamma.
Ondolindë était déjà loin lorsque les feuilles noircies tombèrent à terre.
Chapitre 1
BELLA
On m’a encore vomi dessus. J’aurais dû lancer les paris ce matin en arrivant. Les collègues m’adressent des sourires penauds – seuls les plus courageux osent en rire – tandis que j’avance dans les couloirs. Et j’aurais dû porter une autre blouse que ma favorite.
Pourquoi les patients s’acharnent-ils contre moi, aujourd’hui ? Le karma, peut-être ? Hier, l’une d’entre eux m’a demandé d’être plus aimable. Je lui ai répondu que nous pourrions de nouveau explorer le sujet lorsque sa santé ne dépendrait plus de mon humeur.
Ou alors est-ce simplement l’épidémie de gastro qui sévit à De La Haute Maison ?
— Bah alors, Bella, t’as encore trop contrarié un gosse ?
Jérôme. Jérôme et sa grosse gueule d’abruti. Il tente une pose contre le mur, mais je ne m’attarde pas.
— Eh ! Bella ! Bah… Bah, Bella, attends… attends un peu quand même, non ?
Lui et moi en sommes à la deuxième étape : l’ignorance passive. La première consistait à l’inviter poliment à oublier mon existence. La troisième, s’il persiste, me forcera à la lui faire oublier en le frappant très fort pendant un peu trop longtemps.
Ce mec ne sait clairement pas de quoi je suis capable. Il devrait s’entretenir quelques minutes avec mes coéquipiers.
Je me dirige fermement vers les vestiaires, décidée à retourner à ma chambre pour me reposer. Les gens de l’Institut m’épuisent et le rythme auquel on nous soumet n’aide absolument pas. Tout est différent, ici. Le quotidien, l’air, la culture, la collectivité, l’intensité et la nature des émotions. C’est comme être sorti d’une eau douce pour plonger dans la mer ; ça brûle les yeux, ça pique la gorge et l’arrière-goût n’est pas terrible non plus. Heureusement, tout n’est pas déplorable.
Un bruit sourd retentit dans la pièce, suivi d’un long grincement. La main posée sur mon casier, j’admire une bouteille d’eau rouler jusqu’à mes pieds. Toujours aussi maladroite…
— Il va falloir t’entraîner dur si tu veux pouvoir assurer pendant les missions d’espionnage.
Je souris en parcourant l’endroit du regard. Léanne reste à couvert, mais je l’entends respirer. Rob entre à ce moment dans les vestiaires, sa blouse déjà dans une main et son pull à moitié ôté.
— Tout le monde n’arrête pas de parler de toi et ton nouveau record, tu le sais ?
— J’en avais une petite idée, ouais.
Rob passe devant moi. Il bâille.
— Jérôme fait le malin, mais il oublie la fois où un bébé lui a vomi dans la bouche.
J’inspire profondément.
— C’est dégueulasse, Rob.
— Ouais, mais c’est arrivé.
L’armoire d’en face tangue dangereusement quand un des casiers s’ouvre à la volée. Léanne s’en extirpe à une vitesse folle, les mains en l’air et le visage menaçant. Et alors qu’elle s’apprête à prendre Rob d’assaut, il recule d’un malheureux pas. Léanne rebondit la tête contre ses fesses et finit les siennes par terre, déconcertée.
— Léanne ? Mince ! s’écrie Rob.
La petite jauge ma réaction.
— Si ta maman te voit, elle ne va pas être contente, lui fais-je remarquer en croisant les bras.
Rob la soulève pour la porter contre lui.
— Je t’ai fait mal ?
Mais Léanne fait diversion en s’emparant de ses lunettes pour les mettre sur son propre nez, un sourire attendrissant collé sur le visage. Elle est très maligne, à n’en pas douter. C’est grâce à cette ingéniosité – ou à ce culot – qu’elle parvient à s’échapper de l’école si souvent. Et moi, j’ai toujours un pincement au cœur lorsque Sonia me demande de l’y reconduire.
— Tu as croisé ta maman en venant ?
J’ai déjà surpris Léanne ramper le long de la banque d’accueil de l’Infirmerie, tandis que sa mère s’affairait à trier des dossiers. Léanne se tourne vers moi, un index sur les lèvres. Sans prononcer un mot, elle souffle : Chhhhh…
Une terreur. Léanne est une terreur ; silencieuse, certes, mais intrépide et efficace. J’espère qu’elle conservera ces qualités lorsqu’elle deviendra une Traqueuse destinée à faire prospérer la paix.
Je lui pique son petit doigt et l’embrasse. Je ne connais pas les raisons qui encouragent Léanne à quitter l’école chaque jour pour venir gambader dans l’Infirmerie, et je me demande encore si son mutisme l’empêche de s’intégrer.
— Il faut y retourner, Léanne, avant que ta maîtresse ne vienne te chercher par elle-même, lui dis-je sans jugement.
Elle fait la moue, puis Rob se résigne à la reposer à terre. Offusquée, elle nous lance un regard appuyé avant de quitter les vestiaires, le pas bruyant.
Rob se gratte le crâne.
— Un sacré phénomène, cette petite, commente-t-il.
J’empoigne mon sac en hochant le menton de haut en bas. Enfin libre pour un sommeil de quinze heures !
— N’oublie pas que nous allons en mission, d’ici quelques minutes.
Qu’est-ce qui lui prend à ruiner ma sieste de cette façon ?
— Depuis quand ?
— Regarde ton téléphone.
Ah, oui, ce truc. Je l’apprivoise depuis deux mois et le consulter régulièrement n’est pas encore un réflexe. En fait, l’idée qu’on puisse me joindre à chaque minute avec une facilité aussi déconcertante m’agace profondément. Mon espace vital est tel que si le monde entier devait le respecter, plus aucune vie sur Terre n’existerait.
Message de Fred, ce matin : rdv aux portes à 20 h ce soir, bise.
Rob pose une main sur mon épaule.
— T’inquiète, tu vas finir par t’y faire. Prends ton temps, je crois que Josh aura un peu de retard, de ce que j’ai compris.
Josh, du retard ? Çà par exemple !
J’ai horreur des imprévus.
Une chose m’a toujours fascinée chez les Loups-Garous de De La Haute Maison : leur inconstance. Dire qu’ils sont lunatiques ferait l’effet d’une blague de mauvais goût, mais c’est pourtant la réalité.
Prenons Enzo, l’alpha. Tantôt il déploie toutes les formes de respect pour nous recevoir, tantôt il grogne, les crocs découverts. En y réfléchissant, je crois que tout cela concorde avec la présence ou l’absence de Josh. Josh est absent, le monde roule dans la bonne direction. Josh est là ? Les rails explosent et l’univers dégringole.
Parce que ce gars saute toujours en plein dans le plat et en met partout :
— O.K., d’accord : je veux bien qu’il y ait des frontières, mais au bout d’un moment les loulous, vous ne pensez pas qu’il faudra réfléchir au-delà des notions de chez soi ? Je veux dire, les Gobelins vous ont pris quelques cailloux sans importance… vous les connaissez aussi bien que moi… alors où est le problème ? Vous pourriez en profiter pour réclamer une contrepartie, histoire que tout le monde soit satisfait.
Fred ferme les yeux tandis que les miens voudraient se projeter très fort hors de leur orbite pour déboîter la mâchoire de Josh.
Un des plus jeunes Loups, posté dans un coin de la pièce, sort de sa cachette.
— « Loulous » ? Il a dit « loulous » ?!
Enzo fulmine, lui aussi. C’est à se demander lequel va se jeter le premier sur mon coéquipier. Durant une seconde, je m’imagine leur prêter main-forte.
— Nous allons en parler à notre référent, intervient Fred, ne vous en faites pas. Les règles de prospérité et de longévité interdisent la violation des frontières.
— Et est-ce que tu vas lui rapporter la connerie de ton pote, aussi ?
— Naïm, le rappelle à l’ordre Enzo.
L’alpha se rassoit. La table n’est pas bien grande. Cela s’explique sans doute par les pratiques alimentaires des Loups-Garous. Ils chassent leurs repas sur leur territoire et se nourrissent généralement sur place ; à quoi bon disposer d’un réfectoire commun, dans ce cas ? Cette bâtisse – que dis-je, cette pièce – est d’ailleurs l’unique sur le campement. Les Loups de De La Haute Maison dorment ensemble à la belle étoile, sous des bâches tendues lorsque la pluie les surprend. Je sais que les meutes d’autres Instituts peuvent avoir des us et coutumes très différents, mais je n’ai encore jamais rencontré de Loups habitant un manoir, une maison ou un camping-car, pas même délabré.
— J’en ai marre de toujours fermer ma gueule sous prétexte que ce sont des Traqueurs.
Si Josh ose encore une fois prononcer le mot « rage » dans un moment pareil, je le frappe. Par chance, il a compris mon discours de l’autre fois. Il avait tendance à oublier la situation dans laquelle se trouvent les Ombres et à quel point les Traqueurs peuvent profiter de leur statut. Dont lui, malgré ses convictions.
— Je partage ton sentiment, articule Enzo en nous inspectant tour à tour.
— Je suis désolé les gars, je parle toujours trop vite, s’excuse Josh. Je vais me rattraper. Plus de Gobelins chez vous, promis ; et je vous achète les dix prochains gibiers que vous chassez.
Les murs de chaume nous protègent du froid, mais je commence malgré tout à sentir l’air frais, à rester assise depuis si longtemps. Maintenant, je rêve d’un bain chaud en plus d’une sieste. Faute de baignoire, ce sera une douche chaude puis une longue nuit puisque le soleil s’est couché.
— Tu étais plus sympathique quand ton chef d’équipe était encore là.
J’observe mes coéquipiers. Enzo touche un point sensible, un sujet que moi-même je ne m’autorise pas à aborder.
— Eh bien il faudra te faire à ce nouveau Joshua, tranche Fred, car maintenant c’est moi le chef de cette équipe. Je te rappelle d’ailleurs que ce sujet ne te concerne pas.
Enzo ne sourit pas.
— Évidemment. J’ai bien compris où était notre place : loin sous la vôtre, il semblerait.
Chapitre 2
BELLA
Mon pull seul ne suffit plus à me protéger de la fraîcheur des nuits.
De ce côté, pourtant, du côté des jardins de l’Institut, j’ai toujours eu la sensation que l’air était plus chaud et l’atmosphère plus intense. Peut-être est-ce justement dû à la flore qui peuple l’endroit, l’emplit d’autre chose que de vide.
J’avance dans la forêt. Ici, l’impression n’est plus la même. Les forêts, de nuit, me font l’effet d’un univers froid et hanté. Les troncs creux se tiennent compagnie dans le vent qui tente de balayer les souvenirs de la journée. C’est obscur. Sinistre, familier. Intime. Je lève la tête, tente d’apercevoir un morceau de ciel entre les feuillages. Une partie des courbes de la lune est dévoilée.
C’est puissant.
Je ne vais pas aller plus loin. Je risquerais de rencontrer une équipe en pleine ronde sur le secteur. La surveillance a redoublé ces dernières semaines. À mon arrivée à De La Haute Maison, on ne parlait que de cela : des disparitions mystérieuses dont sont victimes les Ombres de l’Institut Digvix. Il en a fallu du temps pour que notre Institut réagisse un tant soit peu. La sécurité n’est pas encore une priorité, mais a fini par être élevée à un rang d’importance.
J’opère un demi-tour en soupirant. Aux portes des jardins, Fred allume sa cigarette. Il s’adosse au mur, sa fumée se fait emporter. Je le rejoins, prudente. Je pensais qu’il ne fumait plus.
— Je te croyais en train de dormir ? Tu disais être exténuée, s’interroge-t-il à son tour.
Comme quoi aucun de nous deux n’est prévisible. Je remarque son sourire vague.
— Je n’y arrive pas, finalement. J’avais envie de prendre l’air.
— Moi aussi, me confie-t-il en regardant le bout incandescent de sa cigarette.
Et le silence revient. N’étant pas une grande habituée, je réfléchis à un moyen de le rompre quand Fred s’en charge subitement :
— Je sais que Joshua peut être sacrément con, parfois, mais je ne voudrais pas que tu te trompes à son sujet.
— Il ne lui arrive pas simplement d’être con, Fred, j’ai l’impression qu’il le fait exprès en permanence.
Ses mauvaises blagues ne m’ont jamais amusée, pas un seul instant. Et je suis convaincue que ceux qui se contentent d’être drôles pour eux-mêmes ne sont pas de bonnes fréquentations pour les autres.
— Enzo a raison, quand il dit que Josh est différent depuis… enfin, tu vois.
— Non, je ne vois pas.
Ils ne l’ont jamais formulé devant moi. Son existence. Chaque mention du chef de cette équipe, que remplace aujourd’hui Fred, donne l’impression d’une ombre flottante au-dessus de leur tête, d’une présence qui marche dans mes propres pas. J’ai beau tourner le dos, personne n’est jamais là. C’est comme si cet étranger s’était éclipsé du jour au lendemain. Un disparu, voilà ce qu’il est. Ni mort, ni pourtant vivant. Et il hante l’esprit de mes coéquipiers.
Fred grimace imperceptiblement, son attention dirigée au fond des jardins. Je croise les bras, les mains emmitouflées dans mes manches.
— Ni vous ni l’Institut ne me faites confiance, dis-je. J’en ai ma claque.
Fred remue la tête.
— Je te fais confiance, Bella, ne raconte pas n’importe quoi.
— Pourtant c’est comme si votre monde entier partageait des secrets qu’on ne me confiera jamais, à moi.
Je shoote dans un caillou. Une Fée, suspendue près d’un rosier, récolte les pétales secs.
— « Votre monde » ? relève Fred.
Il tire sur sa cigarette tout en m’inspectant.
— Tu t’en exclus volontairement ?
— Si je m’en exclus ? Je débarque d’un refuge paumé à des centaines de kilomètres d’ici, Fred, et malgré toute l’énergie que j’investis depuis des semaines et des semaines dans cet Institut, c’est comme si on ne voulait pas encore m’y faire une place.
D’abord, on a exigé que je rattrape les cours de médecine auxquels mes collègues ont eu le droit pendant des années, afin que je puisse à l’avenir passer un certificat d’aptitude et espérer décrocher un poste fixe à l’Infirmerie. Ensuite, on a réclamé que je participe aux missions des équipes de Traqueurs, on m’a affiliée à l’équipe de Josh et Fred, mais seulement de façon « temporaire ». Je suis une remise en forme physique et un apprentissage pointu des arts d’attaque et de défense, tandis que mes parents m’y ont formée de mes huit ans à mes dix-huit ans. Et alors que je me démène pour l’obtention de mon certificat, j’apprends deux jours plus tôt que peu importe tous mes efforts, « l’Institut n’étant pas dans sa période la plus paisible, le groupe transitoire de direction préfère attendre l’élection d’un nouveau directeur qui pourrait prendre ce type de décision de manière réfléchie. »
D’un : ce nouveau directeur pourrait parfaitement être une nouvelle directrice, merde.
Et de deux : j’en ai clairement rien à carrer de leur souci politique, c’est ma santé mentale et physique qui est en jeu.
Je soigne depuis que je peux tenir une compresse. J’ai assisté mes parents pendant des années, jusqu’à mes seize ans où ils m’ont sentie prête à prendre en soin mes premiers patients. Alors oui, au refuge, on concoctait majoritairement des baumes, des soupes, des tisanes, des cataplasmes à base de plantes, mais je n’observe pas de grandes différences de résultat avec les médicaments que je prescris aujourd’hui – seulement avec l’autorisation de mon tuteur, attention.
L’Institut trouve mes méthodes archaïques. Et si l’Institut trouve mes méthodes archaïques, alors il nous considère, moi et ma famille, comme démodées.
— Ça viendra en temps et en heure, ne t’en fais pas trop. La Corporation vit simplement une période difficile.
Je soupire. Parce que Fred a raison. Imaginez les soupçons qui ont pu naître à mon égard à mon arrivée. En partie déshydratée, je venais de marcher durant des jours ; l’air fou que me procuraient la fatigue et la saleté n’a pas enthousiasmé grand monde, oh non. Et on n’a pas attendu une minute avant de braquer un fusil sur moi pour me faire cracher le morceau : partisane, pas partisane ? Avais-je de quoi prouver ma petite histoire de refuge bucolique ?
Pas le moins du monde.
Mais on a fini par me croire. Peut-être qu’on finira également par me faire confiance, à la longue. Et peut-être que ce chef d’équipe deviendra plus qu’un reflet sombre du passé, d’ici là.
Chapitre 3
ALEX
L’aube est toujours la même, dans cette ville. Un peu de brume encercle les bâtiments, très peu de soleil éclaire les rues. Les sourires ne sont pas instinctifs, le pas est souvent raide. Ça me fout le moral en l’air ce genre d’atmosphère.
Accoudé au balcon, j’épie tranquillement les lève-tôt qui apparaissent depuis leur porte et disparaissent presque aussitôt dans leur voiture. Quelques trottinettes passent, quelques vélos aussi. Puis Bérangère se montre, la main haute dans ma direction. Je la salue en retour. Sacrée grand-mère, toujours à vouloir me nourrir comme si je manquais de poids et à me tricoter mille couvertures en laine franchement dégueu. J’adore ça.
— Tu travailles, ce matin ?
— Ouais, et c’est moi qui paie le café !
— À tout à l’heure, mon grand loup !
Je cligne de l’œil puis m’en retourne dans le salon. Je m’étonne toujours de voir autant de meubles dans une seule pièce. Je n’ai pas pour habitude de m’installer suffisamment longtemps pour qu’émerge l’idée d’acheter une télé, mais cette fois, c’est chose faite. Je crois bien que c’est mauvais signe. Une tranquillité pareille ne dure jamais, en ce qui me concerne.
J’attrape mon bouquin au passage et me dirige vers la cuisine. On gratte à la porte. Je compile du mieux possible, mon livre dans une main et mon bol de céréales au creux du coude, pour ouvrir le verrou. Lilo, la chatte du voisin, entre en remuant le bout de la queue comme si elle me faisait coucou.
— Salut, ma douce, j’ai de quoi te faire grimper aux rideaux, ce matin.
Sans même un regard, elle trottine jusqu’au balcon en ronronnant déjà. J’enfourne une cuillerée de céréales imbibées de lait. On n’avait pas souvent ce genre de trucs, à l’Institut. J’en avais encore moins, dans les Terres lointaines.
La kitchenette devrait bientôt disparaître sous le bordel, faudrait que quelqu’un se décide à se remuer le cul…
— Tu pourrais filer un coup de main de temps en temps, Lilo, y’en a qui bossent la journée.
La petite lionne miaule depuis la porte-fenêtre, la queue sagement enroulée autour de ses pattes. Elle apprécie le soleil matinal, les yeux à demi clos et mime un brin de toilette, histoire de rentabiliser ce temps.
Je dépose mes affaires, recouvrant les quelques trous par lesquels on pouvait encore apercevoir le plan de travail. Je sors la boîte de saumon du placard et l’ouvre bruyamment, rien que pour le plaisir d’entendre Lilo réagir au signal.
— Une petite assiette pour madame et nous sommes prêts…
Nos deux petits-déjeuners dans les mains, je la rejoins.
— S’il vous plaît.
Lilo miaule en se jetant sur le poisson tandis que je m’assois à même le sol, le dos contre la petite table. Je soupire.
— Non seulement j’suis vachement plus sexy que ton papa de vingt fois mon âge, mais je cuisine aussi mille fois mieux, hein ?
Lilo lape une dernière fois son plat et vient se lover contre moi. Elle roucoule doucement.
— Ouais, je sais, elles le disent toutes une fois rassasiées.
— Combien de temps comptes-tu encore rester ?
Bérangère m’examine, les mains autour de sa tasse de chocolat chaud. Elle ne s’installe jamais ailleurs que sur le bar, avec une liste toute prête des choses qu’elle doit à tout prix me raconter.
— Tu m’as dit que tu bougeais en permanence, insiste-t-elle, que tu ne restais jamais plus de quatre semaines au même endroit. Ça fait le double que tu es ici : c’est à cause de moi, c’est ça ?
J’adopte un air dramatique, dos à Bérangère. Je pose le verre que j’essuyais, balance mon torchon sur mon épaule, et pivote lentement.
— Je suis tombé éperdument amoureux de toi au premier contact, tendre Bérangère. Rien ni personne ne peut plus nous séparer.
— Espèce de p’tit con, arrête de te foutre de moi.
— Ce qui nous lie est torride, grandiose. Physique.
Elle abat sa main sur le comptoir.
— Sois sérieux un peu !
Je me marre en haussant les épaules :
— C’est toi qui as commencé à me vanner.
— Mais ma question restait sérieuse.
Je hausse encore les épaules puis retourne à ma vaisselle.
— Je n’ai aucune raison de partir, pour l’instant, réponds-je finalement.
Je retarde l’échéance. Je commence à saturer de n’être nulle part en plus de n’être personne. Seulement, je devrais tôt ou tard quitter ce petit coin paisible pour reprendre la route, je le sais.
Bérangère s’attendrit, croise les pouces sous son menton, rehausse ses lunettes en poussant avec ses deux index. On dirait qu’elle mime un pistolet, c’est vraiment louche.
— T’as l’air d’une mauvaise psy doublée d’une cowgirl, quand tu fais ça. Et le comptoir n’aide pas, t’imagines bien.
Elle penche la tête sur le côté.
— Tu veux mon avis, mon loup ?
— Est-ce que j’ai le choix ?
— T’as l’air heureux, Alex. La plupart du temps. Puis d’un seul coup : pouf ! Tu te dissocies et t’en vas dans un autre univers, et celui-là, il ne m’inspire pas.
Elle ne sait pas de quoi elle parle, mais je la pardonne, parce que c’est Bérangère.
— Je ne crois pas que le bonheur soit quelque chose de permanent, dis-je en empilant les verres. Personne ne peut prétendre être heureux durant chaque seconde de chaque minute, durant chaque heure de chaque jour.
— Moi, si.
— Parce que tu te voiles la face.
— Tu te trompes.
Mon rire n’est pas amusé :
— Éclaire-moi.
— T’as l’air hanté, mon loup. Sache une bonne chose : les fantômes, ça traverse les murs.
Je le sais. Mieux que quiconque.
Bérangère n’a pas toutes les cartes en main pour viser juste. Je ne fuis pas un fantôme du passé, je ne fuis pas mes souvenirs ni ma propre histoire. Je n’ai rien d’un gars qui cherche à se reconstruire.
Je voyage, c’est tout. Je voyage en attendant de pouvoir rentrer.
Chapitre 4
BELLA
Je ferai mieux la prochaine fois.
La bibliothèque est vide, comme chaque soir. Je crois que je me sens plus à l’aise ici, noyée dans un amoncellement terrifiant de bouquins, plutôt qu’à l’Infirmerie. Et je ne suis pas certaine que ce soit normal. Je fais tache à côté de Rob qui transpire la passion pour la médecine ; et aujourd’hui, j’ai fait tache tout court.
Je pose mon livre sur mes cuisses. Le plafond devient soudain plus intéressant que toute autre chose au monde.
La nervosité est ma pire ennemie. Elle me laisse démunie face aux situations les plus graves ; un jour, je vais foirer sévèrement, et qui sait ce qu’il se passera ? Je pourrais tuer quelqu’un dans un moment de stress aigu, je le crois vraiment. Depuis que je me suis affiliée à De La Haute Maison, je n’ai pas eu de cesse de me remettre en question tandis que je venais chercher des réponses.
J’ai affreusement confiance en moi. J’ai confiance en moi et j’estime être quelqu’un de performant, digne d’intérêt et aimable – du moins, c’est la maxime que je me répète tous les matins.
Aie confiance en toi.
Estime-toi.
Tu peux parvenir à surmonter les obstacles du moment où tu t’en donnes les moyens.
Travaille.
Travaille plus encore.
Je ne sais pas si c’est tout à fait moi, cette femme indomptable et prête à tout. Je me sens si vulnérable, parfois… Vulnérable et anxieuse. En vérité, j’ai beaucoup de mal à gérer la détresse des autres et c’est fatal lorsqu’on exerce mon métier. Je hais cet état de sensibilité, de faiblesse. Je hais le ressentir, tout en l’acceptant chez l’autre. C’est à n’y rien comprendre.
Phil, mon tuteur, est d’avis qu’on n’est jamais trop empathique pour soigner, mais simplement parfois trop peu armé. S’il pouvait me donner un bout de son bouclier, je lui en serais reconnaissante à jamais. Il dit aussi que je dois rester moi-même et accepter mes propres faiblesses. Qu’aucun d’entre nous n’est irréprochable. Qu’il ne faut pas oublier que nous restons humains, avec nos propres perceptions, notre propre personnalité, et tout ça.
Mais c’est le cœur du problème : je n’ai aucune idée de qui je suis, de ce contre quoi je dois me battre, de ce que je dois améliorer et de ce que je dois oublier. Je suis à la fois cette jeune femme heureuse d’en découdre et travailleuse, mais aussi celle hésitante et angoissée.
Je pousse un soupir. Depuis quand suis-je aussi introspective, bon sang ?
Je lève de nouveau mon livre de sciences et inspire profondément.
— Et tu as refusé ?
L’expression de Phil me laisse penser qu’il ne comprend pas ma réaction ; elle est pourtant toute naturelle. Je veux dire, Phil est parfaitement qualifié pour prendre la place de direction vacante. Et qui ne voudrait pas d’un Phil comme directeur d’Institut ? Il est compréhensif, juste et organisé – beaucoup trop, même. Je balaie du regard son bureau agencé au millimètre près. En fait, Phil est maniaque, même s’il s’est persuadé du contraire.
Durant les moments les plus tendus, cette aptitude au rangement lui permet d’ordonner ses pensées avec une rapidité impressionnante. Phil ne doute pas, il agit ; et il ne se trompe jamais. Il maîtrise superbement cet équilibre d’empathie et de flegme dont il me parle souvent.
— Je n’ai pas spécialement envie de passer la moitié de mon temps derrière un bureau, s’explique-t-il.
Oui, je le comprends bien.
— Et puis, ajoute-t-il, De La Haute Maison a plus besoin d’un médecin que d’un directeur.
Il n’a pas tort. Je me demande pourquoi la Corporation insiste autant pour que l’Institut remplace l’ancien directeur. Tout fonctionne normalement et même très bien, malgré l’absence d’une hiérarchie formelle. Lorsqu’il s’agit de prendre des décisions, le chef des Traqueurs, celui de l’Infirmerie et celle des Alchimistes se réunissent pour délibérer.
— De toute façon, soupire Phil, on finira par nous imposer quelqu’un, et que ce soit moi ou un autre…
Ma langue meurt d’envie de formuler mes pensées, mais je me contiens. Je ne voudrais pas que Phil pense devoir se sacrifier. Pourtant, si l’Institut ne se décide pas, alors la Corporation tirera quelqu’un de ses différents secteurs et nous collera au cul n’importe qui – un fou, une incompétente, une personne qui réunit la folie et l’incompétence, qui sait.
Phil lit en moi :
— Non, Bella. La dernière chose dont l’Institut a besoin, c’est d’être conduit avec ennui et manque de volonté. Nous sommes à l’entrée d’une période difficile, tu l’as compris.
Je hoche la tête en m’asseyant sur la chaise face à son bureau. Il m’informe justement.
— Une Ombre de plus a été retrouvée morte sur le territoire de Digvix.
— Que vont-ils faire ?
— Ils ne peuvent pas faire grand-chose.
Après avoir classé son dernier dossier, Phil s’assoit à son tour. Il se masse le visage.
— Et nous ?
— On va se contenter de nous préparer au combat, j’imagine.
Je retiens ma respiration. Ma gorge se noue.
Mes parents ont déjà formulé le nom de Baalzephon devant moi. Ils l’ont décrit comme un Alchimiste devenu fou, pratiquant des expériences honteuses sur les Ombres. D’après mes souvenirs, il était affilié à Digvix il y a bien longtemps.
Il devrait être mort de vieillesse, d’ailleurs.
Selon les rumeurs qui couraient au refuge, il cherchait à décupler les pouvoirs alchimiques, c’est-à-dire à procurer à ses Alchimistes de première génération la faculté d’user de la Magie à l’infini, sans n’avoir à puiser dans aucune source. Je pense qu’on ne peut pas défier le cours des choses, je pense qu’on ne peut pas aller à l’encontre de la Magie. On raconte pourtant qu’il a atteint son objectif. Mais alors, quelle est la prochaine étape ? Pourquoi ne pas avoir encore attaqué ?
Mon esprit scientifique s’interroge : les Alchimistes de première génération doivent habituellement aspirer l’énergie de leur élément correspondant, pour ensuite pouvoir reproduire de la matière. Je parle bien de reproduction, non pas de production. Cela signifie qu’un Alchimiste de première génération ne crée pas, il emprunte, puis il rend. L’énergie qu’il aspire est ensuite libérée lorsqu’il la rematérialise et elle retourne à son élément. C’est un cycle. Il arrive rarement qu’un Alchimiste ne soit pas en présence de son élément d’affinité : la terre, l’eau, l’air, constituent notre environnement. C’est une question plus complexe en ce qui concerne le feu. Les Alchimistes ne puisent pas à proprement parler dans les flammes, mais dans la chaleur, et plus rarement encore, dans la lumière. Procurer un effet de combustion à une énergie chaude relève d’une grande maîtrise ; parvenir à rayonnement électromagnétique fort est encore plus difficile.
Ma question est : les Alchimistes de Baalzephon parviennent-ils vraiment à créer de la matière, ou peuvent-ils s’alimenter en énergie de façon continue et sans ressentir la moindre fatigue ? Car c’est généralement cela qui bloque les pouvoirs d’un Alchimiste : l’épuisement. S’il est bien un réceptacle magique à part entière, il n’est pas une créature magique pour autant. Son corps a des limites à l’usage de la Magie.
Les Alchimistes de Baalzephon peuvent-ils produire, ou reproduire à l’infini ? Dans les deux cas, comment Baalzephon a-t-il pu leur procurer une telle faculté ?
Décidément, j’ai du mal à y croire.
— Il paraît qu’il a raflé des Alchimistes et des Traqueurs, il y a quelques années. Pourquoi s’en prendre seulement aux Ombres, à présent ?
Phil siffle entre ses dents.
— C’est un grand débat.
Je fronce les sourcils.
— Que sont devenus tous ces gens ? La Corporation les a ramenés à leur Institut ?
Cette fois, Phil ricane. Un sourire ironique lui reste sur le visage.
— La Corporation a prétendu que les prisonniers de Baalzephon finissaient toujours par gonfler ses rangs.
— Alors…
— Tout le monde est mort, tous sans exception.
Je frémis. Je frémis, puis je me fige. La Corporation a-t-elle réellement abandonné ses propres défenseurs à leur sort, aux mains d’un scientifique tordu ?
— Est-ce qu’il est proche, ce Baalzephon ?
Phil ne semble plus me voir.
— Proche ? Il est déjà là, Bella.
Chapitre 5
ALEX
Il y a quelque chose. Je le sens, ça pousse. Ça ne bouscule pas. Ça ne frappe pas. Ça pousse. Je le sens.
Quelque chose grandit. Il y a quelque chose, merde, je le sens et ça m’encombre sérieusement.
— On met un pied devant l’autre, quand on marche, disait Brian.
Chaque fois, j’étais aussi furieux que s’il m’avait lui-même fait tomber.
— C’est pas moi, c’est mes pieds, d’abord.
Brian, à peine plus haut que trois pommes, m’imita en grimaçant.
— Eh ! Te moque pas de moi !
— Alors, arrête un peu de toujours rejeter la faute sur les autres !
On passait le plus clair de notre temps à rire ou à nous disputer. Et malgré ses trois pommes et quelques en question, Brian parlait déjà comme un petit vieux donneur de leçons. Je suis certain que cette manie ne l’a pas quitté.
Je souffle doucement en attrapant le manche de ma guitare. Je peux voir le ciel depuis le canapé, c’est d’ailleurs pour cette raison que je l’ai placé ici. Ça me permet de jouer tout en profitant des quelques étoiles qu’on peut apercevoir malgré les lumières parasites d’une ville qui ne sait pas dormir.
Je repose l’instrument, impatient, et m’empare d’une veste. La vue sera plus belle sans lampadaire dans les parages.
Cet immeuble est loin d’être somptueux, mais je m’y suis attaché. La peinture jaunie et écaillée fait partie de chez moi. Les escaliers dégueu, mal entretenus, sont un bout de ce qui a existé de plus familier à mes yeux depuis plusieurs années. Je me suis établi ici, sans m’en rendre compte.
Lorsque j’ouvre la porte principale, Lilo s’engouffre à l’intérieur en ronronnant. Elle détale à travers les étages, pressée de retrouver son vieux bienfaiteur. Aucun doute : je ne suis absolument pas son favori. Je souris en sortant dans la nuit.
Je vais devoir partir.
Le gars qui m’a suivi lorsque je suis rentré du travail est encore là, calfeutré dans le noir, certainement convaincu que je ne m’en doute pas. Je ne l’ai pas vu et je ne le vois toujours pas, mais je l’ai senti. Je n’ai aperçu que l’ombre d’une épaule au détour d’une rue, un mouvement furtif, ce qui m’a malgré tout suffi à en déduire le reste : pourquoi je me sentais épié ces derniers jours, ce sentiment de nostalgie qui m’emplissait à la simple vue de ce qui m’attachait un peu à cet endroit, l’idée de plus en plus persuasive de devoir reprendre la route… Fait chier. J’adore Bérangère ! J’apprécie encore plus Lilo !
Baalzephon m’aura à l’usure.
J’insère mes écouteurs dans mes oreilles, l’air de rien. Les mains dans les poches, je mime la tranquillité en me pavanant dans la ville, la musique désactivée. Quelques fenêtres sont ouvertes. Perchés sur leur balcon, certains fument ou partagent une boisson, discutent en continue, de façon fragmentée, ou profitent du faux silence. Tout ça offre un tableau contrasté d’habitants respirant et vivant dans un espace tellement réduit qu’ils ont appris à s’ignorer.
J’emprunte la rue adjacente. Le mieux reste d’éviter la confrontation, maintenant que j’ai la certitude que ce gus n’est pas le fruit d’une sorte de paranoïa. Je ne dois pas trop m’éloigner des endroits fréquentés, mais il ne faudrait pas non plus que j’attire le danger en centre-ville. Rien ne me certifie que la présence de témoins dissuadera mon poursuivant.
Il se rapproche. Je l’entends.
Tout en tournant au carrefour suivant, je lance un mince coup d’œil sur le côté. Il est là, à une centaine de mètres, tout au plus. Et il ne se dissimule pas, marchant d’un pas décidé dans ma direction. Ça pue, putain que ça pue. Je hais profondément me battre : je dois trouver autre chose.
Sans plus réfléchir, je grimpe au mur en escaladant la gouttière, puis m’agrippe aux barreaux du premier balcon que je rencontre. Je me hisse silencieusement, enjambe la barrière en fonte pour me cacher dans le recoin de la porte-fenêtre, accroupi.
Ses pas se rapprochent, les bruissements de son blouson aussi. Note perso : rappeler à Baalzephon que la filature s’apprend. Quoique, rien ne me dit que ce gars connaît Baalzephon, il est peut-être un de ceux qui cherchent à le rejoindre avec un petit cadeau dans l’espoir d’attirer ses faveurs.
Plus de bruit. Petits piétinements. Encore petits piétinements. J’imagine qu’il pivote à plusieurs reprises sur lui-même en s’interrogeant sur ma disparition. Bouffon. Reconnais ta défaite et admire ma victoire.
Il revient sur ses pas… et je me sens con.
Il retourne chez moi, forcément. J’aurais dû y réfléchir, merde ! Histoire de l’assommer et de le jeter dans un coin… Là, je n’ai aucune de mes affaires primordiales, rien pour me préparer à un nouveau petit voyage.
Ni une ni deux je saute du balcon et roule sur l’épaule pour amortir ma chute. Et tandis que je m’imagine repartir illico dans un sprint fulgurant pour réparer ma connerie, une pierre titanesque s’abat en plein dans mes couilles.
— Nan, mais c’est quoi ces manières !
Je tombe à genoux. La vieille secoue son parapluie à deux centimètres de mon nez. Je m’affale les coudes au sol.
— Tu voulais m’cambrioler, hein ? Bandit ! Chenapan !
Ouah, quelle chance : moi qui ai toujours rêvé de me faire castrer par une octogénaire, c’est une case en plus de cochée. Et maintenant, l’autre risque de rappliquer…
— Écoutez m’dame…
— Et qu’vous l’entendez s’exprimer comme une racaille ! On dit madame !
Je pose un pied à terre alors qu’elle me distribue des petits coups de parapluie par-ci par-là, en maugréant. J’ai l’impression qu’elle me jette un sort. L’angoisse.
— Tout va bien, je n’avais pas de mauvaise intention, je vous le jure. Arrêtez de crier comme ça, O.K. ?
— Moi, une hystérique ?! Je t’en foutrai de l’hystérie, fripon, brigand, pilleur…. pi… PIRATE !
— ÇA VA ! Putain ça va j’ai compris ! Vous connaissez votre dico des synonymes, d’accord ! Merde, à la fin !
Le parapluie rebondit trois fois sur le bitume humide. La vieille reste pantoise, pendant que je me casse en boitillant à moitié. Pourquoi mes plans foirent toujours ?
Je reçois le coup en pleine poire.
Et v’là la suite.
Sonné, ça ne m’empêche pas de réagir aussitôt. Je riposte en saisissant son poing de nouveau dégainé et lui assène une frappe monumentale avec mon front. Sa tête valdingue en arrière. Ça fait archi mal, mais pas le temps de niaiser. Ma main droite parfaitement déployée lui fracasse le côté du visage contre le poteau. Il s’écroule.
S’il y a bien un truc que je hais encore plus que me battre, c’est qu’on m’y force.
Plus jamais, plus personne ne me fera de mal. Plus personne mis à part moi. Je soupire en me dirigeant vers mon immeuble. C’est pour ça que je dois encore fuir et il se trouve que je sais exactement où aller me cacher.
Par contre, pour le maniement du coup de boule, on repassera.
Chapitre 6
BELLA
Le réfectoire est bondé. Une envie soudaine de reposer mon assiette sur le buffet me saisit, mais les filles dénichent très vite un recoin inoccupé. Je déteste cette salle de repas, agencée comme un gigantesque autocar. Les quelques petites tables qui autorisent un tant soit peu d’intimité sont toujours prises lorsque j’arrive.
— Vous avez entendu ce qu’on raconte ? lance Candice, certaine de provoquer la curiosité générale.
— À propos de quoi, exactement ? l’interroge Faroudja. C’est pas comme si l’actualité était particulièrement vide, en ce moment.
Je m’assois à côté de Jolène, qui n’a pas su attendre et mâchouille déjà un bout de son pain.
— J’ai entendu dire que des groupuscules prenaient forme un peu partout dans la région. Je connais une Traqueuse qui va souvent aux réunions de celui le plus proche.
— Des groupuscules ? Du genre… des terroristes ? Et qui est cette Traqueuse ? enchaîne Jolène en se penchant en avant, vers Candice.
Je lève les yeux un instant de mon assiette. Jérôme. Assis à droite de Candice. Pratiquement en face de moi. Je rêve. Il m’inspecte en se délectant de son eau comme s’il s’agissait d’un aphrodisiaque.
Mon poing démange.
— Non, non, pas des terroristes. Ce sont des délégués Traqueurs des différents Instituts qui ont initié le mouvement. Ils s’inquiètent de l’avenir des Traqueurs maintenant qu’une nouvelle guerre approche… Et la Traqueuse dont je parle, c’est Margot. Elle m’a dit qu’ils étaient en train de préparer un genre de cahier de doléances… enfin non, elle n’a pas dit « doléances », elle a dit « réclamations », ou « revendications », je sais plus.
— Ils ont bien raison, intervient Faroudja.
Les filles la jaugent en silence, puis me regardent. Je demeure parfaitement silencieuse. Je n’ai aucune idée de ce dont elles parlent et de ce que cache toute cette histoire. Sans tenant ni aboutissant, pas question d’émettre un avis.
— C’était qui, le chef de mon équipe ? demandé-je sans transition.
Jolène s’étouffe à moitié et articule dans un filet de voix :
— Le Maudit ? C’est de lui dont tu veux parler ?
— Oh arrête de l’appeler comme ça, râle Faroudja.
Elle secoue la tête, lasse.
— Aucune de nous ne lui a jamais adressé la parole, me répond Candice.
— Parce que vous n’en avez jamais eu l’occasion ?
Le manoir de De La Haute Maison est très grand, moins que ne l’est le château de Digvix à ce qu’on m’en a rapporté, mais il n’empêche qu’il est impossible de connaître tous les habitants de l’Institut.
— Parce qu’il était maudit, réplique très vite Jolène avant d’enfourner une fourchette de nourriture pour se faire taire.
Faroudja lui assène un regard intransigeant.
— Tu ne perds rien à ne pas l’avoir rencontré, se mêle soudainement Jérôme. C’était un mec insupportable.
L’ouverture est bien trop large :
— Tu veux dire encore plus que toi ?
Contrairement à mes attentes, Jérôme sourit, satisfait. Il glisse sa main posée sur la table dans ma direction.
— Je suis ravi d’entendre que ma présence te fait autant d’effet.
Les yeux rivés sur sa main, je me fais violence pour ne pas y planter ma fourchette et lui trancher le poignet avec la lame qui chauffe d’envie contre ma cuisse.
— T’es un putain de harceleur, Jérôme, balance Faroudja, quelqu’un devrait t’arracher la queue avec les dents.
— Bella pourrait s’en occuper, fanfaronne-t-il.
Je bondis à travers la table. Un fracas d’assiettes et de verres brisés retentit dans le réfectoire. Quelques cris de surprise aussi. Jérôme bascule en arrière avec sa chaise. Il s’écrase par terre, ma main autour de son cou, ma lame sous son menton. La douleur lui tire un mouvement, mais j’enfonce la pointe de mon arme dans sa chair.
— Si tu m’adresses encore une seule fois la parole, tu rêveras que je me sois seulement contentée de t’avoir arraché la queue avec les dents, comme dit Faroudja.
Les yeux révulsés, il lève les mains :
— Doucement, Bella, je rigolais, c’est tout…
Son sang dégouline lentement jusque sur mes doigts. Il grimace.
— T’es sûr de vouloir renchérir ?
Il baisse les bras, vaincu. Je me relève, époussette mon pantalon, souffle un bon coup. J’essuie ma lame sur ma cuisse, puis remarque le silence de mort qui a envahi la pièce. Tout le monde m’observe. Un peu plus loin, Josh m’adresse un sourire triomphant.
— C’est ma coéquipière, se vante-t-il auprès de son voisin de table.
Fred est le premier à applaudir. Toutes les autres paumes l’imitent instinctivement et quelques bouches sifflent entre les acclamations.
Je lâche ma dague à côté de Jérôme, qui contient mal un mouvement de recul, puis je tourne le dos au réfectoire pour partir.
Cette fois, pas question de faire une croix sur ma sieste.
Je traverse l’Institut au rythme d’une furie. Les portes de la bibliothèque sont grandes ouvertes à cette heure-ci, aussi je m’engouffre parmi les étagères sans marquer d’arrêt. Je zigzague jusqu’au bureau de Gertrude, recouvert des dernières parutions.
— Bella, ma douce ! me salue Gertrude. Je viens de recevoir un nouveau livre d’herbologie, il t’intéressera, j’en suis certaine.
— Fantastique, commenté-je en soupesant le poids de l’encyclopédie. Je voudrais bien te l’emprunter, si ce n’est pas déjà chasse gardée.
Gertrude sourit d’un air entendu.
— Ça n’intéresse que toi, ces choses-là.
C’est vrai. Ce n’est pas à De La Haute Maison que je rencontrerai de nouveaux passionnés de botanique. Au refuge, les rares personnes avec qui mes parents et moi pouvions converser autour du sujet, n’étaient autres que des Sorcières ou, à la limite, des Druides. Mais il se révèle extrêmement rare que les Druides quémandent une aide extérieure à leur peuple, c’est pourquoi nous n’en avons rencontré que très peu et surtout solitaires.
— Tu connais mon besoin de tout comprendre et tout expliquer, Gertrude.
Elle hausse un sourcil, les mains jointes sous le menton.
— Eh bien, ce besoin se manifeste aujourd’hui au sujet de quelque chose dont personne ne veut me parler.
Elle hausse l’autre sourcil.
— J’aimerais jeter un œil aux archives que tu conserves encore ici.
Les archives de chaque Institut sont conservées sept ans avant d’être récupérées par la Corporation et stockées dans ses bâtiments. Gertrude me l’a elle-même appris. Donc, peu importe ce qu’il est arrivé au précédent chef de mon équipe, cela est obligatoirement répertorié dans un document que Gertrude a dû un jour classer parmi tous les autres.
— Tu le sais, Bella : je dois savoir quelle est la raison exacte de ta demande. D’ailleurs, cette demande doit normalement être actée par le chef des équipes de Traqueurs.
Je triture la couverture d’un bouquin.
— Et si j’étais l’exception qui confirme la règle ?
— Qu’est-ce qui se passe, Bella ?
Gertrude a tiqué : jamais je n’outrepasse les règles, jamais. Et moi-même je me surprends à vouloir le tenter.
— J’ai été intégrée à une équipe dysfonctionnelle, voilà ce qui se passe. Je récolte les conséquences de problèmes dont je ne connais pas la nature ni la source, parce qu’il semblerait que mes coéquipiers aient reçu l’interdiction de m’en parler.
Et lorsque je m’évertue à évoquer le sujet avec d’autres, je suis confrontée à des discours sans queue ni tête qui épaississent plus encore le mystère.
Gertrude se ferme, presque instinctivement. Elle paraît se couvrir d’un voile solide qui durcit peu à peu pour se transformer en bouclier. Impénétrable. Voilà ce qu’elle est durant de longues secondes. Son regard s’immerge dans des souvenirs douloureux.
Il est mort, on dirait. Mais en quoi est-ce si terrible ? Des Traqueurs meurent tous les jours dans des conditions douteuses et injustes, pourquoi ce silence autour d’une personne en particulier ?
Gertrude inspire, longtemps. Elle se ranime, les yeux teintés d’un sentiment tout neuf : la nostalgie.
— Il s’appelait Alex.
L’émotion se propage depuis ma poitrine jusqu’à mes extrémités. Il a existé. Il a une identité et il