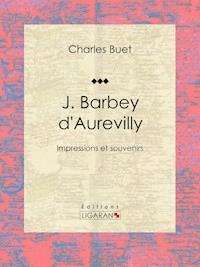
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Saint-Sauveur-le-Vicomte est une petite ville normande, placée dans un site charmant. Lorsqu'on y arrive de Valognes, à l'endroit où la route, décrivant une courbe gracieuse et laissant à sa gauche Rauville-la-Place s'engage dans une avenue de Cytise et d'acacias, on descend lentement et on traverse un pont jeté sur un ruisseau échappé de la Douve dont il va rejoindre le lit, après avoir donné la vie à un moulin caché dans un fouillis d'arbres verts..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335034912
©Ligaran 2015
Cher et vénéré Comte,
Vous avez été l’ami des dernières heures de celui à qui ce livre est consacré, l’ami des premières heures de celui qui a puisé dans une profonde et respectueuse affection, le courage, – peut-être présomptueux, – de l’écrire. Vous avez été l’ami et l’hôte de notre grand d’Aurevilly, qui aimait en vous le cœur autant que l’esprit : ce cœur de gentilhomme toujours ouvert aux sentiments de foi, de généreuse ardeur, de dévouement de sacrifice, de patriotisme ; cet esprit toujours occupé des hautes spéculations de l’intelligence, adonné aux études les plus sérieuses, d’un libéralisme pondéré, d’une admirable rectitude. Ce cœur et cet esprit inspirèrent à Pie IX, de sainte et glorieuse mémoire, la tendresse dont il vous donna tant de preuves. Ce cœur et cet esprit ont entraîné à votre suite les MILLE évêques du monde catholique, – ce majestueux concile ! – qui, saluant en vous l’historien définitif de Christophe Colomb, le défenseur victorieux de sa mémoire, vous ont élu par leur suffrage le Postulateur de sa Cause de béatification.
C’est par votre livre sur Christophe Colomb, – une des pages mémorables qu’aura produite l’histoire en notre siècle de révision historique, – que Barbey d’Aurevilly est venu à vous. Il connaissait déjà vos graves travaux antérieurs sur les questions importantes de la Commune, de l’école, de la rénovation sociale par la Religion. Mais votre magnifique étude du grand navigateur vous signala à son attention comme presque un prophète, et il le fut, lui, prophète, en disant que votre œuvre capitale était la base de cette prodigieuse réparation que, sous vos auspices, l’Église va accorder au calomnié de toutes les sectes.
Dès qu’il vous eût connu, Barbey d’Aurevilly vous aima. Il retrouvait en vous un contemporain de ses jeunes années, nourri des traditions qu’il avait apprises, lui aussi, dès l’enfance, et soumis à des croyances qui le faisaient votre frère, pour cette vie et pour l’éternité.
Il vous dédia l’un de ses livres, parce qu’il savait votre âme digne de comprendre et de juger ce qu’il y mettait d’intentions pures, de sincérité, de largeur de vues. Vous le lisiez avec un plaisir exquis, et vous le défendiez avec toute l’autorité de votre parole contre ceux qui en parlaient légèrement, ne l’ayant point lu, ou l’ayant mal compris.
Il eut même l’honneur de partager avec vous la gloire de certaines basses persécutions et de certaines haines, qu’il a pardonnées à son dernier jour, comme vous-même les avez déjà pardonnées, dans la noble et puissante sérénité d’une vieillesse que Dieu prolonge, pour vous récompenser par la jouissance de votre œuvre.
Quant à moi, je ne veux point énumérer ici tout ce que je dois de gratitude à votre paternelle bonté. Mais je puis dire que vous m’avez traité comme un ami préféré, que j’ai reçu vos leçons, et que j’ai tâché de profiter de vos exemples. À la même table, bien souvent, nous nous sommes trouvés réunis, Barbey d’Aurevilly, vous et moi, avec d’autres convives couronnés de cheveux blancs : mais, le plus jeune, ce n’était pas le dernier-né parmi nous, et tous les cœurs qui battaient autour de vous, à l’unisson, avaient le même âge. Lorsque les verres se choquaient, selon l’ancienne coutume normande et savoyarde, celaient bien des amis, unis dans la même foi, les mêmes sentiments, la même affection, qui se saluaient ad multos annos !…
En mémoire du grand écrivain qui fui un si grand cœur, en souvenir des heures heureuses que je vous dois, je vous prie, cher et vénéré Comte, d’agréer la dédicace de mon livre, où tant de noms qui nous sont bien aimés se trouvent réunis.
Cet hommage n’est, de ma part, qu’un témoignage modeste de mon filial attachement. De votre part, l’accepter, c’est acquérir de nouveaux droits à la gratitude et à la respectueuse affection de votre ami
CHARLES BUET.
Villa Floret, ce 29 janvier 1891.
Le livre que nous offrons aujourd’hui au public aurait pu paraître dix-huit mois plus tôt. L’auteur ne l’a pas voulu. Peut-être se réservait-il de produire son ouvrage après d’autres dont la publication était annoncée. Peut-être voulut-il simplement attendre que le silence fût fait sur la tombe qui venait de se fermer.
Tel qu’il paraît aujourd’hui, ce livre ne satisfera pas toutes les curiosités. À dessein, l’auteur a négligé divers épisodes de l’existence de celui dont il a écrit la vie ; à dessein, il n’a pas prononcé certains noms que l’on s’étonnera de n’y point trouver. Il ne juge même pas à propos de dire pourquoi il s’est tu sur ces épisodes, pourquoi il a omis ces noms. Ce n’est pas qu’il veuille mettre la lumière sous le boisseau. Dans la vie comme dans l’œuvre de Jules Barbey d’Aurevilly il n’y a rien à cacher. Mais il s’est souvenu de l’esprit miséricordieux du Maître.
On ne trouvera, dans ce livre, que des pages bienveillantes. Même en rapportant les opinions du critique, du poète, du romancier, l’auteur n’a point entendu les faire siennes. Il a jugé avec autant d’impartialité qu’il se pouvait et n’a cherché nulle occasion de faire pièce à telle ou telle personnalité littéraire.
Son but unique a été de rendre justice à un homme que la gloire vint chercher trop tard, et qui ne fut pas toujours bien compris de ceux même qui l’approchaient. La tâche assurément pouvait être au-dessus de ses forces : il s’y est essayé de bonne foi, et la seule récompense qu’il ambitionne est d’avoir, au moins en quelque façon, réussi.
Des amis lui sont venus en aide, en lui fournissant les renseignements, les documents qu’il ne possédait pas. Il les remercie tous également sans les nommer. Ils se reconnaîtront assez, et seront fiers, ce semble-t-il, d’avoir participé à une œuvre qui est un hommage sincère à une mémoire profondément respectée.
Saint-Sauveur-le-Vicomte est une petite ville normande, placée dans un site charmant. Lorsqu’on y arrive de Valognes, à l’endroit où la route, décrivant une courbe gracieuse et laissant à sa gauche Rauville-la-Place s’engage dans une avenue de cytises et d’acacias, on descend lentement et on traverse un pont jeté sur un ruisseau échappé de la Douve dont il va rejoindre le lit, après avoir donné la vie à un moulin caché dans un fouillis, d’arbres verts, comme un nid dans l’aubépine.
Au-dessous de la rampe ombragée d’arbres superbes l’œil embrasse un paysage admirable. En bas, coule indolente et limpide la Douve dont le petit port forme le premier plan du tableau. Saint-Sauveur s’échelonne un peu plus loin. À droite s’élève, comme un guerrier des temps héroïques, l’antique château d’Harcourt dont le donjon crénelé semble veiller comme autrefois sur la bourgade assise à ses pieds. Rien de beau comme ces vieux murs troués par la mitraille et revêtus d’un épais manteau de lierre dont la teinte sombre augmente encore la sévérité.
À gauche, dans un massif d’arbres verts, on aperçoit le clocher de l’ancienne abbaye des Bénédictins.
Au-delà se déroule un vaste panorama semé de collines, de bouquets d’arbres vigoureux, de magnifiques prairies où la Douve serpente en répandant la fraîcheur et la vie. L’œil plonge dans ces perspectives sans fin que le soleil revêt de couleurs chatoyantes : c’est l’Italie avec ses plaines si vantées et son ciel si doux.
De l’autre côté, sur la droite, le décor change tout à coup. L’aspect en est grandiose et sévère. La Douve coule resserrée entre deux collines dont les roches dégarnies de toute verdure accusent le travail de l’homme. C’est sur un de ces contreforts naturels, situé à droite de la rivière, qu’est adossé le vieux château.
En face, sur l’autre colline, à l’endroit même où fut tiré le dernier coup de canon qui termina la guerre de Cent ans, s’élève la chapelle de Notre-Dame de la Délivrance d’où l’œil embrasse le pays tout entier. C’est Besneville, avec ses vieux moulins, pittoresquement affourché sur le sommet d’une éminence ; c’est Taillepied dont le blanc clocher perché comme une aire d’aigle sur la pointe d’un rocher se détache d’un rideau de sapins. C’est Doville et sa vieille église. Aux pieds du voyageur s’étale Saint-Sauveur-le-Vicomte, caché comme dans un nid à l’abri de ces collines et de ces montagnes.
Saint-Sauveur-le-Vicomte joua un rôle important pendant la guerre de Cent ans. Prise et perdue alternativement par les Anglais et les Français, cette petite ville était par sa position au milieu de la presqu’île normande une des principales clefs de la province, et ce ne fut qu’après la chute de cette place, en 1450, que les Anglais abandonnèrent la Normandie qui redevint française. Chandos avait fait du château fort une citadelle redoutable démantelée quelques siècles plus tard par Richelieu, qui fit décapiter le donjon et les tours. Elle occupe encore un vaste quadrilatère élevé dans l’angle formé par deux ruisseaux, affluents de la Douve. À chaque coin s’élève une haute tour, privée de ses créneaux. L’une d’elles sert de prison. Le donjon carré de Chandos, ouvrage grandiose, soutenu par d’immenses contreforts, domine tristement, avec les difformités qui le déshonorent, ces vastes ruines. Les anciens remparts, avec leur chemin de ronde, qui reliaient les tours au donjon, chaussés de terres rapportées pour protéger leurs fondements furent convertis en hôpital par Louis XIV sur la demande d’un Jésuite. Et c’est dans cette maison que voulut mourir il y a peu d’années, par humilité, l’abbé Léon d’Aurevilly, frère du grand écrivain.
Au midi de la ligne de murailles qui rattache le donjon et la prison est une cour triangulaire par laquelle on accédait à la forteresse. Les énormes gonds des portes bardées de fer, sont restés enfoncés dans les murs. Tous les vieux ferrements sur lesquels la rouille n’ose pas mordre, qui servaient à lever ou à baisser les herses et les ponts-levis, sont restés là, débris inarrachables, depuis le XVe siècle, mais défigurés par les outrages du temps et des hommes.
La grande porte d’entrée de la forteresse, flanquée de deux tours encastrées dans les murs cyclopéens, s’ouvre sur la ville dont la partie antérieure et moderne s’élève sur les anciens fossés, sur les douves comblées et sur de vastes souterrains changés en caves.
C’est à l’ombre de ces ruines amoncelées, rappelant tant de souvenirs et d’exploits, au milieu de ces souvenirs des luttes géantes du Moyen Âge, que Barbey d’Aurevilly trouva son berceau.
« La maison où Barbey d’Aurevilly vint au monde se trouve à une centaine de mètres au-dessus de l’église, à droite, en montant la longue voie paisible qui va vers le sud. C’est un charmant hôtel du XVIIIe siècle, très complet, avec de superbes jardins enclos de grands murs, qui révèle tout d’abord chez ceux qui le bâtirent et l’occupèrent un état social important, une véritable fortune.
« Chose poignante et qui peint l’homme intime ! Animé par un sentiment spécial, où l’orgueil et la pose n’avaient certes aucune part, Barbey d’Aurevilly, dans les derniers temps de sa vie, venait parfois passer un bout de semaine à Saint-Sauveur, où il ne possédait plus rien que des souvenirs. Parents, amis, tout était mort. Il ne descendait pas à l’hôtel. Il s’installait chez un menuisier qui lui louait à la journée une chambre proprette juste en face de l’habitation paternelle, tombée en des mains étrangères. Accoudé à la fenêtre de cette chambre d’emprunt, ses regards errant sur la maison qui fut celle des siens, n’apparaît-il pas plus touchant que Ravenswood à qui restait du moins le fidèle Caleb et la tour de Wolfgraf planant sur la mer du Nord. »
Les pays, les familles qui, dans l’histoire, ont fait acte de vertu, de généreuse abnégation, de grandeur et de magnanimes sacrifices, portent comme récompense future, au-dedans d’eux, d’impérissables et silencieux germes de félicités, de fortune ou de gloire. Cet épanouissement est une loi providentielle. Et nous voyons cette loi s’accomplir. Pendant les siècles d’héroïsme, où la France se formait dans les luttes sanglantes, Saint-Sauveur fut toujours patriotique, religieux et valeureux. La sainteté s’y montra au XVIIe siècle dans la personne d’une femme, Catherine de Longpré. La valeur guerrière y a laissé partout son empreinte. Il n’y manquait plus que la gloire littéraire. Elle y est maintenant.
Pourtant, comme tous les hommes de génie, Barbey d’Aurevilly a dû subir la sentence Nemo Propheta inscrite aux Livres Saints. Sa gloire si lumineuse à Paris, dans les régions les plus élevées de l’intelligence, est à peine connue de ses compatriotes. Et pourtant ses pas sont encore fraîchement marqués sur cette terre d’oubli. Sans compter le ravissant petit manoir des Tuileries, à deux pas du bourg, appartenant autrefois à sa famille et où s’éteignit en 1835, le fameux abbé de Percy, ancien chapelain de Madame Laetitia, mère de Napoléon Ier, il existe encore dans les deux plus belles rues de Saint-Sauveur, deux superbes hôtels du XVIIIe siècle. Dans l’un, à la façade d’aspect granitique, – un vrai symbole ! – naquit l’illustre écrivain. L’autre appartenait à son oncle, à l’entrée de la rue des Lyces, et borde un des côtés de la place du Fruitier.
Ce n’est pas du dedans, c’est du dehors qu’il faut décrire à grands traits Saint-Sauveur-le-Vicomte. De quelque côté qu’on y aborde, ses hautes tours enlierrées, avec leur grand air antique, dominent tout.
Du temps des fières et nobles rivalités de ville à ville, Valognes regardait Saint-Sauveur comme son Versailles et son plus aristocratique faubourg.
On arrive de l’une à l’autre cité après un parcours de quatre lieues. La route est bordée de fermes, de châteaux et d’églises. La merveilleuse flèche de Colomby, œuvre hardie du plus pur XIIIe siècle a été décrite par d’Aurevilly. La poésie a éternisé une seconde fois la poésie de l’artiste qui a lancé cette téméraire aiguille de pierre dans les airs ! Au bout du plateau des Hauts-Vents, légèrement courbé, en son milieu, comme l’évasement d’une corbeille de verdure, le sol semble se dérober tout à coup comme un effondrement. L’abord de ce territoire qui tombe si soudainement forme le mont de la place, piédestal de la chapelle de la Délivrande et surplombe, en balcon, toutes ces ondulations dévalant jusqu’aux bords de la rivière.
De là, par-dessus l’opulente vallée de la Douve, on admire Saint-Sauveur qui ressemble à une vaste arène romaine, dont les gradins en cercle s’étagent jusqu’à la cime bleue des collines de Normandie. C’est un spectacle oriental que cette forêt de coupoles, de pointes d’arbres et de pinacles de vieilles tours, dont les éclairs font un sinistre albâtre, dans les nuits d’orage.
Des coteaux de Rauville, on ne découvre au-delà des prairies que les dômes et les arêtes de l’abbatiale de la basilique, et de longues files de maisons conventuelles. Les pommiers, les hautes avenues de chênes vieux comme les clochers, les platanes et les ormes séculaires, enveloppent, de toutes parts, ce vénérable monastère bénédictin d’une robe d’un beau vert d’émeraude que teinte d’un peu d’austérité le sévère climat neustrien. De toute la basilique qui a l’ampleur d’une cathédrale et unit au roman du onzième les trois phases de l’ogive, il n’y a que le chevet ogival, avec ses clochetons pointus qui reçoive dans ses splendides verrières à deux étages, chaque matin, les premiers feux de l’aurore.
À cent pas de là, s’élève l’église paroissiale, fière de ses tombeaux historiques et d’une inappréciable statue de l’Ecce Homo, dont l’auteur est inconnu.
Ce paysage avec ces églises et le vaste château de Chandos composent un tableau à enivrer d’enthousiasme artistique le plus imaginatif des paysagistes ! Rien que copier cela, en peintre réaliste, serait faire un chef-d’œuvre ; les siècles et la nature, ces deux grands artistes, ont jeté en silence, aux flancs décrépits de ces illustres ruines, un indicible prestige d’idéal, de rêveuse lividité de glorieux tombeau ! Il y a là des pleurs résignés et des désolations tranquilles, pleines de voix douloureuses, dans ce lugubre veuvage des choses ! L’âme profonde, sympathique et sonore, a des oreilles, des yeux, d’irritables sensibilités, sous la brise de ces souvenirs, et le sunt lacrymæ rerum de Virgile s’est envolé sur tant de régions où l’infortune passe ! Le poète écrivait d’avance des notes de tristesse, dont les siècles, ces impitoyables, aiment à semer leur route, et ils ont jeté jusqu’à nous aussi, sur cette terre martiale, une poignée de cette cendre funèbre dont leurs mains sont pleines !
Pour entrer dans la ville, on traverse trois ponts riches de légendes. La Douve chargée de ses barques blanches, descend avec elles à la mer, d’un cours profond et calme à travers les prairies, et baigne la jolie petite ville que d’Aurevilly trouvait aimable comme un village d’Écosse.
Adossé à son ancienne et giboyeuse forêt, aujourd’hui en partie abattue et morcelée en oasis de bois de hautes futaies, ceintures et parcs de châteaux modernes, Saint-Sauveur s’étale sur les pentes orientales, comme s’il y rêvait mystérieusement à une résurrection. Car ce pays a de la gloire oubliée. Les caveaux de son église abritent des souvenirs et des restes renommés ; comme le vieux château du Quesnoy, couvert d’humiliations, à quelques milliers de pas dans la campagne, garde à son ombre l’étang noirâtre et désert, où périt, comme Œdipe à Colone, Jean Gourgue Sombreval, l’un des plus dramatiques héros de Barbey d’Aurevilly.
Le Quesnoy, dans sa tristesse et ses délabrements, est le temple des Eumémides de Saint-Sauveur, au seuil duquel aurait pu venir s’asseoir l’illustre écrivain, victime des révolutions et des rapacités humaines, et qui, à sa naissance, trouva vide de tous ses biens et de son patrimoine, la maison de ses pères. Mais quand il serait venu s’y asseoir, ce vieux monarque de la plume et du génie, pour y éteindre la vie de son nom, aurait-il pu se glorifier de recevoir sur la poussière des noblesses mortes la visite d’un Thésée sympathique, roi comme lui, et assez ému de ses malheurs pour verser des larmes royales sur ses royales infortunes ?
Ce fut donc à Saint-Sauveur-le-Vicomte que Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly naquit le jour de Toussaint 1er novembre 1808, en pleine épopée napoléonienne. Son père, Théophile Barbey, fils d’une demoiselle de la Blairie, avait épousé Ernestine Ango, fille du grand bailli du Cotentin, et descendante de cet Ango de Dieppe qui déclarait la guerre au roi de Portugal, sous François Ier, venait avec sa flotte bloquer Lisbonne et traitait directement par ambassadeur avec sa Majesté Très Fidèle.
Le bisaïeul maternel de M. d’Aurevilly, M. Ango, de bonne noblesse de robe, occupait une charge à la cour de Louis XV. Son fils, assurent les chroniques (et plus encore la prodigieuse ressemblance de son petit-fils avec la race des Bourbons), fut un des nombreux enfants de l’amour du roi Bien-Aimé. Quoi qu’il en soit de cette filiation quasi royale, qui n’est peut-être qu’une légende, et sur laquelle il déplaisait à M. d’Aurevilly qu’on insistât, le jeune Ango fut tenu sur fonts baptismaux par le roi et la belle duchesse de Châteauroux. À dix-neuf ans, il était nommé grand bailli à robe rouge. Il épousa Mlle de Marigny et en eut trois enfants : un fils qui fit les guerres de Empire, fut fait prisonnier à la déroule de Moscou, fut interné sur les pontons anglais et vint mourir dans sa ville natale ; une fille, mariée à M. du Méril ; une autre fille, qui fut la mère de Jules Barbey d’Aurevilly, femme d’un esprit supérieur et dont le mari, était un parfait gentilhomme.
On remarquera sans doute que les actes civils que nous citons en note gardent le silence sur la qualification nobiliaire. Cependant les Barbey sont nobles, et on ne les connaît dans tout le pays que sous le nom de d’Aurevilly.
Aureville ou Aurevilly, dont les Barbey furent seigneurs et dont ils portaient le nom, est un village de vingt à trente feux, à moins d’une lieue de Saint-Sauveur, sur l’ancienne route royale de Briquebec. Il est très ancien, bâti en maisons riantes, élégantes, riches ; quelques-unes sont entourées de murs percés de belles portes cochères, ombragées d’arbres touffus.
Les deux versants d’Aureville qui ressemblent à de hauts remparts au sommet desquels s’épanouit le village, portent le regard de l’observateur bien loin à l’ouest sur la vallée tortueuse de la haute Douve et sur les frontières de la Hogue, l’ancien repaire des Normands de Neustrie.
C’est autour de ce village que s’étendait le domaine important, appelé dans les actes de famille terre d’Aureville, qui a donné, au XVIIIe siècle, aux Barbey leur « nom de noblesse ». Il leur fut apporté par les femmes. C’est dans cette terre ombreuse, pleine de grands ormes, que Léon et Jules d’Aurevilly se plaisaient tout jeunes, et qu’ils venaient apprendre à l’école de la belle nature neustrienne, à la peindre mieux que jamais n’ont fait les plus fameux paysagistes.
L’enfance de Jules Barbey d’Aurevilly fut sans doute celle de tous les jeunes gentilshommes de son pays et de son temps. Peut-être s’en est-il souvenu lorsqu’il décrivit celle de Néel de Néhou, le petit chevalier d’Un prêtre marié. Il fut élevé par un père et une mère qui gardaient avec un soin religieux tous les souvenirs de l’ancien régime ; il reçut d’eux ces manières chevaleresques, cette haute et sereine politesse qui laisse chacun à sa place, avec l’horreur des vulgaires promiscuités et des camaraderies familières, cette aisance dans les allures que seuls, nos pères connaissaient, accoutumés aux exercices physiques, sachant monter à cheval, tirer l’épée, comme les preux des anciens âges.
Il commença d’abord ses études à Saint-Sauveur, avec M. Groult, un jeune professeur qui tenait le collège de l’abbé de Boisval, devenu depuis lors curé de la paroisse. Excellent élève, il put, lorsqu’il arriva au collège Stanislas, à Paris, obtenir de brillants succès, et faire ainsi honneur à son maître. Charmé de son esprit brillant et profond, de ses façons qui se ressentaient de son origine et des traditions de la cour où ses ancêtres avaient vécu, l’abbé de Percy, chanoine de Saint-Dénis, qui fut aumônier de Madame Mère et qui habitait un ancien manoir des d’Aurevilly, prit en affection le petit Jules. Et celui-ci le lui rendit, car il donnait ce nom de Percy, plus tard, à l’une de ses héroïnes du Chevalier des Touches. Ces Percy, originaires d’Angleterre, étaient cousins des ducs de Northumberland, et, qui sait ? de ce Piercy Shafton, euphuiste distingué, dont Walter Scott a tracé, dans le Monastère, une si amusante caricature.
Jules passait une grande partie de ses vacances à Valognes, chez le maire de cette ville, le docteur du Méril, son oncle. Il y voyait beaucoup la noblesse, qui vivait retirée et boudeuse, au lendemain des désastres de l’Empire, au commencement des vains efforts de la Restauration, gouvernement de passage qui n’avait su, comme on l’a dit trop souvent depuis, ni apprendre ni oublier. Et quoiqu’il ne fut encore qu’un enfant, ses facultés d’observation étaient déjà si grandes que rien ne lui échappait. Ses livres ont gardé la trace de ses souvenirs, et il a flagellé plus d’une personne de cette société de petite ville. Car il n’oubliait rien et sa mémoire était prodigieuse ; les moindres détails des choses de son enfance lui furent toujours présents.
Revenu du collège Stanislas, Jules d’Aurevilly fit son droit à Caen, avec de tels succès que le président de la cour royale voulait le prendre et le garder avec lui. Mais sa vocation pour la littérature l’appelait à Paris. Comment y vivrait-il, pourtant, dans cette grande ville, où il devait arriver sans fortune et sans emploi ? M. Barbey, son père, avait engagé la plus grosse partie de ses avoirs pour envoyer de l’argent à la duchesse de Berry, au moment de l’étrange expédition en Vendée de 1832. D’autre part, les idées prétendues libérales du jeune homme exaspéraient le rigoureux royaliste, qui ne voulait rien faire pour son fils. Heureusement, le grand-oncle de celui-ci, le chevalier de Montressel, lui avait laissé en mourant une rente de douze cents livres, et ce fut avec ce modeste viatique que Jules Barbey d’Aurevilly put obéir à sa vocation, et tenter la fortune.
Comme l’a dit M. Paul Bourget, dans sa préface des Memoranda, M. d’Aurevilly, au rebours de la plupart de ses contemporains, et des plus illustres, n’a pas dévoilé dans des « Mémoires » ou des « Confidences » le roman de ses bonheurs ou de ses mélancolies, et un mystère demeure sur toute sa jeunesse, sur la période surtout de cette jeunesse dont il ne reste aucune trace littéraire ». On sait pourtant qu’il connut Brummell dès son adolescence, ainsi que, plus tard, il connut le comte d’Orsay, et que la vision de ces deux hommes, se juxtaposant à son éducation première et à ses propres instincts, lui inspira ce goût passionné de l’aristocratie, qui fit de lui le dédaigneux et hautain solitaire de la rue Rousselet. Il apprit à s’isoler de la foule, à n’obéir qu’à ses goûts personnels, à inventer pour son usage des luxes qui ne fussent le luxe de personne.
Il ne possédait point la richesse, qui rend tout facile, et ne pouvait réaliser tous ses rêves. Mais le rêve lui tenait lieu de réalité, et M. Emile Zola put se donner l’impertinence de dire que M. d’Aurevilly voyait dans la glace de son armoire, la mer – cette mer normande où ses yeux s’étaient naguère si souvent reposés sur les lames aux larges volutes et sur les gouffres aux tourbillons d’écume.
Il fut donc, probablement, dès ses jeunes années, ce farouche d’indépendance que l’on compare si volontiers à lord Byron, et qui « aura vécu dans notre dix-neuvième siècle a l’état de révolte permanente et de protestation continue. Seulement Byron retranchait ses dégoûts derrière sa pairie et ses quatre mille livres sterling de revenu, et M. d’Aurevilly a dû conquérir son indépendance avec sa plume et son encrier. Il n’a pourtant pas accordé une concession de plus à la société que le châtelain de Newstead-Abbey ; c’est une destinée moins romanesque peut-être, mais, pour qui comprend tout le sens du mot, aussi poétique, sinon davantage ».
C’est assurément dans ce milieu provincial de la Normandie paresseuse de Saint-Sauveur et de Valognes, de la Normandie studieuse de Caen ; c’est dans ; les souvenirs et les traditions de cette terre antique, dans le reflet demeuré en lui des paysages paisibles et mélancoliques de « cette belle pluvieuse qui a de belles larmes froides sur de belles joues fraîches », que M. d’Aurevilly puisa les idées premières de l’Ensorcelée et du Chevalier des Touches. La chouannerie venait à peine de finir, les anciens soldats de l’Empire, licenciés, tuaient leurs loisirs forcés en imaginant des conspirations poétiques ; la jeune noblesse, alors comme aujourd’hui, songeait plus à ses plaisirs qu’à ses devoirs, la religion refleurissait sur les décombres du culte de la liberté, et Chateaubriand, dans le Génie du Christianisme, en attifait les splendeurs pures des broderies de son style.
Dès lors germaient dans l’esprit du jeune étudiant de Caen les descriptions pleines de magnificence des livres qu’il devait gester longtemps, et n’écrire enfin qu’après avoir évoqué, avec ce don de la double vue qu’il possédait certainement, ces visions lointaines embellies par l’effacement, et voilées de la brume veloutée que le temps et l’espace jettent sur toutes choses.
Oui, cet étudiant de Caen, si jeune, si peu prédisposé aux luttes littéraires, notait déjà ses impressions ; déjà son rêve se doublait d’observation ; déjà il se révélait poète, c’est-à-dire créateur, et poète qui séjournait dans un monde de visions magnifiques, en conservant la suprême intégrité de sa pensée, pour citer une fois encore M. Paul Bourget.
Ce livre des Memoranda, publié par l’auteur à l’aurore de sa vieillesse, est saturé de mélancolie, et la mélancolie, mal ordinaire, inévitable, de toute créature d’exception, est chez M. d’Aurevilly « une très particulière combinaison du mépris et de l’enthousiasme ». C’est qu’en effet « M. Barbey d’Aurevilly est un superbe sans ambition et sans timidité qui, d’un geste bienveillant de sa cravache armoriée, écarte de lui bourgeois et princes, parce que les uns et les autres manquent désormais de cette distinction dont il ne saurait se passer et que les plus naïfs mendiants du bon Dieu montrent encore quelquefois dans leurs guenilles : ceux-là, il les aime jusqu’à l’enthousiasme ; il les a non pas racontés, mais chantés dans ses livres, et c’est par eux qu’il se venge des haillons littéraires et politiques de tous les mendiants roublards de l’infâme société où il est forcé de vivre. »
On ne sait rien, ou fort peu de choses, sur le premier séjour à Caen des deux frères d’Aurevilly, car Léon faisait son droit avec Jules. Tous deux fréquentaient les salons royalistes ; ils avaient pour amis tous les jeunes gens de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Ce fut là qu’ils ébauchèrent cette amitié si profonde qui, durant de longues années, enchaîna l’existence de M. d’Aurevilly à celle de Trébutien : qui leur fit, en commun, créer de toutes pièces la gloire de Maurice et d’Eugénie de Guérin. Cette amitié si noble, si pure, si pleine de sacrifices, il semble que Balzac, avec son intuition de toutes choses, l’ait devinée, lorsqu’il décrit celle de David Séchard et de Lucien de Rubempré…
C’est de Caen, la ville monastique, l’antique cité du Moyen Âge et des anciens ducs, que partirent donc un jour les deux frères, abandonnant l’ami que la capitale effrayait, et qui voulait jouir paisiblement de ses travaux, dans une calme et silencieuse retraite.
C’est à Trébutien que Jules d’Aurevilly écrivait en 1834, cette lettre dont nous n’avons pu retrouver qu’un fragment :
« … Je me dépense ici, âme, voix et vie, dans d’inénarrables causeries : c’est un charme infini. Mon frère me lit son beau poème et je me laisse entraîner à cette dérive de poésie, qui, à toute les indicibles mélancolies composant sa divine essence, joint de plus pour moi celle des jours écoulés. Ah ! mon ami, que n’êtes-vous entre nous deux ? Nous parlons, ou pour mieux dire nous rabâchons de vous. Hier, je disais à Léon ce que vous aviez de poétique dans votre nature, cette âme échoïque et que j’ai appelée mon clavier, cette répercussion de toute humeur, cet accord parfait de toute harmonie, et le sujet m’inspirant, je disais bien, presque’ aussi bien que que vous et plus juste, chez Mme Tastu. Je ne voulais que presser du genou le flanc plein d’haleine, solliciter la lyre d’un doigt curieux, jeter l’émeraude comme le roi grec, dans la mer de poésie silencieuse. L’émeraude m’a été rapportée ce matin, et encore plus heureux que celui qui retrouve la sienne dans le ventre du brochet, la mienne m’est revenue tout ornée et entourée de mille cristallisations. Pour parler sans figure, mon ami, Léon a fait une ode en votre honneur et gloire, une ode intitulée Trébutien, comme celle de Sainte-Beuve intitulée Racine. Vous n’en saurez que l’épigraphe, me réservant de vous lire et de vous remettre le tout :
Par une de ces ineffables délicatesses que les gens qui ne sont pas comme nous traiteraient de niaiserie, et qui à vous, j’en suis sûr, fera monter les larmes dans les yeux, Léon est allé écrire cette ode chez votre mère, et il a mis au bas : Écrit rue Neuve-des-Carmélites, chez madame Trébutien.
Ce détail m’a semblé on ne saurait plus touchant.
Je ne sais si c’est la contagion ou quelque corde oubliée qui se retend en moi, mon ami ; mais moi aussi j’ai eu des quarts d’heure de poésie depuis que je vous ai vu. Je vous apporterai trois pièces de vers qui ont eu l’applaudissement de mon frère : l’une est adressée à une jeune fille de quatorze ans, une autre n’est que des stances sur la vie, écrites dans un rythme que j’ai inventé (vous savez combien je suis sévère sur le rythme) et dans un moment où la vie me noyait dans de poignantes amertumes ; et enfin une troisième que je crois antique de pureté, d’altitude et de simplicité fière : une réponse au mot d’une femme : Oh ! pourquoi voyager, dont mon frère a fait une exquise élégie. Je vous montrerai les deux morceaux… »
À son retour de Normandie, après la Commune, – car pendant la guerre M. d’Aurevilly resta à Paris, subit le siège et le bombardement, et fit vaillamment son devoir de gentilhomme et de soldat, – il revint dans son logis de la rue Rousselet, faubourg Saint-Germain. Un coin de province, isolé, tranquille, avec de vieilles maisons à larges fenêtres.
C’est là que la marquise de la Sablière vint habiter quand, ayant renoncé au monde, elle voua ses derniers jours au service des malades.
Les petits marchands tiennent cercle sur le seuil des boutiques ; les portiers flânent sur les trottoirs ; des grappes d’enfants s’égrènent sur le pavé. Leurs joyeux éclats de rire se mêlent aux piaillements des moineaux qui peuplent le jardin voisin des frères Saint-Jean-de-Dieu, – les « sergents de Dieu », disent les bonnes femmes du populaire.
Le romancier habitait donc tout près de son ami Coppée, avec lequel il dînait tous les dimanches, et qu’il aimait d’une tendre affection, encore qu’ils ne marchassent pas dans les mêmes sentiers du pays littéraire.
Une maison modeste. La cour, spacieuse, est ornée de plantes grimpantes qui enguirlandent les fenêtres cintrées ; un puits y rappelle les époques reculées où Paris n’avait pas d’aqueducs. L’escalier aux marches de bois et de briques, est bien éclairé. Au premier, un corridor tortueux, une manière d’antichambre, nu, vide, et dont les murs sont blanchis à la chaux. Pour entrer chez le maître, il fallait connaître le secret. Il y avait un geste à faire, un tiroir à ouvrir, un Sésame, ouvre-toi ! à prononcer.
Il occupait une seule chambre, une chambre garnie, logis d’étudiant ou d’officier de cavalerie : pour déménager on emporte sa valise. M. d’Aurevilly ne se plaisait que dans ce campement. La tapisserie à fond rose qui couvrait les murailles, les rideaux pompadour, brochés de fleurettes aux couleurs vives, lui donnaient l’illusion d’un coquet boudoir du siècle passé, un peu terni, un peu suranné, mais si calme, avec ces nuances éteintes et gaies.
Peu d’ornements. Une miniature de Barbey d’Aurevilly, à dix-huit ans. Une figure d’adolescent rêveur, un Byron brun. C’est au-dessous d’une eau-forte, gravée d’après ce portrait, offerte à son ami Michel Ménard, qu’il avait écrit ces vers :
Un autre portrait, au crayon, le montrait jeune homme, vêtu en lion du boulevard de Gand. On évoque volontiers, sous ce costume, l’élégante image d’Alfred de Musset, des héros de Balzac. Rubempré devait s’habiller ainsi pour faire sa cour à la très noble et très maigre Clotilde de Grandlieu !
Une miniature de sa mère, fort belle avec son chapeau Paméla, de paille jaune à rubans bleus et sa robe de velours noir, aux manches à gigot, selon les modes de 1825 à 1840.
À part ces quelques médaillons, deux belles gravures ; un portrait de Démonette par le peintre Ostrowski, un chevalier du Giorgione, une photographie de la Gioconda. Aucune autre décoration ne relevait la simplicité du papier rose à fleurettes blanches.
Démonette est une chatte, ne vous déplaise, qui partageait avec un gros matou nommé Kroumir les bonnes grâces de l’hôte de céans : un amour de chatte, d’un noir fauve, avec de grands yeux couleur de topaze brûlée, très coquette sur ses coussins roses, et très fière de voir son image timbrée du blason de son maître : d’azur à deux barbeaux accolés d’argent, au chef de gueules chargé de trois quintefeuilles d’or.
Les mêmes armes étaient sculptées sur le fauteuil de M. d’Aurevilly, une grande chaire en vieux chêne comme la table sans tapis où il travaillait, et qu’un pittoresque fouillis encombrait d’écritoires pleines d’encres de couleur, de papiers, de sébilles débordant de sable doré, de plumes d’oie tordues et déchiquetées, de livres et de journaux.
Sur la cheminée, un verre d’eau en cristal irisé, une tête de mort sculptée dans un bloc de marbre blanc et lamée d’or, la maquette en cire d’un saint Michel, une pendule « à sujet », un bougeoir fait d’une baïonnette tordue et nickelée. Autour du cadre de la glace, des photographies. Plusieurs de Mlle Marthe Brandès, une de Mlle Roselia Rousseil ; quelques dessins lestement enlevés à la plume et coloriés à la gouache d’un fils de Roger de Beauvoir dont c’est la carte de visite familière.
Enfin une armoire à glace, un guéridon poussé dans un coin avec des tas de livres sur son marbre gris, un minuscule bureau chargé de boîtes de papier à lettres, marqué à la devise : Never More… Et voilà tout !
Ce qui surprenait, dans ce logis d’écrivain, c’était l’absence de bibliothèque. Les livres qu’on y voyait n’étaient que des instruments de travail, ou les récents envois d’auteurs naïfs qui s’imaginent que le critique s’amuse à lire tout ce qu’il reçoit. Quelques ouvrages de chevet, comme on dit : les œuvres de Byron, en anglais, souvent relues, et fatiguées ; Walter-Scott, Balzac, La Fontaine. En cherchant bien, on eût trouvé peut-être quelque roman de l’hôte lui-même : un exemplaire des Diaboliques, relié en noir, avec une grande croix rouge sur le plat, la tranche noire zébrée de croisettes rouges, et précédé d’une préface calligraphiée et enluminée par Léon Bloy avec un admirable talent d’imagier du Moyen Âge. M. d’Aurevilly aimait les splendides reliures et faisait volontiers présent de ses livres à quelques femmes dont la société lui plaisait, mais il voulait que l’enveloppe fût digne du récit qu’elle renferme.
C’est pourquoi il faisait relier tel de ses romans en moire couleur mauve, avec un encadrement découpé à la mauresque, en maroquin blanc, gaufré d’or. Tel autre était mi-partie vert et rose, à dentelles aux petits fers. Tel autre d’un bleu céleste, ou couvert d’une peluche orange, à coins et à fermoirs d’acier découpé.
En revanche, s’il n’y avait pas de livres dans cette chambre qui sera désormais historique au moins pour les véritables lettrés, il y avait des cannes, et qui se vendront un jour à cent mille exemplaires, comme celles de M. de Voltaire et de M. de Balzac.
Voici d’abord le « pouvoir exécutif » : un gourdin d’incroyable, énorme, noueux, tordu, peint en vert malachite, avec une pomme taillée dans un bloc de cette belle pierre, enchâssée dans une couronne comtale d’argent, qui ainsi qu’un stick, en jonc des Indes, à boule d’agate et à glands rouges et un autre stick à pomme de lapis-lazuli, à glands bleu et argent, ont été donnés par le maître à trois de ses intimes qui les gardent comme un précieux souvenir.
Puis, voici celle qu’il appelait « ma femme » : une forte cravache, à manche en corne de cerf, retenu par une bague d’argent, armoriée de son écusson. Quand il se promenait, cette houssine à la main, vêtu de son pantalon blanc à bande de satin, de son « raglan » doublé de soie blanche, à torsades et à brandebourgs de soie, avec une de ses cravates lamées d’or, garnies de points d’Angleterre ou de guipures, il ressemblait à l’un de ces héroïques magyars de la patrie hongroise qui, à la Diète, acclamaient le roi Marie-Thérèse.
On a beaucoup parlé du costume de M. d’Aurevilly, ce qui ne lui plaisait guère. Il voulait qu’on ne s’occupât en lui que de l’écrivain. En quoi, disait-il, ses habitudes et ses fantaisies pouvaient-elles intéresser la foule ?
Paul Féval s’habillait chez lui d’une blouse et d’un pantalon en tartan écossais ; on célèbre la robe de moine de M. Édouard Pailleron, la simarre écarlate de M. Jean Richepin ; on glosa naguère sur le froc de Balzac et la chemise débraillée d’Alexandre Dumas – père.
M. Barbey d’Aurevilly portait la tunique, ou plutôt le tabart, ou mieux la dalmatique des chevaliers, en laine rouge, bordée de galons multicolores, blancs, noirs, verts, bleus et jaunes, qui dessinent une croix sur la poitrine. Par-dessus il endossait une ample gellabieh (la robe des Arabes), en étoffe blanche. Il se coiffait de la clémentine en drap rouge ou noir, soutachée d’or, le bonnet papal, celui-là même que portaient les cardinaux du XVe siècle et que Léon X a dans son portrait, peint par Raphaël. Ainsi vêtu, il rappelait Dante dont il avait le port majestueux et altier. Sa beauté mâle et vigoureuse, ses traits accentués, son nez en bec d’aigle, allaient bien à ces vêtements pittoresques.
Quand il sortait, il revêtait une redingote moulant son buste, avec des revers larges et des basques juponnant sur le pantalon collant, à bande de soie, toujours noir ou blanc, ou l’habit à revers de velours, ouvert sur le gilet broché, blanc et argent, ou noir à liseré orange ou bleu. Ainsi paré, ce n’était point un élégant anglomane, plus semblable à un quaker qu’à un gentilhomme, mais un grand seigneur que paraît sa fantaisie, et qui faisait valoir, par la grâce de ses manières, l’aisance de ses allures, le charme de son sourire et la justesse de son geste, un costume combiné avec un goût aussi bizarre qu’artistique.
Rien n’était plus désagréable à M. d’Aurevilly que les portraits fantaisistes qu’on faisait de sa personnes Protée qui aimait à changer de formes, il apparaissait toujours herculéen et beau comme ce géant, mais avec des physionomies si diverses qu’il eût fallu, tour à tour, pour le peindre, Zurbaran et Vanloo, Largillière et Goya, ou mieux encore les admirables primitifs de l’école florentine, dont les figures conservent la grandeur farouche des héros du quinzième siècle.
C’est, en effet, un jouteur et un lutteur. C’est un soldat de la plume, ayant flamberge au vent et feutre sur l’oreille. Il fut une des intelligences les plus complètes et les plus complexes de celle époque où il eut tant de rivaux. Il aurait pu, au temps jadis, être un condottiere comme Carmagnola, un politique comme César Borgia, un rêveur à la Machiavel, être Manfred ou Lara… Il se contenta d’être un solitaire, écrivant des histoires pour lui-même et pour ses amis, faisant bon marché de l’argent et de la gloire, et, prodigue éperdu, semant à tous les vents assez de génie pour laisser croire qu’il en avait le mépris.
Quant au logis monacal de la rue Rousselet, c’est là, a dit Paul Bourget, dans un pastel effacé (comme tous les pastels), c’est là que sont venus tour à tour, attirés par le prestigieux feu d’artifice de mots de ce diable d’homme, Charles Baudelaire, qui l’appelait le « mauvais sujet » dans ses jours d’amitié, et le « vieux mauvais sujet » dans ses jours de mauvaise humeur ; Théophile Silvestre, qui le surnommait « le laird », et lui amenait un jeune avocat du nom de Gambetta ; Amédée Pommier et Hector de Saint-Maur, César Daly et le comte de Gobineau, François Coppée et Paul de Saint-Victor, Maurice Bouchor et Boussés de Fourcaud ; combien d’autres encore ! »
Les autres étaient le comte Roselly de Lorgues, Paul Bourget, Gaétano Braga, Valadon, Zacharie Astruc, Émile Lévy, Maurice Rollinat, le docteur Robin, le docteur Seeligmann, Léon Bloy, Georges Landry, Léo Trézenik, le docteur Bernard, Ostrowski, M. Kleine, Octave et Joseph Uzanne, Huysmans et l’auteur de ce livre.
« La ville que j’habite en ces contrées de l’Ouest, – veuve de tout ce qui la fit si brillante dans ma prime jeunesse, – mais vide et triste maintenant comme un sarcophage abandonné, je l’ai, depuis bien longtemps appelée la ville de mes spectres pour justifier un amour incompréhensible au regard de mes amis qui me reprochent de l’habiter et qui s’en étonnent… C’est eux, en effet, les spectres de mon passé évanoui, qui m’attachent si étrangement à elle. Sans ses revenants, je n’y reviendrais pas !…
Que de fois de rares passants m’ont rencontré faisant ma mélancolique randonnée dans les rues mortes de cette ville morte qui a la beauté blême des sépulcres, et m’ont cru seul quand je ne l’étais pas !… »
Cette ville dont parle avec tant de tristesse et d’amertume l’auteur d’Une Page d’histoire, est Valognes, qu’il aimait, en effet, à revoir chaque année, pendant l’automne. « La pluie, m’écrivait-il, est le fard de ma presqu’île. » Mais il cessa d’affectionner le séjour de cette « Herculanum du Nord, où il ne vivait que parmi des tombeaux, et ne rencontrait plus que des ombres ».
Cette petite ville, grise, basse, déserte, silencieuse, fouettée de pluie et de vent, sentant le cidre et la marée, a tout l’air de garder au coin de chaque mur, à la porte de chaque vieil hôtel, un de ces secrets domestiques et sociaux que Balzac a su deviner. Ce petit chef-lieu d’arrondissement était jadis chef-lieu de bailliage, vicomte, sénéchaussée, officialité ; et cent soixante-seize paroisses étaient du ressort de son élection.
M. d’Aurevilly habitait à Valognes un appartement de quatre vastes chambres, dans l’ancien et superbe hôtel de Granval-Coligny. Il couchait dans le lit de son père. Sur la cheminée monumentale, il avait placé un magnifique buste de sa grand-tante, une des femmes les plus belles et les plus remarquées de la cour de Louis XV, qui lui a inspiré quelques-unes de ses plus belles strophes : Le Buste jaune, et des lampes en cuivre du travail le plus précieux, ayant appartenu, dit-on, à Charles-Quint.
Chaque fois qu’il retournait à Saint-Sauveur-le-Vicomte, M. d’Aurevilly allait en pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrande, vieux sanctuaire bâti après la croisade d’où saint Louis de France revint mort, et qui s’élève sur une des plus charmantes collines du Cotentin. Il appelait ses « Champs-Élysées » la vaste lande qui environne la Délivrande. Il voyait dans cet édifice abritant une statue de la Vierge, la foi agissante de ses pères, dont l’ombre splendide le suivait partout. Sa jeunesse y avait pris des images ineffaçables, aux temps où il y venait prier chaque année.
Il préférait ce beau site à tous ceux qu’il avait peints et disait un jour au chapelain de la Délivrande que Dieu, en dessinant ce paysage, avait pris des traits de beauté physique, des reliefs, des accidents, des contours, des ondulations, des formes et des profils à tous les panaromas de la péninsule Cotentine, depuis le mont Saint-Michel jusqu’à la pointe d’Anderville.
Ce fut en 1843 que Barbey d’Aurevilly publia son premier roman l’Amour impossible, qui ne fit pas grand tapage. Deux ans plus tard, il donnait le fameux livre qui est comme la préface de sa vie, comme la synthèse de son talent et de son caractère, Du Dandysme et de Georges Brummell, et le volume était à peine paru qu’Alfred de Vigny lui écrivait une lettre, curieuse, que nous avons citée dans une autre étude.
Brummell ne tirait sa célébrité que de son élégance et son biographe devait tirer la sienne de la force de sa raison. Sa place est néanmoins dans l’histoire des mœurs anglaises, dans celle des traditions sociales.
« Lorsque son livre parut, l’auteur du Dandysme et de Georges Brummell, dit M. d’Aurevilly, n’était pas un dandy, mais il était à cette époque de la jeunesse qui faisait dire à lord Byron, avec sa mélancolique ironie : Quand j’étais un beau aux cheveux boucles…, et, à ce moment-là, la : gloire elle-même ne pèserait pas une de ces boucles ! »
Et peut-être pour excuser ses propres exagérations d’élégance, l’historien de Brummell ajoutait ces réflexions si typiques et si impertinentes de vérité :
« Si le Dandysme : avait existé de son temps Pascal, qui fut un Dandy comme on peut l’être en France, aurait donc pu en écrire l’histoire, avant d’entrer à Port-Royal : Pascal, l’homme au carrosse à six chevaux ! Et Rancé, un autre tigre d’austérité, avant de s’enfoncer dans les jungles de sa Trappe, nous aurait peut-être traduit le capitaine Jesse au lieu de nous traduire Anacréon ; car Rancé fut un Dandy aussi, – un dandy prêtre, ce qui est plus fort qu’un dandy mathématicien, et voyez l’influence du dandysme ! Dom Gervaise, un religieux grave, qui a écrit la vie de Rancé, nous a laissé une description charmante de ses délicieux costumes, comme s’il avait voulu nous donner le mérite d’une tentation à laquelle on résiste, en nous donnant l’envie atroce de les porter ! »
Il n’est donc point étonnant qu’à propos de ce livre, Paul de Saint-Victor ait pu dire de M. d’Aurevilly qu’il avait, dans la littérature, une place à part, dont l’isolement est une hauteur.
« Le talent chez lui est si grand et si éclatant qu’il attire ceux-là même qu’eloigneraient ses idées entières et altières. Le polémiste effraye souvent, l’artiste étonne et charme toujours. Au plus fort des coups qu’elle porte, l’épée maniée par cette main vaillante fait admirer les ciselures de sa poignée, et la splendeur de sa lame. Son style violent et exquis, superbement raffiné, énergique et délicat à outrance, est d’une couleur qu’il est impossible de confondre avec aucune autre. L’empreinte qu’il laisse sur l’imagination ressemble à la morsure de l’eau-forte. Dans un pêle-mêle de mille phrases, on reconnaîtrait une des siennes, à son allure et à son accent, à sa façon d’agiter l’image et de porter la pensée.
Ce talent de si grand vol et de si large envergure, le petit livre Du Dandysme le recélait déjà tout entier. Il était tassé, quintessencié, concentré dans cet opuscule taillé à facettes, comme le génie des Mille et une nuits dans sa buire de bronze. »
Les portraits de M. d’Aurevilly furent nombreux. Celui de M. Émile Lévy, offert par le peintre au modèle, qui fit sensation au Salon de 1877, et qui figure au premier rang dans la galerie de M. Charles Hayem, le montre dans sa pose habituelle, debout, les cheveux envolés en touffes soyeuses autour de son large front ; la bouche ayant un sourire ironique sous ses longues moustaches noires parsemées de fines parcelles de poudre d’or. Une cravate garnie de dentelles s’épanouit en un large nœud sur les revers de satin de sa redingote, et ses manchettes de blanche batiste se rabattent sur les manches. L’attitude, le port de la tête, tout est fort beau dans ce portrait.
Un autre, que fit de lui le jeune peintre Léon Ostrowski, pour une revue illustrée, le représente chez lui devant sa cheminée, dans une pose familière. Puis celui de M. de Liphart dans la Vie moderne, celui de l’aquafortiste Rajon pour l’édition de ses œuvres chez Lemerre. Enfin le petit médaillon qu’il montrait avec émotion et qui lui rappelait tant de souvenirs, où il est représenté à dix-huit ans, coiffé à la mode de 1825, et le torse enveloppé du grand manteau romantique, il le donnait volontiers à ses amis, avec des épigraphes curieuses. Sur le mien, il ne mit, tout ou travers, qu’un gigantesque paraphe enveloppant son nom d’un zigzag de foudre.
Quand on vit dans la retraite, on aime à relire ces livres faits de chroniques, jadis éparses dans les journaux, et dont l’auteur tire une seconde mouture en les réunissant en volume. Ils rappellent, à ceux qui l’ont connue, cette existence intellectuelle du Paris moderne, faite d’imprévu, de travail sans trêve, de plaisirs sans frein, où les jouissances de l’esprit ont le pas sur toutes les autres.
Que de fois n’a-t-on pas dit : « On cause à Paris, partout ailleurs on parle. » Cet art de la causerie a pourtant baissé en ce siècle qui est celui de l’action, et les grands travailleurs, souvent, sont des silencieux. Beaucoup d’écrivains sont verbeux et prolixes dans leurs discours, mais combien peu savent causer dans le vrai sens du mot, avec l’expression juste, la répartie prompte, la réflexion rapide, les aperçus toujours nouveaux, la verve et l’humour sans cesse en éveil, avec finesse et sans préciosité, avec cette nuance de raillerie qui n’est jamais acerbe, et suivant toujours la causerie dans les sujets les plus variés, en partant, par exemple, des pyramides égyptiennes pour aboutir à l’éternel féminin, en passant par mille extravagances apparentes, où se mêlent les théologies, les sciences, la philosophie, les arts, les voyages, les frivolités de la mode, les anecdotes, les médisances, les citations classiques, et tant de noms !
Barbey d’Aurevilly fut un de ces causeurs brillants à la fois et profonds, sachant dire les moindres choses avec une sérénité d’Olympien, d’une mémoire prodigieuse qui lui faisait citer les auteurs les plus oubliés et lui fournissait toujours à propos, le mot topique, effroyablement juste. Sa phrase et sa prose n’avaient jamais rien de vulgaire : l’une ou l’autre était à la fois violente et parée, aristocratique et militaire.
« Il ne s’est pas fait cette prose, il a seulement noté la parole intérieure qu’il se prononce à lui-même dans la solitude de sa chambre de travail, et la parole improvisée qu’il jette au hasard des confidences de conversation. J’ai bien souvent remarqué, au cours de mes entretiens avec lui, – un des plus vifs plaisirs d’intelligence que j’ai goûtés. – cette surprenante identité de sa phrase écrite et de sa phrase causée. Il me contait des anecdotes de Valognes ou de Paris avec cette même puissance d’évocation verbale et la même surcharge de couleurs qui s’observe dans ses romans. Il s’en allait tout entier dans ses mots. Ils devenaient lui, et lui devenait eux. Je comprenais plus clairement alors ce que la littérature a été pour cet homme dépaysé et quel alibi sa mélancolie a demandé à son imagination. De là dérive, entre autres conséquences, cette force de dédain de l’opinion qui lui a permis de ne jamais abdiquer devant le goût du public. »
On ferait un volume des mots de Barbey d’Aurevilly. Un des plus beaux est celui qu’il dit, chez moi, un soir qu’on devisait au coin du feu, d’un androgyne presque fameux, déjà célèbre par ses démêlés avec la police correctionnelle : « Ne me parlez pas de cette femme, s’écria tout à coup M. d’Aurevilly : elle déshonore l’impudeur ! »
Je me souviens d’un souper que nous fîmes, Barbey d’Aurevilly, Vallès, Bourget et moi, après la première représentation d’un antique mélodrame, l’Incendiaire ou l’Archevêque et le Curé, qu’on avait monté au théâtre de l’Ambigu pour répondre à ma pièce, le Prêtre, jouée récemment au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Vallès appelait à grands cris le garçon – l’éphèbe du torchon, disait l’auteur de Cruelle Énigme, – et demandait des verres de pétrole, en guise de punch. Il nous conta, avec des gestes fous, avec un regard qui voyait en dedans, la mort de l’archevêque Darboy, assassiné par la Commune. Et sa voix altérée, ses yeux humides, certains frissons qui lui couraient à fleur de peau nous mettaient fort mal à l’aise. On changea de conversation, mais l’ex-condamné à mort revenait obstinément à son idée fixe. Puis il divagua, parla de revendications sociales, de meurtres nécessaires, et finit par ces mots : « Il nous faudrait quatre-vingt mille têtes de bourgeois ! » M. d’Aurevilly, très calme, balançant son verre entre le pouce et l’index, répartit froidement, de sa voix sonore : « Moi, monsieur, celle de Sarcey me suffirait ! »
On connaît ce mot galant dit, je crois, chez la baronne de Poilly. La marquise de G…, une des beautés célèbres du second Empire, s’était assise par mégarde sur le chapeau du maître, ce fameux chapeau à larges bords doublés de velours noir, et l’avait complètement écrasé :
– « Oh ! le pauvre chapeau, murmura-t-elle en s’excusant.
– Plaignons-le tous, madame, s’écria-t-il avec un geste d’une irrésistible bouffonnerie, il n’a pas senti son bonheur ! »
Un jour qu’on parlait devant lui de ces politiciens qui veulent tout réformer, qui parlent à tout propos des vingt années de corruption impériale, il laissa tomber ces paroles dédaigneuses :
– « Ils entrent dans les écuries d’Augias… mais c’est pour en remettre. »
N’est-ce pas lui aussi, qui disait mélancoliquement à la vieille Mme de *** qui lui offrait, solitaire, une tasse de thé au coin de la cheminée et proposait une causerie à deux d’excursions dans le passé :
– « De longues histoires, au coin du feu, ce sont les bals de la vieillesse ! »
On conte aussi qu’une grande dame s’était mise en tête de le convertir, et avait obtenu de lui une entrevue chez le libraire Lemerre. Au jour dit, elle arriva, et lui décocha à brûle-pourpoint cette question :
– « Monsieur, êtes-vous catholique ?
– N’avez-vous donc rien lu de moi, madame ?
– Si. J’ai tout lu, au contraire. Mais alors pourquoi choisissez-vous des sujets qui semblent par leur nature… ou du moins je veux dire des histoires qui pourraient avoir l’air… Excusez-moi, je vous en supplie, mais je m’étais dit que certainement vous devez être catholique. Pourquoi donc ?… »
La figure de M. d’Aurevilly s’éclaira d’un sourire de condescendance. Il avait compris les étonnements et les angoisses de la dame, et daigna lui donner l’explication qu’elle souhaitait.
– « Madame, je suis catholique, vous l’avez dit, et si je traite de préférence des sujets qui vous étonnent, c’est de propos délibéré : le catholicisme donne plus de saveur au péché. »
La dame très pieuse, d’abord interloquée, essaya de sourire et feignit de prendre cette réponse pour un brillant paradoxe, et c’était, en effet, un de ces paradoxes qu’il aimait à soutenir.
Mais lui, sans se soucier des fibres qu’il déchirait avec une sereine cruauté, ne s’aperçut même pas de l’affliction où il jetait son admiratrice, et continuant avec feu :
– « Oui, dit-il, je suis un passionné, en état de lutte incessante contre la faiblesse de ma nature, et, s’il faut tout vous dire, j’aime le danger, j’ai comme une folie de bravoure. Alors, l’idée de l’enfer m’attire ; je le défie, je le nargue, et c’est peut-être ce qui vous aura scandalisée dans mon catholicisme. »
Barbey d’Aurevilly était un fanatique de l’action.
Il y a quelques années, il se trouvait à Sèvres, chez un écrivain, avec le poète André Lemoyne et quelques autres. On dîna bien et longuement ; la soirée, toute pétillante de paradoxale causerie, passa sans qu’on sentît couler le temps, et tout à coup quatre heures du matin sonnent. On s’étonne, on rit, on veut se séparer, mais le maître et la maîtresse de la maison retiennent leurs hôtes ; on soupe des restes du dîner, jusqu’à ce que les lueurs du jour éclairent la situation.
– « Décidément, il faut s’en aller, dit André Lemoyne, mais comment ?
– Comment ? Mais à pied, parbleu, répond le laird de Ravenswood.
– À pied !… vous n’y songez pas ?
– J’y songe si bien que je pars et que je vous emmène. »
Et il partit, en effet, allègre et dispos, se redressant de toute sa hauteur, et il parcourut sans le moindre effort apparent le chemin, assez long, qui mène de Sèvres à Paris, tandis qu’André Lemoyne, dont la taille avait un peu l’air de sortir de la poche de son compagnon, trouvait, malgré le poids bien moins lourd de ses années à lui, la route longue, fatigante, et le suivait en répétant entre ses dents : « Quel diable d’homme !… mais quel diable d’homme ! »
Sa liaison avec Baudelaire demanderait, pour être bien contée, un Tallemant romantique. Elle commença par un article sur les Fleurs du mat, dans lequel le critique, fortement touché par le poète, avait parlé avec complaisance du talent et aussi des vices moraux de Baudelaire.
Celui-ci, agréablement caressé, car il aimait à passer pour très corrompu, se rendit chez son critique, et prit, en mystificateur qu’il était, un air d’homme offensé. Et avec ses façons douces et catégoriques :
– « Voyez, monsieur, dit-il, dans quelle situation délicate vous vous êtes mis à mon égard. Vous m’avez donné le droit de vous demander raison, et si, en effet, je vous envoyais des témoins, votre foi catholique vous empêchant de vous battre en duel, vous seriez fort embarrassé.





























