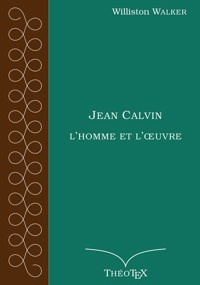
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
La vie de peu de réformateurs a fait l'objet d'autant de recherches historiques que celle de Jean Calvin : les pages qui lui sont consacrées se comptent par dizaines de milliers, nombre qui est à la hauteur de l'importance du personnage, mais qui reflète aussi parfois une minutie de détails proche de l'idolâtrie. Cependant les biographies de ce Français exceptionnel restent peu lues, étant en général épaisses, écrites il y a longtemps, et non rééditées. Celle de Williston Walker (1860-1922), historien américain de la Réformation ayant enseigné à l'université de Yale, mérite de l'être. Traduite par Nathanaël Weiss (1845-1928), rédacteur du Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, elle n'a pas le charme littéraire de la prose de Merle d'Aubigné ou de Bungener, mais elle offre une abondance de sources, qui fait comprendre que l'auteur a tout lu sur le sujet, sans toutefois tomber dans la recherche excessive d'Émile Doumergue. Elle se distingue surtout par sa grande hauteur de vue, qui lui permet d'évaluer honnêtement les qualités et les défauts du héros réformé. La tragédie de l'épisode de Michel Servet est à cet égard particulièrement bien traitée ; le portrait moral de Calvin tiré à la fin de l'ouvrage emporte notre conviction. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1909.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322469758
Auteur Williston Walker. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Il n'y a guère de pays où Calvin soit aussi peu connu et ait été moins sérieusement étudié que dans sa patrie. On peut même dire que ceux qui auraient voulu le connaître d'un peu près n'avaient pas à leur disposition de biographie en français digne d'un tel sujet.
Il y a plus d'un demi-siècle, à une époque où le culte de l'histoire impartiale était peut-être plus en honneur que de nos jours, M. Jules Bonnet avait été officiellement chargé de recueillir la correspondance du réformateur, et l'on prêtait au célèbre historien Mignet, « à qui appartenait l'initiative de ce recueila », l'intention de tracer du mouvement religieux et social inspiré par Calvin, un de ces tableaux historiques où il excellait. Il se borna, sous forme de compte-rendu des Lettres françaises parues en 1854, à en rédiger une esquisse magistrale dans neuf articles du Journal des Savants (1856-1860) où ils restèrent malheureusement ensevelis.
[François-Auguste Mignet (1796-1884) avait écrit un chapitre remarquable dans son mémoire intitulé Etablissement de la Réforme religieuse et constitution du Calvinisme à Genève, lu à l'Académie des sciences morales et politiques les 15 et 22 nov. 1834 et réimprimé dans ses Mémoires historiques (1854). Voici, après 1834, dans leur ordre chronologique, les principaux travaux biographiques consacrés à Calvin en France et dans la Suisse française : — 1852, l'article des frères Haag dans la France Protestante, t. iii ; — 1854, les Lettres de Jean Calvin, publiées par Jules Bonnet, deux volumes in-8o, ne contenant que les lettres françaises et qui n'eurent pas de suite ; — 1856-1860, les articles de Mignet (Journal des Savants, déc. 1856 ; février, mars, juillet, août 1857 ; janvier, mars, déc. 1859 ; février 1860) ; — 1862, F. Bungener, Calvin, sa vie et son œuvre, un vol. in-18 ; — 1863-1878, J.-H. Merle d'Aubigné, Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, 8 vol. in-8o ; — 1872, G.-A. Hoff, Vie de Jean Calvin, un vol. in-18 ; — 1877, Ch. Dardier et A. Jundt, articles Calvin et Calvinisme dans l'Encyclopédie des sciences religieuses, t. ii ; — 1882, H.-L. Bordier, article Calvin dans la 2e édition de la France Protestante, t. iii ; — 1888, Abel Lefranc, La Jeunesse de Calvin, un vol. in-8o ; — 1898, A. Lefranc et E.-H. Vollet, articles Calvin et Calvinisme dans la Grande Encyclopédie, t. viii. — Je ne mentionne ici que les études biographiques proprement dites parues en français. Il sera amplement question, plus loin, des travaux importants consacrés à telle ou telle partie de l'œuvre du réformateur, par exemple par Ch. Borgeaud, E. Choisy, A. Rilliet, A. Roget, etc.]
La biographie populaire de Félix Bungener, Calvin, sa vie et son œuvre, parue en 1862, — au moment où les savants strasbourgeois Baum, Cunitz et Reuss lançaient le prospectus des Opera Calvini, dont la publication devait se poursuivre pendant trente-huit années, — n'existe depuis longtemps plus en librairie. — L'Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, commencée par J.-H. Merle d'Aubigné en 1863, devait s'arrêter, avec le huitième volume (1878), à la mort de Luther, survenue 18 années avant celle de Calvin. Pendant que cette publication, plus littéraire que strictement historique, se poursuivait, et au moment où MM. Baum, Cunitz et Reuss commençaient à faire paraître la volumineuse et si importante correspondance du réformateurb (1872), un pasteur alsacien, M. G.-A. Hoff, écrivait une Vie de Jean Calvin qui n'est pas sans mérite, mais qui, éditée par la Société des traités religieux, resta absolument inconnue du grand public.
En dehors de ces ouvrages, il n'y avait que les articles biographiques, d'ailleurs remarquables, de la France Protestante (1852 et 1882), de l'Encyclopédie des sciences religieuses (1877) et de la Grande Encyclopédie (1898), ce dernier seul postérieur au volume par lequel M. Abel Lefranc avait renouvelé l'histoire de la Jeunesse de Calvin (1888).
En attendant l'achèvement, encore éloigné, du Jean Calvin, commencé par M. E. Doumergue en 1899, rien n'était donc plus désirable qu'une biographie à la fois assez détaillée pour mettre le lecteur français au courant de tout ce qui a été publié depuis près d'un demi-siècle, et assez résumée pour donner, sans sécheresse, une idée complète, « objective », de ce que fut Calvin, de ce qu'il voulut et de ce qu'il accomplit. Ce livre, un étranger, familiarisé avec l'histoire religieuse de l'Europe occidentale, que Calvin modifia si profondément, mais éloigné de nos divisions confessionnelles, politiques et ecclésiastiques, était peut-être mieux placé qu'un Français pour l'écrire avec impartialité.
M. Williston Walker est professeur d'histoire ecclésiastique (histoire de l'Église chrétienne) à l'université bien connue de Yale, à New Haven, dans le Connecticut, États-Unis d'Amérique. Il a donc été élevé dans un pays où le calvinisme a exercé une influence religieuse et sociale prépondérante et d'autant plus remarquable qu'il s'y est développé librement, sans être assombri et déformé par les luttes sanglantes qui ailleurs l'ont discrédité, en déshonorant ses bourreaux.
Un livre dans lequel Mr Walker réussit à condenser, en moins de cinq cents pages, la substance de son enseignement sur le développement, de l'ensemble de la Réforme, intitulé The Reformationsc, le désigna à l'attention d'un de ses collègues, M. Samuel Macauley Jackson, professeur d'histoire ecclésiastique à l'université de New-York. Celui-ci avait entrepris de diriger la publication, sous le titre de Heroes of the Reformation d'une série de biographies critiques des principaux réformateurs ; il confia à M. Walker celle de Calvin qui parut en 1906 sous le titre de John Calvin, The Organiser of Reformed Protestantism.
[Ce qui signifie Jean Calvin, l'organisateur du Protestantisme réformé. Les mots français d'organisateur et de réformé ne rendant pas exactement le sens d'Organiser et de Reformed, nous avons préféré le titre français plus simple et plus court, qui correspond, d'ailleurs, bien au contenu du volume, de Jean Calvin, l'homme et l'œuvre.
Nous aurions mauvaise grâce à ne pas rappeler qu'un peu après le volume de M. Walker, mais encore en 1906, parut à Paris le JCalvin de M. A. Bossert. C'est un portrait beaucoup plus sommaire que celui du biographe américain et qui n'a d'ailleurs pas la prétention d'être une étude critique approfondie.]
Ce volume avait, sur toutes les autres biographies antérieures de Calvin, l'avantage de s'appuyer, d'abord sur la collection complète des Opera, terminée en 1900, puis sur un grand nombre de travaux critiques, parus surtout à l'étranger. J'eus aussitôt la pensée qu'il y aurait intérêt et profit, pour des Français, d'y contempler Calvin en quelque sorte du dehors, tel qu'a pu se le représenter un de nos contemporains, étranger à tout ce qui nous divise en France, mais rompu aux discussions théologiques d'autrefois et d'aujourd'hui, et capable de dégager, de la masse des documents originaux étudiés de première main, le caractère et le rôle historique et mondial du réformateur.
Madame Weiss a bien voulu entreprendre la tâche ardue de rendre en français le sens exact et, autant que possible, le style de l'original anglais. J'ai revu ce travail et, avec l'autorisation de l'auteur, en ai çà et là précisé ou légèrement retouché la rédaction, surtout au point de vue bibliographique. Enfin, l'Association du Monument international de la Réformation, à Genève, ayant résolu de le publier sous son patronage, son président, M. le professeur Lucien Gautier, s'est obligeamment chargé de revoir encore ma révision et d'en corriger avec moi les épreuves, ce dont lui sauront gré tous ceux qui, dans un livre d'histoire, apprécient l'importance de l'exactitude, cette forme matérielle de la vérité.
Paris, 6 Mai 1909.
L'œuvre et la personne de Calvin ont été l'objet d'un intérêt très marqué pendant ces dernières années.
La publication monumentale de tous ses écrits par les éditeurs strasbourgeois qui, soit ensemble, soit successivement, en avaient été chargés, a été suivie par les études de Kampschulte, Cornelius, Lefranc, Lang, Müller, Wernle et Choisy. Elle a été couronnée par l'important travail de Doumergue, plus qu'à moitié terminé à l'heure actuelle. Les ressources mises ainsi à la disposition de l'historien justifiaient la composition d'une nouvelle biographie populaire du réformateur. Aussi éprouvons-nous le besoin de témoigner notre gratitude aux savants nommés plus haut.
L'auteur s'est trouvé dans la nécessité de faire un choix dans l'importance à donner aux événements d'une carrière aussi remplie, dont l'influence et les controverses ont été aussi étendues que celle de Calvin. Il a donc résolu de traiter avec le plus de détails l'éducation de Calvin, son développement spirituel et son œuvre d'organisation, plutôt que d'insister sur les menus faits de ses luttes à Genève, ou les petits incidents de ses relations si complexes avec les divers pays où s'étendait son influence. Ce livre en dit cependant assez long, l'auteur l'espère, pour faire comprendre la nature et les diverses phases des principales controverses de Calvin et pour indiquer le caractère et l'importance de ses relations avec la Réforme dans son ensemble.
L'éditeur tient à remercier pour leurs utiles suggestions et leur concours, surtout en lui procurant les illustrations de ce volume, M. le pasteur Eugène Choisy, docteur en théologie, président de la Société du Musée historique de la Réformation à Genève, et M. le pasteur Denkinger, conservateur de ce Musée. Il adresse également ses remerciements à M. le pasteur Nathanaël Weiss, secrétaire de la Société de l'Histoire du Protestantisme français à Paris.
Université de Yale. 1er janvier 1906.
La tâche de celui qui veut écrire une vie de Calvin a été facilitée par plusieurs bibliographies très détaillées de tous ses écrits. La meilleure est celle d'Alfred Erichson, le plus récent éditeur des Œuvres de Calvin : celle qu'il fit pour les derniers volumes de la séried et qu'il a également publiée séparément en un format plus condensé et plus commode sous le titre de Bibliographia Calviniana. Une liste utile à consulter se trouve aussi dans le second volume de la Cambridge Modern History. Philip Schaff, dans le septième volume de son History of the Christian Church a fait une nomenclature qui, bien que plus ancienne, est très utile aussi, à cause des aperçus qu'elle renferme sur la valeur relative des auteurs cités.
Toutes les collections antérieures des œuvres complètes de Calvin ont été remplacées par l'édition magistrale des Joannis Calvini Opera quae supersunt omnia commencée en 1863 et terminée en 1900, sous la direction des savants éditeurs strasbourgeois, Jean-Guillaume Baum, Edouard Cunitz, Edouard Reuss, Paul Lobstein, Alfred Erichson et leurs collaborateurs.
[Brunswick. Ce sont les volumes xxix-lxxxvii du Corpus Reformatorum. A. Erichson en a exposé le plan et l'exécution dans le Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, xlix, 613 (1900).]
Cette série renferme dans les volumes i-xa les traités théologiques de Calvin ; dans les volumes xb-xx les lettres de Calvin ou celles qui lui ont été adressées, dans les volumes xxiii-lv ses travaux exégétiques et homilétiques. Quand cette édition se trouve citée dans le cours du présent ouvrage, c'est sous le nom de Opera.
Il faut ajouter aux lettres que contiennent les Opera la Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, si soigneusement annotée par Aimé Louis Herminjarde et dont neuf volumes avaient paru quand leur publication a été interrompue par la mort du savant de premier ordre qui les éditait. Les derniers volumes d'Herminjard ont eu l'avantage de paraître après la section correspondante des Opera. L'éditeur a pu ainsi les citer dans ses références aux lettres de Calvin, et profiter du résultat de recherches postérieures. L'édition des Lettres françaises de Calvin faite par M. Jules Bonnet ne doit être employée qu'en la comparant à celle plus critique des Opera ou encore à celle d'Herminjard.
Le volume xxi des Opera renferme les premières Vies de Calvin par ses amis Bèze et Colladon, publiées en 1504, 1565 et 1575 dans leurs éditions originales.
La plus importante des biographies modernes, la première en date et la plus complète, si l'on tient compte de l'époque où elle a été écrite, est celle de Paul Henry, pasteur de l'Église française de Berlin : Das Leben Johann Calvins, des grossen Reformators, en trois volumes, Hambourg, 1835-1844. Pour son temps, c'était la biographie la plus circonstanciée, mais aussi la plus élogieuse du réformateur genevois, son plus habile panégyrique. Cet ouvrage a été complètement dépassé par des publications plus récentes.
Un travail dont le but est tout l'inverse du précédent, mais qui ne peut prétendre à aucune valeur scientifique, étant tout au contraire violemment polémique et sans scrupules, c'est L'Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de Calvin par le catholique Vincent Audin, publiée à Paris en 1841, en deux volumes.
En 1850, un historien anglais, Thomas-Henry Dyer, a publié à Londres, en un seul fort volume, The Life of John Calvin. Il se base surtout sur une étude minutieuse et très personnelle de la correspondance de Calvin, et s'est aussi servi de l'ouvrage de Paul Henry ; toutefois ses opinions sont fort différentes de celles du biographe berlinois. Il critique Calvin, il est même sévère pour lui, mais son livre a beaucoup de valeur. Il ne s'étend pas sur les origines du réformateur et ses débuts, mais raconte en détail les démêlés qu'il eut à soutenir à Genève.
Félix Bungener a fait paraître à Paris, en 1862 et 1863, un volume d'histoire populaire, intitulé Calvin, sa vie, son œuvre et ses écrits. Quoique bien écrit, cet ouvrage n'ajoute pas grand chose à ce que l'on savait déjà sur le sujet.
L'une des meilleures parmi les anciennes biographies de Calvin est celle du pasteur bâlois Ernst Stähelin, Johannes Calvin, Leben und ausgewählte Schriften, publiée à Eiberfeld, en deux volumes, en 1863. Ce travail, consciencieusement rédigé, se distingue par l'effort que l'auteur a tenté pour caractériser la personnalité du réformateur.
L'ouvrage de Jean-Henri Merle d'Aubigné, professeur à l'École de Théologie de la Société Evangélique de Genève, dont le premier volume a paru en 1863 sous ce titre : Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, mérite surtout d'être mentionné à cause de son énorme diffusion, en particulier dans les pays de langue anglaise. Son histoire de la Réforme genevoise va jusqu'en 1542. Bien que l'auteur ait mis des documents originaux à la base de son travail, il est extrêmement partial, peint ses portraits sans ombres et sacrifie sans cesse à l'effet dramatique.
Une biographie bien supérieure est celle du professeur vieux-catholique à l'université de Bonn, Frédéric-Guillaume Kampschulte, Johann Calvin, seine Kirche und sein Staat in Genf. Le premier des trois volumes dont devait se composer l'ouvrage est sorti de presse en 1869 ; le second était terminé au moment de la mort de l'écrivain — 3 décembre 1872 — mais, bien que confié à son ami, le professeur Carl-Adolphe Cornelius, de Munich, il n'a été publié qu'en 1899 et cela par les soins du Dr Walter Gœtz, de l'université de Leipzig.
Le troisième n'a jamais été commencé. Bien que, sans contredit, peu sympathique à Calvin, trop disposé à critiquer le réformateur et très influencé par les Galiffe, qui regardaient Calvin comme un usurpateur étranger à Genève, le travail de Kampschulte, quoique inachevé, est, soit pour son exactitude scientifique, soit pour sa connaissance des événements auxquels Calvin prit part, indispensable à qui veut étudier le réformateur.
[Jacques-Auguste Galiffe et Jean-Barthélemy-Gaifre Galiffe, de Genève, père et fils, soutinrent avec beaucoup de savoir la thèse qui représente Calvin comme un intrus étranger, imposant sa tyrannie à Genève qui jusqu'à lui avait été libre. Les principaux ouvrages de Galiffe père sont : Matériaux pour l'histoire de Genève, Genève, 1829, et Notices généalogiques sur les familles genevoises, ibid., 1836. Ceux du fils sont : Quelques pages d'histoire exacte (procès Perrin et Maigret), dans les Mémoires de l'Institut national genevois pour 1862, et Nouvelles pages d'histoire exacte (procès d'Ameaux), ibid. pour 1863. Ils représentent dans les temps modernes l'opposition des anciennes familles genevoises contre Calvin. Tout en reconnaissant que le jugement de Kampschulte est prédisposé à la sévérité, nous croyons qu'il y a de l'exagération dans les critiques que lui adresse Doumergue (ii, 717-721) ; celui-ci déclare cependant : « Pour des historiens catholiques, il est certain que Kampschulte et Cornelius ont fait preuve, vis-à-vis de Calvin, d'une impartialité remarquable, » bien que cette impartialité lui paraisse insuffisante.]
En la personne d'Amédée Roget, professeur à l'université de Genève, cette ville a possédé un historien de valeur. Son Histoire du peuple de Genève depuis la Réforme jusqu'à l'Escalade, en sept volumes, 1870-1883f, décrit la période qui s'étend de 1536 à 1567 et par conséquent toute l'activité de Calvin à Genève. Ce récit, très impartial, parlant des choses d'une manière tout à fait objective, a une grande valeur, due en particulier aux nombreuses citations tirées des archives genevoises que l'auteur connaissait à fond.
En 1888, un jeune savant français, Abel Lefranc, aujourd'hui professeur au Collège de France, a fait un brillant début dans la carrière en publiant, à Paris, une étude fort importante sur la Jeunesse de Calvin.
Quatre ans plus tard, feu le professeur Philip Schaff a donné, dans le septième volume de son History of the Christian Church, une esquisse soigneusement faite de la carrière de Calvin et de son influence. Elle se distingue par les mérites et par les défauts habituels à cet auteur.
M. Eugène Choisy, savant pasteur genevois, a publié, en 1897, La théocratie à Genève au temps de Calvin. C'est un exposé succinct, mais d'une réelle valeur, des principes qui guidaient Calvin dans sa politique genevoise.
Un article très remarquable est celui de feu le professeur Rudolf Stähelin dans la troisième édition (due à Albert Hauck) de la Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kircheg.
Un pasteur de Halle, August Lang, a étudié à fond et avec succès la conversion de Calvin, ses premiers écrits théologiques et ce qu'il devait aux premiers réformateurs. La discussion s'est poursuivie dans des articles de la plus grande importance, dus à la plume du professeur Karl Müller de Tubingue et du professeur Paul Wernle de Bâle.
[Die äliesten theologischen Arbeiten Calvins, dans les Neue Jahrbücher für deutsche Theologie de 1893, Bonn, pp. 273-300 ; Die Bekehrung Johannes Calvins, dans les Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche, Leipzig, 1897, i, 1-57 ; Der Evangelienkommentar Martin Butzers, Leipzig, 1900. Il a aussi écrit sur la vie de famille de Calvin et ses relations avec Luther et Mélanchthon. Calvins Bekehrung, dans les Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen pour 1905, pp. 188-255. Noch einmal die Bekehrung Calvins, dans la Zeitschrift für Kirchengeschichte, xxvii, 84-99 (1906).]
En 1899, feu le professeur Carl-Adolphe Cornelius de Munich, l'ami et le coreligionnaire vieux-catholique de Kampschulte, a réuni les études qu'il avait faites en vue de terminer le travail inachevé de celui-ci. Il les a groupées en un volume avec quelques autres monographies sous le titre de : Travaux historiques concernant surtout la période de la Réformation. Dans ce livre, il étudie le voyage de Calvin en Italie et son œuvre à Genève jusqu'en 1548. Son ouvrage est fait dans le même esprit que celui de Kampschulte, avec la même connaissance approfondie de toutes les sources accessibles. Pour cette période-là, Cornelius est indispensable à qui veut étudier Calvin.
[Carl-Adolphe Cornelius mort le 10 février 1903. Historische Arbeiten vornehmlich zur Reformationszeit, Leipzig. La plupart de ces études avaient d'abord paru dans les Abhandlungen der königlichen Akademie, Munich, 1886-1895.]
L'année 1899, où parut le volume de Cornelius, vit également la publication du premier tome de la remarquable biographie qui sera un monument élevé non seulement au réformateur de Genève, mais aussi à son laborieux biographe, le professeur Emile Doumergue, de la Faculté de Théologie de Montauban. Trois des cinq volumes projetés ont paru, le second en 1902 et le troisième dans les dernières semaines de 1905. Le premier fait connaître l'histoire de Calvin jusqu'à la publication de l'Institution, le second jusqu'à son rappel à Genève, le troisième enfin est consacré à décrire cette ville ainsi que l'intérieur et l'entourage de Calvin. On n'a pas entrepris jusqu'ici de faire une biographie aussi détaillée d'aucun autre des chefs de la Réforme. L'ouvrage de Doumergue est intitulé : Jean Calvin : les hommes et les choses de son tempsh. L'intérêt et la beauté du livre sont rehaussés, non seulement par d'abondantes reproductions photographiques, mais encore par des dessins d'une réelle valeur artistique dus au crayon d'Henri-Armand Delille. Il laisse peu à désirer pour l'ampleur et la minutie de l'exposé. Mais on lui a fréquemment reproché, et avec raison, d'être un perpétuel panégyrique. M. Doumergue est, avant tout, un admirateur de son héros, mais un admirateur qui ne s'épargne pas la peine, et s'il est incontestablement entraîné à des exagérations, c'est en raison même de son enthousiasme. Son jugement critique est également mis parfois en défaut par son désir d'extraire des sources tout ce qu'on peut en tirer et de présenter Calvin sous le jour le plus favorable. Malgré cela, cet ouvrage a une grande valeur pour tous ceux qui désirent étudier Calvin. L'auteur du présent livre tient à reconnaître tout ce qu'il doit à M. le professeur Doumergue et espère que cette œuvre monumentale, déjà si avancée, pourra se poursuivre sans interruption jusqu'à son complet achèvement.
Dans le second volume de The Cambridge Modern History, publié en 1904 sous le titre de Calvin and the Reformed Church, le Dr Andrew Martin Fairbairn, Principal de Mansfield College, Oxford, a donné un court résumé de l'œuvre de Calvin. Ce travail se distingue surtout par une profonde pénétration des mobiles qui dirigeaient le réformateur et de leur importance spirituelle.
Aucune notice bibliographique, si restreinte soit-elle, ne serait complète, si l'on ne mentionnait pas le Bulletin historique et littéraire publié par la Société de l'Histoire du Protestantisme français à Paris. Cette publication, sous l'excellente direction de M. le pasteur Nathanaël Weiss, est actuellement dans sa cinquante-cinquième année (1906). On y trouve en abondance des études, documents et comptes rendus d'une incontestable utilité pour quiconque veut faire de Calvin le sujet de ses études.
Calvin appartient à la seconde génération des réformateurs. Au point de vue chronologique, et dans une large mesure au point de vue théologique, sa place est plutôt parmi les héritiers que parmi les initiateurs de la Réforme. Quand il naquit, Luther et Zwingli avaient vingt-cinq ans, Mélanchthon allait entrer comme étudiant à l'université de Heidelberg et Henri VIII inaugurait son règne mémorable. Aucun de ces chefs n'avait, il est vrai, commencé son œuvre réformatrice ; mais la Réforme avait atteint son développement complet en Allemagne et dans la Suisse allemande avant que Calvin fût arrivé à l'âge d'homme. En dépit de cette entrée plus tardive sur le théâtre de la gigantesque lutte du xvie siècle, Calvin doit être rangé parmi ses chefs les plus influents. Il ne pouvait faire son œuvre qu'après avoir été précédé par Luther et Zwingli ; mais il était bien plus qu'un architecte construisant sur des fondations faites par d'autres hommes. Son œuvre a été préparée et n'a été possible que grâce à beaucoup d'influences antérieures. Il sera donc utile de jeter un rapide coup d'œil sur l'état du pays où grandit Calvin : nous connaîtrons ainsi le sol et l'atmosphère où plongent ses premières impressions religieuses et intellectuelles.
Au début du xvie siècle, le royaume de France occupait à certains égards une situation prépondérante parmi les états de la chrétienté. Son unité nationale, l'organisation de son gouvernement et son influence politique en Europe pouvaient être comparées favorablement avec celles des autres contrées. L'activité de ses habitants ne s'étendait pas jusqu'aux extrémités du monde comme celle des Espagnols, qui venaient de s'imposer à l'attention et traversaient la période fiévreuse des découvertes qui marquèrent la fin du xve siècle. Le développement de la France était plus naturel, plus solide, moins artificiel que celui de sa puissante rivale méridionale. Les formes du gouvernement de l'Angleterre étaient, il est vrai, plus populaires, mais sa puissance matérielle passait pour bien inférieure à celle de la France. Le saint empire romain germanique, malgré ses riches cités, son commerce florissant, ses nombreux soldats, pouvait, moins que la France, faire usage de sa force, à cause de ses divisions et de l'absence d'esprit national. La France, au début du xvie siècle, bien qu'encore loin d'avoir atteint son complet développement d'état moderne, était le plus avancé des royaumes européens, à l'exception peut-être de l'Angleterre, où la vie nationale se dessinait déjà, plus que partout ailleurs, dans le sens des conceptions modernes.
François Ier (1515-1547) personnifiait les tendances caractéristiques de la monarchie française de cette époque, où Calvin devait poser les fondements de son œuvre. Ce souverain, d'une ambition militaire sans bornes, désireux d'acquérir pour la France une influence souveraine en Europe, jouissait d'une popularité due à son charme personnel, son esprit, son éloquence, son tact et ses dons artistiques et littéraires. Ses qualités sociales attirèrent autour de lui une cour élégante ; mais sa morale facile et son manque absolu de religion personnelle et de sérieux le rendirent incapable d'apprécier l'importance fondamentale de la gigantesque lutte religieuse qui bouleversa l'Europe pendant son règne. Sous ce règne la France eut une politique militaire agressive, sans grand succès, et une cour brillante ; l'unité nationale fut portée à un haut degré, de même que la prospérité du pays.
Depuis des siècles, les relations entre l'Église catholique et la monarchie étaient des plus étroites en France et empreintes d'une cordialité sans parallèle ailleurs en Europe. L'Église et le roi s'étaient soutenus l'un l'autre contre la noblesse. La première, profondément orthodoxe, dans le sens où le moyen âge comprenait l'orthodoxie, et résolument hostile aux hérétiques de l'intérieur, tels que les Cathares ou Vaudois, manifestait contre les prétentions extrêmes du pouvoir papal une plus grande opposition que les autres branches de la chrétienté occidentale. Elle avait un sens profond de son unité et de ses droits « gallicans », auxquels la papauté même ne devait pas toucher. Mais le pouvoir grandissant de la couronne l'amenait à surveiller plus étroitement aussi l'Église, et ce contrôle fut encore fortifié quand, en 1516, François Ier et Léon X conclurent le fameux Concordat. Désormais le roi nommait les titulaires des fonctions les plus élevées du clergé séculier et régulier. Le Concordat donna au souverain une plus grande autorité sur l'Église de France ; à la papauté, il assura une augmentation de revenus. Bien que les droits de l'Église fussent ainsi, en quelque mesure, sacrifiés, elle était exempte de bien des ingérences et redevances que le Saint Siège faisait peser lourdement sur d'autres pays. On ne trouvait donc pas en France cette haine populaire de la curie romaine si répandue en Allemagne et qui rendit possible le rapide développement de la révolution luthérienne.
Néanmoins ce serait une erreur de supposer qu'en France l'état spirituel de l'Église fût supérieur à celui qui existait dans les contrées où la couronne ne jouissait pas de la même influence. On trouvait en France, comme dans le reste de la chrétienté latine, les mêmes erreurs, une conception tout extérieure de la religion, une importance capitale attribuée aux rites, tels que pénitences, pèlerinages, indulgences, au lieu que l'accent fût mis sur l'état du cœur ou la règle de la vie. Les critiques qu'on peut faire avec justice à l'Église romaine de cette période dans son ensemble, s'adressent aussi bien à celle de France. L'accroissement du pouvoir de la monarchie favorisa beaucoup moins les intérêts spirituels de l'Église en France qu'un développement analogue de l'autorité royale au sud des Pyrénées ceux de l'Église espagnole. Aucun souverain français du xve ou xvie siècle ne manifesta un zèle comparable à celui d'Isabelle de Castille ou même de l'empereur Charles Quint. Les rois de France jouirent du contrôle sur l'Église que leur valait leur participation à la nomination de ses principaux dignitaires. Ils appréciaient cet accroissement de revenus. Ils étaient naturellement enclins à s'opposer à des changements qui modifieraient d'une façon sérieuse une organisation aussi profitable pour eux. Mais dans leurs nominations ecclésiastiques ils donnaient surtout de l'importance aux considérations politiques. On continua, sans aucune opposition du pouvoir royal, les fâcheux errements qui avaient prévalu jusque-là, en confiant les hautes charges à des gens moralement indignes ou encore en accumulant les bénéfices sur la tête de favoris, bien intentionnés peut-être, mais qui ne pouvaient leur donner aucuns soins spirituels. Dans son ensemble, la France, au début du xvie siècle, paraît avoir été satisfaite de son sort au point de vue religieux : si on la compare à l'Allemagne ou à l'Espagne on verra qu'elle n'éprouvait pas au même degré que ces deux pays le besoin d'une amélioration.
Dans la Cambridge Modern History, i, 659, Henry-C. Lea donne un frappant exemple de cumul, contemporain de la vie de Calvin. Le fils du duc René IIl de Lorraine naquit en 1498. En 1508, il prit possession des revenus de l'évêché de Metz ; 1517 le vit évêque de Toul ; il y ajouta Térouanne en 1518 ; en 1521 Valence et Die ; Verdun en 1523. Il devint archevêque de Narbonne en 1524. On le fit en 1533 archevêque de Reims et primat des Gaules. En 1536 il était évêque d'Albi et l'année suivante archevêque de Lyon. Il acquit ensuite les évêchés de Mâcon, Agen et Nantes. Il résigna plusieurs de ces postes en faveur de parents, mais resta titulaire de la plupart jusqu'à sa mort en 1550. Il possédait en outre les abbayes de Gorze, Fécamp, Cluny, Marmoutiers, Saint-Ouen, Saint-Jean de Laon, Saint-Germer, Saint-Médard de Soissons et Saint-Mansuy de Toul.
L'université de Paris continuait à être à l'avant-garde des forces intellectuelles de la France. Dès le commencement du xiiie siècle sa grande réputation faisait de ce centre de la science médiévale le type par excellence dont toutes les autres universités du nord de l'Europe désiraient se rapprocher. C'est dans ses murs qu'avaient enseigné Thomas d'Aquin, Bonaventure, Duns Scot, Guillaume d'Occam, d'Ailly et Gerson. Son bon renom comme centre d'instruction théologique avait considérablement diminué au début du xvie siècle, mais il était encore grand. Sa Faculté de théologie avait une réputation mondiale d'orthodoxie impeccable ; on l'appelait la Sorbonne, parce que son enseignement se donnait surtout dans le collège fondé en 1253 par Robert de Sorbon. Elle ne manquait ni de courage ni d'indépendance. Naguère, en 1516, l'université avait donné la preuve de sa jalouse préoccupation des libertés de l'Église gallicane, par l'opposition qu'elle avait faite au Concordat. Mais elle n'en était pas moins, à tout prendre, un obstacle au progrès. Elle était énergiquement opposée à toute innovation dans le domaine de l'enseignement ou de la doctrine. Ce n'est pas qu'elle négligeât tout à fait les connaissances nouvelles qui lui arrivaient d'Italie par dessus les Alpes. Dès 1458 on avait enseigné le grec dans ses murs, mais pendant un court espace de temps seulement. Un renouveau d'intérêt pour l'idiome attique avait été éveillé par la venue, en 1508, de Jérôme Aléandre, si fameux plus tard comme antagoniste de Luther à Worms. Les amis des études classiques sentaient bien pourtant, malgré cette approbation, que l'université leur était hostile, ses tendances scolastiques et ses méthodes arriérées. Pour ses chefs le grec était le « langage de l'hérésie » et ils condamnaient les enseignements de Luther dans les termes de la plus vive répulsiona. Malgré cela, la nouvelle doctrine gagnait rapidement du terrain en France dans les premières années du xvie siècle. On commenca à imprimer des livres en grec, à Paris, en 1507. Deux ans plus tard, le chef des humanistes français, Jacques Lefèvre, déjà célèbre par ses travaux mathématiques et ses études sur Aristote, publiait son Commentaire sur les Psaumes qui servit à Luther dans les premières années de son enseignement à Wittemberg. Parmi beaucoup d'élèves distingués, Lefèvre n'en avait pas de plus remarquable que Guillaume Budé : son Commentaire de la langue grecque, de 1529, lui fit une réputation européenne. C'est à l'influence de Budé auprès de François Ier qu'est dû l'établissement, à Paris, en 1530, des lecteurs royaux : ils devaient enseigner le grec, l'hébreu, les mathématiques, dans l'esprit de la Renaissance, et s'en acquittèrent avec un zèle qui excita l'hostilité de la Sorbonne. Ce furent les fondements du Collège de France. Sous le règne de François Ier, du reste, cet enseignement nouveau était devenu tout à fait à la mode. Le roi lui était ouvertement favorable et la liste des savants, des architectes et des artistes dont il fut le protecteur est une des gloires de son règne. Marguerite d'Angoulême, sœur aînée de François Ier, était encore mieux disposée que lui à soutenir les hommes et les méthodes de la Renaissance. Son libéralisme grandissant devait l'amener à une sympathie très catégorique pour le protestantisme, bien qu'elle n'en ait jamais fait publiquement professionb. D'une manière générale, les hommes animés d'un esprit libéral avaient en Marguerite un ferme défenseur ; elle accorda à plusieurs une protection effective, surtout après son mariage, en 1527, avec Henri d'Albret, roi de Navarre, qui la mit à la tête de la petite cour de Nérac. François Ier protégeait ces novateurs par admiration pour la science des humanistes, bien plus que par conviction religieuse. Cette protection cessa quand le nouveau levain parut menaçant pour la constitution et les doctrines de l'Église catholique, si utile à la monarchie française au point de vue politique et financier.
En France, comme ailleurs en Europe, il est certain que le nouvel enseignement incitait à la critique de l'Église, telle qu'elle existait jusqu'alors. A son point de vue, l'opposition de la Sorbonne était amplement justifiée. L'esprit de la Renaissance, c'était le retour aux sources, à l'inverse de la scolastique de la dernière période du moyen âge. Commençant par l'étude des écrivains de l'antiquité classique, il devait bientôt porter ses recherches sur les sources de la vérité religieuse, abandonner d'Ailly, Occam, Scot et Thomas d'Aquin, pour remonter jusqu'à saint Augustin et plus haut, jusqu'au Nouveau Testament. Ces essais d'investigation n'impliquaient pas en général d'intention hostile pour l'Église établie. Des hommes tels qu'Erasme, Ximénès ou Reuchlin croyaient que la vraie science, l'étude des Écritures et des Pères, une opposition sérieuse à la superstition, à l'ignorance et à la mauvaise administration de l'Église suffiraient à opérer les améliorations nécessaires. Ils n'avaient aucune envie d'une révolution.
Cet esprit de réforme humaniste était personnifié en France par Lefèvre, qui méritait bien la première place parmi les chefs religieux de son pays, dans la génération qui précéda Calvin. Il la méritait, tant par ses propres services rendus à la cause du réveil religieux, que par les disciples auxquels il inspira un zèle analogue, si ce n'est plus grand encore, préparant ainsi la voie à l'œuvre plus complète de Calvin.
Né à Etaples en Picardie, vers le milieu du xve sièclec, Jacques Lefèvre fut de bonne heure attiré à Paris, où il apprit le grec d'un fugitif natif de Sparte, Georges Hermonyme. En 1488-1489 un voyage en Italie excita son activité humaniste, et son esprit religieux se manifestait essentiellement par sa sympathie pour un type de piété très mystique. Il était de petite taille, modeste, doux et bon, sa vie faisait honneur à sa piété ; ses qualités personnelles lui valaient autant d'amitiés que son zèle pour la science inspirait d'admiration. Ses disciples eurent les destinées les plus variées dans la lutte pour la Réforme, mais ils semblent tous avoir voué une singulière affection à leur maître. Parmi eux nous citerons Guillaume Briçonnet, d'une des plus nobles maisons de France, et qui, devenu évêque de Meaux, s'honorait d'avoir été son élève ; de même Guillaume Budé, à l'inspiration duquel on devait l'établissement des lecteurs royaux ; François Vatable, qui fut parmi eux le premier professeur d'hébreu et enseigna cette langue à Calvin ; Gérard Roussel, plus tard confesseur de Marguerite d'Angoulême, évêque d'Oloron et, pendant un temps, ami de Calvin ; Louis de Berquin, qui devait mourir sur le bûcher pour sa foi protestante ; enfin Guillaume Farel, qui devint l'ardent prédicateur des doctrines évangéliques dans la Suisse française et l'intime associé de Calvin.
Briçonnet ayant été nommé abbé du grand monastère parisien de Saint-Germain des Prés en 1507, Lefèvre fut amené à en faire sa demeure pendant les treize années qui suivirent. C'est là qu'aidé des ressources de la belle bibliothèque du couvent, il se consacra avec une singulière fraîcheur d'esprit à l'étude de la Bible. En 1512 il publia une traduction latine et un commentaire des Épîtres de Paul, qui montrent clairement le développement de sa pensée. Lefèvre ne brisa jamais avec l'Église romaine en tant qu'Église ; il en retint toute sa vie certaines doctrines caractéristiques. Néanmoins, cinq ans avant les thèses de Luther, il en était arrivé à nier le mérite des œuvres, à comprendre le salut comme une pure grâce de Dieu, à douter de la doctrine de la transsubstantiation, à ne croire qu'en la seule autorité des Écrituresd. Ces affirmations, quoique très claires, n'étaient que les assertions d'un doux et savant mystique, qui ne voyait aucune incompatibilité entre ses idées et le cordial concours à apporter à l'Église telle qu'elle existait alors. On ne peut donc pas s'étonner que peu de gens aient su voir ce qu'il n'apercevait pas. Son livre ne fit pas sensation ; il continua sa paisible carrière, possédant toujours plus complètement l'affection de ses élèves et amis et obtenant, grâce aux bons offices de Briçonnet, l'estime de François Ier et de Marguerite.
Luther commençait à cette époque son œuvre de réformation en Allemagne, et vers 1519 ce pays retentissait du bruit de la lutte. Bientôt ses écrits furent connus en France. La Sorbonne, son syndic Noël Bédier en tête, condamna ses opinions en avril 1521. Les critiques contre l'Église, qui jusqu'alors passaient presque inaperçues, paraissaient désormais dangereusement « luthériennes ». Lefèvre lui-même devint suspect. En 1517 et 1518 il avait publié une étude savante, tendant à prouver que Marie Magdeleine, Marie, sœur de Lazare, et la femme qui oignit les pieds du Sauveur n'étaient pas une seule et même personne. Cette démonstration nous fait l'effet d'être purement du domaine académique ; mais c'était nier l'enseignement habituel de l'Église, c'était affirmer, par les faits, le droit d'interprétation personnelle des Écritures, enfin c'était une incursion, par un maître ès arts, sur un terrain que seul un docteur en théologie avait le droit d'explorer. Lefèvre, grâce aux soupçons que les idées de Luther avait fait naître, fut à son tour attaqué par Bédier, son opinion sur le problème des trois Maries fut condamnée par la Sorbonne, environ sept mois après que celle-ci eut rendu sa sentence contre le réformateur saxon.
Mais, un an environ avant la condamnation de son livre, Lefèvre avait quitté Paris pour l'asile que lui offrait à Meaux son ami Briçonnet, depuis 1516 évêque de cette ville. Par ses aspirations, cet évêque était un digne élève de Lefèvre. Il reconnaissait la nécessité de réformes et croyait avec les humanistes qu'en retournant aux sources, par l'étude de la Bible et la prédication des vérités bibliques, on remédierait aux maux de l'Église. Il ne voyait pas la nécessité d'une révolution et ne se rendait pas plus compte que Lefèvre du sérieux de la situation. Mais il était prêt à faire plus que la plupart des humanistes pour employer les remèdes auxquels il croyait ; la sympathie de Marguerite lui était acquise, soit pour ses convictions de réformateur, soit pour ses efforts pratiques. Il se mit sérieusement à l'œuvre. Soutenu par ses encouragements et par ceux de Marguerite, Lefèvre publia en 1523 une traduction du Nouveau Testament qui devint en 1530 une version de la Bible tout entière. Elle n'était pas la première traduction des Écritures faite ou imprimée en France ; mais celles qui avaient été faites précédemment étaient défigurées par les abréviations et modifications de texte si répandues au moyen âge. Lefèvre donna une version soigneusement faite sur la Vulgate et amendée çà et là par des comparaisons avec le texte grec. Sans être une traduction remarquable, le travail de Lefèvre contribua certainement à augmenter le nombre des lecteurs de la Bible en France.
[Reuss et Berger dans Hauck, Realencyclopädie, iii, 126-131 ; Doumergue, i, 98 ; The Cambridge Modern History, ii, 283. Le Nouveau Testament avait été imprimé en français à Lyon vers 1477 et la Bible tout entière, modifiée comme nous l'avons mentionné plus haut, à Paris, environ dix ans plus tard.]
Entre temps, Briçonnet inaugurait une active campagne de prédications dans son diocèse ; il était secondé par Roussel, Vatable, Farel et Michel d'Arande qui tous avaient eu Lefèvre pour maître et pour inspirateur. Mais bientôt surgirent de grandes difficultés. Les champions de l'ordre existant regardaient Briçonnet comme ne valant guère mieux que les luthériens. D'un autre côté, cette nouvelle prédication ne pouvait se borner à une simple explication des Écritures. Dans la pratique la réforme humaniste était presque impossible, sauf comme attitude individuelle. Farel s'éleva contre la papauté et fut probablement renvoyé par Briçonnet en 1523. Bientôt se produisirent des attentats iconoclastes absolument antipathiques à Briçonnet, à Roussel et à la plupart de leurs amis. En décembre 1524, un cardeur de laine de Meaux, Jean Le Clerc, arracha un exemplaire de la bulle du pape de la porte de la cathédrale de Meaux et la remplaça par une déclaration où il taxait le pontife d'Antéchrist.
[Il fut fouetté et marqué au fer rouge à Paris, le 17 mars 1525. Le 22 juillet suivant il fut brûlé à Metz pour avoir mutilé une statue de la Vierge.]
En janvier 1525, Briçonnet dénonça les actes de Le Clerc et des complices qu'on lui soupçonnait, mais la situation politique ne tarda pas à rendre sa position intenable. La grande défaite des Français à Pavie fut suivie par la captivité du roi en Espagne, où Marguerite alla le rejoindre en août. Désormais le Parlement de Paris était libre de faire prendre des mesures contre Briçonnet, sans crainte d'opposition. Ses prédicateurs furent interdits et les traductions de Lefèvre condamnées à être brûléese.
Briçonnet trouva que la situation dépassait ses forces. Son courage n'était pas très grand ; même s'il avait été plus hardi, il n'est pas douteux que ses timides efforts de réformation auraient eu des résultats plus révolutionnaires que ceux qu'il aurait prévus ou souhaités. Le 15 octobre 1525, il rendit deux décrets synodaux condamnant les livres et les doctrines de Luther et déplorant l'usage abusif de l'Évangile par ceux qui niaient le purgatoire et rejetaient le culte des saints. Son œuvre réformatrice était finie à Meaux. Lefèvre et Roussel furent contraints le même mois de fuir jusqu'à Strasbourg pour sauver leur vie ; mais Briçonnet lui-même resta en possession de sa charge jusqu'à sa mort en 1534. La faveur royale suivit heureusement les exilés. François Ier, à son retour de Madrid en 1526, les rappela. Il donna à Lefèvre le poste de précepteur de ses enfants et de bibliothécaire du château de Blois. C'est là que le vieux savant put continuer à travailler à sa traduction de la Bible. Marguerite, toujours charitable, voyant la tension de la situation ecclésiastique s'aggraver, le recueillit en 1530 à sa cour de Nérac, où Lefèvre mourut six ans plus tard. Roussel continua à prêcher la Réforme en France et l'on verra qu'à un moment critique il influença Calvin ; mais son quiétisme mystique était plus marqué encore que celui de Lefèvre. Comme Lefèvre et Briçonnet, il voyait bien la nécessité d'une réforme, mais sans désirer ou comprendre la nécessité d'une révolution ou être disposé à en faire les fraisf. Grâce à l'appui de Marguerite, il obtint l'évêché d'Oloron et y mourut en 1552, laissant une grande réputation de fidélité dans l'administration spirituelle de son diocèseg.
Pourtant si Lefèvre, Briçonnet et Roussel ne voulaient que d'une réforme humaniste sans rupture avec Rome, s'ils n'étaient pas disposés à la lutte, d'autres, inspirés du même esprit que les novateurs allemands, désiraient accomplir la même révolution en France. La plupart de ces réformateurs radicaux sortaient de la classe des marchands et des artisans, mais on trouvait aussi dans leurs rangs quelques hommes de savoir et d'origine plus élevée. Nous avons déjà parlé de Guillaume Farel, le bouillant élève de Lefèvre, et nous aurons ample occasion d'en parler davantage dans la suite de ce récit. Parmi ces réformateurs les plus irréductibles se trouvait un homme de haute naissance, Louis de Berquin, appartenant à la noblesse picarde et, comme Farel, disciple de Lefèvre. La dignité de son attitude, sa science et son caractère élevé lui acquirent l'amitié de François Ier et de Marguerite. Il paraît même avoir été conseiller du roi, et était lié avec N. Béraud, Erasme et Budéh. Traducteur de quelques écrits d'Erasme et de Lutheri, il collabora ainsi à la Réforme ; aussi l'attaqua-t-on dès 1523. Mais au début, et à plusieurs reprises, le bon vouloir de Marguerite et de son royal frère le sauvèrent. A la fin toutefois la faveur de François Ier lui fit défaut, parce que le roi était absent et sans doute absorbé ailleurs, lorsque, grâce à un retour offensif, Berquin exaspéra ses ennemis et succomba à une coalition de la Sorbonne et du Parlement. Il fut pendu, puis brûlé à Paris en place de Grève, le 16 avril 1529. La sentence des « juges délégués » avait été aussitôt exécutée, pour éviter une intervention possible du roi. On ne pouvait espérer de grands ménagements des tribunaux français pour les hérétiques des classes inférieures lorsqu'on vit un gentilhomme aussi hautement appuyé périr comme le plus chétif condamné. Par la mort de Berquin, le protestantisme français du type le plus sérieux perdit son représentant le plus en vue. Néanmoins, on ne peut l'appeler un chef. Il n'était pas un organisateur, et semble n'avoir eu que peu de zèle missionnaire. Il lutta surtout seul, et, quand il mourut, il n'avait fortifié le mouvement réformateur que par l'exemple de son courage.
La grande majorité des réformés français les plus avancés sortaient des classes les plus humbles, et leur conduite, dans bien des cas, était propre à exaspérer plutôt qu'à attirer les sympathies. Des excès iconoclastes, tels que ceux de Meaux, furent répétés dans divers lieux, notamment à Paris en 1528. L'esprit français est plus impulsif que celui des Allemands. L'iconoclasme se retrouve dans bien des pays à l'époque de la Réforme, mais nulle part il ne montre mieux qu'en France son aspect irritant et insensé. Dans certains pays les briseurs d'images représentaient une révolution populaire, au lieu qu'en France ils n'étaient encore qu'une poignée au milieu d'une population hostile et irritée.
[Cette affirmation paraît excessive. Avant la première guerre de religion, où ils furent surtout des actes de représailles, les excès iconoclastes comme celui de 1528 (qui, d'ailleurs, fut peut-être l'œuvre d'un agent provocateur) sont extrêmement rares. (Trad.)]
Vers 1530 le mouvement réformateur en France progressait sous ses deux formes, mais lentement et irrégulièrement. Sa forme humaniste attirait les gens cultivés. On éprouvait une grande sympathie pour les efforts de Lefèvre partout où l'enseignement nouveau avait pénétré à la cour et dans les milieux instruits. Sans rompre avec Rome, une attitude critique était devenue générale vis à vis des doctrines et des pratiques du moyen âge, surtout parmi les jeunes générations des hommes d'étude. Les réformateurs humanistes avaient peu de sympathie pour les novateurs plus radicaux. Si les premiers n'étaient pas à la hauteur de leur tâche, les seconds ne gagnaient pas le grand public à leur cause. Ce qui manquait surtout au mouvement réformateur français, c'était un chef, dont l'esprit organisateur grouperait ses forces dispersées et divergentes. Ce chef, tout en ayant le respect du monde savant, devait aller plus loin dans son opposition à Rome que n'allaient les humanistes. Il fallait qu'il fût aussi ferme que les radicaux dans leur opposition à la papauté et capable de montrer que les excès iconoclastes n'étaient qu'un épisode de la lutte, et rien de plus. Son type de théologie devait être sympathique à la mentalité latine. Calvin fut le premier de ces chefs-là. Unir les forces, politiquement et intellectuellement divisées, dans leurs attaques contre Rome et les abus de l'Église, en une réelle unité spirituelle et cela non seulement en France, mais encore en Suisse, aux Pays-Bas, en Ecosse et même, dans une grande mesure, en Angleterre ; présenter la théologie de la Réforme d'une manière sympathique à l'esprit latin, développer enfin une forme de constitution ecclésiastique qui fût indépendante de l'État, forme qu'avait su adopter le romanisme, mais que la plupart des réformateurs avaient abandonnée, et la combiner avec la participation de l'élément laïque au gouvernement ecclésiastique, totalement inconnue de l'Église romaine : tels devaient être les résultats de son œuvre.
La vénérable cité épiscopale de Noyon, située à une centaine de kilomètres au nord-nord-est de Paris, est bâtie sur la petite rivière de la Verse, à moins d'une lieue de l'endroit où cet affluent se jette dans l'Oise. Dans les conditions où se faisaient les guerres au moyen âge et même au xvie siècle, la situation de cette ville ne lui permettait pas de résistance bien sérieuse. Son principal avantage naturel fut toujours la grande fertilité du sol de ses environs. Sa population, sans avoir jamais été nombreusea, n'en possédait pas moins certains caractères distinctifs. Il en est fait mention pour la première fois comme d'un poste sur la route de Reims à Amiensb, et cela probablement dès le ive siècle de notre ère ; puis elle acquit une notoriété ecclésiastique lorsque, vers 531, saint Médard y transféra son siège épiscopal, tandis que jusqu'alors le chef-lieu du diocèse avait été la ville qui s'appela plus tard Saint-Quentin. Ses successeurs résidèrent aussi à Noyon, et cela jusqu'à la Révolution française qui mit fin à l'existence de cet évêché. L'importance acquise par cette cité au viiie siècle est attestée par le fait que Charlemagne y fut couronné comme roi des Francs en 768. Il est presque certain que ce fut également à Noyon que la même cérémonie fut célébrée pour Hugues, le premier roi capétien, en 987. Le développement politique, au xiie siècle, amena l'organisation, relativement paisible d'ailleurs, des citoyens en commune en 1108 ou 1109 ; mais vers la fin du siècle suivant le pouvoir ainsi conquis était en grande partie sorti des mains des bourgeois : l'autorité avait été ressaisie par le clergé ou avait passé entre les mains de fonctionnaires, représentant la puissance royale qui grandissait chaque jour. Les formes extérieures de la commune se maintenaient : au temps de Calvin on admettait de nouveaux bourgeois, on nommait un maire et des conseillers et ceux-ci conservaient quelques vestiges d'autorité.
Noyon avait, au début du xvie siècle, l'aspect d'une ville aussi cléricale qu'au moyen âge. Comme le commerce et l'industrie, si peu représentés de nos jours, l'étaient encore moins alors qu'aujourd'hui, l'élément ecclésiastique y avait le champ libre pour y faire valoir ses intérêts. Actuellement encore, plus d'un siècle après la suppression de l'évêché de Noyon, la situation dominante du clergé est rendue sensible par l'aspect spécial que présente la ville au point de vue architectural. Son imposante mais massive et sombre cathédrale, construite vers le milieu du xiie siècle, unit la force du style roman à quelques-unes des grâces du gothique qui commençait alors à se développer dans la région. Cet édifice demeure comme un témoin du zèle et de l'esprit de sacrifice de ceux qui l'ont élevé. A côté de ce monument principal de la piété médiévale, Noyon possède encore une élégante maison capitulaire du xiiie siècle où les chanoines de la cathédrale tenaient leurs séances, tandis que la bibliothèque, construite au xvie siècle, et quelques fragments encore existants de l'évêché attestent l'importance, maintenant disparue, des anciens prélats. D'autre part, le fait que le pouvoir civil n'était pas insignifiant est prouvé par l'Hôtel de Ville, curieux bâtiment de la Renaissance, construit en 1486. Les regards de Calvin durent fréquemment le contempler, de même que les autres édifices que nous venons d'énumérer.
Le plus notable de tous les habitants de Noyon au xvie siècle était l'évêque, de droit l'un des douze pairs de France et, en sa double qualité de comte et de seigneur spirituel, le plus grand propriétaire foncier de la contrée. Celui qui occupait ce poste important de 1501 à 1525, c'est-à-dire pendant l'enfance de Calvin, était Charles de Hangestc, d'une des meilleures familles nobles de Picardie. Il eut pour successeur son neveu Jean, dont l'épiscopat de 52 années se prolongea jusqu'après la mort de Calvin : sa nature batailleuse l'entraîna à des querelles avec son Chapitre, pour des raisons aussi insignifiantes que celle, par exemple, de son droit à porter une barbe ; d'autre part, son indifférence pour les questions religieuses du jour rendit son orthodoxie suspecte. Les rivalités n'étaient pas rares entre les évêques de Noyon et les cinquante-sept chanoines dont se composait le Chapitre. Ce corps possédait de nombreuses propriétés foncières et d'anciens droits qui lui permettaient de soutenir ses prétentions à termes égaux et parfois supérieurs. En outre, à côté des deux pouvoirs ecclésiastiques qui se groupaient autour de la cathédrale, Noyon se faisait remarquer par ses églises paroissiales, ses établissements monastiques richement dotés et par d'autres preuves tangibles de l'importance de ses intérêts ecclésiastiques. L'éducation n'était pas oubliée non plus : Noyon possédait une ancienne école, fondée en 1294 par le chanoine Robert Lefèvre, et que l'on surnommait l'école des Capettes, à cause du couvre-chef de ses écoliers. Calvin lui-même en fut élève. En se plaçant au point de vue du xvie siècle, Noyon devait être une ville agréable à habiter pour les gens d'Église et pour les laïques qui ne vivaient pas de commerce. Elle avait ses intérêts et ses conflits locaux, sans parler des préoccupations d'intérêt général qui y pénétraient du monde extérieur. La proportion de ses citoyens instruits et de position aisée devait être considérable. Les querelles qui y éclataient pouvaient être mesquines, mais elles devaient stimuler l'intelligence.
Noyon appartenait géographiquement à la Picardie et ses habitants possédaient les traits caractéristiques de la race picarde. Ardents, amateurs de controverses jusqu'au fanatisme, dogmatiques enthousiastes et tenaces, les Picards ont combattu sous tous les drapeaux dans les luttes qui ont divisé la France, mais n'ont jamais fait preuve de tiédeur ou d'indifférence. Ils sont capables de produire des chefs de partis et prêts à pousser leurs principes jusqu'aux limites extrêmes de la logique. Une province qui a donné naissance à Pierre l'Hermite, aux philosophes Roscelin et Ramus, aux révolutionnaires Desmoulins et Babeuf, pour n'en pas nommer d'autres, devait être favorable aux idées de réformation des débuts du xvie siècle. La Picardie fournit un contingent de noms importants, outre celui de Calvin, à la liste des réformateurs religieux de la France. Parmi eux figurent Lefèvre, Olivétan, Roussel et Vatable. Il était donc vrai, comme le disait déjà au xie siècle un évêque de Noyon, que c'était un « pays fertile en guerriers et en serviteurs de Dieu. »
La famille où Calvin devait naître s'était élevée sur l'échelle sociale pendant les dernières années du xve siècle. Elle n'était pas originaire de Noyon même, mais du petit village voisin de Pont-l'Evêque, où les Cauvin — c'est ainsi qu'ils prononçaient leur nom — étaient domiciliés depuis longtemps et d'où ils partaient pour exercer la profession de leurs ancêtres, celle de bateliers sur l'Oise. Le grand-père de Calvin, dont le prénom paraît n'avoir pas été conservé, passe pour avoir ajouté le métier de tonnelier à celui de batelierd





























