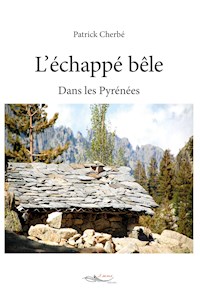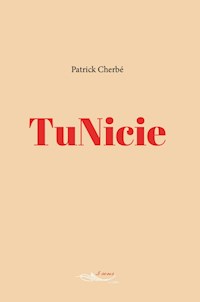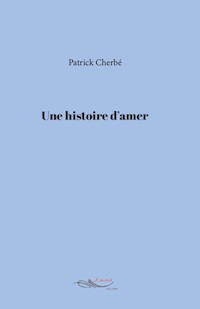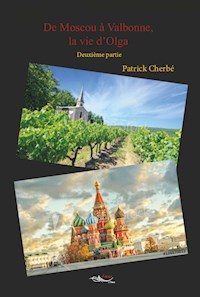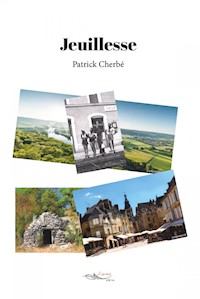
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’idée de ce roman puise sa source dans l’exposition photographique de Michel ARCHAMBEAU consacrée au Périgord Noir.
Cette exposition qui s’est tenue au Musée de la Gare Robert Doisneau à Carlux, a mis en valeur l’œuvre de M. ARCHAMBEAU et sa passion pour cette région.
Mais les personnages et les faits relatés dans cet ouvrage n’ont aucun lien avec la réalité et ne sont que pure imagination de l’auteur.
Que M. Michel ARCHAMBEAU soit chaleureusement remercié d’en avoir aimablement autorisé la publication.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Chef d’entreprise retraité après une carrière en France et à l’étranger dans le domaine de la parfumerie. A la suite de ses deux premiers romans,
Patrick Cherbé signe ici son nouvel ouvrage traitant du thème des relations intergénérationnelles et de l’implication d’une vie à tenter d’en ‘sauver’ une autre, venant d’un monde différent, grâce à son expérience, ses certitudes, sa patience.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick Cherbé
JEUILLESSE
Du même auteur
– Une histoire d’amer ou l’itinéraire d’un enfant bâté
2020, 5 Sens Editions
– De Moscou à Valbonne, la vie d’Olga
Tome I, 2019, 5 Sens Editions
– De Moscou à Valbonne, la vie d’Olga
Tome II, 2019, 5 Sens Editions
Et la lumière fuit !
L’obscurité tomba de nulle part sur les champs, les bourgs et les hameaux, comme si quelqu’un avait fermé sans prévenir les fenêtres et les volets du ciel au cœur de la journée. Une intolérable sombreur, totalement illégitime à cette heure de la journée, s’était abattue sans autre préavis que la chute soudaine de ténèbres inédites et angoissantes. Un peintre titan peignait in situ à coups de larges spatules sa funèbre toile tout là-haut. Sa gouache mercure s’assombrissait insensiblement, s’agglutinant strate après strate au tableau tel un nuage d’abeilles à son essaim. L’air bourdonnait du bruit sourd d’un moteur d’avion propulsé par un ventilateur géant. Superposées, les couches de peinture compactes gonflaient un énorme ballon, une immense montgolfière sans nacelle, sans pilote ; un aérostat fantôme au ventre sombre d’une obésité hors norme, une panse repue d’herbe noire que le vent agitait sans peine dans tous les sens comme un ballon de baudruche brandi par un enfant dans une fête foraine.
Un effet miroir coloria aussitôt les prés, les arbres et les toits dans les mêmes tons gris-noir, comme si un poulpe géant avait aspergé le sol de son encre fuligineuse. La poussée d’Archimède faiblissant, le bas-ventre du monstre traînait si bas qu’il tutoyait l’épaisse canopée brune des forêts. Il faisait nuit en plein midi. Le Périgord Noir portait bien son nom à cet instant précis où la grosse bedaine menaçait d’éclater à tout moment. Elle coiffait le paysage tel un grand couvercle d’ébène, une espèce de linceul noir qui descendait doucement vers la terre. Un silence arrogant, inhabituel, s’était installé, les oiseaux et toute la faune s’étaient tus, les cieux étaient en deuil, la nature passée de la vie à un sommeil comateux puis à trépas. Dieu, fatigué, déprimé, venait de fermer les yeux du monde.
Une étrange atmosphère planait, celle d’un enterrement fantôme, sans prêtre et sans cortège funèbre, au-dessus d’un gigantesque aître orphelin de tout lieu de culte, un cimetière sans sépultures ; un koimêtêrion comme disaient les Grecs, un dortoir au sens premier du terme, sans lits et sans occupants.
Quelques brisures d’un bleu-électrique puissant déchirèrent cet immense suaire couleur noir de fumée, juste avant un fracassant grondement en décalé qui fit tressaillir la terre, les bêtes et les hommes. Une brève interruption de son s’ensuivit, une insonorité plus silencieuse que le silence glaçant les esprits, comme si la nature s’était arrêtée de respirer. Soudain une avalanche de hallebardes s’abattit violemment avec un sifflement de flèches froidement décochées, se plantant dans le sol comme des couteaux. Les frondaisons, résonnèrent d’un bruit de feuille de papier froissée, les gouttes teintées de nacre grise, de plus en plus grosses martelaient le feuillage de ce bruit cassant que fait la pluie en tambourinant obstinément sur une marquise de verre pour la briser. Un mur d’eau se mit à cascader rendant la vision quasiment nulle, prisonnière d’un rideau noir opaque, impénétrable. La cataracte tomba dru, longuement. La violence de cet assaut parut aux hommes et aux bêtes une éternité. Un blitzkrieg interminable et puissant venu d’un ciel de haine promettait l’enfer à la terre. Les bourrasques, les éclairs, le tonnerre, la pluie puis les grêlons, produisirent l’effet surprise d’une armée décidée à en finir avec l’ennemi. La guerre fit rage sans discontinuer jusqu’à ce que la miction du nimbostratus fût accomplie.
La baudruche géante vidée, la lumière revint peu à peu par l’Ouest, le vent retomba, la pluie cessa, un cessez-le-feu unilatéral venu du ciel avait été ordonné. L’affusion noire, verticale, avait tout ravagé : des blés fauchés, des barrières détruites, des branches arrachées gisaient çà et là. D’immenses flaques réflectrices avaient projeté la toile du ciel au sol, inondant les chemins et les prés ; des vaches encore couchées, engourdies, au cuir suintant, pointaient de leur museau les stigmates du déluge. Perturbé, le bétail s’était même arrêté de ruminer, un silence de mort semblait célébrer le chaos. Seule la rivière affolée, charriait bruyamment un serpent d’eau boueuse où un fatras de végétaux et d’objets hétéroclites s’abandonnait à la violence bouillonneuse et torrentueuse du courant. La désolation marquait de son empreinte vigoureuse et oppressante un paysage perclus, à genou. Attila était descendu des cieux.
La détrempe du peintre démiurge avait abandonné son liant et s’était diluée dans l’éther pénétré d’une forte odeur de pétrichor, de terre, d’humus, de feuilles et de bois mort. Les couches épaisses de gouache craquelée s’étaient décollées de son support aérien, le tableau de l’artiste avait disparu et son flochetage avec. Il ne s’exposait plus mais une odeur animale putride s’était propagée, un mélange d’air humide, de limon et d’eau croupie montait lentement des entrailles d’une glèbe éviscérée, meurtrie, agonisante.
Au pays du précieux champignon poussant sous la strate muscinale transformée par les Périgordins en ossuaire de diamants noirs, la population assommée se réveillait après ce cauchemar diurne digne d’un cataclysme biblique. Des charpentes détuilées et des voitures avaient été balayées, aspirées puis projetées à terre. Des chênes centenaires fracturés, ouverts comme des livres, des lauzes, des briques et des tuiles canal brisées jonchaient les rues, les cours et les jardins. Un mauvais jeu de mots avait fait la manchette de la une du canard local dénonçant un impressionnant « briques-à-brac ». Cette fois-ci les épopées de Gilgamesh et de Noé avaient bien eu lieu. « Le Déluge » de Francis Danby et l’ « Outrenoir » soulagien avaient passé un pacte unissant les deux peintres dans une vision noire et apocalyptique du monde. Monsù Desiderio leur avait prêté main-forte, cette fois Nomé et Barra s’en étaient pris à la nature, à des monuments végétaux, ne laissant que des ruines dans un décor de fin du monde, fidèles à leurs œuvres eschatologiques abandonnant leur peinture au regardeur, saisi, plongé dans un sentiment de détresse et d’impouvoir.
Seul le Tuber melanosporum, à l’abri sous la terre, avait échappé à la colère des cieux. Malgré la violence de l’attaque, ses fins cueilleurs taiseux avaient salué l’abondance de cette pluie torrentielle pourvoyeuse de cette délicate truffe parfumée in-humus, sournoise, ne dévoilant son arôme inhumé qu’au flair subtil et exercé des chiens et des porcs rompus à l’exercice. Fidèles des dieux chthoniens, les trufficulteurs, rabassiers de père en fils, dénicheurs de pépites, orpailleurs de la glèbe, avaient cependant déploré la chute de quelques yeuses immémoriales, mères nourricières du Graal local.
Un autre homme n’avait pas regretté ce moment intense où son pays avait cru apercevoir la Grande Sorgue : Michel Rochambeau, photographe depuis plus de cinquante ans, si attaché à son Périgord natal qu’il se disait Périgordin depuis plusieurs siècles.
Ses photos prises uniquement en noir et blanc immortalisaient son terroir à travers un procédé traditionnel : l’argentique ; par extension du procédé induisant une pellicule recouverte d’une fine couche de nitrate d’argent, il nommait ainsi son appareil muni d’un film qu’il développait lui-même, à l’ancienne, dans une chambre noire à l’odeur ascétique dont il tirait des épreuves de vieilles bouilles couturées, de pierres périgordines au naturel sombre et brut. Son talent de magicien de la lumière redonnait vie à ses sujets et les magnifiait. « Nul besoin de pixels ou de capteurs numériques », disait-il à tous ceux qui osaient lui parler de nouveautés photographiques révolutionnaires. Convaincu qu’on ne vit bien le présent et l’avenir qu’à la lumière de sa mémoire, fidèle à la photographie classique, avec son argentique il transmettait son Périgord natal en voie de disparition comme Doisneau avait transmis par son talent les images, l’âme et l’air du temps révolus des rues parisiennes d’antan. Subjugué par ce spectacle de fin du monde, abrité sous son large chapeau, Michel avait bravé la ruche tueuse, immortalisant les scènes dantesques avec des dizaines de clichés plus noirs les uns que les autres avant d’y ajouter la lumière du juste. Ses clichés furent si réalistes que la presse locale s’en empara. Le lendemain une partie de son œuvre était déjà exposée aux yeux, à la stupeur et à la détresse des lecteurs meurtris dans leur âme et leur chair. Périgord ou « Péri…Gore », la presse ne savait plus quels titres inventer.
Depuis quelques années Rochambeau reconstituait patiemment la mémoire de plusieurs types de maisons anciennes à gouttereaux et fenestrons ou de constructions qui disparaissaient du paysage peu à peu comme les bories, les aiguiers, les burons, les caselles, les clèdes, cairns et autres tumulus, ayant toutes des fonctions bien précises, utiles jadis aux bergers, aux fromagers, aux cultures du tabac ou de la châtaigne, pour fumer, sécher les récoltes, héberger les animaux et les hommes. Il avait beaucoup photographié les murs et les terrasses à ciel ouvert comme les bancaous, les restanques ou les faysses, mettant en valeur les terres les plus pentues.
Michel aimait ces pierres noires, sèches ou ces lauzes plates recouvrant les édifices. En les capturant c’est un bout d’âme du pays qu’il ranimait. En la fixant sur la pellicule il la gravait dans la mémoire collective des futures générations de Périgordins. Il rendait hommage au colossal travail d’épierrage et de remblayage de ses ancêtres les compagnons restanquères, ces hommes qui avaient ainsi apposé le paraphe anonyme de leur éprouvant labeur séculaire. Il était même allé jusque dans l’Aveyron, le Cantal et les monts de l’Aubrac photographier les burons, ces constructions de pierre sèche, vestiges d’une architecture populaire, paysanne. Il les avait trouvées en altitude en empruntant les drailles, ces pistes par lesquelles les troupeaux transhumaient, et les pâturages où les éleveurs des vallées menaient les bêtes lors de l’estive. Certaines dataient du XVIIe siècle où étaient nés avec le temps les savoureux saint-nectaires, laguiole, fourme ou cantal. L’architecture pastorale qu’il avait découverte au cours de ses déambulations l’avait aussi initié peu à peu au langage de ses ancêtres. Auprès des vieux du coin il avait appris que le mot buron provenait de la racine bur qui avait donné en vieux français buiron synonyme de cabane. Il était attaché à ce vocabulaire oublié que ses expositions dépoussiéraient à travers les explications et commentaires dont il rédigeait lui-même les textes placés sous chaque photo.
Aux journalistes parisiens venus couvrir les stigmates de la catastrophe, en guide historique scrupuleux il se fit un plaisir, un devoir, d’expliquer qu’on dit Périgordins pour les habitants de l’ensemble du Périgord et Périgourdins ou Pétrocoriens pour les habitants de Périgueux ; que le grand Fénelon était né ici, à Sainte-Mondane (Senta Mundana en idiome local), à moins de dix minutes en voiture. De peur qu’ils écrivissent des fadaises sur son Périgord, il précisa que Périgueux se trouvait à l’origine, avant la conquête romaine, en territoire gaulois et non en Aquitaine séparés par « la rivière Garumna » ainsi dénommée par Jules César. Il ne fut pas peu fier non plus de leur annoncer que « soun païs » en avait vu d’autres, que les Périgordins, un grand peuple valeureux, avait fourni plusieurs milliers de guerriers à Vercingétorix pour l’aider à affronter les légions romaines ; que ses ancêtres, fidèles à leurs coutumes, avaient même conservé leurs divinités gauloises sous la domination romaine.
Fidèle à l’étymologie du mot photographe ou peintre de la lumière, Michel Rochambeau avait ce réflexe, propre à tous les amoureux de leur région quelle qu’elle fût, de braquer sur la sienne son projecteur, sanctuariser ainsi ses pierres, ses monuments, ses rites, ses visages burinés, ses costumes. Son pays était unique et pour lui la pétrolisation culturelle de sa région n’était autre que l’expression du sentiment fort et intime d’appartenance à une terre, à un terroir, une façon de préserver son identité, quête légitime, naturelle et inhérente à tout être humain fidèle au jardin qui l’a vu naître. Son identité, il l’avait aussi puisée dans l’origine de son patronyme, vieux nom de famille originaire du massif central, dérivé d’arcanbald, issu des racines arcan (signifiant sincère, naturel) et bald (audacieux, intrépide). Pas la suite arcanbald avait aussi généré orcanbald ou rocanbald. Quelques années avant sa retraite, ses ex-collègues, plus jeunes, tous inconditionnels adeptes du digital et du numérique, l’avaient amicalement surnommé Archamtique.
Après la catastrophe, parcourant la campagne, armé de son argentique en bandoulière, prêt à le dégainer à tout moment, il avait continué à fixer sur sa pellicule les lieux saccagés. Malgré le retour de la lumière, le noir bilan de la dévastation l’emportait dans les esprits de la population traumatisée. Au cours de sa balade post-cataclysme il avait remarqué, à sa grande satisfaction, que la plupart des édifices de pierre centenaires avaient tenu le choc contrairement aux armatures et charpentes contemporaines des toitures et des hangars. Les chabanos ou cabanes de pierre sèche aux toits de lauzes avaient résisté à la fureur du cyclone, ni les piédroits ni les linteaux n’avaient cédé. Quant aux larmiers, reprenant du service, ils n’avaient pas trahi le labeur rocailleux et inhumain des anciens, repoussant efficacement au dehors la bile et le fiel ivres de la colère des dieux.
Mais il était bien un des rares à se réjouir, les gens eux, mus et préoccupés par des soucis matériels, économiques, étaient désespérés. Les standards des mairies, des courtiers, des pompiers, avaient été surchargés d’appels, beaucoup prenaient des photos numériques des dégâts subis dans leur proche environnement dans l’espoir d’une prise en charge urgente par les assurances. Mais pour cela il fallait que l’événement fût qualifié officiellement par l’État de catastrophe naturelle. Les mairies prises d’assaut par les administrés, les maires harcelés jusqu’à leur domicile, tous les villages et leurs habitants étaient sens dessus dessous.
Dans le bistro du coin, Michel se posa pour discuter de l’événement avec le patron et lire le canard local dans lequel ses premières photos faisaient déjà la une. À côté de lui un jeune homme au look un peu zonard, discutait au téléphone. Ils étaient les deux seuls clients présents dans l’établissement. Qu’il l’eût voulu ou non Michel fut bien obligé d’entendre la conversation. En faire abstraction eut été une prouesse, tant le jeune, absorbé par sa discussion, parlait fort, ignorant toute autre présence dans la salle. Mais qu’il écoutât ou non il ne captait rien, pourtant il y avait bien des mots de français correctement prononcés dans cette conversation ; le nez dans le journal, sans rien laisser paraître, il tendit l’oreille pour tenter de déchiffrer ce sabir énigmatique, impénétrable. Il connaissait bien le patois et quand il ne voulait pas que sa discussion avec un gars du coin soit comprise par des visiteurs, il mélangeait des mots d’occitan avec du français. Mais là, c’était comme si ce visiteur parlait un autre patois, inintelligible, « or, de nos jours, se disait-il, les jeunes ne parlent plus patois ».
Il éprouvait un sentiment étrange qu’il ne parvenait pas à expliquer, c’était le monde à l’envers. D’habitude les vieux du coin se mettaient à parler leur langage codé à la vue d’un touriste entrant dans l’établissement ; aujourd’hui c’était lui le touriste, étranger sur ses propres terres. D’où venait ce jeune, encore adolescent, baragouinait-il un charabia pour ne pas être compris ou parlait-il un autre idiome qu’il ignorait ?
Il adressa un regard discret au patron, une vieille connaissance qu’il côtoyait depuis des années, accompagnée d’une moue expressive, l’air circonspect, la bouche fermée, interrogative, demandant s’il le connaissait. Depuis son comptoir le cafetier lui renvoya des œillades tout aussi perplexes en remuant la tête négativement, les épaules et les coudes en suspension.
– Wesh Morrain !… Samedi on s’est trop enjaillés avec TMTC… Il était avec sa baé. On est allés chiller dans le square… et on a tiré sur un zouz… trop ouf !… Qui ? Sa gow ?… Ouais ! Un peu zoulette sur les bords !… Si ! Y avait une autre zouz pas cheum mais restée dans la friend zone ! Mais lui il est trop swag ! Un badasse, une vraie gueule de thug !… Ici ? Non, Miskine ! Y a que des thug life ! Mais le zouz super ! On était OKLM ! Trop posey !… Et toi, wesh ?
Les deux hommes échangèrent des mimiques pleines de questionnements, haussant et fronçant tout ce qu’ils pouvaient : les épaules, le menton, les yeux, les sourcils. Le gamin devait avoir à peine quinze-seize ans et ils n’avaient pas compris le moindre sens de ses phrases. Accentuant leur pantomime, muets, ils se regardaient, hésitant entre le désir de garder leur sérieux ou éclater de rire. Une irrésistible envie de pouffer les avait submergés lorsqu’ils avaient entendu : « On est allés chier dans le square », mais ils surent détourner les yeux l’un de l’autre pour ne pas exploser.
– En fin de soirée y a un blackos et un babtou qui nous ont cherchés… Non ! Non trop fragile le babtou ! Avec TMTC zont vite tracé… Non, TKT, j’fais gaffe aux poukaves… Et puis Osef !… Ouais, askip !… Kchua ? T’as le seum ?… Tire-toi un zouz ! Posey !… Aley, wesh Morrain !
Le jeune homme se leva, régla sa consommation sans prononcer un mot et sortit, laissant les deux hommes médusés.
– Un zouz patron et k’sasott ! dit Michel d’un ton sérieux qu’il ne put maîtriser longtemps.
– Kchuuuaaa ? répondit du tac-au-tac son vieil ami.
Les deux hommes qui s’étaient retenus jusqu’alors éclatèrent de rire, libérant leurs zygomatiques frustrés depuis un bon moment.
– Purée ! On vieillit Michel ! On n’a rien pompé ! On est largués !
– Pour sûr ! Mais il doit être étranger ou d’origine étrangère, pas possible autrement ! Allez ! Faut que j’m’arrache ! dit-il en imitant maladroitement la gestuelle et la dégaine pleines de désinvolture du jeune qui ne manqua pas de provoquer à nouveau l’hilarité du patron.
Michel sortit à son tour et aperçut le jeune homme assis sur l’unique banc de la place du village. Intrigué par cet échange téléphonique auquel il venait d’assister, Michel s’approcha pour tirer au clair cette énigme. Était-ce un étranger, un jeune Périgordin, et surtout quelle langue parlait-il exactement ?
– Bonjour jeune homme, je peux ?
– Si vous voulez.
– Désolé de vous importuner mais je vous ai entendu tout à l’heure discuter au téléphone et vous parliez une langue que je ne connais pas. Est-ce que vous êtes Périgordin ?
– Non, Bordelais, je suis arrivé hier.
– Mais vous parlez français et une autre langue en même temps que je ne comprends pas.
– Ah mais c’est une langue de jeunes comme on dit, on se comprend entre nous.
– C’est votre patois en quelque sorte ?
– Ah non ! Quelle horreur !
– Mais d’où sortent ces mots que je ne comprends pas ?
– Un peu de partout, de l’anglais, du wolof, de l’arabe, du russe, du polonais, de l’hindi…
– La seule phrase que j’ai comprise et qui m’a fait beaucoup rire c’est : « On est allés chier dans le square… »
– Ah non pas du tout ! Vous avez entendu chier mais j’ai dû dire tchiller. Ça vient de l’anglais « to chill » qui veut dire se distraire, prendre du bon temps. Si j’avais voulu dire chier, j’aurais dit « iech ».
– Ah ok ! Mais vous parlez couramment l’anglais alors ?
– Chui nul en anglais ! En fait ces mots sont tirés de chansons de rap qu’on écoute beaucoup mais pas les vieux. Euh pardon !
– Non, pas grave ! T’as raison, chui un vieux pour toi, c’est normal. Autant appeler un chat un chat ! Je m’appelle Michel et toi ? Je peux te tutoyer ?
– Kk ! Moi c’est Véer.
– Véer ? Pas commun ! Enchanté Véer ! Kès tu fais dans la vie ?
– J’me balade.
– Tu es au lycée ?
– Non ! Plus… J’ai plaqué l’école. Je m’emmerdais grave.
– Moi j’ai 62 ans et toi ?
– 17 ! C’est un interrogatoire ?
– Non non ! Excuse-moi, juste pour faire connaissance.
– Kk ! Bon j’vais y aller. Au revoir Michel.
– Tu vas où ? Euh… sans indiscrétion aucune bien sûr !
– Ché pas, je vais marcher.
– T’as pas de voiture ?
– J’ai 17 ans je vous ai dit, chui venu en bus.
– O.k. Véer, bonne balade. Voici ma carte, dit-il en lui tendant un bout de carton pincé entre le pouce et l’index, tu m’appelles quand tu veux, j’habite seul. Si tu veux venir manger un bout ou dormir, n’hésite pas, j’ai ce qu’il faut. J’habite ici au bout du village. Ça me ferait plaisir de discuter avec toi. Bonne balade. À plus peut-être. Prends soin de toi.
– TKT Michel !
– Quoi ?
– T’inquiète !
– Ok ! Et si tu sais pas quoi faire, moi aussi je me balade beaucoup à pied. Je connais le coin, on peut faire une virée ensemble, dit-il en s’éloignant.
Si Michel ne comprenait rien à sa langue il pensait avoir tout compris de la situation de Véer. Le gamin était paumé, il avait fait plus de deux cents kilomètres sans savoir trop où il allait, fuyant vraisemblablement Bordeaux. Pour se perdre dans ce petit village près de Sarlat, fallait-il qu’un jeune branché comme lui fuie quelque chose ou quelqu’un ! Il ne savait pas pourquoi mais il avait envie de l’aider, sa bouille de paumé angélique, sa dégaine de zonard, son jeune âge surtout, l’avaient ému.
C’était le 25 mai 2019, l’exposition de ses œuvres à l’espace Robert Doisneau de Carlux son village natal, venait de s’achever. Elle était intitulée : « Nostalgique Périgord Noir » et avait eu beaucoup de succès, même les médias parisiens en avaient dit quelques mots. France Info télé avait fait un petit reportage sur le sujet. En Dordogne il commençait à être connu et respecté. Dans son village d’à peine six cents âmes, il était la célébrité du coin. Photographe indépendant, retraité, il n’avait d’autres soucis que de s’adonner à sa passion et poursuivre sans pression économique ses balades à la recherche de clichés originaux. Veuf depuis une dizaine d’années, ses enfants vivaient à Paris, quand il ne se promenait pas dans la nature, il lisait, s’informait, se cultivait et développait ses photos lui-même chez lui.
Il pensait à Véer, à cette rencontre improbable avec ce mioche qui aurait pu être son petit-fils. Il avait pigé que Véer n’était pas son vrai prénom et qu’il n’avait pas voulu révéler sa véritable identité. Il se revoyait au même âge, rebelle lui aussi, ne sachant que faire de sa vie. On ne sait rien à dix-sept ans et encore moins de quoi sera fait demain. Sans se soucier du lendemain on rejette tout, l’école, les parents, le système. Michel, c’est la photo qui l’avait sauvé dès l’âge de douze ans. Il aimait dire malicieusement que c’est elle qui l’avait révélé. Il avait travaillé toute sa vie dans la photographie industrielle. Cette exposition avait été le couronnement de sa carrière car ses clichés étaient exposés pour la première fois. Il en avait fait des milliers, exclusivement consacrés à son Périgord natal, jusqu’à ce qu’un jour il se décide à les sortir des cartons où ils dormaient depuis des années. Le style qui l’avait rendu célèbre consistait à ramener la lumière sur le sujet en s’inspirant de la technique des gravures des XVII et XVIIIes siècles. Ses prises de vue minutieuses préservaient aussi le secret de sa réussite, son travail sur la lumière et la part d’ombre délibérée avait révélé son esprit artistique. Pour tous les Périgordins Michel avait constitué la mémoire patrimoniale ravivant les racines paysannes de cette région.
Il repensait à Véer en se disant que s’il n’y avait pas eu la photo dans sa vie, il serait peut-être parti, trimardeur sur les routes, à la recherche lui aussi de l’inconnu. Ni l’école ni le sport ni le système éducatif ne l’avaient attiré dans sa jeunesse. Et si, à soixante ans passés, il vivait toujours dans un petit village du Périgord c’est parce que justement il n’avait jamais accepté le système devenu, au fil des dernières décennies, de plus en plus libéral et coercitif à la fois. Il voyait ces couples, ces jeunes, vivre avec des salaires de misère qui ne faisaient plus rêver les jeunes ados. Il les comprenait, s’interdisant de les juger. L’avenir qu’on leur réservait n’augurait rien de bon, il voyait tous les samedis ces défilés de gilets jaunes dans les rues. Ces manifestations, parfois violentes, traduisaient la désespérance du peuple qui avait faim de tout, surtout d’une autre vie, se considérant comme le plouc-émissaire d’un état sourd aux problèmes de son quotidien. Il avait eu la chance de naître après la guerre, de ne pas connaître le chômage ni la précarité. Mais il avait vu venir petit à petit, au cours des années 80/90 les limites de ce libéralisme effréné, proposé, imposé aux gens. L’exultation pudique mais réelle des trente glorieuses n’avait pas survécu aux trois décennies de plein emploi. C’est aussi pour ça qu’il méprisait la traîtrise de Mitterrand, un faux socialiste qui avait cédé aux sirènes du libéralisme économique dès 83.
Depuis quelque temps, Michel s’était documenté, avait essayé de comprendre pourquoi tout partait à veau l’eau, pourquoi les jeunes mais pas seulement, étaient désabusés, sans projet, sans avenir. Il en voulait aussi à un certain Adam Smith. Considéré comme le père des sciences économiques modernes, ce philosophe, économiste, avait fait beaucoup de mal selon Michel à la nouvelle civilisation qui se dessinait alors. Censées dépasser l’obscurantisme et promouvoir les connaissances, « Les Lumières » avaient éclairé les hommes comme il éclairait artistiquement ses photos mais elles avaient aussi leur part d’ombre. Cet Écossais du XVIIIe siècle, auteur de « La Richesse des nations », texte fondateur du libéralisme économique, avait marqué son époque et l’avenir aussi.
Pour Michel, depuis 1983, la France était entrée de plain-pied dans le monde libéral quand Mitterrand, deux ans à peine après son élection, avait trahi l’esprit du socialisme et ses engagements électoraux comme à son habitude ; quand il décida avec son sherpa Jacques Attali, très inspiré comme toujours, d’ouvrir le pays au Marché et au libéralisme outrancier. L’argent avait très vite commencé à exercer sa prééminence sur l’homme. Les affaires, le pognon, comme il disait d’un ton méprisant, avait bouffé l’être humain devenu un objet, une simple marchandise. Smith n’avait rien « pondu » d’original car beaucoup de ses idées avaient déjà été avancées par d’autres économistes renommés comme Hume, Quesnay, Locke ; son talent provenait du fait qu’il avait su emprunter à ces hommes leurs différentes analyses éparpillées, leurs idées économiques hétérogènes dont il avait su tirer la synthèse. Il avait inventorié tous ces matériaux composites en les reliant entre eux pour en faire une compilation malheureusement cohérente.
Michel, en bon paysan au sens noble du terme, s’était intéressé à la théorie des physiocrates français du même siècle pour qui seule la terre était pourvoyeuse de richesse. Ils se prononçaient en faveur d’un État fort, confié au Roi tout en prônant une décentralisation administrative déléguant la gestion des affaires locales à des représentants élus agissant de façon autonome par rapport au pouvoir central. Une espèce d’alliance entre autorité royale parisienne et décentralisation que revendiquaient justement les gilets jaunes. Michel disait ironiquement, non sans une grosse pincée de vérité, que le Roi était toujours en place en 2019 mais que la décentralisation restait à réaliser. Lorsqu’il voulait se débarrasser de boit-sans-soif obstinément embarqués dans une discussion politique, il se disait Brissotin avant tout, ce qui mettait rapidement un terme aux conversations de comptoir avec ses co-villageois ignorant aussi bien le brissotisme que le girondisme.
Après la tornade les villages et les campagnes pansaient leurs plaies comme ils pouvaient, à Sarlat la DDE bien équipée avait déblayé l’ensemble des objets que le vent avait volés et déposés sans ménagement loin de leur lieu initial. Les pompiers avaient aspiré les mares dans les rues. Malgré tout quelques stigmates trahissaient encore çà et là dans les parcs, sur les trottoirs et le bitume, le passage de ce puissant désherbant venu du ciel. Les villageois, eux, sans autres moyens que leurs bras, restaient englués dans une torpeur résignée en attendant l’aide des employés et des engins de la DDE.
Ce matin-là Michel buvait son café dans le matin calme aux nuances encore rose oranger d’un ciel cueilli au réveil. « Nul besoin d’aller en Corée, pays du matin calme ! » pensait-il. Lui, il en profitait tous les jours des matins calmes. Plus il avançait en âge plus il aimait contempler la nature et apprendre, se cultiver entre deux balades photographiques. C’est ainsi qu’il avait appris que l’expression « le pays du matin calme » provenait d’une mauvaise traduction des missionnaires venus en Corée. Paul Claudel en poste en tant qu’ambassadeur au Japon n’avait pas manqué de le rappeler indiquant que la traduction exacte est « pays du matin frais ». Mais depuis l’arrivée des missionnaires au XIXe siècle, tous les étrangers se mirent à qualifier la Corée de pays du matin calme, la méprise fut telle que les Coréens résidant à l’étranger épousèrent l’expression erronée et petit à petit, même en Corée, les matins frais étaient devenus calmes.
Il ne quittait pas le Périgord mais ses escapades avaient valeur de voyages, de safaris-photos comme il se plaisait à le dire. Depuis un bref séjour au Maghreb, il savait que Safari en arabe signifie « mon voyage », ses voyages à lui se déroulaient en « Périgordie », pays de ses matins calmes et frais. Il était très tôt, le soleil n’avait pas encore ouvert complètement les yeux du monde. De sa terrasse il voyait sa lueur poindre au-dessus d’une mer de châtaigniers et de chênes. Contrairement à l’idée reçue très répandue chez les visiteurs étrangers et français du Périgord, l’appellation « Périgord Noir » n’était pas du tout due à la couleur de la truffe mais à ces forêts de chênes verts au feuillage si dense, si épais qu’il faisait sombre à l’intérieur. À l’instar de Paul Claudel, soucieux de la vérité, Michel ne manquait pas de le préciser aux gens de passage ou aux touristes plus curieux que curieux.
La radio gémissait seule dans son coin en guise de petite musique de fond, un animateur parlait dans le vide entre deux chansons. À 6 h 30 il monta le volume pour écouter les informations. Il n’écoutait la radio que le matin et uniquement France Bleu Périgord pour avoir des nouvelles du coin.
« Bonjour ! Nous vous souhaitons un bon réveil et une belle journée à l’écoute de France Bleu Périgord ! Malheureusement nous apprenons une nouvelle bien dramatique pour commencer cette matinée. Un homme a été retrouvé sans vie cette nuit dans une rue de Sarlat. Apparemment, d’après les premières indications de la police, il s’agirait d’un jeune homme sans domicile fixe, aucune trace de violence n’a été relevée sur son corps. Son identification est en cours. Nous vous en dirons plus dans nos prochaines éditions. »
Le corps de Michel tressaillit, ses yeux s’ouvrirent grand, il fixa le poste de radio l’air terrifié, il se demandait s’il avait bien entendu ce qu’il avait entendu. Il coupa le son de la radio, ses jambes se mirent à trembler. Comment savoir s’il s’agissait de Véer ? Pas de numéro, plus de nouvelles de lui depuis l’autre jour ! Il enfila un blouson, saisit les clés de sa voiture, son téléphone portable et s’apprêta à foncer vers Sarlat. Avant de démarrer il alluma son téléphone qu’il coupait tous les soirs avant de s’endormir. Il vit que cette nuit il avait reçu un appel masqué à 23 h 52 exactement. Il démarra en trombe. Après avoir parcouru deux-trois kilomètres il reçut un nouvel appel masqué. Il écrasa de toutes ses forces la pédale de frein et se rangea sur le bas-côté.
– Allô, qui est à l’appareil ?
– C’est moi Véer.
– Oh putain ! Tu m’as foutu la frousse de ma vie !
– Oh oh Papé ! C’est quoi ce vocabulaire ? Ça te ressemble pas !
– T’es où ?
– Pas loin dans un bled.
– Comment ça s’appelle ?
– Euh ! Sim… Sim…
– Simeyrols ! l’interrompit sans ménagement Michel. Va jusqu’à l’église et ne bouge plus, attends-moi, suis là dans trois minutes. Ok ?
– Ok ! Mais…
– Y a pas de mais, fais ce que je te dis !
Michel raccrocha et lâcha un « P’ti con ! » bien appuyé tout en posant le téléphone sur le siège passager sans le quitter des yeux comme s’il continuait à parler à Véer. Il redémarra pied au plancher. Arrivé tout près de l’église, il vit le gamin les épaules rentrées, frigorifié, aussi frais qu’un gardon nageant dans les eaux troubles et chaudes d’une centrale nucléaire.
– Salut ! Monte ! Où as-tu passé la nuit ?
– Dehors !
Il retenait ses mâchoires pour ne pas faire claquer ses dents.
– Tu pouvais pas m’appeler ?
– Mais j’té phoné, tu répondais pas !
– À minuit ! Y a longtemps que je roupille à cette heure-là !
– Ben pour moi, c’est à peine le début de soirée !
– T’as mangé ?
– Non !
– Depuis quand ?
– Deux jours environ…
– T’es inconscient ! Tu pouvais pas m’appeler avant p’ti con ? !
– Mais…
– Bon je t’emmène à la maison, tu vas prendre un bain chaud et un bon p’ti déjeuner !
– Mais…
– Y a pas de mais qui tienne. C’est moi qui commande. Tu t’es vu ? Tu trembles de tout ton corps ! Tu tiens pas debout. C’est bon pour attraper une bonne crève, ça ! Ici les nuits sont fraîches, même à la bonne saison ! Après tu pourras repartir si tu veux.
– T’es colère Papé ?
– Non mais j’ai eu la trouille ! Et puis appelle-moi Michel !
– Pourquoi la trouille ? OKLM Michel !
– C’est quoi OKLM ?
– Au calme ! Cool si tu préfères !
– On a retrouvé un corps sans vie cette nuit à Sarlat ! Un jeune SDF !
– Ah ! T’as cru que c’était moi ? !
– Kès-ce t’aurais pensé à ma place ? Bon sang ! J’en ai encore la chair de poule !
À peine rentrés, Michel lui indiqua la porte de la salle de bains.