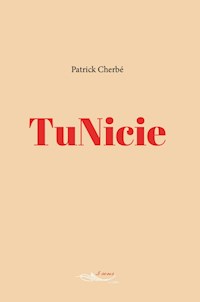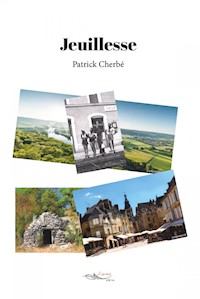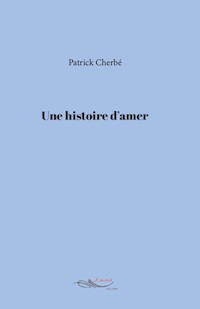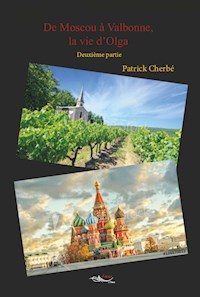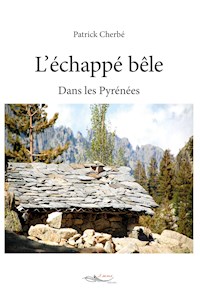
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Gabriel, s’évade d’une prison située près des Pyrénées, côté français, où il purge une longue peine due à son activité au sein d’un réseau de drogue. Au cours de sa fuite, de nombreuses péripéties jalonnent un parcours compliqué qui le confronte à des situations singulières. Des aventures qu’il n’aurait jamais imaginé vivre dans le monde libre.
Quelques scènes de sexe et de violence épicent le récit, tandis qu’un meurtre improbable, difficilement élucidable, plane tout au long de plusieurs chapitres. En toile de fond, la majesté des Pyrénées et leurs dangers fixent le cadre de cette échappée, jusqu’au Pays Basque espagnol, où un relent d’irrédentisme demeure perceptible encore au XXIe siècle.
Des dialogues directs, secs ou tendres, mettent à nu la personnalité des principaux protagonistes. Dureté, amour et humour alternent au gré des relations qui se nouent et se dénouent, au fil d’un récit parsemé d’images poétiques, rafraîchissantes et toniques de la faune et la flore pyrénéennes. Aussi exaltante que risquée, cette fuite éperdue dont la finalité est de rejoindre l’Argentine via l’Euskadi, apprend beaucoup à Gabriel, sur lui-même et la société des hommes qu’il tient pour son pire ennemi. En quête d’un autre monde, l’avenir radieux d’une nouvelle vie semble lui tendre les bras, mais les obstacles se multiplient…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Chef d’entreprise retraité après une carrière en France et à l’étranger dans le domaine de la parfumerie. A la suite de ses cinq premiers romans,
Patrick Cherbé signe ici son nouvel ouvrage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick Cherbé
L’ÉCHAPPÉ BÊLE
DANS LES PYRÉNÉES
Du même auteur
– TuNicie
2021, 5 Sens Editions
– Jeuillesse
2020, 5 Sens Editions
– Une histoire d’amer ou l’itinéraire d’un enfant bâté
2020, 5 Sens Editions
– De Moscou à Valbonne, la vie d’Olga
Tome I, 2019, 5 Sens Editions
– De Moscou à Valbonne, la vie d’Olga
Tome II, 2019, 5 Sens Editions
La nuit faisait sa tête des mauvais jours. Passive, éteinte, la lune boudait. Suspendues, déployées comme un dais au-dessus d’un lit de nuages de poix, les étoiles, lumignons du néant, brillaient pour d’autres yeux. Empêché, le ciel s’était absenté.
L’impénétrable obscurité régnante rendait les lieux sinistres, des cris d’animaux effrayants, dignes d’un mauvais film d’épouvante, déchiraient cruellement le silence, telle une lame lacérant un corps hurlant de douleur.
À la recherche d’une cache, Gabriel marchait sur ce chemin perdu, voûté de ramures dépouillées, dans cette campagne glaciale, enténébrée. Les branches penchées sur lui gémissaient au moindre souffle de vent. Dans les buissons, des froufrous intempestifs d’ailes anonymes, émoustillant les fourrés sur son passage, le faisaient sursauter. La nature omniprésente, invisible, pesait lourdement sur ses sens, transis de froid et de peur. Dans la nuit, l’invisibilité des choses et l’origine incertaine des bruits, signaient l’énigme, le mystère, ajoutant à l’angoisse l’inconnu, l’imprévu, l’imprévisible. Autour de lui, le néant avait englouti toutes les sources de lumière. Ses yeux tâtonnaient dans le vide telle une main cherchant en vain un interrupteur dans une pièce noire. Seul le ruban hésitant du chemin guidait de temps à autre ses pas dans l’obstruction nocturne, vers l’unique direction permise, une espèce de suivez-moi-jeune-homme précaire, démesurément prolongé, irréel, traînant paresseusement derrière l’ondoyante robe noire d’une inconnue.
« L’homme chérit la nature à condition de la voir », pensa-t-il, muet d’effroi que son imaginaire exacerbait malgré lui. Mort de frousse, il s’obligeait à se raccrocher à des lieux communs pour faire diversion. « Un chemin mène toujours quelque part », se disait-il en se rassurant comme il pouvait. Il se demandait s’il était sur le bon. S’était-il trompé, dans l’opacité de cette nuit tétanisante ? Il ne savait plus trop, il l’avait emprunté plusieurs fois dans sa jeunesse, mais aujourd’hui il reconnaissait à peine les lieux. Il doutait. Le temps pressant, il allongea le pas et s’en remit à son instinct comme on s’accroche à une bouée pour ne pas sombrer dans l’abîme glacé d’un océan d’angoisse.
Des hurlements à la mort, au loin, répétés à intervalles réguliers, supposant une présence animale inquiétante, mi-chienne, mi-louve, finirent par le convaincre de se concentrer sur son objectif : faire abstraction à tout prix de cet environnement lugubre, pour le moins hostile et déstabilisant. Le robinet cesse de couler dès qu’on décide de ne plus l’entendre, pensa-t-il.
À la faveur d’une faille récurrente repérée depuis plusieurs semaines dans le système de surveillance, à l’heure où le chien devient loup, Gabriel venait de s’évader de la prison où il purgeait depuis un an une peine de quinze ans de réclusion qu’il avait décidé un soir d’abréger coûte que coûte, le regard scrutateur, piégé dans les cloques d’un plafond écorché. Cette fuite éperdue décuplait ce sentiment de peur qui torturait son ventre. Il revoyait des séquences de son enfance, lorsque, puni, on l’enfermait dans une pièce noire. Son cœur battait encore plus fort aujourd’hui, il fuyait depuis des heures, ignorant s’il allait dans la bonne direction, tout en imaginant une meute lancée à ses trousses, ivre de vengeance et de représailles.
En dépit des risques, du danger, le désir de liberté avait été le plus fort. L’idée de marcher, de courir, sans obstacles, sans murs, sans grilles, longtemps, loin, l’avait obsédé pendant des mois. « Un jour je m’évaderai », s’était-il promis en apercevant à travers les barreaux de sa cellule, les lambeaux d’or d’un soleil provocateur, insolent de certitude. Ces croisillons d’acier le taraudaient comme une obsession térébrante, privant sa vue d’un ciel libre et entier. Ils le renvoyaient à son jugement dont le texte ne mentionnait pas « quinze ans de prison » mais bien « quinze ans de privation de liberté ». Le mot « privation » qui avait l’air insignifiant dans le prononcé du jugement, était tout, sauf un détail pour Gabriel. Ces neuf lettres revêtaient toute leur importance. Lorsqu’il voyait les gardiens prendre leur service le matin ou passer des nuits à surveiller, il se disait que ces pauvres types, jeunes ou vieux, en avaient pris sciemment pour au moins trente ans. Il pensait qu’il fallait être soit pervers, soit bercé de profondes désillusions pour se résigner à passer sa vie dans un tel endroit, glauque, sans avenir, sans ambition, sans idéal. Par bonheur, les livres, seul dérivatif accessible en prison, lui avaient permis de tenir, de s’évader par la pensée, l’imagination, et leur cortège de rêves, d’idéal, d’espérance.
À présent, son rêve, manifestement le plus fou de sa jeune existence, était exaucé. La liberté, il venait de la recouvrer. Pourtant il paniquait, la savait fragile, sursautant à chaque friselis, chaque craquettement de la petite faune composée de mystérieuses créatures blotties dans les buissons. À cette heure-ci l’alerte avait été donnée. Il avait juste quelques heures d’avance. Maigre consolation ! Mais l’épaisseur de la nuit lui en offrait quelques-unes en supplément. Était-ce un signe ? Il n’en savait rien. Cette obscurité, aussi dense qu’inhabituelle, au premier abord défavorable, lui laissait croire que le regard céleste d’une étoile veillait malgré tout sur lui. Une seule suffisait, même invisible. Ce soir c’était peut-être la bonne, puisqu’elle avait intercédé auprès de toutes les divinités du firmament qui l’avaient protégé des humains lancés à ses trousses, d’un commun accord, dans un improbable et miraculeux consensus. Ce soir il était pris en chasse comme un vulgaire gibier, mais le Très-Haut ou ses précurseurs, dieux du panthéon pyrénéen, semblaient veiller sur lui.
Au fur et à mesure de sa progression dans le noir, une kyrielle de pensées hantait son esprit. Ses sentiments restaient partagés, ambigus, voire contradictoires. Heureux, effrayé, mais dévoré simultanément par le doute, il gambergeait. Il songeait : « La liberté, oui ! Mais à quel prix ? Comment en jouir ? » Elle n’a de sens que vécue pleinement, sans entraves. Sans quoi, en cavale, elle se mue en sujétion à son tour, une sorte de permission empêchée. Il refusait la liberté fragmentée, en éclipses, il la désirait absolue, aboutie.
L’espace infini, l’orgie des senteurs humides de la nature, l’étourdissaient autant qu’ils l’angoissaient. À certains moments ils avaient le goût de la liberté, à d’autres, selon les lieux, celui des effluves de chanci, d’humidité putrescente, lui rappelant les odeurs du confinement délétère de sa cellule. Curieusement, des parfums de liberté et de captivité se télescopaient dans sa tête, dans une invraisemblable alchimie, une ivresse singulière que son cerveau essayait de gérer en vain. « Le Loup et le Chien » des fables de son enfance hurlaient en même temps entre ses tempes.
« Tout ça pour ça ! », pensait-il en marchant dans la mousse dense de la nuit. Il avait pourtant fait son choix en se glissant dans la peau du loup. Bientôt, avant l’aube, il devrait se cacher, se tapir, comme une bête traquée, solitaire. Il avait parcouru de nombreux kilomètres. Épuisé, affamé, il devrait bientôt quitter cette cavée pour s’enfoncer dans la forêt, éviter toute rencontre avec l’espèce humaine. Tout avait été prévu avec son frère, ils avaient découvert cette cache, une cabane, du temps où ils chassaient ensemble quand ils étaient plus jeunes. Mais il paniquait à l’idée de ne pas la retrouver dans ces ténèbres profondes et oppressantes. Un camarade de lycée, originaire de Lannemezan, perdu de vue, parti depuis longtemps chercher fortune à l’étranger, lui avait fait découvrir ce territoire sauvage, perché, suspendu comme une terrasse au-dessus du plateau. Son frère les avait accompagnés quelques fois.
Ne prendre aucun risque, se faire oublier du monde, ces deux impératifs conditionnaient désormais son salut. Les nuits seraient les seules opportunités de se déplacer et de fuir. À plusieurs reprises, dans sa course folle, il avait trempé les semelles de ses chaussures dans des gours et des biefs pour que les chiens ne puissent suivre sa trace, tenté d’effacer son odeur en frottant son corps avec différents feuillages. Chirurgie plastique du visage, faux nom, nouvelle coupe de cheveux, faux papiers, il avait tout imaginé pour réapparaître un jour sous une nouvelle identité.
Commencer une vie toute neuve était sa seule chance s’il parvenait à faire disparaître toute marque de son passé qu’il traînait comme une infirmité honteuse, une inavouable anomalie.
La veille, le jour de son évasion, il avait aperçu la guipure des cimes blanches au loin sous le cristal d’un ciel haut et pur. « Que la montagne est belle ! » Telle une fulgurance, le refrain de Ferrat parcourut son esprit. Le chanteur avait en partie raison, pensa-il, mais l’éclat majestueux des sommets, dressés comme des épissoirs magiques, effilés, dissimulait aussi les pièges dont il devrait se préserver. Depuis le centre pénitentiaire de Lannemezan, à quelques crêtes de l’Espagne, les pics enneigés semblaient lui indiquer la voie grisante de la liberté autant que celle des obstacles démesurés se dressant déjà devant lui. À la fois boussole géante et barrière infranchissable, la superbe chaîne des Pyrénées l’aimantait tout en l’effrayant, telles des sirènes aux charmes pétris d’embûches et de dangers.
Pour ne pas laisser le doute s’enraciner, il se départit très vite de ses états d’âme. Pour l’heure il devait regagner avant le petit matin cette vieille cabane de chasseur abandonnée où il trouverait tout le nécessaire d’un trekkeur : chaussures, habits de montagne, vêtements chauds, duvet, une mini-pelle, deux bâtons de randonnée télescopiques, une lampe électrique, une petite gourde qu’il remplirait au gré des sources, des torrents pyrénéens, et une carte d’état-major.
Cette carte serait sa rose des vents, son vade-mecum, pour atteindre le petit port de Pasaia dans la province de Guipúzcoa, où un vieux pêcheur lui indiquerait comment rejoindre en douce un pays d’Amérique du Sud. Loïc, son grand frère, vendeur d’articles de pêche, avait connu ce vieil homme lors d’un de ses voyages au Pays Basque, et lui avait rendu un fier service alors qu’il était en grande difficulté financière. Miguel de son prénom, parlant très bien français, avait promis à Loïc de lui rendre au centuple ce service s’il avait besoin de lui un jour. Dès qu’il en eut la possibilité il s’acquitta de sa dette, puis, le temps, la vie, par leur œuvre empêchés, ne leur avaient pas permis de se revoir. Dans sa jeunesse cet ancien aventurier ibère avait guidé sa rosse dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, avant de regagner son village natal à l’heure de sa retraite. Loïc avait indiqué à son frère le nom du port où il rencontrerait Miguel et son pointu : Pasaia, petite ville du Pays Basque espagnol, au pied de San Sébastian. Il n’en savait pas plus, pas même si le vieil homme était encore en vie.
Comme l’océan, Miguel matérialisait le dernier repère, l’ultime étape où Loïc pouvait conduire son frère dans son exode. Pasaia bornait les limites de ses compétences, y rencontrer Miguel étant le dernier conseil qu’il pouvait lui prodiguer. Mais pour la partie pyrénéenne, fort de ses nombreux treks, dans l’Ariège, en passant par les Hautes-Pyrénées jusques aux confins de l’extrémité atlantique de la chaîne, il avait fait de son mieux. Il avait longuement préparé le tracé du parcours pour que Gabriel ne croise personne jusqu’à sa destination atlantique. Ce dernier n’avait qu’une obsession : longer la chaîne des Pyrénées, tantôt côté français, tantôt côté espagnol, selon l’accessibilité des lieux, puis suivre scrupuleusement l’itinéraire préconisé par son frère sur la carte, pour que le moindre berger, français ou espagnol, n’eût la possibilité de l’apercevoir. En cette période de l’année, les bergers et leur troupeau n’avaient pas encore pris leurs quartiers d’estive. Gabriel savait que les policiers français donneraient son signalement à leurs collègues ibériques, qu’il serait compliqué de passer à travers les mailles d’un filet tendu de part et d’autre de la frontière. Sa seule chance de s’en sortir, s’il était aperçu de loin par quelqu’un, était de se faire passer pour un trekkeur solitaire. Un homme fraîchement évadé ne pouvait être aussi bien équipé. Son matériel de pro ou presque serait son meilleur alibi.
Son frère Loïc, amoureux de la nature, ancien amateur du ballon ovale, sportif dans l’âme, avait mis, à la fin de sa carrière de rugbyman, toute son énergie dans la pratique du trekking. Il connaissait ses adeptes, ses champions, ses aficionados les plus célèbres, les petits secrets des équipements, des accessoires, les pays et les lieux courus dans le monde où ce sport se pratique à grande échelle… Jusqu’à l’origine du mot trek qui ne provenait pas de l’anglais comme Gabriel l’avait longtemps pensé, mais de l’afrikaans, qui signifie exactement migrant. C’était précisément ce qu’il vivait, une espèce de migration solitaire, un réfugié pénitentiaire sans papiers, déguisé en grand randonneur pédestre, effectuant la périlleuse traversée d’une zone sauvage, difficile d’accès.
Ce sentier forestier perdu au-dessus du Lannemezanais, terre d’ovalie et de chasse, devait le conduire à cette première cache. Il y trouverait de quoi se reposer, se vêtir de vêtements chauds, et se restaurer pendant quelques jours si nécessaire. À la faveur des premières pâles lueurs de l’aube, il finit par repérer l’endroit où il devait quitter le sentier.
Après quelques dizaines de mètres parcourus dans les sous-bois, à l’écart du chemin, il aperçut une masse noire envahie par la végétation. De guingois, faite de bric et de broc, perdue au milieu d’une foule d’arbres en rangs serrés, pareils à des frocards processionnaires immobiles, raides et stoïques, dans leur coule aux manches amples en guise de ramure, complices du fil de neige invisible des araignées, la cabane de son adolescence, malgré un aspect peu accueillant, prenait soudain toute son importance. Valeur sûre de refuge, d’apaisement et de repos, après cette échappée effrénée, ininterrompue, depuis les premières heures de son évasion, elle lui offrait un répit salutaire.
Il poussa la vieille porte de bois vermoulu. Surpris, une espèce de lérot brun-noir se faufila entre ses jambes en chicotant. Un sac de montagne étanche, rempli de vivres suspendu à une esse dans le vide, l’attendait comme prévu. Épuisé, il n’eut même pas la force de manger, but quelques gorgées d’eau à la régalade, et étendit sur le sol la natte enroulée perpendiculairement à la partie supérieure du sac. Un unique petit banc de bois bancal composait le mobilier de la cabane. Il employa ses dernières forces à barricader la porte à moitié pourrie avec un morceau de bois, en guise d’épar, coincé entre le chambranle et les planches du mur opposé. À peine eût-il terminé que son corps lui intima aussitôt l’ordre de s’allonger, de dormir le plus longtemps possible et sa tête d’oublier cette folle journée. Le sommeil débordant de ses yeux, les éteignit insensiblement. Saoulé de fatigue, il étira ses membres, poussa un long soupir avant de chavirer dans l’inconnu.
Il dormit d’un trait jusqu’en fin d’après-midi. Malgré la petite musique flûtée du gazouillis incessant de la faune matinale, rien n’eut raison de son sommeil. Perturbé par une violente et soudaine fringale sur le point d’étriper son estomac, à peine eut-il ouvert un œil que son hypothalamus lui intima l’ordre de se jeter aussitôt sur le sac. Il avala goulûment quelques cônes de fromage industriel sur du pain de mie et grignota un sachet de fruits secs. Rassasié, il but quelques gorgées d’eau, s’assit sur le banc et écouta longuement le silence. Il restait une poignée de minutes avant le crépuscule. Il devait respecter à la lettre les consignes et les conseils de son frère. Surtout ne pas sortir avant la nuit complète, même si alentour, aucun signe de présence humaine ne se manifestait, observer un silence de plomb. Il ne sortirait ce soir que pour assouvir des besoins naturels, passerait la nuit suivante, puis une deuxième journée dans cette cabane. Il y avait assez de réserves pour y rester vingt-quatre heures supplémentaires, plus longtemps si besoin en les rationnant. Plus il patienterait, plus les traces et les odeurs qu’il avait laissées pendant sa fuite disparaîtraient définitivement.
Même enfermé entre quelques planches pourries, les odeurs de bois mort, de champignon, de mousse de chêne, exhalaient les plus belles fragrances du monde, celles de la liberté, comparées aux émanations quotidiennes d’une mixture irrespirable d’eau de javel, de sueur, de chaussettes sales et d’urine. Malgré tout, le temps et les vivres étaient comptés ; mourir est économe, survivre dépensier. Coupé de tout et de tous, il réalisait qu’à partir de ce moment il se retrouvait seul, sans moyen de communication, un vrai Robinson perdu dans son île déserte, dans le silence et le vacarme de cet océan de verdure. Il savait qu’il devait rester digne dans l’épreuve, pour lui-même, son moral, mais aussi pour son frère auquel il était lié désormais par un pacte.
Loïc avait bien voulu l’aider à mener à bien cette évasion à condition de respecter un contrat moral. Il lui avait demandé, s’il réussissait, de bannir définitivement les milieux de la drogue et de vivre une vie normale en travaillant honnêtement comme tout le monde. Peu lui importaient son futur métier et le lieu de son activité, pourvu qu’il fût en règle avec les lois du pays dans lequel il vivrait. S’il ne tenait pas son engagement, il cesserait de le voir et romprait pour toujours leurs relations. Gabriel repassait en boucle le discours de son frère tenu dans l’intimité du parloir. Ce devait être son deuxième grand défi : ne plus décevoir personne, ni lui, ni le reste de la famille. Il n’avait plus le choix, il se devait de réussir cette évasion et respecter les termes du contrat comme il en avait fait le serment.
Un hélicoptère passa au loin qui lui fit lever les yeux au plafond tricoté de planches mal ajustées, ne laissant entrevoir que des fragments de ciel et de branches. Il s’arrêta de respirer quelques secondes. Le monstre bruyant, assourdissant, tournoya un moment au-dessus de la forêt, puis s’éloigna lentement, le rotor renvoyant curieusement des échos sourds de moteur de bateau naviguant au loin en mer. Il haletait, comme s’il venait de courir. Il resta longtemps prostré, guettant un retour éventuel de la machine. Si le monstre d’acier revenait au-dessus du toit des arbres, c’est qu’il aurait été repéré. Sa cavale prendrait fin d’ici quelques heures tout au plus. Une immense battue serait alors organisée dans un dernier carré, comme on traque un sanglier ou un chevreuil avec des hommes et des chiens. L’hallali serait vite sonné et la curée des justiciers pourrait commencer.
La machine infernale ne revint pas, la forêt replongea dans sa torpeur de bois mort et de végétation encore hibernante en cette fin d’hiver. Il ne reprit vraiment sa respiration normale que quelques minutes plus tard, autorisant enfin son cœur à battre naturellement.
Au vacarme des pales et du moteur avait succédé un calme sourd, presque anesthésiant. Pareil à un jour de plein hiver, quand les flocons tombent sur une première croûte de neige, sous des épaisseurs de silence ; l’instant de grâce apaisant, réparateur, qui préserve l’âme après le trouble d’un effort intense ou d’une frayeur paralysante. Pour Gabriel le silence s’était substitué au temps, abolissant les minutes et les heures. Il n’osait le déranger de peur de le profaner, de trahir ses secrets. Les bruits l’avaient fatigué, meurtri. Ils l’indisposaient. Son avenir serait fait de silence, lui disait sa conscience tout bas. Il y puiserait son énergie, l’absence de bruits lui redonnerait l’envie de vivre. Muets eux aussi, les oiseaux rêvaient déjà dans leur nid aux aventures du lendemain ; leur béquillon profitait de quelques heures de répit avant de claqueter à nouveau, dès le lever du jour. C’était l’heure où les règnes animal et végétal s’immobilisent, suspendent leurs trépidations, dévitalisent campagnes et forêts pour mieux survivre au deuil nécessaire de la nuit, à cette petite mort accouchant chaque matin d’une résurrection attendue de tous, qui embrase le ciel en le mettant à feu et à cyan.
Il ouvrit une boîte de conserve et se restaura à nouveau sans grand appétit. Les yeux plongés dans d’insondables réflexions, Il mâchait sans conviction. Dans l’indolence générale de la végétation, de l’apathie du règne animal, des pensées désordonnées ferraillaient bruyamment dans sa tête. Le ventre un peu moins vide, son esprit reprit mollement le dessus, tentant de remettre de l’ordre dans ses idées assaillies d’images déchirantes. Il imaginait déjà les membres de sa famille épiés, placés sur écoute, ses proches sous surveillance, en garde à vue, entendus par les enquêteurs. Même s’il savait qu’ils ne pourraient rien dire, que le secret de son évasion, la date, l’heure, la direction de sa fuite, avaient été bien gardés, que seul son frère, dans la confidence, aurait pu révéler. Et bien qu’il eût fallu le torturer pour ça, ces images minaient malgré tout sa conscience. Il ne pouvait s’empêcher de songer à tous ceux qu’il avait abandonnés, aux cuisantes blessures, aux profondes cicatrices creusées peu à peu, que les années n’effaceraient jamais.
Pour sa part, Loïc avait su se faire oublier, se forgeant un alibi en béton. Trois jours avant l’évasion, il avait pris soin de quitter la région, après avoir organisé, une décade auparavant, des rendez-vous d’affaires en Normandie et en Bretagne, loin de la région Sud-Ouest. Impossible donc de le soupçonner d’avoir directement participé à l’évasion. Toute complicité le mettant en cause ne pouvait qu’être écartée par les enquêteurs, ceux-ci ayant la preuve qu’il ne pouvait être présent ni à Lannemezan ni dans les parages au moment des faits. Prudent, afin d’éloigner tout soupçon d’intervention indirecte et préméditée, il s’était abstenu de rendre visite au prisonnier au cours des trois dernières semaines précédant le jour J. Sachant qu’une perquisition serait ordonnée à son domicile, il s’était débarrassé de son vieil ordinateur, afin que ne soient ni tracées, ni mesurées, les longues visites de certains sites, liés de près ou de loin à l’évasion de Gabriel. Tout avait été préparé de longue date, d’un commun accord avec son frère, dès ses premières visites. Il avait étudié dans les moindres détails la logistique et les dispositifs à mettre en œuvre avant la fuite. Les solides sacs bourrés de vivres, d’eau, de conserves et d’aliments lyophilisés, sous vide, pouvaient attendre le futur locataire des lieux pendant des semaines. Loïc les avait soigneusement remplis après s’être entouré de mille précautions, ne manipulant vivres et sac qu’avec des gants. Il avait poussé la vigilance jusqu’à se faire livrer afin qu’il ne manipulât sans protections les objets. La deuxième planque était une ancienne palombière abandonnée dans un massif forestier situé sur les premiers hauts versants des Pyrénées, dernière étape avant la vraie montagne. Il savait qu’aucun chasseur n’y monterait puisque la zone avait été interdite à la chasse depuis plus d’un an, sous la pression d’une association d’écologistes. Malgré cela, il avait prévu l’éventuelle présence de chasseurs braconniers, d’où le conseil donné à son frère de s’évader à la fin de l’hiver, le passage des palombes s’effectuant chaque année en octobre-novembre, de l’aube jusqu’en fin d’après-midi. Toutes ces précautions faisaient de lui le digne gardien du secret des deux frères. Second viatique, cet affût de chasseur serait placé sous le signe de la liberté, le dernier avant l’Atlantique qui serait comme il l’espérait, son dernier mur. Mais aussi celui de la grande randonnée de sa vie, d’un vrai trekking long et risqué. Il serait plus complet, plus lourd, plus volumineux, accueillant mini-réchaud, vêtements chauds, pharmacie de secours, sac de couchage, raquettes, lampe frontale à utiliser rarement et à bon escient, tente et tapis de sol. Désormais il dormirait à la belle étoile dans les forêts en altitude. Loïc avait choisi les couleurs les plus discrètes possible. Le risque d’être vu ou aperçu serait plus grand à cause de certains passages à découvert, car il devrait bivouaquer sur les hauteurs, le plus loin possible des humains. Mais l’altitude avait son revers de médaille, il serait exposé aux risques, aux incertitudes d’éventuelles rencontres avec des bêtes sauvages, aux aléas de la chance ou de l’infortune.
Il pensait à tout ça, à tout ce qui le guettait. Il se glissait dans la peau de ces milliers de gens, Espagnols et Français, qui avaient, au cours de la première moitié du vingtième siècle, fui la guerre civile en Espagne dans les années trente et l’avancée des Allemands pendant la guerre de 39/45 dans les Pyrénées. Mais c’était une autre époque. De part et d’autre il y avait de la fraternité, de l’entre-aide, partagées par les frontaliers des deux peuples, avec toute une organisation de passeurs, de gîtes, de planques, prévus pour les migrants fuyant la guerre de part et d’autre.
Lui, il était seul, contre le monde entier, face à ses compatriotes, comme aux Espagnols de l’autre côté de la frontière, car il savait que son signalement serait donné simultanément par Interpol dans les deux pays. Il était l’ennemi numéro 1.
À trente-cinq ans, il avait déjà fait de la prison, mais cette dernière peine était trop lourde. Il ne s’imaginait pas sortir à plus de cinquante ans, trop vieux, déconnecté du monde et de la vie. Il avait donc tenté le tout pour le tout, un coup de poker, jouant les années les plus importantes de sa vie. L’échec était interdit. Connaissant la puissance d’Interpol, il était convaincu qu’elle ne lui laisserait aucune chance de s’en sortir s’il était repéré. Avec près de deux cents pays membres dont l’Espagne, cette organisation constituait une véritable nasse, gigantesque, planétaire, avec des bureaux sur tous les continents. Traquer les hommes recherchés était sa spécialité, elle déployait des moyens colossaux pour les identifier et les localiser dès qu’elle lançait une alerte.
Tapi au fond de cette cabane, il prenait toute la mesure de cette fuite qui déposait sa vie à la croisée des chemins, basculant dans l’inconnu, à cet instant précis. Il ne savait pas quand il reverrait ses parents, son frère, sa compagne, à qui il n’avait rien dit et qu’il ne reverrait pas de sitôt. C’était le prix à payer, se faire oublier mais aussi oublier tous ceux qu’il aimait, pendant de longues années. Une vie entière peut-être. Il lui était interdit de chercher à reprendre contact avec eux. Il le savait et pensait à tout ça, à cet avenir incertain qui se profilait et à celui des siens qui devraient vivre avec le cruel déchirement de sa longue absence. Au fur et à mesure il prenait conscience que sa nouvelle situation consistait de fait à abandonner ses racines, son histoire, à faire table rase de tout, jusqu’à son nom. En prison il avait entendu parler d’hommes qui avaient tenté la même aventure, certains avaient exceptionnellement réussi, réapparu sous une autre identité à la fin de leur vie. Les autres, la majorité, avaient été repris ou tués pendant leur échappée. Son destin se jouait bien maintenant. Non seulement il serait seul jusqu’à sa destination finale s’il l’atteignait, mais aussi vraisemblablement pour très longtemps. De l’isolement d’une cellule de la Centrale à celui d’une cellule à ciel ouvert, dangereuse, hasardeuse, menaçante, y avait-il une réelle différence ? Le jeu en valait-il la chandelle ? Pourtant, engagé dans un continuum spatio-temporel, il avait atteint un point de non-retour. Son Rubicon avait été franchi.
Toutes ces réflexions se bousculaient dans sa tête, semant le désordre et l’émiettement de ses pensées. Elles remettaient en cause sa conception du monde, de la vie, de tout, sans exception, jusqu’à l’idée même de l’évasion. Au fond des bois, face à lui-même, à sa destinée, elle ébranlait sa conscience ; personne pour le rassurer, l’apaiser, il était devenu un hérésiarque de la vie, sans adeptes, retranché dans son frêle moutier, où il était plus que jamais seul au monde. Son corps parvint à s’endormir mais son âme demeura insomnieuse, soumise à des relents d’incertitude et de brume existentielle.
Toute la journée du lendemain les mêmes idées refirent surface, il aurait voulu quitter les lieux au plus vite, parcourir et humer l’air de nouveaux espaces, oublier la confusion de ses ruminations.
Comme programmé, il marcha de nuit, de longues heures, avant d’atteindre la palombière. Arrivé au pied de la tour de bois, il gravit péniblement la vieille échelle tressée de liane et de corde pour s’installer au milieu de la canopée. Ce ne fut pas sans mal, les maigres barreaux moisis se dérobaient sous ses pieds, l’obligeant à maintes reprises à se contorsionner pour progresser.
Tout là-haut, il eut le sentiment de s’être hissé au-dessus des poussières et des turpitudes du monde. Si depuis ce promontoire, avant, les chasseurs tuaient les palombes, lui, il tuerait le temps, mais pas n’importe lequel, celui de son passé. Il attendrait quelques jours avant de se lancer dans la grande aventure. Le temps que les recherches qu’il espérait infructueuses réduisent les moyens mis en œuvre dans la région, que la police décide d’orienter la chasse à l’homme vers d’autres horizons. Les réserves du premier sac lui laissaient de la marge pour ne pas entamer le second de sitôt. Enveloppé dans un tuilage de végétaux, entre ciel et terre, il épierait, à travers la dentelure des feuilles, les bruits au sol et dans les airs, une position idéale pour voir sans être vu, une sorte de moucharabieh organique protecteur et observateur. Pour une fois, ce serait lui le guetteur, la sentinelle, du haut de sa tour de contrôle, minaret sultanesque, mirador du camp du monde libre, imprévisible et hostile.
Issu d’une famille modeste, ayant grandi dans une cité HLM de la banlieue toulousaine, celle des « Izards » au nord de la ville rose, il était très tôt tombé dans les travers du commerce de la drogue, finissant, comme beaucoup de ce quartier, par céder à l’argent facile. Enfant sauvage, insoumis, dès les premiers mois de sa majorité il avait connu une première peine d’incarcération. C’est peut-être là aujourd’hui, perché sur la cime des arbres, dans ce grand océan de l’air, niché sur son lit de verdure, sur ce balcon en forêt, qu’il se sentait enfin véritablement à sa place, en adéquation avec lui-même, à l’écart de la société et de sa misérable grisaille. Il se voyait transformé en plante humaine, en sipo matador, au moment où la lumière trouant le feuillage entrait dans son âme délivrée, il disait adieu au monde claustral des hommes pour entamer un voyage astral vers le monde libre des oiseaux et des hauteurs célestes. La grandeur de la solitude et la magie d’un silence d’embuscade le comblaient. Il muait, abandonnant la peau écorchée, nécrosée, d’un passé encombrant pour s’éclairer des lumières d’un nouvel avenir. Pour la première fois, il éprouvait la sensation de tenir entre ses mains son destin. C’était décidé, il serait désormais l’unique artisan de son bonheur, maître d’œuvre et seul juge de sa seconde vie. Tel un chat haret, il venait d’accomplir sa féralité, un retour à ce qui avait toute sa vie ferraillé au plus profond de son être : l’amour de la nature et l’insoumission au monde des hommes.
Il avait toujours refusé le panurgisme des bêlements humains. Sa conception de l’existence trouvait son expression dans cette phrase qu’il répétait souvent : « Il n’y a que les poissons morts qui suivent le courant. » La société n’était pour lui qu’une ruche dont chaque citoyen, coulé dans le moule d’une communauté aux alvéoles multiples, était l’éternel captif. Et malheur à celui qui n’adhérait à aucune corporation. À sa manière, il exprimait sa désobéissance civile, une désobéissance si vile qu’il s’était mis au ban de la société, la qualifiant de dictature tranquille. Ne pas payer ses impôts, refuser les injustices, le « groupir » moutonnier assenti, plus par nécessité que par envie, rejeter les injonctions administratives, leurs menaces… il était prêt à tout pour se démarquer de ce qui contribuait à la déshumanisation, ne pas se fondre dans ce moule impérieux, vivre en rebelle accompli, tel le Walden de Thoreau offert par son frère. Il avait toujours opposé les horreurs, les bassesses du monde des hommes à la grâce de la nature, son harmonie, sa beauté.
L’esprit emmuré dans ses opinions dissidentes, même ses avocats commis d’office ou non, réquisitionnés ou intéressés, n’étaient à son sens que des abeilles nourries au miel d’une rhétorique convenue. Il détestait leurs propos verbeux, vides, pompeusement déclamés à la barre. Toutes drapées dans leur robe de deuil, juges inclus, ces figures imposées, comme il disait, prenaient leur verbosité pour de l’éloquence, mais il n’en avait jamais été la dupe et leurs effets de manche, leur posture solennelle, hiératique, le laissaient froid et indifférent. Il savait qu’ils jouaient tous une comédie dont l’épilogue était connu d’avance, ils trichaient. Fort de ces considérations dont il était définitivement convaincu, il ne respectait personne, même pas la police qu’il raillait ouvertement dès que l’occasion se présentait, employant des mots durs, à la limite de l’impudence, ce qui lui avait parfois coûté cher. Lors d’une interpellation, alors qu’il était encore mineur, un inspecteur en mal de mots d’esprit, lui avait dit : « tu finiras mal, tu mets trop de cœur à l’outrage ! Et pas assez au respect des autres ! »
« Qui aime bien charrie bien ! » lui avait répondu du tac au tac Gabriel.
À son instituteur lui demandant de conjuguer au tableau le verbe créer, il avait rétorqué :
– Vous perdez votre temps Monsieur, je sais créer, je suis un créateur né.
L’instituteur croisa les bras, planta son regard dans le sien quelques secondes, comme pour l’intimider.
– D’accord ! fit le maître interloqué. Alors, montre-nous ton génie créatif au tableau, poursuivit-il, passablement irrité.
Gabriel monta sur l’estrade, se saisit du bâtonnet blanc, que lui tendit le maître.
– Tiens, fais-en bon usage, conjugue-moi le verbe créer Monsieur le Génie Créateur !
Il s’approcha du tableau et écrivit « Je craie, tu craies, il crait… »
– T’aimes bien faire ton malin, hein ?
– Oui Monsieur, je suis comme ça, c’est ma nature !
Il faisait partie de la race de ces vivants insoumis qui ne s’interdisent rien, n’hésitant pas, quand ils le jugent opportun, à faire preuve d’une forte animosité mâtinée d’ironie féroce. « Je ne suis pas comme les autres » répétait-il à qui voulait bien l’entendre, il se rassurait comme il pouvait en tentant de s’en persuader. Issu des bas-fonds d’une société concentrée le plus souvent dans les cités, à la périphérie de la métropole toulousaine, il avait toujours vécu en marge de la collectivité, il estimait pouvoir vivre désormais en lisière de l’humanité durant toute son évasion, mais pour combien de temps ?
L’idée d’être un jour repris le hantait, il savait que cette palombière, devenue sa thébaïde, refuge et prison à la fois, le protégerait tant qu’il s’y confinerait. Il demeurait, malgré lui, tiraillé entre deux sentiments : l’envie de la quitter pour la grande aventure de sa vie qui l’attirait, la prudence et la conscience des dangers potentiels qui l’y retenaient.
La sagesse et les serments l’emportèrent sur le désir fou de quitter les lieux au plus tôt. Il resta ainsi quelques jours, suspendu entre la raison impérieuse de l’attente sclérosante, passive, et les rêves bouillonnants d’un ailleurs inconnu, aux parfums inédits, alliciants, tel celui d’une jolie femme qu’on veut suivre après l’avoir croisée. « Il est urgent d’attendre », finit-il par se convaincre.
La nuit, les bruits au sol provoqués par toutes sortes d’animaux, le réveillaient de temps à autre. Le grognement des sangliers en glandée, le froissement des feuilles mortes soulevées par des groins puissants, fouineurs, mus à grands coups de hure, interrompaient parfois les rares moments de pur silence, celui qui enferme les sens dans une bulle quand plus rien ne bouge. Bête à manger du groin, voilà une bonne définition du sanglier, se dit-il en souriant. Sanglier, singulier, solitaire, même racine, même étymon qui fait de ce porc sauvage ce que le loup est au chien. Il avait fini par bénir ce tapage nocturne qui le réveillait parfois en sursaut sans l’affoler. Peu à peu son sommeil apprivoisait ce remue-ménage, avec le plaisir chaque fois renouvelé de réaliser que ces bruits avaient remplacé définitivement ceux de la prison. Ils le délivraient de ces réveils cauchemardesques empreints du sentiment d’impuissance, d’une espèce de stérilité de l’être qu’éprouvent les prisonniers en ouvrant les yeux, rattrapés par la réalité de leur condition, de ces lieux crasseux, hostiles, dépourvus d’humanité, les ramenant cruellement à la vanité, à la fragilité de leur existence. Ne plus se réveiller dans l’enfermement cellulaire, ne plus entendre ce qu’il appelait la symphonie carcérale : le fracas des portes grillagées claquant incessamment, le pas graisseux des gardiens pendant les rondes de nuit, le cliquetis métallique de leurs trousseaux, leur regard indiscret à l’autre bout de l’œilleton, violeur autorisé de l’intimité, de la dignité des détenus, lourd climat délétère, poisseux ; tout ici lui procurait une joie indicible confinant au bonheur, celui tant désiré d’agir désormais en homme libre, tel un sanglier glandant tranquillement, bâtisseur de son propre royaume. Sur un arbre perché, il prenait le temps de glander lui aussi, au-dessus des bassesses humaines, il fusionnait sa respiration avec celle des arbres, il reprenait confiance, refaisant le plein de superbe et d’oxygène. Ce petit triomphe de l’ego, cette espèce de « je vous ai bien eus » toquaient de temps à autre à la porte de ses pensées.
Un puissant sentiment de délivrance l’envahissait quelques secondes et il se rendormait, rasséréné, heureux. Une harde de sangliers ou de chevreuils piétinant un lit de feuilles à bout de sève, résonnait à présent comme un salut, un signe de bienvenue parmi les êtres du monde libre. Il voyait en eux un concentré de sagesse empirique, chez les matons un condensé de bassesses impudiques. « Pauvres types ! Les lois étant celles de la République, ils se sentent investis du titre de gardien de la République ! » Quand il pensait à ces garde-chiourmes, un profond dégoût balayait ses sens. Il n’éprouvait que du mépris pour ces types au QI indigent, il ne pouvait s’empêcher de voir en eux les otages consentants d’un système, les galériens d’un navire voguant vers une vie de frustration et de vide, enfermés à jamais dans les cales obscures, sordides et puantes d’une existence plate, servile. Il n’avait pas plus d’égards pour eux que pour une branche morte gisant au sol. Plus jamais de sa vie il ne chasserait les animaux, porteurs aujourd’hui d’un immense message de liberté. Il se serait bien volontiers glissé dans la peau d’un « Sanglier de Cornouailles » d’un prince local, répondant au prénom prédestiné d’Arthurus, frère des ours, conformément à la dimension symbolique de sa propre quête. En homme-ours, il s’identifiait à cette faune sauvage, prêt à hurler avec les loups. Comme eux, il se déplaçait la nuit pour se terrer au petit matin.
Il avait vu un jour, furetant au milieu des étagères de la bibliothèque, un livre d’art où figuraient des reproductions des tableaux du peintre Franz Marc, dont il n’avait jamais entendu parler auparavant. Privilégiant les représentations animalières, cet artiste s’efforçait de mettre en valeur dans ses œuvres la puissance de la force vitale naturelle des animaux. Ce livre lui revenait maintenant à la mémoire, il se rendit compte à cet instant qu’il épousait totalement l’esprit de Franz Marc associant les animaux et les couleurs de ses tableaux à des valeurs comme le bon, le beau, le vrai, qu’il ne rencontrait plus chez l’homme.
Parfois, il visualisait ces tableaux et les gestes des gardiens. Il ne trouvait décidément aucune excuse à ces hommes exerçant ce métier. L’expression affirmant qu’« il n’y a pas de sot métier », le révulsait. Si ! Et s’il n’y en avait qu’un, c’était bien celui de gardien de prison. Passer un concours pour devenir geôlier à vie, était pour lui le comble de la misère cérébrale humaine, de la déchéance non seulement intellectuelle mais aussi du bon sens et de la santé mentale d’un individu. Ce choix délibéré signifiait renoncer consciemment à sa liberté. Fallait-il être aussi crétin pour s’enfermer avec ceux qui n’avaient pas choisi de l’être, respirer des odeurs d’urine et de remugle à longueur de journée ! ? Il pouvait éprouver de la compassion à la rigueur pour les kapos qui avaient choisi cette voie en temps de guerre pour sauver leur peau, mais pas pour les lauréats de ce concours passé en temps de paix, avec pour unique ambition de fouler, trente-quarante ans, les lieux d’ambulations et de promenades d’âmes en déshérence, dépossédées de leur destinée. Triste engeance que ce troupeau de cafards en costume élimé ! Noir, comme la mort qui rôde dans des couloirs pisseux, les clés de l’enfer dans les mains, leur vie durant. Avocats, juges, policiers, matons, curés… tous de noir vêtus, jouaient la même pièce. Aucun ne trouvait grâce à ses yeux. Symboles de l’interdit, de l’enfermement, du surveiller et sévir, il les conchiait tous.
En se rendormant, il lui arrivait de noyer son sommeil dans des rêves prolongeant sa cavale, anticipant sa découverte de l’Amérique du Sud, de ses espaces infinis, sauvages et libres. Miguel qu’il n’avait jamais vu, pas même en photo, nourrissait ses songes. Il se voyait en compagnie du vieil homme qu’il imaginait autant pêcheur que pécheur devant l’éternel, barbiche blanche, dos voûté, un peu fruste, au vieux look d’aventurier, de baroudeur, venant à sa rencontre sur le port de Pasaia, avec la débonnaireté touchante d’un grand-père accueillant son petit-fils. Loïc lui avait affirmé qu’il serait capable de lui obtenir de faux papiers grâce à ses réseaux de l’autre côté de l’océan, l’océan de la liberté. Malgré le froid, ces films qu’il projetait sur l’écran vert de ses nuits rustiques, offraient à ses réveils un sentiment de plénitude, de plaisir souverain, où la nature lui donnait une nouvelle chance, une espèce de seconde vie qui valait la peine d’être vécue. Il irradiait comme si la lumière sortait de son corps, il aurait réchauffé une ombre.
Sa tête comblée d’images amérindiennes, de vastes étendues pampéennes, se perdait dans un tourbillon, une sorte d’ivresse qui troublait ses pensées pleinement engagées sur la voie de ce nouvel avenir plein d’espérance.
Loïc avait mis dans le sac des livres de petit format, un mini-précis d’espagnol, un manuel de survie en cas de coup dur, ainsi que ce livre de poche : le « Walden » de Thoreau. Gabriel avait appris l’espagnol en deuxième langue, comme tout collégien de la cité des violettes qui se respecte. Mais l’époque insouciante de l’adolescence et des cours d’espagnol n’était plus qu’un lointain souvenir, or l’espagnol allait sans doute devenir bientôt, à l’évidence pour plusieurs années, la langue de son quotidien. C’est ce qu’avait anticipé Loïc en préparant le barda. Quant au « Walden », connaissant son jeune frère, indocile et jusqu’au-boutiste, il savait qu’il le dévorerait.
Le lendemain matin très tôt, au moment où, jalouse l’une de l’autre, l’aube et l’aurore, impitoyables, torturent à qui mieux mieux la nuit jusqu’à lui faire rendre l’âme, il entendit du remue-ménage au sol, des pas lourds semblaient fouler les feuilles mortes qui ne ressemblaient pas à ceux d’un sanglier ni même d’un chevreuil. Allongé sur le dos, il se retourna silencieusement pour glisser ses yeux entre deux planches mal ajustées. Mais les minuscules interstices ne permettaient pas d’entrevoir le ou les auteurs de ces bruits. Il n’apercevait que des taches brunes parcellaires, en mouvement, sans parvenir à identifier le ou les propriétaires. Il rampa jusqu’à l’autre extrémité de la palombière où deux planches semblaient offrir au regard à peine plus d’espace. Il retint son souffle tout en évitant le moindre geste qui eût pu provoquer ne serait-ce qu’un petit couinement de planche. Il s’efforça de rendre son corps aérien, à la limite de l’immatérialité. Il l’ondula en rampant à la manière d’un serpent, effectuant une longue et silencieuse reptation jusqu’à cet espace interstitiel un peu plus large que les autres. Seul, dans les limbes de cette nature sauvage depuis quelques jours, ses sens s’aiguisaient, son ouïe s’affinait, son aptitude au silence et à l’art du camouflage aussi. Vivre entre les terres et l’éther l’avait peu à peu animalisé.
Au prix de clignements multiples et contorsionnés de ses paupières collées au plancher de bois, il parvint à distinguer cette masse brune appuyée sur le tronc du chêne, solide socle de sa planque sur pilotis. Un énorme ours brun levait la tête en direction du ciel invisible, pointant son épais museau vers le haut. Il humait l’air en fixant la palombière, décidé à grimper. Il avait déjà empoigné le fût avec ses antérieures. Bien qu’encore au pied de l’arbre, le souffle rauque de son énorme truffe chercheuse envoyait à Gabriel des ondes hostiles, comme le message d’un assaillant prêt à en découdre. Il comprit que son repas frugal agrémenté de sardines, de pain de mie et de confiture, avait suffi à ensorceler le flair de l’animal. Fébrile, n’ayant aucun projectile à portée de main, il se demanda si l’arbre soutenant sa planque allait se transformer en refuge ou en souricière. Il savait qu’il y avait quelques spécimens, notamment dans les Pyrénées Centrales, où l’espèce, vivant jadis en grand nombre puis progressivement exterminée, avait été réintroduite à travers quelques individus importés récemment d’Europe Centrale, au grand dam des éleveurs pyrénéens. Un ours peut grimper jusqu’à la cime d’un tronc, à la verticale, Gabriel en était conscient et commençait à prendre la menace au sérieux. La bête avait entamé son ascension. Vu son gabarit, sa corpulence, ce devait être un mâle solitaire. Là-haut, la trappe donnant accès à la palombière n’était pas assez large pour son corps trapu, massif. Mais rien n’arrête un ours affamé à la sortie de l’hiver. Ses crocs avaient assez de force pour s’attaquer aux planches et les déchiqueter. Quand le ventre ordonne, la gueule maronne.
Arrivé à la moitié du tronc, agrippé, le plantigrade marqua une pause, jeta un regard désabusé au sol puis pointa à nouveau son large mufle vers le haut. Il semblait réfléchir, et avoir réalisé que, outre l’odeur de sardine qui l’avait conduit jusqu’au pied du chêne, sa truffe avait décelé la présence d’un humain. Un ours est capable de sentir de la nourriture à plusieurs kilomètres de distance, et aucun obstacle, pas même la présence d’un homme, n’est en mesure de le détourner de son objectif. Gabriel savait que c’était le seul mammifère terrestre doté d’un odorat supérieur à celui du chien. Ne sachant que faire pour le dissuader de poursuivre son assaut, il saisit la boîte vide et la jeta violemment sur la tête de l’animal. Elle rebondit sur son museau avant de retomber à terre. L’ours redescendit pour s’en emparer, la lécha longuement, gloutonnement, la plaquant au sol avec ses grosses pattes avant. Mais, visiblement déçu, il leva sa tête à nouveau en direction de la palombière.
Il se mit à tournailler autour de l’arbre, sans pour autant se décider à grimper. L’odeur poissonneuse qu’il avait flairée de très loin venait maintenant du sol. Sa fourrure s’ébroua comme si une main géante, mystérieuse, la brossait fougueusement. Puis il se ravisa, s’approcha de la boîte, remit son museau dedans, la lécha, la renifla quelques secondes et s’éloigna, au grand soulagement de Gabriel. L’odeur de sardine provenait bien de cette boîte, et visiblement, ses récepteurs olfactifs ne détectaient plus de nourriture alléchante en hauteur.
C’était la première grande frayeur de son périple qui n’en était qu’à son tout début, elle était de taille. Qu’adviendrait-il en cas de face-à-face avec un ours, lorsqu’il camperait au sol, en altitude, seul au monde ? Il ne serait qu’une proie facile pour les prédateurs.
Première leçon à tirer de cet épisode : ne jamais bivouaquer près de son lieu de couchage, s’en éloigner le plus possible avant d’installer son campement. La méfiance était de mise à l’égard de l’espèce humaine mais il ne devrait pas négliger le danger des bêtes sauvages. Cet avertissement sonnait comme une monition laïque, naturelle, sauvage, une injonction majeure, ne débouchant que sur une seule alternative : être prudent, vigilant à l’extrême, ou bien risquer la mort. Non seulement il serait définitivement seul au monde, mais il n’aurait ni cabane ni palombière sur son chemin pour s’y réfugier en cas de danger absolu. Remis de ses émotions, le calme recouvré, il se détendit en s’abandonnant aux songes de son nouvel eldorado, loin de cette forêt, sous des cieux sud-américains plus cléments.
Cet épisode l’obligea à faire le point sur les hypothétiques animaux dangereux pour sa vie. Il y avait l’ours bien sûr, le loup éventuellement et le lynx dans une moindre mesure. Cependant ces trois prédateurs attentent rarement à la vie de l’homme, c’est ce que disent les défenseurs de la cause animale.
Or, il avait appris juste avant son incarcération, qu’un Français s’était fait attaquer récemment dans sa tente par un grizzli dans les Territoires du Nord-Ouest canadien. Son corps avait été retrouvé bien loin de son abri de toile, à moitié dévoré. Il se souvenait aussi d’une anthropologue, une Française, une certaine Nastassja… quelque chose, qui, elle aussi, s’était retrouvée quelque part dans le Grand Nord sibérien, dans la gueule d’un ours qui l’avait défigurée. Elle s’en était miraculeusement sortie, ce qui lui avait fait déclarer lors d’une interview : « Heureusement que les ours se suivent et ne se ressemblent pas ! »
L’ours représentait donc un réel danger. Deux cas de figure seulement pouvaient générer une réelle menace pour sa vie, soit l’attrait de la nourriture, soit une femelle accompagnée de ses petits. En dehors de ces deux éventualités, l’ours reste un animal sauvage et solitaire friand de moutons, d’agneaux ou de miel, mais qui ne s’en prend à l’homme que très rarement. Il se réconforta avec ces remarques et s’empressa de chasser l’idée du pire.
La troisième nuit, après avoir repris des forces, il décida de se remettre en route. Cette fois-ci c’était le début du grand trekking, de la grande aventure vers son Far-West à lui. Quelle que soit la nature du lieu, une cellule ou une cache, il mesurait combien l’état de confinement prolongé devient une gangue où se terrent l’ennui et le dépérissement. Malgré le froid piquant des hauteurs en cette fin d’hiver, il avait envie de tout le ciel dans les yeux, un toit naturel bleu ou couleur pluie, mais entier, au-dessus de ses pensées, et la lumière d’un soleil orgueilleux pour les éclairer de temps en temps. Par ailleurs, les beaux jours approchant, requinqué, plein d’espoir, il voyait dans tout cela le symbole, le catalyseur d’un laser virtuel braqué sur ses projets, illuminant, sublimant son destin.
Il marchait, son gros sac sur le dos, les bâtons télescopiques dans les mains, comme un vrai randonneur correctement équipé, expérimenté. Il grimpait, sa détermination demeurait intacte. Reposé depuis quelques jours, il gravissait la pente allègrement, son corps puisant son énergie dans l’odeur grise des roches. Traversé par les forces de l’envie, il bandait ses muscles et décuplait ses ressources physiques et morales. Étrangement, ce lourd fardeau gorgé d’eau qu’est le corps de l’homme, ne le décourageait nullement. On eût dit qu’il venait de recevoir une double ration de vie. Le tracé sur la carte qu’il avait eu le temps d’examiner dans les moindres détails, lui enjoignait de gagner une altitude bien plus élevée, il obtempérait. Sa volonté d’avancer coûte que coûte vers les lendemains de l’espoir le stimulait d’autant. Il se sentait aérien. Ni la raideur des pentes, ni la raréfaction de l’oxygène n’avaient raison de sa détermination.
Plus il montait, plus l’air se rafraîchissait. Il enfila sa paire de gants, remonta le col de son anorak. Il était parti sous un ciel pur, étoilé. Mais sans vraiment les voir, il devinait les nuages s’amonceler au fur et à mesure de son ascension, comme une épaisse fumée noire éteignant une à une les étoiles. Il traversa longuement une partie de la pente à découvert, semblable à une grande friche isolée, délaissée, où l’herbe de printemps commençait à pousser, l’obligeant à lever ses pieds à chaque foulée pour ne pas trébucher. Affutés comme une pierre à fusil, regardant vers le haut, ses yeux anticipaient son ascension. Il se voyait déjà en haut de la friche. Il fonçait, cap ouest toute, avait prévu de marcher non-stop, pendant trois heures au minimum avant de faire une halte, souffler un peu, se restaurer et repartir jusqu’au petit matin, jusqu’au dernier reste de nuit. Ses yeux tiraient son esprit vers le haut comme un treuil hissant une charge. Il savait qu’en présence du réel, le regard résolu accueille aussitôt la certitude impérieuse du donné ; la conscience, elle, a besoin de plus de temps pour l’accepter, alors il la motivait, l’élevait mentalement vers les sommets en la portant aux nues.
Par chance, l’obscurité était moins dense que la nuit de son évasion. À découvert, la pénombre est toujours moindre que dans un chemin bordé d’arbres. Ses sens poursuivaient leur ensauvagement, sa vision s’accoutumait, augmentant peu à peu son acuité, de sorte qu’il parvenait à distinguer les formes et apprécier les distances. Insensiblement il développait sa nyctalopie au fur et à mesure qu’il progressait dans cet environnement nocturne que tout un chacun aurait jugé hostile et impénétrable.
Plus haut, il apercevait des étendues de plus en plus claires, ridées de zastrugi, ces vaguelettes d’écorce de neige sculptées par les vents, tant redoutées par les skieurs, linceuls d’une flore éternellement prisonnière. Cette lumière blanche contrastait avec le ciel sombre dont l’immense cape noire éteignait les couleurs, privées de leur existence même, de leur pouvoir magique. Pour une fois la terre éclairait le ciel.
Il évoluait dans cette étendue comme dans un film noir et blanc, il en incarnait le personnage principal. Il se sentait définitivement libre, délibérément, aurait dit son frère en cette circonstance. Il respirait à pleins poumons l’air froid, presque glacé, de la montagne. Monumentale, massive, orgueilleuse, elle se dressait devant lui sans pour autant l’effrayer. Il commençait à l’apprivoiser, elle ne lui faisait plus peur. Après tout, il allait vivre avec elle des jours et des nuits, elle serait son refuge et son amie. Rude et protectrice, muraille, armure et tanière à la fois, il devrait composer avec ses pièges et ses caches naturelles, dangereux ou providentiels. Il traversa un moment d’euphorie, celui que l’homme éprouve quand il croit posséder les clés de la lecture du monde et qu’il suffit de pousser les portes de son propre destin pour se convaincre qu’il tient dans le creux de ses mains. L’altitude l’avait porté sur un des toits du monde, il tutoyait l’empyrée, le lieu privilégié des dieux. Mais pour une fois cette euphorie ne provenait pas d’une prise d’hallucinogène, comme la mescaline, dont il faisait commerce à Toulouse ; cet enjouement s’était révélé de lui-même au seul contact d’une nature grandiose et de l’extase que lui procurait la dimension océane de tous ces sommets environnants, couronnés de leur diadème éternel. Une extase augmentée du sentiment jouissif de pleine et entière liberté. Il n’en percevait que les vertus, une transcendance naturelle, une ablution de l’esprit, dénuée de perversité chimique, d’hallucination, de vomissements, de troubles de la concentration ou de la mémoire. Il était en paix avec le sublime de ce décor naturel et avec lui-même.
Il avait lu en prison que les hallucinogènes avaient fait les joies et les misères d’écrivains célèbres comme Sartre, Michaux, Huxley et bien d’autres. De grands poètes en manque d’inspiration, au bord de la crise de vers, en avaient abusés. Ici, au cœur de la sève du monde organique, d’enivrants bouquets d’essences naturelles, il n’avait nul besoin d’alcaloïdes ou de produits psychédéliques aux effets secondaires dévastateurs. La Nature régnait, généreuse, stimulante, sainement excitante. Ce bien-être, ce plein-être, lui donnaient la fierté arrogante du bailador, du danseur de sevillana, bombant le torse, cambrant le corps et les bras, extatique, prêt à faire claquer ses talons pour un zapateado endiablé, jalousé fiévreusement par une seguidilla attendant son heure. Ayant fui la misère de leur temps, répondant au nom de Ruiz, ses grands-parents n’étaient-ils pas Espagnols ? Son grand-père Ramon lui avait dit un jour : « ¡Tu eres Español y tienes sangre de reye en la palma de la mano! Tu es Espagnol et c’est du sang royal qui coule dans tes veines ! » Ces souvenirs réveillaient la fierté donquichottesque des vieux Ibères qui dormait en lui, au moment où son corps et son âme évoluaient entre les deux pays, emblèmes et foyers de ses racines, au cœur du massif des Pyrénées, tout là-haut, en équilibre sur la crête de sa double identité ; à cheval sur les deux versants de ses origines, pour un peu il se serait pris pour un Semprun, un Arrabal.
Les grandes plaques blanches qu’il observait tout là-haut s’étiraient progressivement, éclairant de mieux en mieux les pentes qu’il gravissait. Le vent glacé fouettait son visage. Aveuglé de froid il chaussa ses grosses lunettes par-dessus sa cagoule. Les plaques de neige exposaient presque trop les versants, il se mettait en danger en arpentant ces trouées blanches, on pouvait distinguer une silhouette à cinquante mètres à ce moment précis. Si le ciel avait été pur et la lune pleine, l’énergie spectrale des lumineuses zastrugi eût achevé le travail et démis l’obscurité de ses funestes fonctions.
Il marcha ainsi autant qu’il pût. Au cœur de la nuit il s’abrita au pied des jambes massives des grands sapins noirs, déposa son sac et resta assis longtemps, épiant les moindres bruits alentour. La nature se taisait, rien ne bruissait, la chapelure de neige avait, semblait-il, figé les animaux et les arbres. Le triomphe du silence avait étouffé les moindres clameurs montant de la vallée, totalement engourdie à cette heure. Il suivait des yeux les fines perles de vapeur blanche sortant de sa bouche après chaque expiration. Il croqua une pomme trouvée dans une des poches extérieures de son sac, mangea quelques fruits secs, avala une gorgée d’eau, d’un revers de manche essuya une goutte perlant le long du philtre, puis décida de repartir. Précautionneux, avant de se lever, il creusa un trou dans la terre pour y enterrer le trognon. Il poursuivit son ascension jusqu’au bout de la nuit, seul au monde. Du moins le croyait-il. Les longues heures de marche avaient fatigué ses membres, meurtri douloureusement ses muscles. Le froid engourdit son nez, un appétit de lion commençait à ronger son estomac. Il était temps de se poser pour reprendre des forces avant le coup de flûte du premier merle pressé de vivre, trouver le lieu adéquat puis marcher à nouveau une petite heure pour s’en éloigner, avant d’atteindre la frange verte d’une forêt mentionnée sur la carte, programmée pour sa première étape de bivouac. Il restait donc une bonne distance à parcourir avant que la lumière n’éclate au grand jour, que les cimes mauves n’accueillent les premiers poinçons du matin.
Arrivé sur les lieux de son premier campement sauvage, épuisé mais rasséréné par la pensée réconfortante de l’effort accompli, il déplia sa Quechua avec la dextérité d’une Andalouse déployant son éventail. Il s’autorisa une première fantaisie pour réchauffer corps et âme, en ingurgitant cul sec une lampée de rincette dont son frère avait glissé parmi les vivres une petite flasque de chasseur, chromée, un rien gentry, finement gainée d’une robe de cuir fauve. Un cadeau d’au revoir ou peut-être d’adieu ? Il zippa la porte de la tente plantée parmi de jeunes sapins accroupis sur l’herbe, la refermant définitivement comme le dernier baissé de rideau d’une scène de théâtre après une longue, une éprouvante représentation. Tandis que la première clarté s’apprêtait à venir au monde, il sentit la magie scélérate de l’alcool lui brûler les veines tout en martelant ses tempes. Insensiblement ses paupières se laissèrent happer par les dernières ténèbres qui absorbèrent définitivement tout son être dans le néant. L’écran de son cerveau s’éteignit brusquement, comme une ampoule rendant l’âme, abandonnant tout pouvoir au sommeil, lui confiant l’entière responsabilité d’ouvrir les portes du rêve ou du cauchemar.
Tout au long de cette première nuit, son activité cérébrale, prit le contre-pied de son état de fatigue profond. Était-ce le besoin supplémentaire de s’affranchir de cette situation inédite, de l’espace et du temps qu’il expérimentait depuis quelques jours, ou le simple caprice d’un psychisme désirant obstinément revivre sous une forme farfelue, baroque, les dernières scènes de cette fuite insensée ?
Ni l’un ni l’autre. Le théâtre de ce songe d’une nuit d’hiver fut bien celui où il se déplaçait depuis son évasion mais avec la magie, l’inattendu, l’imprévisible dont les rêves ont le secret. Pendant que les yeux dormaient, le cerveau, lui, s’offrit une séance d’onirologie. Il revit exactement les lieux qu’il venait de traverser, mais en plein jour. Tout s’éclaira, sous le soleil, comme si la pellicule du film de la nuit précédente avait été colorisée ; un paysage à couper le souffle, des forêts à perte de vue, les couloirs qu’il avait empruntés, les passages à découvert, nus comme des chaumes, les plaques de neige vierge luisant sous un ciel bleu électrique, dominant les cimes immaculées à l’autre bout de ses yeux. Ce rêve prolongea l’état euphorique qui l’avait accompagné tout au long de l’ascension, jusqu’au moment où une énorme gueule se pencha sur lui, un animal imaginaire venu de nulle part. En entrant dans le champ du rêve, l’indésirable visiteur en interrompit subitement la sérénité, comme de gros nuages noirs recouvrant d’un coup les couleurs et les images de ce tableau d’une authentique fraîcheur pastorale, invitant l’œil à une paisible et douce contemplation. Gabriel crut entendre un aboiement qui le réveilla aussitôt, le cœur affolé, l’esprit confus, les yeux embrumés, il se demanda quelques secondes s’il était réveillé ou si son rêve tournait au cauchemar.