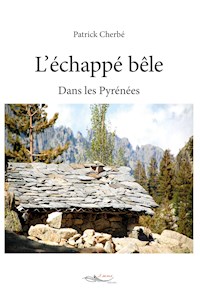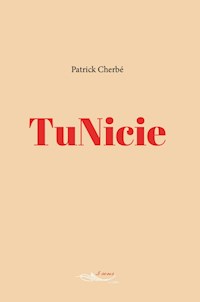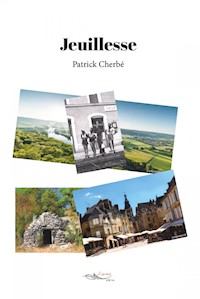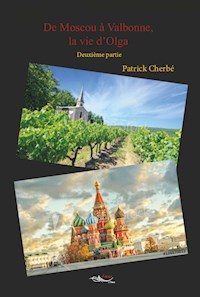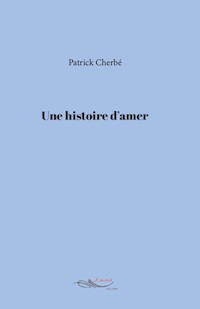
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Il aurait voulu être musicien, poète, peintre, artiste ou écrivain, être heureux, achever « Les Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau » où l’auteur présente une vision philosophique du bonheur, proche de la contemplation et de l’absence de trouble, cette ataraxie que Grassouille aurait tellement voulu vivre. La chanson célèbre interprétée par Nicole Croisille (le blues du businessman) le faisait rêver autant qu’elle lui brisait le coeur. À trente-cinq ans passés, il n’était que numéro deux, papa tenait toujours les rênes de la société Heyman & Fils. Tandis que sa fissapapasthénie le torturait, il voyait s’envoler ses rêves d’artiste…"
À PROPOS DE L'AUTEUR
Chef d’entreprise retraité après une carrière en France et à l’étranger dans le domaine de la parfumerie. A la suite de son premier roman, Olga, tiré d’une histoire vraie,
Patrick Cherbé signe ici son second ouvrage, nous invitant ainsi à découvrir le monde secret du parfum, à travers les yeux de Grassouille, héros malgré lui de cette fiction.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
– De Moscou à Valbonne, la vie d’Olga
Tome I, 2019, 5 Sens Editions
– De Moscou à Valbonne, la vie d’Olga
Tome II, 2019, 5 Sens Editions
Patrick Cherbé
Une histoire d’amer
ou l’itinéraire d’un enfant bâté
On choisit pas ses parents
On choisit pas sa famille1
Une ondée de ciel bleu s’abattait sur le pays l’inondant d’une luminosité sogdienne inhabituelle. Cette pureté céleste propre à l’Asie Centrale, cette nitescence banale à Boukhara ou Tashkent tout au long de l’année, illuminaient exceptionnellement la cité des parfums baignée de cette singulière lumière ouzbèke en ce jour de février de l’an de Grasse 1987. Le clocher de la cathédrale et la tour sarrasine de la vieille ville, massifs, fiers, campés sur leurs pierres blanches et grises, trônaient en lieu et place des dômes bleus du Régistan de Samarcande.
Avec la vigueur d’une pluie divine gorgée d’eau micellaire balayant l’éther, le mistral avait chassé les traînées blanches et les poussières en suspension de la veille. Un panorama translucide s’étirait anormalement, par-delà les plaines grassoise et mouginoise, laissant deviner aux regards badauds et oisifs une immense plaque d’argent immobile dans le lointain blondi par le soleil s’arrachant au Levant.
N’était la campagne verdoyante entre Grasse et les côtes cannoises, la blondeur safranée de cette écharpe figée, pétrifiée, rejointe au loin par un ciel lumineux, aurait pu s’identifier au désert de l’antique Transoxiane ou d’un isthme dunaire abolissant toute présence marine. La mer avait disparu, l’Afrique tutoyait le sud de l’Europe, une espèce d’indentation terrestre venue du grand sud laissait pénétrer l’Algérois en territoire gaulois. Une grande plage de sable ocre s’étendait entre la France et l’Algérie, un tableau sorti tout droit ce matin-là d’une œuvre orientaliste ; comme si Gustave de Guillaumet avait posé son œil et son pinceau sahariens sur l’horizon depuis le promontoire des jardins de la Princesse Pauline juchés au-dessus de Grasse.
Là-haut, une légère brise jouait en sourdine une sonate pour piano, une marche turque mozartienne susurrée aux oreilles de pierre et de bronze de Pauline Borghese, sœur préférée de Napoléon Bonaparte, et d’Ivan Bounine, premier prix Nobel russe de littérature. À la pointe du promontoire, juste au-dessus du vide, une petite plaque faisait le guet, honorant un autre prix Nobel : Frédéric Mistral, dans l’attente lui aussi d’une statue ou d’un buste. Ce petit écriteau dont le fantôme du poète scrutait le panorama d’Antibes aux monts de l’Estérel, se dressait en surplomb sur le lit rose des toits de Grasse où le célèbre auteur provençal avait fait une halte il y a bien longtemps. Il avait écrit quelques vers sur la cité grassoise dans « Mireille » (Mirèio), le chef-d’œuvre qui l’avait consacré à Stockholm dont l’écriteau exhumait un extrait.
Malheureusement, occultée par la renommée internationale du parfum, l’histoire grassoise de ces trois prestigieux personnages qui avaient séjourné et vécu à Grasse avait été un peu oubliée par les habitants.
Au volant de sa fiat Panda Gilles, dit Grassouille, roulait vers son bureau. Depuis toujours dans sa famille chacun portait un surnom. Il devait le sien à son embonpoint qui l’avait caractérisé dans sa petite enfance. Plus tard les miracles de l’adolescence avaient fait fondre ses kilos lui donnant un tout autre corps devenu dégingandé, chétif, maigrichon, presque étique. Malgré cette métamorphose le surnom Grassouille était demeuré dans la bouche de tous. Derrière de petites lunettes carrées dues à une myopie doublée d’un fort astigmatisme, ses yeux fourbes d’avorton, plongés dans ses pensées, fixaient la route sans la voir. Il la connaissait par cœur. Tout petit déjà il empruntait cet itinéraire avec son papa pour rejoindre ce même bureau, d’où un chauffeur l’emmenait à l’école. Déjà, Grissouille, son père, lui avait cédé virtuellement un bout de son siège de président qu’il tenait lui-même de son père Grossouille.
Arssouille, l’arrière-grand-père, avait fondé la société au XIXe siècle. De père en fils la famille Heyman transmettait la poule aux œufs d’or et Gilles-Grassouille, l’aîné de sa fratrie, savait depuis sa prime enfance qu’il présiderait un jour à la destinée de la société de papa, de grand-papa et d’arrière-grand-papa. Plus tard, à son tour il préparerait à la relève sa progéniture, la cinquième génération. Sa vie, son avenir, avaient été décidés sans son accord, bien avant sa naissance. Il avait été programmé comme un androïde, ce matin ce n’était pas lui qui conduisait, pas plus qu’il ne dirigeait sa vie et son avenir.
Il n’en était pas conscient mais la société Heyman menait son existence par le bout du Nez. Elle tirait les ficelles d’un margotin binoclard, d’un automate dont un vieil arbre à cames assurait le paramétrage.
Cette société spécialisée dans la création de parfums et la production d’huiles essentielles comme des dizaines d’autres à Grasse, s’était diversifiée dans les années 1950-1960 en se lançant dans la fabrication d’arômes alimentaires. Les années d’après-guerre et les trente glorieuses propices à la consommation de masse avec l’arrivée des grandes surfaces annonçant la mort progressive et programmée des petits épiciers, avaient suscité chez les industriels du parfum des velléités d’augmenter leurs profits grâce à la manne alimentaire qui se profilait. Désormais les arômes allaient pouvoir être vendus en quantités à des groupes industriels s’apprêtant à bouleverser les habitudes alimentaires des Français. La publicité entrait chez les Gaulois par la petite lucarne et par la transmission sans fil plus connue par les anciens sous l’acronyme TSF. L’inéluctable apparition de la malbouffe pointait le bout de son nez avant d’arriver dans les réfrigérateurs et les assiettes des consommateurs.
Gilles-Grassouille souffrait de fissapapasthénie, une pathologie bien connue dans la région. Il s’était juré de conjurer le sort en prouvant coûte que coûte que l’endogamie familiale et professionnelle ne serait pour rien dans sa réussite.
Il assumait difficilement cette charge de dépositaire de la marque de famille qu’il portait douloureusement comme un sherpa chancelant sous son écrasant barda hétéroclite. De par sa jeunesse et son inexpérience, sa casquette d’épigone lui conférait malgré lui une image famélique de blanc-bec, une pâle copie de ses prédécesseurs.
Légèrement voûté, pas très beau, les épaules en dedans, il affichait un sourire pincé en coin. Ses petits yeux sournois, son air penaud, sa minuscule voiture, lui donnaient un air de fonctionnaire subalterne, rabougri, mal dans sa peau. Gilles-Grassouille Heyman portait plusieurs fardeaux sur ses épaules. Il avait fait des études mais pas celles qu’attendait papa, il avait raté polytechnique et cet échec avait meurtri la fierté de Grissouille Heyman.
Cela n’aurait eu aucune espèce d’importance si le fils de son concurrent direct n’avait pas réussi, lui, le concours de l’X. Il avait vécu l’insuccès de son fils comme un camouflet, une humiliation personnelle. Son amour-propre avait été atteint et à travers lui la dignité de toute une dynastie car depuis plus d’un siècle les deux familles se livraient une bataille féroce sur les marchés du monde entier. Dès que l’une implantait une filiale dans un pays, l’autre répliquait dans la foulée. C’était une guerre commerciale mais pas seulement, de prestige aussi, les deux entreprises pesaient lourdement à elles deux sur la région autant qu’une multinationale peut phagocyter un bassin d’emploi local.
Bien avant la date elles avaient acquis la puissance et la renommée de GAFAM locales se voyant qualifiées de « multirégionales ». Elles trustaient directement et indirectement près de 60 % du marché du travail du pays grassois faisant vivre toutes les petites entreprises de la région, les transporteurs, les fournisseurs, les petits artisans etc. Le Maire, le Sous-Préfet, le Président de la Chambre de Commerce, les Présidents des départements et des régions, tous les édiles et les notables du coin sans exception, considéraient les deux sociétés avec beaucoup d’égard et de déférence. À elles seules elles finançaient une grande part de la taxe professionnelle dont les collectivités territoriales bénéficiaient chaque année.
Grand, arborant un nez démesurément vissé au milieu d’une mine fière et arrogante, Grissouille, lunetteux lui aussi, la face percluse de furoncles, dissimulait sa timidité derrière une condescendance et une superbe immodérément affectées. Il ne riait jamais. Ni Charly Chapling ni Fernandel, les stars de cinéma de son époque, n’avaient pu décoincer ses zygomatiques, personne n’avait jamais pu lire l’esquisse d’un sourire sur son visage maladivement acnéique.
À trente-cinq ans Gilles-Grassouille craignait toujours son père qui ne lui avait jamais pardonné son échec au concours d’entrée de l’X. Outre le poids de ce déboire universitaire, le jeune surgeon de la dynastie subissait indirectement une autre pression venue, elle, de son frère cadet John dit Granssouille. Le droit d’aînesse revenant à Gilles-Grassouille, il n’en demeurait pas moins que la grande taille et la beauté de son frère contrastaient ostensiblement avec l’allure gauche et empruntée de sa personne. John-Granssouille, chimiste comme son père, jouissait, comme souvent dans les familles de toutes conditions, de la préférence implicite et manifeste de son géniteur.
Gilles-Grassouille souffrait de cette différence qu’il jugeait injuste et dégradante. Sa fierté et son amour-propre bouillonnaient intérieurement sans qu’il n’en fît jamais écho ouvertement.
Le poids de la responsabilité successorale, la désaffection paternelle et cette compétition fratricide en devenir focalisaient l’attention de Gilles-Grassouille au point d’en ressentir un mal-être sous-jacent mais bien réel.
Il devait bon gré mal gré apporter sa pierre à l’édifice. Et ce matin son regard perdu dans le pare-brise témoignait de son questionnement thétique : « Que vais-je bien pouvoir faire pour exister ? »
Il aurait voulu être musicien, poète, peintre, artiste ou écrivain, être heureux, achever « Les Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau » où l’auteur présente une vision philosophique du bonheur, proche de la contemplation et de l’absence de trouble, cette ataraxie que Grassouille aurait tellement voulu vivre. La chanson célèbre interprétée par Nicole Croisille (le blues du businessman) le faisait rêver autant qu’elle lui brisait le cœur. À trente-cinq ans passés, il n’était que numéro deux, papa tenait toujours les rênes de la société Heyman & Fils. Tandis que sa fissapapasthénie le torturait, il voyait s’envoler ses rêves d’artiste. Car, s’émanciper, renoncer à sa charge pour être lui-même, il n’avait eu ni le cran ni la force de l’envisager. Céder sa place à son frère cadet eut été un immense déshonneur et une défaite personnelle. La mort dans l’âme, il s’était résolu à étouffer sa flamme d’esthète. Ce désir inassouvi l’avait peu à peu replié sur lui-même. La fierté, l’orgueil et le poids de l’héritage industriel l’empêcheraient-ils toute sa vie d’être lui-même ?
Dernièrement il avait enduré une nouvelle humiliation péremptoirement infligée par son père : le choix de Grissouille pour diriger le département de la parfumerie et des huiles essentielles s’était porté sur son frère cadet John-Granssouille. Pour faire passer la pilule le patriarche lui avait présenté la direction du département arômes comme la partie la plus prometteuse, potentiellement beaucoup plus porteuse à terme que la parfumerie ; la création de la nouvelle unité arômes devant donner un nouvel élan à l’entreprise dont il serait le moteur et le pro-moteur.
Depuis plus de cent ans la parfumerie avait donné ses lettres de noblesse et sa notoriété à l’entreprise, Gilles-Grassouille avait comme toujours subi silencieusement le choix de Grissouille, mais il avait reçu cette dernière décision comme un nouvel affront personnel avilissant et déshonorant. Malgré ce nouvel épisode infamant il avait refoulé sa rancœur, attendant le jour où le bâton de maréchal lui serait définitivement transmis.
Le moment venu, il se vengerait, il serait capitaine et aurait en main le destin du navire familial. Mais pour l’heure il expérimentait la dure loi du dauphin, du second, les vexations que lui infligeaient Grissouille et les revers inattendus de la vie.
Son tempérament inquiet, soucieux, acariâtre, avait fini par faire de lui un homme suspicieux, renfrogné, dont il tentait en vain d’effacer l’image. Une image qu’il renvoyait malgré lui, son sourire crispé et son humour douteux, pince-sans-rire, trahissaient un mal-être évident que les employés ressentaient et percevaient naturellement.
La nuit, seul avec sa conscience, il maudissait ce déterminisme contre lequel sa soif de reconnaissance et sa fatuité demeuraient impuissantes. Il s’en voulait néanmoins de n’être pas courageux, de ne pas oser clamer à la face du monde son inclination pour l’art, son goût pour une autre destinée. Le parcours de Simone de Beauvoir le hantait parfois, celle dont le père aurait souhaité un fils pour en faire un polytechnicien. Réussir le concours d’entrée à l’X puis refuser de succéder à son père eurent été des actes nobles et libérateurs. Être lui-même, s’orienter définitivement vers une autre voie choisie par ses soins ou bien, au pire ou à défaut, faire ses armes dans une autre entreprise industrielle lui eut apporté reconnaissance et panache.
Au lieu de ça sa couardise le condamnait à la succession avec pour seul mérite l’héritage d’une dynastie. C’est bien cela qui le tourmentait tous les jours dans sa voiture : ce démérite, cette filiation abusivement légitimée et légitimante, ce droit d’aînesse, cet avantage préciputaire, hérité d’un autre temps, remontant au système féodal.
Outre ses humiliantes avanies, la chance ne souriait pas non plus à Gilles-Grassouille qui avait eu des filles tandis que son frère avait donné la vie à des garçons. Malgré tout, son droit d’aînesse le consolait, le gouvernail lui reviendrait de droit un jour, reléguant son frère puîné à une position vassalisée. Il serait un jour à la barre.
Cette situation, ces faits, étaient la cause de tous ses tourments. Étranger à lui-même, Gilles-Grassouille expérimentait une période camusienne bien lourde pour ses frêles épaules. Dans une région baignée de mer et de soleil, coincé entre un père castrateur, autoritaire et un avenir aussi lucratif qu’ennuyeux au mépris de ses idéaux et de ses aspirations, il était une espèce de Meursault prisonnier d’un château, écrasé par la charge échue, tentant « d’accorder sa respiration aux soupirs tumultueux du monde » qui l’entourait. Il se situait en dehors de la société, du monde insensé au sens étymologique du terme, montrant une certaine passivité aux êtres et aux choses. Cette absurdité du monde extérieur provoquait en lui un rejet qui l’enfermait dans son univers à lui. Il avait appris l’allemand au lycée et il se souvint en conduisant que le château (forteresse au sens étymologique du terme) où il se rendait se dit Schloss en allemand signifiant aussi serrure, allait-il s’enfermer (einschließen) à vie dans l’usine de papa ou relever la tête et refuser un parcours balisé bien avant sa naissance par toute une famille. À ses yeux, cette programmation niait sa subjectivité, son essence même, réduisant sa personne à la simple émergence d’une huile non essentielle de plus dans le PIF : le Paysage Industriel des Fragrances. Ce terme était apparu quelques décennies auparavant lorsque Grissouille son père, fit son entrée dans la profession dans les années cinquante. Son gros appendice gogolien n’avait pas échappé à l’esprit narquois des concurrents et des fournisseurs. D’une simple moquerie de potache l’acronyme PIF était passé au statut d’institution dont tout le monde avait oublié l’origine au grand soulagement de la famille Heyman. Seuls les anciens de la profession en connaissaient aujourd’hui la généalogie.
Malgré ses déconvenues, sa faiblesse d’âme, sa lâcheté, ne lui laissaient point le choix. Il attendrait patiemment durant plusieurs années la passation de pouvoir en courbant son échine déjà voussurée. Il devrait composer avec son frère, nommé directeur de tout le département parfumerie. Il respecterait la mort dans l’âme le dicton appris auprès de sa grand-mère : « La patience mène à bien, la précipitation à rien. »
Tu quoqe mi fili
La patrilinéarité, ce système de filiation procédant du lignage masculin, serait-elle l’opportunité de sa vie ou un cadeau empoisonné ? « Toi aussi mon fils, tu feras comme moi, tu hériteras du nom et des titres de papa ! » Résonnait à son oreille cette voix caverneuse, quasi sépulcrale, que lui seul entendait. Cette ancestrale tradition transmise de stèle funéraire en pierre tombale à laquelle on ne dérogeait jamais posait unilatéralement l’aptitude indubitablement clonable de père en fils.
Aurait-il le talent nécessaire pour gagner l’estime de son père, le respect de ses employés et de la profession ? Autant de questions obsédantes que Gilles-Grassouille se posait inlassablement. Malgré l’évidence d’une carrière prémâchée, sa fissapapasthénie et le népotisme séculairement établi le rongeaient jour après jour, dévastant son amour-propre, cette servitude à laquelle il n’échappait pas le confondait.
La société disposant de filiales dans le monde entier, il ne trouvait de répit que dans ses voyages intercontinentaux, loin du siège de la société, des regards scrutateurs, des visages au mutisme insolent mais ostensiblement défiants. Dès qu’il était assis sur son siège, il bouclait sa ceinture et soupirait bruyamment comme pour se débarrasser d’un fardeau ou expirer un air virtuellement pollué encombrant ses bronches, son esprit et ses pensées. Il partait une semaine vers un autre continent, il s’évadait littéralement, s’émancipant au fur et à mesure que l’avion prenait de l’altitude. Léger, aérien, il redevenait lui-même et mesurait dans ces moments combien le rôle qu’il était tenu de jouer sur terre empoisonnait sa vie.
Chaque voyage prenait des airs de vacances. Pour un temps il quittait avec joie et frénésie son itinéraire d’enfant bâté. Plus rien ne pesait sur ses épaules. Ses ardeurs, ses penchants esthétiques et esthétisants reprenaient le dessus. Développer le chiffre de l’entreprise, engraisser les comptes en banque de la société et de la famille, s’entourer d’avocats spécialisés dans l’optimisation fiscale, jouer avec les comptes du siège et des différentes filiales pour soustraire les dividendes aux législations les plus drastiques de la planète, recruter les meilleurs experts financiers chargés de mettre au point de complexes montages financiers, réduire comptablement le montant des bénéfices soumis à l’impôt, tout cela l’ennuyait, il n’avait jamais été fasciné par cet avenir qu’on lui proposait.
Au cours d’un de ses déplacements en Chine, il apprit l’existence d’une civilisation matrilinéaire, son mode de vie avait attiré son attention. Un client lui avait parlé d’une ethnie dans le sud-ouest de l’Empire du Milieu : les Mossos. Depuis des siècles quelque quarante mille personnes vivaient aujourd’hui selon les coutumes ancestrales selon lesquelles chacun relève du lignage de sa mère. Ainsi la transmission par héritage de la propriété, des noms de famille et titres passait et passe toujours par le lignage féminin. Malgré le régime autoritaire de Pékin administré à l’endroit des ethnies et leur sinisation forcée, les Mossos avaient réussi à conserver leur planning familial et leurs mœurs.
La politique de l’enfant unique mise en place dans tout le pays avait conduit une majorité de foyers à privilégier la naissance des garçons avec pour conséquences désastreuses des centaines de milliers d’infanticides à travers tout le pays. Le système de famille matrilinéaire des Mossos avait eu au moins pour effet l’évitement salutaire de ces massacres ; la naissance de filles étant rendu nécessaire puisqu’elles transmettent le lignage. En marge de ces considérations ethnographiques, Gilles-Grassouille se prenait à rêver de ce système qui n’aurait pas fait de lui en France l’héritier de droit d’un empire dont il ne souhaitait pas au fond de lui-même prendre les rênes.
De passage à Jakarta, il avait aussi appris l’existence à Sumatra en Indonésie de la plus grande société matrilinéaire du monde où quelque huit millions de personnes vivent selon leurs codes ancestraux. Chez les Minangkabau, les femmes sont propriétaires de la terre, des biens immobiliers et mobiliers qu’elles transmettent à leurs filles. Les hommes n’ont rien. Les enfants portent le nom de leur mère et l’homme qui en a la responsabilité n’est pas leur géniteur mais leur oncle maternel. Pour le mariage c’est la famille de la fille qui demande la main du garçon. En cas de divorce la mère garde les enfants. Dès l’âge de sept ans les garçons quittent la maison pour habiter dans une maison commune où ils apprennent les enseignements religieux et culturels. Les adolescents sont encouragés ensuite à expérimenter d’autres milieux que leur communauté initiale pour y revenir et enrichir celle-ci de leur expérience où ils deviennent membres du Conseil des oncles.
Si d’un point de vue religieux l’Indonésie avait été islamisée, la communauté des Minangkabau avait conservé l’adat, son droit coutumier, qui régit encore aujourd’hui les codes de leur société. Le fait que la République d’Indonésie reconnaisse l’adat à côté du droit civil hérité de la colonisation hollandaise et du droit religieux musulman et hindouiste avait forcé le respect de Gilles-Grassouille. La tolérance sociale et familiale pouvait donc exister, se disait-il, des hommes étaient heureux sans pour autant devoir posséder ou diriger !
Si en Chine la société matriarcale perdurait, c’était surtout dans les campagnes, en Indonésie en revanche, elle était observée aussi dans les villes. La Chine avait comme au Tibet tenté d’imposer violemment partout ses règles de vie et de société mais les Na de la nationalité Naxi (grand peuple) avaient bien résisté (Na étant leur autonyme car c’est ainsi qu’ils se nomment contrairement aux Chinois qui les appellent péjorativement les Mossos).
Gilles-Grassouille s’ennuyait, riche mais sans âme, sa vie dénuée de création que la part des anges et le manque de temps prélevaient en totalité le désolait. L’avion devenait ce vaisseau dans lequel il aurait voulu monter chaque jour pour, comme il disait, « s’élever au-dessus des vomissures terrestres », cueillir dans l’éther le meilleur des idées et de la pensée esthétiques.
La seule parcelle de création qu’offrait l’entreprise était la composition de parfums, l’alliage de matières premières nobles, le charme de l’onirisme olfactif. Composer pour créer. Or même à cette part du gâteau il n’avait pas accès. L’expression ne pas être en odeur de sainteté faisait décidément sens. L’odorat était devenu un sens interdit pour lui. Condamné à l’anosmie, il tâcherait de ne pas sacrifier à l’agueusie.
Il comprenait qu’il faisait partie de cette mécanique dont les gens ne sont même plus conscients, comme dans les œuvres de kafka « Le procès » ou « La métamorphose », où l’individu est le jouet d’un système qui le dépasse. Le double sens que donne l’écrivain praguois au terme « procès » (jugement et proce… sus) dénonce le système absurde que l’univers kafkaïen met en lumière. Comme les héros de Kafka, Grassouille relevait d’un procès, d’une procé… dure, d’un proce… ssus dont il était prisonnier.
« Gosse de riche ! », avait-il entendu tout au long de son enfance et de son adolescence. Ce sobriquet insultant augmenté du surnom dépréciatif de Grassouille pesait encore sur sa mémoire. Il fallait désormais relever la tête, gagner ses lettres de noblesse, soigner sa fissapapasthénie, éviter qu’elle ne se transformât en fissapapatrophie ; cette pathologie pouvant entraîner des effets secondaires graves sur son état psychique, sa libido ou son intellect.
Puisqu’il était condamné pour plusieurs années encore au développement de la partie la moins noble du château, il devait trouver un moyen de s’y épanouir. Ce serait son défi, son « tchalleindj » qu’il prononçait à l’anglaise on ne sait pourquoi, peut-être pour faire bien, montrer qu’il était dans le coup, à la manière de ces journalistes parisiens aussitôt imités par les Provinciaux frustrés de l’être.
Papa lui ayant payé des études aux États-Unis, il fallait bien qu’il en restât quelques traces. L’anglais était aussi un moyen de se démarquer de son père resté au pays toute sa vie. Mais Gilles-Grassouille ignorait que challenge était un mot bien français attesté dès le XIIe siècle emprunté plus tard par les Anglais et que la vanité parisienne avait indûment détourné phonologiquement juste par parisianisme snobinard. Ce mot écrit alors chalenge en vieux français désignait une chicane, une attaque, un défi. À l’image de ce mot l’ethnocentrisme forcené germanopratin et médiatique avait fait des ravages tout au long du XXe siècle dans la langue française et le franglais avait envahi tous les secteurs de la société, y compris et surtout le monde de l’entreprise et les médias. Ce jacobinisme linguistique et nombriliste procédait de son pendant politique depuis le XVIIe siècle dont on trouvait déjà trace dans la littérature de cette époque ; le journalisme et la publicité enfoncèrent le clou tout au long de la deuxième partie du XXe siècle.
Ce franglais créé par un noyau d’énergumènes rayonnant dans un petit périmètre de la capitale, issus de quelques journalistes médiatisés, de fils de pub et de billettistes à la culture indigente n’existant qu’à travers les micros et les caméras, témoignait d’une ignorance crasse de l’anglais. Cette population podcastée dite popo, au niveau d’anglais en phase terminale, se posait en académie parisianiste du nouveau dictionnaire branché. Les Popos, champions du contresens franglais adeptes du globish, fiers de truffer leur français déficient de leurs piteuses créations, étaient à l’origine de mots dont ils détournaient le sens à l’insu de leur plein gré. Le dernier en date étant déceptif au lieu de décevant (formé sur deceptive : trompeur en anglais). Seuls quelques puristes aidés de Québécois résistaient tentant d’imposer courriel au lieu de mail ou, plus difficile, pourriel au lieu de spam. Même sans parler de franglais, Bobos et Popos ne manquaient pas par leur ignorance d’étriller la langue française avec par exemple leur dernier-né ponctuant quasiment toutes les phrases, ce « au final » entendu partout au lieu de : finalement, en dernier ressort, pour finir, à la fin, en dernier lieu ou in fine. Quitte à emprunter de l’anglais, autant le faire du latin, langue nourricière, ce serait plus logique. Utiliser du frantin plutôt que du franglais apporterait plus de cohérence, et en l’occurrence « in fine » serait bien plus pertinent et plus élégant.