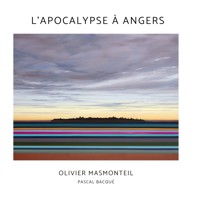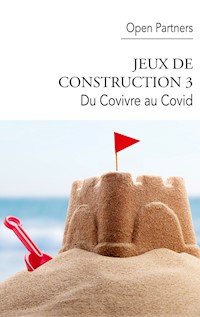
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
"Alors voilà : coutumiers désormais de cet exercice de la prise du recul, de la réflexion gratuite au sein de notre Open Lab (luxe que nous nous autorisons, entre deux réunions de chantier ou de mairie, pour garder autant que possible le contrôle sur notre propre métier), nous voudrions revenir ici, dans ce tout petit livre, sur ces deux évènements majeurs, l'un dû à une puce de plus en plus petite, celle du digital, et l'autre quelque chose d'encore plus petit, un virus - mais, tous deux, comme dans les deux infinis de Blaise Pascal, ayant des conséquences presque infiniment grandes. Si, par ce travail, nous contribuons à donner à notre action, et à celle de nos partenaires ainsi que des politiques qui nous lisent, une plus grande clarté et une plus grande maîtrise de nos enjeux, alors nous aurons gagné notre pari, renouvelé chaque année. C'est à vous, lecteur, qu'appartient la réponse à cette dernière question." L'open Lab d'Open Partners
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Une révolution mondiale ?
I. CO C’EST COOL OU CO C’EST CON ?
1. Petite histoire de l’étroitesse
2. Welcome to the coworking California
3. Le Co en France
4. Avant le déluge, les projets : Co-loscopie !
II. SERONS-NOUS COVIDÉS ?
Avertissement
1. La nouvelle crise du logement
2. Distanciés, ou distancés ?
3. Durable ou éphémère ?
4. L’intouchable humanisme
APPENDICES
Le questionnaire d’Yves Crochet
Le questionnaire de Laurent Strichard
Votre questionnaire
Les enquêtes du Lab
UNE RÉVOLUTION MONDIALE ?
Les mois que nous venons de traverser se sont révélés, pour le monde, comme un véritable coup de tonnerre. Notre Lab, chez Open Partners, a pour tâche de mesurer les changements, les enjeux tactiques et stratégiques pour orienter notre action, dans le monde du bâtir, et dans notre combat pour une meilleure façon d’habiter, et donc de vivre.
Nous avons été gâtés.
Il y eut d’abord, pour commencer, les mois stratégiques d’une révolution annoncée dans l’habitat, en particulier pour certaines populations qui nous occupent tout particulièrement, à savoir les jeunes, étudiants et actifs. Les enjeux de cette révolution (déclinée dans plusieurs noms dont la consonance anglo-saxonne ne doit pas nous cacher trop longtemps les enjeux hexagonaux : co-working, co-living…) sont immenses, et nous sommes non seulement très loin de savoir en quoi elle va vraiment consister, mais aussi de mesurer ses conséquences.
Révolution dans la façon de travailler, révolution dans la façon de vivre, révolution, qui sait, dans la société ou même dans la civilisation ? Civilisation qui, depuis le XIXe siècle, a mis en avant les grandes divisions du monde entre l’économie agricole et l’économie industrielle, organisant les villes en conséquence (car il y a belle lurette que les paysans pratiquent le co-working et le co-living), sur le modèle d’une séparation de la sphère de l’existence privée et de celle de l’existence professionnelle. C’est la bourgeoisie dominante qui a su formuler, avec beaucoup de puissance alors, cette organisation et même cet idéal d’un travail sérieux, productif et épanouissant dans des entreprises qui se localisaient dans des sièges et des bureaux, contrepartie de la demeure privée, grande pour le patron, petite pour l’ouvrier, mais chacun « roi dans son royaume ». Qui n’a pas en tête les chansons de M. Banks dans Mary Poppins, qui « mène une vie aisée » et s’en enchante, peu conscient des tempêtes qui l’attendent, et vont durablement changer son home sweet home ? Car ce sage et modeste employé d’une grande banque de la City est véritablement « le roi », chez lui, appuyé sur les traditions domestiques anglaises comme Victoria (ou Elisabeth) sur les traditions de la couronne ; au monde du travail, un énorme et arrogant bâtiment est dévolu, celui de sa banque, et chez lui, une petite maison aux proportions extérieures modestes, mais qui révèle des espaces spacieux, où chacun est à l’aise avec « dignité » et « civilisation ».
La dimension profondément dichotomique des deux mondes est accentuée par la différence d’attitude de Banks dans un lieu et l’autre ; au siège de la banque, il baisse la tête ; chez lui, il énonce bruyamment ses principes et ses lois domestiques. Par ailleurs, il ne sera jamais question de parler de son travail « avec Mme Banks ». Une fois encore, la frontière entre les deux sphères est bien infranchissable, précisément parce que ce sont plus des sphères que des territoires différents sur une même carte.
Avec la révolution du digital, tout change, parce que les repères se dématérialisent.
D’une part, la doctrine selon laquelle un pôle d’activité économique devait non seulement s’organiser mais aussi se signaler par un lieu propre est mise à mal, pour une raison essentielle : le travail est désormais médié par un instrument universel, qui fut d’abord l’ordinateur, dernier objet avant la dématérialisation ultime, puis enfin un réseau (lequel devient principal, tandis que l’ordinateur y devient auxiliaire ; bien entendu, d’autres perspectives se profilent, avec l’I.A., le cerveau connecté, et la possibilité d’un nouveau totalitarisme, avec la fin de l’existence personnelle. Tout le fantasme de la vieille S.F. semble prendre corps. Mais c’est une autre histoire… pour le moment !)
En attendant, le travail n’est plus vissé à un lieu, quand bien même le distanciel induit aussi le besoin de se réunir plus souvent, ce qui n’est pas le dernier des paradoxes ; il n’est plus question, dans ce qu’on appelait jadis le travail des « cadres de l’entreprise », de noircir le papier des comptes, des plans stratégiques, des contrats au bureau, mais sur son ordi. Ce qui veut dire que, possiblement, il n’est plus nécessaire de les ranger, tous, dans une armoire, et toutes les armoires dans des salles d’archive – pas plus, d’ailleurs, qu’il serait nécessaire que les rédacteurs soient chacun dans leur bureau. L’open space, le vaste « plateau » hérité des salles de rédaction journalistiques, ou encore, si l’on veut être plus corrosif, du tailorisme, mais étendu à toute l’économie, fut un signe fort de cette évolution, mais encore inachevée.
Car on pourrait imaginer que la fin de l’évolution, ce serait tout simplement la disparition du bureau tel qu’on l’avait connu, depuis la révolution industrielle.
C’est dans ce cadre que le co-working et le co-living ont contribué à accélérer ces mutations, non sans brouiller d’ailleurs quelques repères ancestraux.
Car si l’on travaille dans la même pièce sans appartenir nécessairement à la même société, c’est que la réunion dans un lieu a moins de sens qu’avant ; ou bien, ce qui n’est pas nécessairement contradictoire, que c’est la façon de faire – travailler, chercher, sur son ordinateur, en réseau – qui compte plus que le groupe ou la société pour qui on le fait – si c’est bien pour une société qu’on travaille.
Mais si au fond on travaille pour soi, comment créer le lien social, comment “networker” en “distanciel”, ce nouveau mot à la mode ? Comment remplacer l’idée qui vient du hasard de la rencontre, comment permettre la fin d’un malentendu qui vient du courage de la rencontre, ou de son hasard dans les couloirs de la société ?
En ce qui concerne les sociétés, la question des start-up, à savoir des sociétés naissantes (ce sujet nous occupe tout particulièrement, puisque nous développons, dans cette perspective, des résidences pépinières), appuyées essentiellement sur une idée, et donc sur un projet à venir (et donc surtout sur des entrepreneurs tenaces, ces aventuriers d’aujourd’hui, qui risquent souvent tout à chaque nouveau projet) a pendant de nombreuses années joué un rôle de pionnier, incitant les entreprises qui n’en étaient pas à adopter une part de leur culture1. Il en est résulté ces vastes espaces qui se sont voulus, autant que possible, plaisants, d’autant plus que leur destination devenait moins univoque, moins monolithique. Par ailleurs, l’origine californienne de ce modèle, et donc la culture d’entreprise contemporaine américaine a largement énoncé les canons de ce mode d’organisation, si possible « jeune », toute proche des espaces dits outre-Atlantique « d’entertainment » – le fameux baby-foot, ou parfois, chez les meilleurs d’entre eux, les lits à sieste, transformant tout soudain l’espace austère de l’entreprise en joyeux bordel post-estudiantin.
Et c’est justement là qu’insensiblement, on en est venu à prolonger cette expérience du co-working, où les barrières et les codes de l’entreprise ancienne avaient été ébréchés, en co-living, c’est-à-dire, en conséquence du progrès galopant du digital, dans une abolition de la frontière privé-public.
Car tout commence, dans le co-living, par l’économie.
L’espace de co-working devient si fun, si détendu qu’il ressemble à un « chez soi » (trop, d’ailleurs ? Est-ce pour cela que de nouvelles dénominations ont fleuri, comme le concept de « pro-working ? ») Alors, tout naturellement, mon « chez moi » peut devenir un espace de co-working. Et une fois admis le fait qu’après tout, un lieu n’est plus soit celui du travail, soit celui de la vie privée, on peut décider de vivre dans un espace privé avec de quasi-inconnus – avec, en tous cas, des gens qui échappent à ma sphère. C’est ainsi qu’année après année, s’est accomplie la lente mutation dont nous sommes les témoins tantôt admiratifs, tantôt inquiets. Nous, professionnels de l’immobilier, qui avons autant pour tâche d’accompagner les évolutions de l’habitat, que de proposer des projets qui contribuent à l’améliorer.
Pourtant, derrière ce dessin à gros traits, une réalité bien plus complexe se cachait. D’abord, tous les espaces de co-working ne marchaient pas. Certains grands noms, pionniers majeurs réputés indéboulonnables, mettaient la clé sous la porte. Et les plus grands fonds d’investissements ont failli y laisser leur peau en déversant les fonds qui leurs ont été confiés sur les modèles qui ne rencontraient pas encore leur public… Dans le domaine des résidences junior, qui sont notre spécialité, certaines résistances se faisaient jour, aussi bien du côté des états que des élus.
Pour bien mesurer cette complexité qui devait orienter notre travail présent et futur, nous avons décidé, chez Open Partners, de réaliser quelques grands travaux d’enquête dans les populations que nous visions.
Surtout : est-ce que finalement le co-living, compte tenu aussi de la pression énorme que représente le coût du logement dans un budget d’étudiant ou de jeune actif, était, comme jadis en URSS ou comme aujourd’hui à Londres ou New York (où tout le monde a son roommate), allait être une révolution inévitable ? Et si oui, une révolution souhaitable, désirable, plaisante ? A quelles conditions ? En offrant quelles garanties à ceux que leur bourse et peut-être leur projet destinaient à ce nouvel « art d’habiter » ?
Qu’est-ce que la révolution du Co révélait en fait ? Un besoin expérientiel ? Les moments partagés, les moments de socialisation, hier réputés accessoires, devenus désormais essentiels ? Même du côté des grandes écoles, on se sensibilisait à ces nouvelles questions…
C’est alors que survint le Covid.
Il est beaucoup trop tôt pour se faire une idée claire des effets de cette tragique pandémie non seulement sur l’économie, mais encore sur le monde et sur l’organisation de la société. Mais une chose est sûre : dans l’irrésistible ascension du co-loving et du co-working, l’obligation des distanciations sociales ou non, des précautions, et l’expérience stupéfiante du confinement de la moitié du globe ont soudain redistribué les cartes – avec, pour la première fois depuis la Renaissance, une Asie qui s’impose face à un Occident en crise fondamentale. Leurre, brève parenthèse, ou nouvelles règles du jeu ? Il est trop tôt pour le savoir, même si les enquêtes que nous avons diligentées, chez Open Partners, nous donnent déjà d’intéressantes indications.