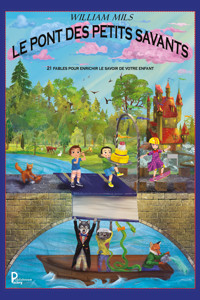Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jour nucléaire
- Sprache: Französisch
« Je ne sais pas comment on fera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais comment on fera la quatrième : avec des bâtons et des pierres. »
Albert Einstein
Comme le tritium, l’homme brillera-t-il un jour dans l’obscurité de la nuit ?
Le vitrage à côté de moi renvoie mon image, et il semblerait que je sois... un ange.
Les ingénieurs se trouvant sur le port de Pula s’aperçurent d’une défaillance du système de guidage.
À bien y regarder, je pencherais plutôt pour un faucon, non, un aigle royal, ils sont si majestueux !
Moi aussi je t’aime Eduardo, mon idiot de mari !
Avant de quitter pour de bon les terres du paradis, il dit simplement cela :
– Ami de la liberté, je reviendrai.
Il faut dire que construire le Crystal palace sur Hyde Park, c’est une idée des plus osées !
Quand le génie des habitants de la Terre croise le pire monstre qui sommeille en eux, quelle création cela nous donnera-t-il ?
C’est ce que je vous invite à découvrir tout au long de ces fables toujours plus haletantes et originales qui vous feront voyager au fur et à mesure de votre odyssée vers une réflexion qui, je n’en doute pas, sera acharnée, sur la réalité d’un passé inquiétant, sur un futur qui ne semble plus vraiment acquis à notre cause.
Plongez-vous encore et encore dans chacune d’elles, cela pourrait un jour vous sauver la vie !
Nous ne sommes acteurs que de notre existence, du temps de notre époque, et il serait bien qu’un jour nos descendants puissent se poser les bonnes questions, enfin si notre arrogance animale leur permet de découvrir les bonheurs et désagréments de la vie sur une planète si belle lorsque nous voulons bien la laisser en paix.
J’espère que vous en apprécierez la lecture, là, bien au chaud dans votre lit, là, bien au fond de votre fauteuil ou là, sur le transat de votre belle terrasse, car on ne sait jamais qui le destin laissera siéger en compagnie des scorpions, blattes et oursons d’eau...
William Mils
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lucie
Toi, le vent divin qui souffle sur ma flamme.
Toi, l’héroïne de mon encre.
À jamais je te dis... merci!
WILLIAM MILS
JOUR NUCLEAIRE
Jeu de grands
–Ah, non, Général Powel ! Je refuse catégoriquement de vous le céder pour un prix aussi bas !
–Voyons, Colonel Imovich ! Au contraire, ce paiement me semble tout à fait juste, voire généreux.
–Votre demande est une insulte directe à notre grand dirigeant : Vladimor Pouline !
–Allons, allons, comme vous y allez, mon cher Colonel ! Vous, les Russes, vous ne pouvez jamais faire la part des choses, toujours à être poursuivis par le poids infernal de votre rouge passé.
–Vous pouvez bien parler, Général. Votre pays n’est qu’un ramassis d’esclaves, prisonniers, vagabonds et meurtriers. Pas étonnant que votre nation sombre encore et encore dans la violence !
–Trêve de discours, Imovich. Me donnez-vous la place Rouge ?
–La place Rouge contre la route 66, je ne répondrai même pas à cela, tant la différence de prestige est grande.
–Que voulez-vous en échange ?
–La statue de la Liberté ! Échangeons un fleuron de notre pays contre l’un des vôtres. C’est bon pour vous ?
–Ahaha ! Mais êtes-vous donc tous fous dans votre pays ? Vous pensez vraiment que le peuple américain, dans sa grandeur insolente, ferait un échange aussi inégal ? Pas aujourd’hui, Colonel, pas aujourd’hui.
Vous l’aurez voulu, je relance et je récupère au passage le mont Rushmore.
–Je ne savais pas que les vieilles pierres vous plaisaient tant, Colonel Imovich. Cela ne me dérange guère de voir partir ces têtes que je n’ai jamais vraiment aimées.
–Powel, sous vos airs détachés, je vois bien que cette perte vous irrite au plus haut point. Ces pierres, comme vous le dites si bien, sont l’essence de votre maigre passé, une relique que votre électorat ne vous pardonnera pas d’avoir perdue.
–L’électorat ? Il ira là où je lui dicterai d’aller, un point c’esttout.
–Général, vous devriez faire attention. Vos paroles ressemblent de plus en plus aux nôtres. Un changement de camp vous plairait-il ?
–Ne doutez jamais de la force écrasante de notre démocratie, Imovich. Vous risqueriez de perdre la partie sans vous en rendre compte.
D’ailleurs votre avancée n’est pas la bienvenue. Je vous prends votre gisement de gaz, ainsi que votre porte d’or, cela calmera peut-être votre arrogance naturelle.
–Vous, les États-Unis, ressentez le besoin de contrôler les autres peuples, de leur dicter votre façon de faire, de vivre. Mais que cela est grotesque ! Regardez bien devant vous, mon ami, voyez notre noble grandeur et apprenez de nous, sinon…
–Sinon quoi, Colonel ?
–Sinon vous ne verrez peut-être plus le soleil se lever.
–Je dois bien l’avouer, les Russes savent à merveille utiliser les canaux de la diplomatie !
–Je veux le Capitole, où je marcherai sur Hawaï.
–Encore et toujours des menaces, cela ne rime à rien de gonfler les muscles. Je suis l’Amérique et vous, vous devriez savoir que la température n’est pas clémente pour un Russe natif de Sibérie.
–Pendant que vous paradiez inutilement, Général, j’ai racheté Boeing et Pepsico. C’est à vous.
–À qui croyez-vous faire peur, Colonel Imovich ? Pas à moi, en tout cas. Vous avez récupéré Pepsi, il me reste Coca-Cola et Boeing ? Sachez qu’un avion ne sert à rien s’il tombe…
–On m’a demandé de rester courtois, Américain de mes deux ! Tout général que vous êtes, tout acte hostile envers notre nouvelle flotte sera vu comme un acte de guerre.
–Voilà des mots fort désobligeants, surtout dans la bouche d’un colonel de la soi-disant grande armée de Russie.
–Voici pour vous, pour vous apprendre à vous tenir.
–Soyez maudit, Powel. Ce coup est à la limite du règlement !
–Oui, tout à fait. À la limite, mais c’est tout.
–Ne vous faites pas prier, Imovich. Cédez-moi vos parts de chez Gazprom, Sistema et Kamaz, vous verrez bien comment nous transformons des entreprises à la dérive en joyaux boursiers.
–Général, je veux Intel et Amazon… Immédiatement.
–Impossible et je vous contre par une entrée en force dans le capital de Rosoboronexport, ça vous apprendra à trop tarder.
–Vous pouvez bien rentrer en force là où vous le voulez, mais une chose est certaine, vous n’en ressortirez pas sans dommage.
–Vous perdez du terrain, Colonel, je ne donne pas cher de votre peau de militaire si vous revenez bredouille dans votre mère patrie.
–Au pire, venez chez moi, j’ai besoin d’un jardinier.
–Ah ! La chance tourne en ma faveur comme vous pouvez le voir, je choisis donc Chevron et Facebook.
–Mais quel mauvais choix tactique ! Le pétrole, vous en avez déjà et largement en plus, sans parler de cette épine de Facebook que vous venez de vous infliger.
–Comment cela ?
–Vous, les tordus de la répression de toutes les libertés, dites-moi comment vous allez faire pour museler un groupe qui ne vit que pour le bavardage ?
–Comme d’habitude, Général. Comme d’habitude.
–Je me disais aussi, rien ne change vraiment chezvous.
–Si, Walt Disney ! Vous serez bientôt fort surpris de voir défiler votre souris sous les dignes couleurs de notre sainte patrie.
–N’avons-nous pas les mêmes couleurs ?
–Nos couleurs sont la bravoure et la gloire éternelle à la mémoire de notre peuple, rien à voir avec votre drapeau couvert des étoiles d’Hollywood.
–Ne soyez pas médisant, Colonel. Vous imaginez bien que nous connaissons l’existence de votre compte Neflix !
–Laissez mes hobbies en dehors de cela, cela ne rime à rien, c’est entre vous et moi que ça se passe.
–Fort bien. De plus je viens de recevoir un appel m’indiquant que vos mines de cuivre et de tungstène battaient dorénavant pavillon américain !
–N’importe quoi, aucun drapeau américain ne sera toléré à l’intérieur de notre grande Russie, plutôt mourir que de voir cela un jour.
–Et l’ambassade, Colonel ? N’en a-t-elle pas un magnifique, flottant librement sur ce territoire qui sera certainement un jour à nous ?
–Même pour les généraux, les rêves se font la nuit. Oui, même pour vous, Powel !
–Nous ne sommes pas une nation de rêveurs, nous sommes une nation de créateurs, de savoir et de liberté.
–Je prends donc la liberté de capturer le Golden Gate Bridge, Intel et Amazon. Comme c’était libre, vous comprenez…
–Je suis las de parler avec le représentant d’un pays dont le PIB est plus faible qu’un pays comme l’Allemagne ou le Brésil ! Donnez-moi ce que je vous demande et rentrez chez vous faire dresseur d’ours, comme le fait si bien votre président.
–Et la Tsar Bomba, Général ? La Tsar Bomba de mon président, vous savez ce qu’elle vous dit ? Alors restez dans votre blanche maison qui vous sied si bien : la niche du chien.
–Ah, ça y est ! Voilà enfin la menace de la force atomique. Je vous félicite, Colonel, d’avoir tenu si longtemps avant de me la proposer.
–Je ne rigole plus, Général Powel, rendez-nous nos propriétés ou soyez à jamais le témoin de la destruction de l’Amérique.
–Vos vieilles bombes crasseuses et rouillées ne toucheront jamais nos plaines ni nos lacs, c’est une promesse devant Dieu, Colonel.
–Vous passerez donc un bonjour de ma part à votre Dieu fantoche. Un peuple qui croit en n’importe quoi est un peuple d’idiots.
–Un peuple qui croit en Staline est un peuple de quoi ? À votre avis, Général ?
–Un peuple incroyable.
–Non, un peuple de consanguins.
–Eh bien, voyons ce qu’il restera de votre peuple de fanatiques de la gâchette dans cinq, quatre, trois, deux, un… Envoi de la bombe n° 1 sur le Texas !
–Attendez, attendez et… Je vous contre avec le déploiement de notre bouclier antimissile et je prends le lac Baïkal, cela devrait vous apprendre la politesse.
–Envoi des bombes n° 2 et 3 sur l’Indiana et la Géorgie. La force, il n’y a que ça de vrai contre des traîtres à la patrie tels quevous.
–Je commence à ne plus vraiment m’amuser, Colonel Imovich. Jouons donc avec vos stupides règles et voyons qui de nous deux a le titre de nation suprême.
–Soit, Général.
–Je prends le musée de l’Ermitage en compensation, puis je vous fais cadeau de quatre beaux missiles « made in America » directement dans votre face de Russkof ! Et je déclenche encore une fois le bouclier par sûreté.
–Trop tard pour l’Indiana, plus que trente secondes et votre État deviendra une boule de feu. Parfait pour vos grillades du dimanche !
–Dieu, sauve-nous !
–Dieu, sauve-nous, Dieu, sauve-nous… Vous n’avez que ça à la bouche, mon cher Général. Un peu de fierté, voyons !
–Hop ! Bye bye l’Indiana, et je relance un coup, manière d’envoyer le Nevada, la Californie, l’Utah et l’Arizona le rejoindre en direction de Jésus-Christ.
–N’oubliez pas ce que nous avons en Europe, très très proche de vous.
–Quoi, comme vos quatre pauvres petits missiles ? Attendez voir… Ils sont tombés en… Sibérie, bravo, vous avez fait peur aux ours !
–Et là alors, cela vous convient, Colonel ?
–Vous n’oseriez tout de même pas ?
–Déclenchement du système d’attaque européen !
Et ça nous fait, eh bien, pas moins de quatre-vingts jolies têtes qui viennent embrasser, non pas les ours, mais Lénine en personne.
–J’engage le bouclier de protection moscovite. Il est comme notre nation, infranchissable.
–Dites ça au quartier Kitaï-gorod qui vient de se faire vaporiser !
–La guerre totale, c’est donc là votre souhait ? Eh bien voici que votre vœu est exaucé.
Envoi des missiles « RS-28 Sarmat », un pour chaque état encore debout, Satan vous saluera bientôt !
–Cela ne servira à rien, Colonel, c’en est fini de vous. Plus assez de cartes dans votre jeu, plus assez de missiles, de bombes.
–Attendez, attendez, attendez et… C’est vrai, j’ai perdu !
–Bon, Ludovic, on est à huit parties gagnées pour moi et sept pour toi. On en refait une ?
–Non, ça va, j’en ai assez de ce jeu-là, d’autant plus que tu finis toujours par vouloir tout détruire, c’est énervant.
–Et tu fais quoi, toi, Alex ?
–Je me défends, c’est tout.
–Mouais, eh bien jouons alors à prendre les richesses de l’Afrique. C’est l’opus n° 2 que je viens de me payer. Tu verras, les graphismes sont tout bonnement époustouflants.
–Ça me va, d’autant plus que j’avais adoré les scènes de répressions du peuple dans le n° 1.
–Tiens, maman amène le goûter. Mangeons un bout avant de tout conquérir !
–Bonne idée et après ça je deviendrai, à 12 ans, le premier empereur de l’Afrique…
Fin
L’ange de la trinitén° 82
–Oh, quelle belle sieste je viens de faire ! Merveilleux.
–Vrouuuum ! Crac-crac-crac !
–Mais d’où vient ce bruit assourdissant ? Et puis où suis-je ?
Allez, Brian, va me chercher ce palan. Il va être l’heure de charger.
–Eh ! Vous, venez me voir. Dans quel endroit sommes-nous ?
–Quelle impolitesse ! Le gars passe devant moi, comme ça, sans même me regarder. C’est moche.
–Brian, dès que tu as fini de la fixer, retrouve-moi dans la salle de réunion, nous avons un briefing avec le colonel Paul Tibbets.
–Et voilà que le malotru remet ça ! Si tu continues, mon p’tit gars, je vais en référer à tes supérieurs. Tu vas avoir chaud aux fesses, c’est moi qui te le dis.
–Ahhh ! Mais fais attention, veux-tu ? À force de me balloter de droite à gauche, je vais vraiment finir pas tomber à terre.
–Louis, Milton, venez m’aider. Ce truc pèse littéralement le poids d’un éléphant.
–C’est ma pause. Prends plutôt Cameron, il aime soulever de la fonte les week-ends, cela devrait lui convenir.
–D’accord, mais ne traîne pas trop, je risque d’avoir besoin de bras en plus.
–OK, OK !
–Bon, je comprends un peu mieux la situation. Le vitrage à côté de moi renvoie mon image et il semblerait que je sois un… ange. Comment je le sais ? Eh bien je le sais, c’est tout. Et puis vous en connaissez beaucoup des personnes avec des ailes blanches dans le dos ?
Je me regarde sous toute les coutures et apparemment je serais une espèce de porte-clefs, possiblement en bois, avec un anneau d’attache en métal à l’une de mes extrémités. Charmant comme résurrection… L’anneau est attaché à une goupille métallique, lui-même se tenant sur un engin de forme aérodynamique.
–Monsieur, Monsieur ? Milton, c’est ça ? Venez, s’il vous plaît !
Toujours pas de réponse. Eh bien c’est compris, les anges tels que moi ne semblent pas pouvoir communiquer avec de simples mortels. Ça va être amusant…
Je ne me rappelle plus ma vie avant mon réveil. La seule chose dont je suis sûr, c’est que, par le passé, de mon vivant, j’étais bien un être humain, un homme. Comment un ange de bois le saurait ? Question des plus simples. Je réfléchis, je m’interroge, je me questionne, je cherche la discussion avec les autres humains et non avec un cafard ou le Beagle couché au fond du hangar. Malgré cette affirmation, je ne ressens aucun regret d’être pendu là, sans autre pouvoir que de contempler les humains s’affairer à des tâches toujours plus ardues. Ah, j’entends le bruit des rangers qui frappent le sol. Enfin ils reviennent, je commençais à m’ennuyer. Le palan qui maintenait mon habitat en l’air vint le déposer sur un charriot de métal solide sur ordre du capitaine William S. Parsons. Les hommes se mettent autour de moi, ils attendent quelque chose, mais je ne sais pas encore ce que c’est. Ah ! Eh bien bravo, Milton. Espèce d’imbécile, je vais te maudire dix fois. Il fallait bien que ça arrive, le gars s’est permis de me toucher avec ses doigts crasseux, sans se préoccuper un seul instant de mon bien-être. Mais cela n’est pas le pire, l’effronté me repose sur la carcasse de métal, la tête face à l’acier. Merci pour la vue… Je ne peux plus voir ce qu’il se passe, mais je reconnais le bruit d’un camion se dirigeant vers nous. Le son se rapproche de plus en plus, l’odeur d’essence aussi. J’ai l’impression que les soldats veulent m’attacher à l’arrière, je sens le chariot se balancer légèrement de droite à gauche. Eh ! Un gars vient de me percuter violemment, cela me contrarie de ne pas pouvoir lui rendre la pareille, mais je lui pardonne, car dans sa maladresse, son impact m’a permis de me retrouver dans une position plus favorable.
Effectivement, nous étions dorénavant accrochés à un GMC CCKW 352, en partance pour une destination inconnue. Les hommes sont tous montés dans la caisse en bois à l’arrière de la cabine de pilotage.
Ceux-ci rigolent bruyamment, sortant des blagues de mauvais goût plus vite qu’une mitrailleuse Tompson ne peut tirer en rafale.
Le véhicule s’arrête à une centaine de mètres de notre point de départ et je me retrouve nez à nez avec un gigantesque avion B-29 Superfortress. Me voici donc devant l’un des plus gros bombardiers de sa génération, brillant de mille feux, les ailes majestueuses, mais pas aussi belles que les miennes.
Louis, Milton, Cameron et d’autres types s’affairent consciencieusement à charger l’engin dans la soute de l’avion.
Pour moi, c’est une première, un peu comme une visite guidée. J’écoute ceux qui travaillent, apprenant par la même occasion le jargon aéronautique.
C’est ainsi que je j’apprends que le 21 juillet 1945 un ordre venant de très haut, du président Harry S. Truman lui-même, a lancé l’opération. J’entends parler du projet Manhattan, de sa concrétisation finale et cela ne me dit rien qui vaille.
Mon fidèle destrier se nomme « Little boy ». Drôle de nom pour celui qui doit apporter la paix dans le pays qu’ils nomment « Japon ». Le vent au-dehors me fait virevolter sans peine. Impossible de lui résister, forcément, je ne suis qu’un petit ange de bois.
En me déplaçant au gré des bourrasques, je m’aperçois alors qu’une inscription se trouve sous le cockpit de l’avion.
Je bouge tellement qu’il m’est difficile de déchiffrer les lettres peintes en noir sur la carlingue.
Le vent tout à coup s’apaise, me laissant le temps d’y voir plus clair. « Enola Gay », voici ce qui se trouve là-bas, mais je ne sais pas ce que cela signifie. Sûrement un nom de code. Mon avion appartiendrait au 509e escadron de bombardement et serait issu d’une série spéciale, fortement modifiée, avec réunion des deux soutes de largage.
–En faisant cela, embarquer avec aisance ne fut pas un problème pour mon acolyte Little boy et moi.
–L’identification est-elle toujours celle de remplacement ?
–Oui, mon Colonel. Il porte toujours le chiffre 82 et son marquage de queue est bien le « R » appartenant au 6e escadron de bombardement. Chacun des hommes présents prend son courage à deux mains, hissant le plus justement possible la pièce de métal.
–Sa forme ressemble à une canette de soda… non, une capsule… non, un médicament ! C’est ça, une gélule. Nous allons soigner la population japonaise avec cela ?
Après diverses vérifications, la soute se ferme, les gars retournent au hangar, me laissant seul à l’intérieur.
Dorénavant il n’y a que les cris du vent sur la carcasse qui me tiennent compagnie, sans oublier les aller-retour incessants des gardes autour du zingue.
Je regrette un peu de ne pouvoir dormir. La nuit est tombée, seuls les relais des soldats bercent mon existence de bois. Je m’ennuie ferme.
Des camions se rapprochent de l’appareil, il se passe quelque chose, pourtant il n’est pas 1 h du matin.
De grands projecteurs sont alors allumés autour de la carlingue, me permettant d’y voir comme en plein jour. La porte de l’avion s’ouvre et j’y vois entrer les douze hommes formant l’équipage.
Je reconnais le colonel Tibbets, pilote en chef de l’Enola gay, le capitaine William S. Parsons, ainsi que le major Thomas Ferebee.
– Au-dehors, il y a plus de monde qu’à l’accoutumée. Les flashs des appareils photo illuminent le cockpit brutalement, le rendant à l’ombre aussi rapidement qu’ils l’en avaient arraché.
–Il est 2 h 40, les gars. Il est temps pour nous de rentrer dans l’Histoire. Préparez-vous au décollage, nous partons voler.
Il y eut un cri d’encouragement ou de satisfaction, je ne sais pas vraiment, mais l’atmosphère devint tout à coup moins pesante.
Les moteurs tournaient à plein régime, Tibbets fit un signe en direction de l’extérieur, afin que tous s’écartent un peu plus, puis les salua de la main.
C’est parti ! Les moteurs Wright hurlent leur fureur dans un déluge de chevaux qui propulse l’aéronef en avant.
La piste, elle aussi, est éclairée par des projecteurs, de sorte que personne ne rate son décollage dantesque.
L’avion prend de l’angle, puis s’élève dans le ciel, mettant le cap vers la ville d’Hiroshima, laissant l’île de Tinian s’enfoncer dans la noirceur de la nuit.
À la suite, deux autres B-29 le suivent de près, celui du major Charles Sweeney, nommé « The great artist », dont le travail fut celui de la prise de mesure, mais aussi celui du capitaine Georges Marquardt, qui n’a, quant à lui, aucun nom, mais dont le devoir est de capturer les instants fatidiques de ce qui va se passer sur les terres nippones.
Au total, six avions de type B-29, participent à cette mission, qui rentrera dans les annales de l’humanité.
Paul Tibbets, le commandant de bord, place son B-29 à une altitude d’environ trente-deux mille pieds, suffisamment loin pour ne pas trop attirer l’attention de la défense japonaise.
Le vol se passe sans problème, mais plus nous approchons de notre objectif, plus les hommes ont la mâchoire crispée.
Le capitaine William Sterling Parsons se place près de moi, trifouillant un moment l’objet. Il signale à tous son bon travail en disant :
–Armement OK !
Je n’ai pu voir la manipulation qu’il a effectuée, mais j’imagine que celle-ci lui était réservée, en tant que chef de la mission.
–Eh ! Sous-Lieutenant Jeppson, nous sommes à trente minutes de notre objectif, c’est à vous.
–Bien pris, mon Colonel. Je m’en charge, j’espère que votre mère nous portera chance !
–C’est bien dans cette optique que son nom a été peint sur l’avion !
Je vois donc le sous-lieutenant Morris Richard Jeppson retirer trois bouchons d’armement de couleur verte, pour les remplacer par trois autres de couleur rouge.
Le capitaine Parsons et le sous-lieutenant Jeppson rendent compte à tout l’équipage de la bonne mise en œuvre de Little boy L11.
À un moment donné, j’aperçois l’avion du capitaine Georges Marquardt à travers le cockpit.
–Celui-ci s’approcha des nuages et, pendant un instant, l’ombre qu’il projeta dessus se met à ressembler à l’entité du Mal, il sera nécessaire que l’on me contrôle la vue, je pense.
–Nous y sommes ! crie le colonel Tibbets.
Je vais enfin savoir ce que nous faisons réellement ici.
–Major Ferebee, c’est à vous. Prenez le pont Aioi pour cible et, dès que vous êtes prêt, vous avez l’ordre de faire votre devoir.
–Bien reçu, mon Colonel !
Il se met à régler son viseur Norden puis déclenche l’ouverture de la soute du B-29 avec assurance.
8 h 15, la libération de Little boy est rapide. Son nez pointant désormais vers le bas, je peux, pour la première fois de ma nouvelle vie, découvrir la ville d’Hiroshima au Japon.
En un rien de temps nous prenons une vitesse folle sans jamais changer de cap, droit devant.
J’aperçois un court instant dans le ciel les B-29 qui s’éloignaient de moi à toute vitesse.
–Messieurs, votre travail est terminé. Bon vent.
La ville se rapproche à bon train, me permettant d’apercevoir de plus en plus de détails.
Celle-ci semble bâtie en grande majorité de constructions légères en bois, dont les rues et ruelles ne semblent pas très larges.
–Je le vois, il y a de la vie en bas, des hommes travaillant ici et là, des femmes revenant des courses, des enfants rentrant de l’école.
D’un côté de la route je distingue une dispute, le conducteur d’une voiture aurait touché la devanture d’un magasin de tissu et le patron a bien l’intention de demander réparation.
Un peu plus loin, une dizaine d’enfants s’amusent à plier du papier en forme de grue, il me semble que cela s’appelle « origami ».
Deux rues plus loin, une vieille femme a laissé tomber son panier à terre, les quelques pommes de terre qu’il contenait dévalent la pente sans pouvoir s’arrêter.
Grâce à la détermination d’un petit groupe de soldats qui passe par là, la petite mamie retrouve son bien, puis les remercie chaleureusement pour cette aide inespérée.
De l’autre côté, vers le pont en T, des bateaux rentrent de leur pêche quotidienne, laissant le reste du travail à ceux à terre, afin qu’ils puissent vendre du poisson bien frais.
Un bâtiment semble sortir de l’ordinaire, car construit en dur, avec des briques, du métal et du ciment. La bâtisse contraste fortement avec le reste des petites constructions, toutes de bois faites.
Il est aussi beaucoup plus imposant, sans parler de sa hauteur, lui permettant de toiser aisément la ville.
Celui-ci se termine par une coupole en acier, semble-t-il recouverte de cuivre du plus bel effet.
Notre chute continue, mais le pont d’Aioi que le major avait ciblé semble s’éloigner de plus en plus, suffisamment en fait pour que notre destination devienne l’hôpital de Shima.
Il ne reste que six cents mètres à notre duo pour arriver jusqu’au sol et, j’en suis certain maintenant, cet objet de métal a la forme d’une gélule. Forcément, c’est pour venir en aide au peuple japonais ! Normal que notre point d’arrivée soit l’hôpital, oui, car aider les gens, c’est bien ce que font les anges… Non ?
Le journal de Miss Marpule
À mon cher journal :
Jour 1 :
Ça y est, j’ai enfin obtenu mon premier véritable rôle.
Moi, Éléanor Marpule, 22 ans, fille de Mike Bradlow et Jessica Marpule, ai réussi l’impossible : obtenir une place dans le prochain film de Hughes Brickan.
Après une bonne trentaine de tentatives, puis de refus, enfin quelqu’un me donne la chance de prouver ce que je vaux vraiment. Je n’étais pas sûre de mon choix de carrière avant l’entrée au Nottingham collège, mais il faut dire qu’il n’y a rien de plus beau pour moi que d’avoir choisi cette voie.
Jour 2 :
C’est le grand jour, car cet après-midi, c’est la rencontre avec toute l’équipe du tournage, dont le staff suppléant et toute la troupe qui va animer cette magnifique expérience.
Qui aurait pu penser que mon premier film serait un long métrage ? Direct dans la cour des grands !
Après des départs chaotiques où l’on m’a bien fait comprendre que les castings, c’était la jungle, il fut incroyable d’y être acceptée en passant devant toutes ces filles, prêtes à tout.
Ce qu’elles ne savaient pas, ces chères dames, c’est qu’il y avait une partie de chant non précisée dans l’offre du casting. Nous, les femmes, nous avons une panoplie de produits et autres gadgets permettant de passer de « passable » à « trop bonne », mais quand il s’agit de chanter, rien n’existe encore pour passer du chant du canard à celui de la Castafiore.
Avec ma jolie voix, je les ai balayés ces pots de peinture humains. Bien fait pour elles ! N’ont qu’à tenter une carrière dans le X.
Jour 3 :
Je suis nerveuse, terriblement nerveuse.
Le texte à apprendre est difficile, basé sur une façon de parler datant de 1943. Je n’aurais pas pu choisir plus compliqué comme premier rôle qu’un film basé sur la Seconde Guerre mondiale, plus précisément une fiction où les nazis auraient débarqué sur nos terres anglaises.
Le réalisateur m’a attribué le second rôle féminin aux répliques somme toute modestes, mais avec quatre phases de chants et autant de chansons à mémoriser.
Je n’ai que deux semaines pour les retenir avant le début du tournage. Va falloir que je me donner un sacré coup de pied aux fesses !
Jour 4 :
Les scènes s’enchaînent bien, les autres acteurs sont dans le circuit depuis plus longtemps que moi et cela se ressent dans leur jeu. Mira Lide, la star de ce film, malgré une froideur naturellement assumée, s’est tuée à la tâche, embrassant totalement le rôle de Sophia von Mark, richissime marchande d’art allemande poursuivie par les sbires d’Hitler.
J’ai, pour la première fois, chanté devant la caméra. Ce n’était pas si difficile que ça, pas de pression, mais il m’a fallu refaire la scène une bonne douzaine de fois avant que cela ne soit parfait.
Jour 5 :
Ma prochaine scène de chant se passera dans les galeries de Nottingham. D’après mes recherches celles-ci furent creusées par les Saxons, puis continuées tout au long des siècles, servant de cachots, caves à bière, tanneries ou abris antiaériens. C’est bien dans ce but que le réalisateur a choisi de nous y faire tourner. L’endroit risque d’être difficile à apprivoiser, l’acoustique doit y être vraiment spécial. Je ne m’en fais pas trop, j’ai déjà chanté dans des églises ou dans des clubs. Ce défi, je le surmonterai, comme tous les autres d’ailleurs.
Jour 6 :
Mauvaise journée pour tout le monde.
La pluie s’est invitée pour nos prises en extérieur, chamboulant le planning établi par un réalisateur moribond. Il décide de le mettre en pause, préférant filmer mon interprétation troglodyte à la place, par gain de temps et d’argent.
Je ne vais pas me le cacher, le son est désastreux.
Les rebonds de ma voix contre les parois résonnent trop, perturbant les enregistreurs. L’ingénieur son en chef stoppe cette mascarade, ordonnant au staff de lui laisser quelques jours pour corriger le flux sonore.
Un retard de plus qui, même s’il ne me met pas en cause directement, dégrade mon moral de chanteuse.
Jour 7 :
L’ingénieur propose une solution inédite, celle de me faire dormir dans la salle de tournage, avec un staff réduit, pour que mon oreille interne s’habitue à cette acoustique difficilement gérable. Le réalisateur accepte, pourvu qu’il n’ait pas besoin d’y rester lui aussi.
Je ne suis pas enchantée par cette proposition. Passer une nuit entière dans cet endroit spartiate ne m’excite guère. En y réfléchissant sous la douche, je me pose la question du bienfondé. J’espère ne pas m’enrhumer dans ce lieu humide et puis après tout, je m’en fous, l’ingénieur prendra ses responsabilités si je suis atteinte d’une pneumonie.
Jour 8 :
J’ai amené dans la galerie de quoi tenir un siège.
Je devrais pouvoir me détendre sans problème avec l’achat judicieux de chips goût poulet, bonbons en tout genre et boisson gazeuse.
Je ne tourne que le matin. Pour le reste de la journée le réalisateur me demande de fredonner mes chansons à l’intérieur, afin de m’approprier l’espace.
Je remonte à l’air libre de temps en temps pour voir l’avancée des scènes du jour, un peu jalouse de les entendre s’amuser sous un soleil plus clément qu’à son habitude. Je commence à apprivoiser la signature de ma voix, réglant les graves comme les aigus de manière à retrouver une justesse plus audible et agréable.
Une microrépétition en fin de journée donne raison à l’ingénieur.
Mon chant s’est transfiguré de la plus belle des façons. Il me félicite, j’en suis heureuse, mais il n’annule pas pour autant ma sortie camping.
Le réalisateur a demandé si des volontaires seraient enclins à me rejoindre pour cette nuit et quatre personnes ont levé la main pour tenter cette expérience hors norme.
Tous les frais de la nuit seront pris en charge par la réalisation, les heures étant aussi considérées comme jour travaillé. Un vigile sera présent à l’entrée de la grotte afin d’y assurer notre sécurité. Il n’impose qu’une seule condition : aucune fête ne devra être organisée, ni aucune action néfaste pouvant dégrader ma voix, ce qui semble tout à fait compréhensible.
Nuit 8.5 :
Des lits de camp militaires nous attendent déjà dans le fond de la pièce. J’ai avec moi : Lucy, la scénariste en second, Maria, la maquilleuse, Brad, le machiniste et Lidia, l’une des figurantes. À l’intérieur la température à peine fraîche ne gêne personne. Je n’aurai finalement pas besoin de mes trois plaids en polaire, mon sac de couchage fera très bien l’affaire. La production a loué un Airbnb à moins de cent mètres de là, afin que chacun des participants puisse prendre une douche ou accéder aux commodités. C’est comme ça qu’un roulement se met en place, finissant forcément par Brad, seul homme téméraire à être avec nous. Ils sont tous sympas, l’ambiance est joyeuse et je ne vois pas passer la soirée.
Il est temps pour moi de me coucher. Je ne peux pas décevoir mon équipe, j’aurais trop honte de faire n’importe quoi demain.
Jour 9 :
Il est 5 h 34 du matin, heure à laquelle je dors normalement profondément, mais des sons parviennent à mes oreilles, des bruits qui m’interpellent.
Je parle aux autres, mais personne ne me répond. Je décide d’allumer.
Je m’aperçois avec stupeur que la pièce est vide de ses habitants, ce qui me pousse à me lever pour aller voir.
Je remonte doucement à la lueur de mon téléphone, espérant que ce ne soit pas les autres qui me feraient une farce. Je vois bien que le bruit s’intensifie à mesure que je grimpe à la surface, je prie pour que cela ne soit en fait que mon imagination.
Je me retrouve à une trentaine de mètres de la sortie, la nuit encore profonde m’empêche de voir à l’extérieur de la cavité. Le bruit, quant à lui, est d’une pression assourdissante, me faisant mal aux tympans. Je ressens comme des vagues me traversant le corps, couplées à chaque fois à des sons ressemblant à ceux des câbles mis en surtension. C’est flippant, je préfère redescendre et attendre qu’il fasse jour.
N’ayant rien à faire à part attendre, je me recouche, inquiète, mais trouve tout de même le sommeil.
Mon réveil fait son job à 7 h 30, mais je suis déjà bien réveillée. Je sors de mon sac promptement, m’habille, puis monte en direction de la sortie. Personne ne semble être revenu pour dormir, c’est inquiétant.
Le bruit s’est arrêté, seul l’impact de mes pas résonne dans la galerie.
Je suis à dix mètres de la sortie, la luminosité du soleil est suffisante pour bien voir que des dizaines de corps sont là, par terre, sans réaction aucune. Je suis prise de panique en les voyant, espérant une nouvelle fois que cela ne soit qu’une petite moquerie de l’ensemble du staff.
Les corps de Lucy, Brad, Lidia et Maria sont proches de moi, je m’approche d’eux lentement.
Je leur parle, leur dis que cela n’est pas très amusant, que nous avons du pain sur la planche, que nous devons nous dépêcher de nous préparer, mais rien n’y fait. Aucun mouvement ne provient des corps.
L’angoisse me prend, je manque d’air et dois me stopper quelques instants pour reprendre mon souffle.
C’est ainsi que je me rends compte que d’autres corps gisent à terre un petit peu partout autour du site.
Prenant mon courage à deux mains, je secoue le corps de Lucy, priant pour qu’elle me crie d’un coup « Surprise ! », mais aucun battement cardiaque ne semble plus animer la jeune femme. Je me redresse d’un coup, m’accroupissant une seconde après pour vomir mon repas. Mes oreilles sifflent, ma vue se trouble… Mais que se passe-t-il, bon sang ?
Je prends mon téléphone pour sonner l’alerte et compose le 999… Personne ne répond.
Je recommence, toujours pareil…
Je compose alors le 112, encore raté.
Je ne sais plus quoi faire et personne de vivant à trois cents mètres à la ronde.
Je décide alors de partir vers la caserne de pompiers ou le poste de police le plus proche afin d’y quérir de l’aide. Je suis contente d’avoir une appli me donnant accès aux principaux centres de secours en offline, parce que ni le téléphone, ni les SMS, ni Internet ne voulaient m’aider sur ce coup-là.
En regardant la carte numérique, je vois que le poste de police central n’est pas à plus de un kilomètre de ma position, alors bye bye les pompiers se trouvant à plus de cinq kilomètres, car m’y rendre me ferait perdre un temps précieux.
Je cours vers l’endroit indiqué sans jamais croiser personne. Partout sur le chemin se tiennent là, jonchant le sol, hommes, femmes, enfants, tombés d’un coup, ressemblant à s’y méprendre à des statues.
J’arrive à la porte, je sonne, sonne et sonne encore, mais personne ne vient à ma rencontre. La gâche électrique m’empêche d’avoir un accès direct aux locaux. Pour en avoir le cœur net, je me débrouille pour avoir une vue intérieure en effectuant une petite pirouette pour me permettre de jeter un coup d’œil par l’une des fenêtres. Ils sont tous morts : personne de vivant, que des cadavres sous mes yeux.
Mais qui peut bien nous venir en aide lorsque les services d’aide sont eux-mêmes dans le besoin ?
Je commence à redescendre un peu, mon esprit ne tressaille plus à la vue d’un corps, car il les déshumanise pour ne pas altérer ma santé mentale.
Mais diantre, pourquoi suis-je la seule à être encore debout ? Cette question taraude mon âme.
La seule solution qu’il me reste est de passer chez moi pour regarder si la télévision est toujours fonctionnelle.
Je n’en ai pas l’habitude, mais je m’élance dans une course rapide, pour parcourir le kilomètre qui me sépare de ma bicoque.
J’arrive à la porte, cherche les clefs qui sont dans mes poches, m’apercevant que les clefs en question sont bien dans la poche, mais de la veste restée au fond de la grotte. Ni une ni deux, je décide de briser l’une des vitres sur le côté. Il me faut bien dix bonnes minutes pour accéder à l’intérieur. Personne ne m’avait prévenu de la grande difficulté de casser un triple vitrage. J’allume. Pas de soucis, l’électricité arrive toujours chez moi. Plus qu’à trouver la télécommande.
Je la trouve sur l’accoudoir du canapé, non loin du corps immobile de Noisette, la petite chatte que la voisine m’avait confiée le temps de ses vacances en France. Je vois donc que les animaux ont eux aussi accompagné les humains dans le trépas, j’espère qu’ils iront tous au Paradis.
La télévision s’allume sans problème, mais aucune chaîne ne retransmet quoi que ce soit. Même les chaînes d’informations en continu sont désactivées.
Je sais pertinemment qu’une terrible catastrophe s’est abattue sur l’Angleterre. Cela semble si irréel, si fou que je peine à me rendre compte de la situation.
Mais c’est bien sûr, la famille El Bachir en bas de la rue ! Ils ont la télévision par satellite, peut-être que là-bas…
Je prends quelques affaires, les papiers importants, puis sors ma voiture du garage.
Dehors le calme règne en maître, nouveau seigneur de ma rue, de ma ville et probablement de ma patrie.
Je regarde ma maison de brique rouge avec émotion, première véritable location de ma jeune vie, que je me devais déjà de quitter. Je démarre, puis me place n’importe comment en face de leurs résidences. Personne ne devrait venir m’importuner pour cela.
Malheureusement pour moi, les fenêtres avaient des barreaux et la porte en aluminium me paraissait indestructible.
Petit point sur ma santé : depuis ma pirouette au centre de police, je ressens des nausées et une migraine naissante joue du tambourin à l’intérieur de ma tête.
Ce bourdonnement sourd refuse de se mettre à l’arrêt malgré les trois cachets de paracétamol avalés en une seule prise.
Je me suis aussi rendu compte d’une légère baisse de mon acuité visuelle, mais rien de grave.
Est-ce que les bruits de cette nuit étaient liés à ce massacre ? Pour ma part, j’en suis sûre et certaine.
La douleur se fait de plus en plus intense, sourde. Il ne serait pas judicieux de prendre la route tout de suite, alors que rien ne m’y oblige.
Retour chez moi pour y faire une petite sieste réparatrice avant de partir pour Londres.
Je me couche dans mon lit douillet, seule, dans cette maison entourée d’êtres humains sans vie, espérant qu’ils ne se rebellent pas comme dans les films d’horreur.
Bonne nuit.
Jour 10 :
Je me réveille naturellement, le mal de tête semble avoir disparu, mais pas les courbatures. Je m’aperçois alors qu’au-dehors il fait nuit noire. Mais combien de temps ai-je dormi ?
Ma montre m’annonce 3 h 38 du matin, imaginez-vous ma surprise devant ce qui ne devait être qu’un repos passager, et non le tour du cadran !
Je n’ai plus envie de dormir, maintenant, mais que faire ? Partir en pleine nuit ? Non, cela ne serait pas prudent.
Je me lève juste pour aller aux toilettes et me désaltérer, retournant par la suite sur mon couchage, afin d’y bouquiner en attendant les premiers rayons du soleil.
Le livre m’ennuie vite, je préfère éteindre et laisser passer le temps.
Je me rendors finalement trente minutes plus tard. Comme quoi, on ne dort jamais assez…
Mon réveil me fait sursauter à 8 h pétantes, le ciel est nuageux mais clair et je suis dans une forme olympique. Je prends mon petit-déjeuner tranquillement, mon esprit me faisant croire qu’au-dehors ce n’est qu’une de ces « Flash mob » qui sejoue.
C’est la première fois que je suis heureuse de ne plus avoir de famille en vie. Mon père est décédé il y a six ans, ma mère s’en était allée lorsque j’avais 19 ans.
Il est temps pour toi, Éléanor, de prendre le large. C’est parti ! J’ai les trois quarts du plein, ce qui est largement suffisant pour rejoindre Londres.
Mon GPS m’indique de passer par Sutton Bonnington plutôt que par Shepshed, je l’écoute forcément.
J’espère ne pas rencontrer de blocage important. Si les gens sont tous tombés en même temps, voitures et camions peuvent s’être écrasés n’importe où.
J’en ai pour un petit peu plus de deux heures de route pour entrer dans la capitale, je n’aime pas trop conduire autant, mais là, c’est un cas de force majeure.
Les gens sont restés à leur place, comme si une photographie les avait fixés dans le temps.
Je fais de mon mieux pour n’écraser personne, question de respect et d’honneur, zigzagant de part et d’autre de la chaussée jusqu’à sortir de Nottingham.
Je rentre sur l’A453, espérant qu’aucun corps ne se trouve en travers de mon chemin.
Car oui, j’ai peur de heurter un corps, peur de mourir bêtement, alors que je suis toujours bien en vie.
Je ne dépasse pas les quatre-vingts kilomètres-heure, la prudence prévaut sur ce tapis de bitume rien qu’à moi.
Des voitures sont immobilisées contre les rambardes de sécurité, les occupants endormis à jamais dans leur cercueil roulant. Plusieurs véhicules ont brûlé à cause de la violence des chocs, leur carcasse fume toujours à mon passage.
Je n’aurais pas dû regarder à l’intérieur. À l’arrière de cet amas de ferraille, je peux distinguer les deux petits corps calcinés d’enfants, toujours attachés à leur siège.
Si je survis, il me faudra bien dix ans de psychanalyse pour effacer ce souvenir !
Les kilomètres défilent sous mes yeux déjà fatigués de ne trouver que désolation et solitude.
Je passe Leicester, Wellingborough, Luton, avant de me retrouver à Londres.
Je m’arrête devant une enseigne Sainsbury’s sur Tottenham road pour y trouver mon repas de midi.
Le magasin est encore ouvert, signe que le phénomène a dû se produire avant minuit, fermeture habituelle.
Forcément à l’intérieur se trouvent des corps, des corps et encore des corps de tous âges et genres.
Je passe la dépouille de papy par la droite, enjambe mamie de justesse pour récupérer une bouteille d’eau gazeuse et deux canettes de Red Bull®.
Je continue vers le frigo contenant les sandwichs où se trouve Tony, beau gosse dans mes âges, aux allures de star de sitcom outre-Atlantique. Malgré le poids de la mort, celui-ci a gardé un visage gracieux, charmant, fort plaisant.
J’ai envie de lui couvrir le visage, comme pour éviter qu’il ne s’abîme, mais cela ne serait pas juste pour les autres, alors je te laisse là, Tony, ou qui que tu puisses être. Repose en paix.
Je me dirige vers la sortie, première fois de ma vie que je m’en vais sans payer, quand un bruit de pales d’hélicoptère me vient aux oreilles.