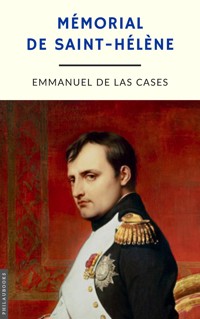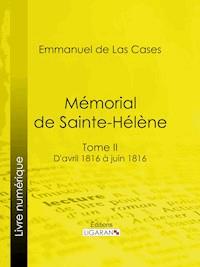Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Depuis 1830, tous les ans plusieurs personnes déposaient à la Chambre des pétitions pour le retour en France des restes mortels de l'empereur Napoléon, et toujours ces pétitions étaient renvoyées, à l'unanimité, au président du conseil. Cette année (1840), après la formation du cabinet du 1er mars, je prévins M. Thiers, président de ce cabinet, que je lui adresserais une interpellation pour savoir quelle suite on avait donnée à ces pétitions."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ste Hélène, 15 Octobre 1840.
Déssiné par J. Rigo ; Sous les yeux et d’Après les indications de Mr le Bon Emmel de LAS CASES Membre de la Mission de Ste Hélène.
Dellaye Edt Place de la Bourse 13. Lith. Rigo Fce Pass Saulnier 19.
La relation qu’on va lire est un recueil de souvenirs ou d’impressions qui datent, les uns de la première jeunesse de l’auteur, les autres d’une époque toute récente. À ces deux époques de sa vie, M. Emmanuel de Las Cases a été témoin de la plupart des faits qu’il rappelle ; souvent aussi il a joué un rôle dans les évènements qu’il retrace. À ce double titre, il a pu avec un légitime orgueil parler lui-même et se mettre en scène. Si grand que soit l’intérêt qui s’attache à la mémoire de Napoléon, et en raison même de cet intérêt, le lecteur ne saurait être indifférent aux souvenirs tout personnels du jeune secrétaire de l’Empereur à Sainte-Hélène.
On peut le dire sans flatterie, le nom que porte l’auteur de ce livre est un nom historique. Un biographe contemporain dont les appréciations sont à l’abri du soupçon, surtout en cette circonstance, n’a pas craint de mitiger sa sévérité ordinaire à l’égard de certains hommes politiques en disant : « Ce nom aura un long retentissement dans la postérité, car il est lié à celui d’un grand capitaine dont les succès et les revers ont également étonné le monde. M. de Las Cases père n’avait point été l’adulateur de Napoléon aux jours de sa toute-puissance, il fut le courtisan de sa haute infortune ; son fils Emmanuel fut associé à ce religieux sacerdoce… son nom est devenu impérissable… »
S’il en est ainsi, non seulement on lira avec intérêt les simples récits, les curieuses observations que renferme ce journal ; mais encore on s’associera volontiers aux sentiments, aux émotions du narrateur ; on aimera à le suivre sur ce rocher où, captif, il y a vingt-cinq ans, il est revenu naguère, représentant de son pays, de la France ! Sans doute aussi on voudra savoir ce qu’il était avant son pieux exil, ce qu’il est devenu depuis, ce qu’il est aujourd’hui.
Dans cette pensée, nous croyons être agréable à ceux de nos lecteurs qui ignorent la vie de M. Emmanuel de Las Cases, en en rassemblant ici les principales circonstances. Cette esquisse biographique sera au moins un guide utile pour la lecture de ce livre.
M. Emmanuel-Pons-Dieudonné DE LAS CASES est né le 8 juin 1800, à Vieux-Chatel, auprès de Brest (Finistère). Élève du Lycée impérial (collège Louis-le-Grand), lors de l’invasion des étrangers en France, il fut au nombre des jeunes volontaires de ce Lycée, qui formèrent une compagnie d’artillerie.
Nommé page de l’Empereur à la fin des cent jours, M. de Las Cases, alors âgé de seize ans, suivit à Sainte-Hélène l’illustre exilé. Les circonstances de ce départ et celles du voyage ont été racontées par M. le comte de Las Cases, dans son Mémorial ; celles du séjour, qui dura dix-huit mois, l’ont été également ; mais dans ces récits, les faits qui se rapportent à M. Emmanuel de Las Cases ne sont que des faits matériels, pour ainsi dire. Nul ne pouvait dire que lui-même, ce qu’il sentit, ce qu’il éprouva à cette époque. Et pour réveiller, pour ranimer tous ses souvenirs, pour leur donner une nouvelle vie et un intérêt nouveau, rien ne pouvait être plus favorable que la noble mission qu’il vient d’accomplir. On lira dans ce livre le récit de cette époque importante de sa vie : lui seul pouvait être son biographe sur ce point. Bornons-nous à dire que, pendant son séjour à Sainte-Hélène, M. Emmanuel de Las Cases écrivit, sous la dictée de Napoléon, presque toute l’histoire des campagnes d’Italie, en 1796 et en 1797, et plusieurs autres morceaux historiques.
Napoléon était sur le point de dicter à son jeune secrétaire l’histoire civile de son consulat, lorsque, accusé d’entretenir une correspondance illicite, dans le but de favoriser l’évasion de l’Empereur, M. le comte de Las Cases fut, ainsi que son fils, arraché à cette prison qui lui était si chère. Arrêtés tous deux par ordre du gouverneur, sir Hudson Lowe, le père et le fils furent tenus au secret pendant un mois, avant d’être séparés plus complètement encore de l’objet de leur culte. C’est alors, après une discussion avec sir Hudson Lowe, que M. Emmanuel de Las Cases, exaspéré par les indignes traitements que ce gouverneur faisait subir à Napoléon, jura d’en tirer vengeance, si jamais il retrouvait en pays libre l’impitoyable geôlier. Envoyé avec son père au cap de Bonne-Espérance, et de là en Europe, il eut à souffrir, de la part des gouvernements anglais, belge et prussien, une série révoltante de vexations et d’injustices. Nous avons entendu dire à M. E. de Las Cases qu’il doit à son séjour chez l’étranger son ardent amour de la liberté légale et de son pays.
Au milieu de ces rudes épreuves, M. E. de Las Cases regrettait vivement sa captivité passée. Sainte-Hélène était devenue pour lui comme une seconde patrie. Il osa espérer ou plutôt désirer de la revoir. Mais ce fut en vain qu’à plusieurs reprises il sollicita cette faveur du gouvernement anglais. Voici comment fut accueillie sa demande.
Downing-street, 19 novembre 1819.
À. M. Em. de Las Cases.
Monsieur,
J’ai reçu l’injonction de lord Bathurst de vous accuser réception de votre lettre du 15 septembre, par laquelle vous demandez la permission de retourner à Sainte-Hélène. Je suis chargé de vous répondre que S.S. ne peut point vous permettre de retourner en cette île. Je saisis cette occasion pour vous faire connaître que la lettre que vous avez adressée au général Bertrand lui sera envoyée à Sainte-Hélène.
J’ai l’honneur, etc.
HENRI GOLBURN.
Ne pouvant obtenir la permission de retourner à Sainte-Hélène, M. E. de Las Cases demanda et obtint, vers la fin de 18 19, celle de rentrer en France sous un nom supposé. Il fit d’abord son droit à Strasbourg, mais se sentant peu de goût pour le barreau, il vint à Paris, où il se livra à l’étude des sciences. La chimie, la physique, même la médecine, furent tour à tour l’objet de ses travaux ; mais l’histoire et la politique étaient ses études de prédilection.
Cependant la mort de Napoléon avait ramené sir Hudson Lowe en Angleterre. Cet odieux exécuteur, après avoir arraché le comte de Las Cases à l’amitié et à l’affection de l’Empereur, avait cherché, par un raffinement de cruauté, à le perdre dans l’opinion de son captif. Ce nouveau grief n’était pas nécessaire pour rappeler à M. E. de Las Cases la promesse qu’il s’était faite à lui-même. Il prétexte un voyage d’instruction, prend congé de sa famille et part pour Londres. Il y cherche son adversaire, le rencontre et lui inflige le plus sanglant des outrages, un coup de cravache. La réponse était dictée d’avance ; mais l’ex-gouverneur eut recours à la justice ; il obtint un mandat d’arrêt contre son ancien prisonnier, et stimula, dit-on, par l’appât de 2 000 livres sterling de récompense le zèle des agents de police chargés d’exécuter ce mandat. La peine infligée par les tribunaux eût pu être fort sévère ; M. de Las Cases crut pouvoir s’y soustraire, et grâce à l’intervention généreuse de plusieurs Anglais, dont quelques-uns lui étaient inconnus, il parvint à s’embarquer et à rentrer en France. Trois ans plus tard, le 11 novembre 1825, à huit heures et demie du soir, M. E. de Las Cases fut assailli à Passy, à deux cents pas de la maison de son père. Il fut frappé de plusieurs coups d’une arme à double tranchant, l’un à la poitrine, un autre à la cuisse droite ; mais le premier se trouva amorti par son portefeuille. M. de Las Cases blessa lui-même un de ses deux assassins, qui prirent la fuite. Par un hasard, au moins singulier, sir Hudson Lowe, l’ex-gouverneur de Sainte-Hélène était à Paris, précisément à cette époque, et il avait habité incognito le village de Passy. Après le fait, il avait d’abord déclaré qu’il ne quitterait pas Paris, avant que les coupables fussent saisis par la justice ; mais il partit précipitamment. Au reste, sir Hudson Lowe est réprouvé de ses compatriotes eux-mêmes, il était expulsé honteusement de la société, du club militaire, de la garde royale où il servait, et de son régiment par le corps des officiers.
En 1828, M. E. de Las Cases mit à profit ses études politiques ; il adressa à la Chambre des Députés une pétition pour demander que l’âge des électeurs fût fixé à vingt-cinq ans et celui des éligibles à trente, réforme qui, comme on le sait, fut adoptée en 1830. Cette demande était appuyée d’une brochure intitulée : de l’Éligibilité et de l’âge des Éligibles, « travail qui annonçait, dit le biographe que nous avons déjà cité, des études sérieuses et des vues généreuses d’amélioration sociale. »
« Les ordonnances de juillet, dit-il encore, trouvèrent M. E. de Las Cases disposé à l’insurrection. Dès le mercredi, il prit les armes, combattit sur divers points (à la porte Saint-Denis, rue du Petit-Carreau), et, le jeudi, entra à l’Hôtel-de-Ville. Il fut un des premiers, avec M. Baude, et le colonel Zimmer, à donner sa signature pour divers actes d’urgence ; signatures qui eussent été un arrêt de mort pour leurs auteurs, en cas de défaite du parti national.
Apprenant qu’il se tenait une réunion de députés chez M. Laffitte, M. E. de Las Cases y courut, et se prononça vivement pour la formation d’une commission provisoire de gouvernement. De là il se rendit de nouveau à l’Hôtel-de-Ville, où il passa le reste du jour et la nuit auprès des généraux Lafayette et Gérard. Ce dernier n’ayant point d’aide de camp, accepta les services de M. de Las Cases. En cette qualité, le vendredi il accompagna le général à la première séance que les députés tinrent au Palais-Bourbon. Le pavillon blanc flottait encore sur les Invalides ; il reçut mission de s’y rendre et d’y faire arborer le drapeau national.
En récompense de ces services, le maréchal Gérard, par une lettre du 3 septembre, demanda pour M. E. de Las Cases la décoration de la Légion-d’Honneur, et de plus, la commission des récompenses nationales lui décerna la croix de Juillet. »
Peu de jours après la révolution de Juillet, M. E. de Las Cases fut appelé au ministère de l’intérieur par M. Guizot, qui lui proposa une préfecture. M. de Las Cases répondit qu’il était à la disposition du Gouvernement, et prêt à se rendre utile, en quelque qualité que ce fût. Dans un pareil moment c’était un devoir que d’accepter des fonctions publiques, et un devoir qui n’était pas sans danger. Néanmoins cette proposition n’eut pas de suite.
La réforme sollicitée, en 1828, par M. E. de Las Cases, fut adoptée. Dès lors, il pouvait prétendre à la députation, et préféra le mandat du député à la dépendance du fonctionnaire public : il sollicita les suffrages des électeurs de son département, et fut élu, en octobre 1830, au premier tour de scrutin, par le grand collège du Finistère.
M. E. de Las Cases vint soutenir à la chambre les grands principes de liberté reconnus en 1789. Il présida en plusieurs circonstances la réunion Lointier, et ce fut sous sa présidence, que la société, au nombre de plus de cent soixante membres, discuta le projet de la loi électorale présentée aux chambres, et fixa le cens à 200 fr., chiffre qui fut adopté par la chambre. M. de Las Cases termina ses travaux législatifs par un compte-rendu de sa conduite parlementaire, et donna, l’un des premiers en France, ce salutaire exemple d’un député soumettant à ses électeurs la ligne politique suivie par lui, et les motifs qui la dirigent.
M. E. de Las Cases sollicita de nouveau les suffrages des électeurs de l’arrondissement de Brest (extra-muros), et fut élu sous l’empire de la nouvelle loi électorale, à l’adoption de laquelle il avait pris une part active (6 juillet 1831). De retour à Paris, il s’associa à la politique du 13 mars, à cette glorieuse politique, tant calomniée alors, tant admirée depuis, même par ses adversaires. La session de 1831, on se le rappelle, fut féconde en orages et en utiles travaux. M. de Las Cases, l’un des appuis de l’illustre Casimir Périer, fixa alors et arrêta son système et sa conduite politique. Il est resté fidèle depuis aux grands principes qu’il adopta à cette époque. Dans un compte-rendu de ses travaux parlementaires pendant cette session de 1831, M. de Las Cases disait, après un exposé lucide et complet de la situation :
« Avec cet ensemble de circonstances intérieures et extérieures, fallait-il faire une opposition systématique ? Non. Vous m’avez approuvé lorsque questionné par vous sur ce point j’ai eu l’honneur de vous répondre que jamais une opposition systématique n’entrerait dans ma manière de voir. En 1814, c’est l’opposition systématique du corps législatif et du sénat qui a amené la première restauration ; en 1815, c’est l’opposition systématique de la chambre des cent jours qui a amené une seconde restauration, quoique d’abord on l’eût proclamée impossible, à cause de l’unanimité que venait de montrer la France. Chacun disait alors : Napoléon peut être renversé, mais, à coup sûr, Louis XVIII ne le remplacera pas !…
Notre gouvernement a-t-il fait des fautes ? Il n’y a pas de doute. Quel est le gouvernement qui n’en a point fait ? Les trois ministères qui se sont succédé en ont tous commis de nombreuses : celles de la présente administration se trouvent surtout dans le détail et dans la forme, beaucoup plus que dans le fond. Nécessitaient-elles une opposition systématique, je ne le crois pas. En politique, les grandes bases et le but bien arrêtés, la marche d’un individu doit constamment dépendre des circonstances variables qui l’entourent et se modifier sans cesse sur elles.
J’ai toujours eu devant les yeux le mandat impératif (car je reconnais celui-là) que vous m’avez unanimement donné, la volonté que vous m’avez unanimement manifestée de maintenir et de conserver le gouvernement fondé en juillet, qui en définitive est notre ouvrage, dont l’existence constate notre principe de la souveraineté nationale, dont l’élection faite par nous clot et termine quarante ans de révolution. Dans cette vue, je ne me suis enrôlé sous la bannière d’aucun parti. J’ai voulu demeurer libre et indépendant autant de l’opposition que du ministère ; rester maître et arbitre de mes actes. Si vous m’avez assez estimé pour m’honorer du titre de votre mandataire, c’est que sans doute vous m’avez regardé comme capable de vous représenter par moi-même. J’aurais cru trahir votre confiance, me mettre au-dessous du poste que vous m’aviez donné, vous manquer à vous-mêmes, si je m’étais rangé d’avance dans telle ou telle fraction politique, si j’avais annulé mon intelligence au profit de telles ou telles personnes, même de celles que j’estime et respecte le plus. J’ai agi. Je vous rends compte, messieurs les électeurs, vous êtes maintenant mes juges. Je recevrai avec reconnaissance tout ce qui me viendra de vous, mais je n’écouterai que vous et récuserai tout le reste. »
Ce n’était pas sans raison que M. de Las Cases s’était montré conservateur, et l’un des plus zélés partisans de la politique ferme et résistante de Casimir Périer. Quelques jours après l’envoi de son compte-rendu aux électeurs de son arrondissement, éclataient les sanglantes journées des 5 et 6 juin. M. de Las Cases ne se contenta pas de donner au gouvernement le concours politique qui lui était nécessaire pour triompher des factions ; il prit les armes, bien que ses fonctions de député l’affranchissent du service de la garde nationale, et se rendit au cloître St-Méry, en qualité de combattant-amateur, suivant l’expression singulière d’un biographe. On lit dans un journal du 6 juin 1832 :
Dès le matin, M. Emmanuel de Las Cases, député, s’est joint à la compagnie des voltigeurs du 4e bataillon de la 1re légion, et a marché avec elle toute la journée sans sortir un instant des rangs.
Le 1er juin 1834, M. de Las Cases adressait à ses commettants un nouveau compte-rendu. C’était à la suite des évènements d’avril. Il y disait :
« En résumé, messieurs, ma conduite politique, depuis que vous m’avez honoré de votre mandat, a été constante et toujours la même. J’ai mis toute mon étude à rechercher les faits, à reconnaître la vérité, que tant de passions diverses défigurent sans cesse, et je me suis efforcé de marcher dans le sens de l’intérêt général. Depuis quarante ans la France a manifesté plusieurs fois, autant que peuple l’a jamais fait, la volonté d’être nation libre ; mais aussi elle a également manifesté sa ferme et énergique volonté et contre le despotisme et contre l’anarchie. Ainsi, lorsqu’en 1795 elle mettait un million d’hommes sous les armes et ruinait ses finances présentes et à venir, c’était pour se préserver du joug de l’étranger : lorsqu’au 18 brumaire elle se jetait en masse dans les bras du général Bonaparte, lorsqu’elle lui livrait successivement plusieurs de ses libertés, c’était pour qu’il la préservât de l’anarchie qui la dévorait. Je pourrais vous citer les autres époques remarquables. La France ne veut se plier à aucun joug, soit qu’il vienne d’en haut, soit qu’il vienne d’en bas. Elle veut jouir de sages libertés. Ces sages libertés, la révolution de 1830 les lui a données. Tout privilège est détruit. Il n’est pas une carrière qui ne soit ouverte à tout homme d’un mérite réel, dans quelque classe, dans quelque rang que la nature l’ait placé. Désormais on a le droit de tout dire, de tout discuter ; on en use au point de discuter même le principe du gouvernement, ce qui, jusqu’ici, n’avait été permis, à ma connaissance, chez aucune nation, et ce qui me paraît même inadmissible. Si quelques réformes sont jugées nécessaires, vos mandataires ont le droit d’initiative, la tribune et la discussion légale leur sont ouvertes. Voilà l’ordre de choses à la conservation duquel ont tendu et mes votes et ma conduite politique. J’ai continué, ainsi que j’avais commencé, à être également indépendant et de l’opposition et du ministère. Député de la France, j’ai cherché à satisfaire les intérêts de la France. Vous jugerez, messieurs, si j’ai rempli le mandat que vous m’avez confié. »
Au mois de septembre 1837, M. de Las Cases fut nommé officier de la Légion-d’Honneur. En novembre 1837, il recevait encore du suffrage de ses commettants son mandat de député, dont on ne saurait lui reprocher d’avoir abusé, ni même usé dans son intérêt personnel. Il n’est guère d’administration, en effet, qui ne lui ait fait l’offre d’une belle position dans les affaires. M. de Las Cases a toujours refusé, pour demeurer indépendant. Voici ce qu’il disait encore lui-même à ses électeurs :
« Oui, je suis vraiment un homme indépendant ; et pour le rester, ainsi que je vous le disais, messieurs, je n’ai jamais voulu être fonctionnaire public. Lors de son premier ministère, M. de Montalivet m’a plusieurs fois offert une préfecture ; je l’ai toujours remercié. M. Baude, lorsqu’il était sous-secrétaire d’état au département de l’intérieur, a plusieurs fois insisté vivement pour me faire accepter une préfecture, je l’ai pareillement remercié. Je passe sous silence plusieurs offres, par respect pour la personne auguste au nom de qui elles m’étaient faites. Lorsque M. Martin (du Nord) est entré au ministère des travaux publics et du commerce, il m’a appelé aux fonctions de secrétaire général, et une auguste personne daigna me faire dire qu’elle verrait avec plaisir mon acceptation ; j’ai remercié, pour rester indépendant ».
Le 29 novembre 1837, M. de Las Cases partait pour Haïti sur la frégate la Néréide, en qualité de plénipotentiaire, pour régler d’un commun accord avec les autorités de la république les difficultés qui s’étaient élevées au sujet du paiement des sommes que cette république devait à la France sur l’indemnité stipulée par l’ordonnance royale du 17 avril 1825. Il ne nous appartient pas d’apprécier la manière dont M. de Las Cases a rempli cette mission diplomatique. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que la Chambre écouta avec la plus grande faveur le discours étendu et plein de faits nouveaux, dans lequel M. de Las Cases rendit compte de cette affaire, et justifia le traité à la conclusion duquel il avait coopéré. On lira à la fin du volume cet important document, qui témoigne du soin scrupuleux avec lequel M. de Las Cases s’est acquitté de cette tâche épineuse.
Comme récompense de cette mission, M. le comte Molé lui offrit les fonctions de Conseiller d’état en service ordinaire, fonctions auxquelles est attaché, comme on sait, un traitement de 15 000 francs. M. de Las Cases refusa cette offre comme toutes les autres, et cela, comme il l’a dit lui-même, parce qu’il voulait et veut rester indépendant. Voici la lettre qu’il reçut à cette occasion de M. le comte Molé :
Monsieur le baron,
Votre rare désintéressement vous ayant fait préférer les fonctions gratuites de conseiller d’état en service extraordinaire aux fonctions rétribuées du service ordinaire, le roi vient de vous nommer, selon votre désir, conseiller d’état en service extraordinaire. Je laisse à M. le garde des sceaux le soin de vous annoncer d’une manière plus officielle ce témoignage de la satisfaction de sa majesté pour le nouveau service que vous venez de rendre à son gouvernement et à la France.
Agréez, etc.
Signé MOLÉ.
Paris, 20 mai 1838.
Au mois de mars 1839, M. E. de Las Cases a été réélu député pour la cinquième fois, malgré les vives attaques dont sa candidature a été l’objet.
Telle a été jusqu’à ce jour la vie de l’auteur de ce livre, de ce jeune homme dont le moral s’était trouvé en serre chaude à Sainte-Hélène, suivant l’expression de Napoléon, qui, captif et exilé à seize ans, est devenue à trente l’un des représentants de son pays. Certes, c’est là une destinée digne d’envie sous plus d’un rapport, digne d’intérêt dans tous les cas, et capable au moins de piquer la curiosité des plus indifférents.
Depuis 1830, tous les ans plusieurs personnes déposaient à la Chambre des pétitions pour le retour en France des restes mortels de l’empereur Napoléon, et toujours ces pétitions étaient renvoyées, à l’unanimité, au président du conseil. Cette année (1840), après la formation du cabinet du 1er mars, je prévins M. Thiers, président de ce cabinet, que je lui adresserais une interpellation pour savoir quelle suite on avait donnée à ces pétitions. Chaque samedi suivant, M. Thiers me demanda d’ajourner mon interpellation, et je pus juger qu’une négociation était ouverte à Londres au sujet des restes mortels de l’Empereur.
En effet j’appris bientôt que la correspondance suivante avait eu lieu :
M. GUIZOT AU VICOMTE PALMERSTON.
Londres, 10 mai 1840.
Le soussigné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S.M. le Roi des Français, conformément aux instructions qu’il a reçues de son gouvernement, a l’honneur d’informer S.E. le ministre des affaires étrangères de S.M. la Reine des royaumes unis de la Grande-Bretagne et d’Irlande que le Roi a fortement à cœur le désir que les restes de Napoléon puissent reposer en France, dans cette terre qu’il a défendue et illustrée, et qui garde avec respect les dépouilles mortelles de tant de milliers de ses compagnons d’armes, chefs et soldats, dévoués avec lui au service de leur patrie.
Le soussigné est convaincu que le gouvernement de S.M. Britannique ne verra dans ce désir de S.M. le Roi des Français qu’un sentiment juste et pieux, et s’empressera de donner les ordres nécessaires pour que les restes de Napoléon soient transportés de Sainte-Hélène en France. Le soussigné a l’honneur d’offrir à Son Excellence l’assurance de sa plus haute considération.
Signé GUIZOT.
LE VICOMTE PALMERSTON À M. GUIZOT.
Foreign-Office, 3 mai 1840.
Le soussigné, principal secrétaire d’État de Sa Majesté pour les affaires étrangères, a l’honneur d’accuser réception de la note, en date de ce jour, qu’il a reçue de M. Guizot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S.M. le Roi des Français, et qui exprime le désir du gouvernement français que les restes mortels de Napoléon puissent être rapportés en France. Le soussigné ne peut mieux répondre à la note de M. Guizot qu’en transmettant à Son Excellence copie d’une dépêche que le soussigné a adressée hier à l’ambassadeur de sa Souveraine à Paris, répondant à une communication verbale qui avait été faite à lord Granville par le président du conseil (M. Thiers) sur le sujet dont traite la note de M. Guizot. Le soussigné a l’honneur de renouveler à M. Guizot l’assurance de sa plus haute considération.
Signé PALMERSTON.
LE VICOMTE PALMERSTON AU COMTE GRANVILLE.
Foreign-Office, 9 mai 1840.
Mylord, le gouvernement de sa majesté ayant pris en considération la demande faite par le gouvernement français, à l’effet de rapporter de Sainte-Hélène en France les restes mortels de Napoléon Bonaparte, vous pouvez assurer M. Thiers que le gouvernement de sa majesté accédera avec grand plaisir à cette demande. Le gouvernement de sa majesté désire que la France regarde la promptitude avec laquelle nous donnons cette réponse comme un témoignage du désir du gouvernement de sa majesté britannique d’éteindre jusqu’aux derniers restes de ces animosités nationales qui, pendant la vie de l’Empereur, maintinrent en armes les deux nations ; et le gouvernement de S.M. Britannique a la conviction que si quelques traces de ces sentiments hostiles existaient encore, ils seraient enfermés dans la tombe qui va recevoir les restes mortels de Napoléon. Le gouvernement de S.M. et le gouvernement français prendront ensemble les mesures nécessaires pour la translation de ses cendres.
Je suis, etc.
Signé PALMERSTON.
LE COMTE GRANVILLE AU VICOMTE PALMERSTON.
Paris, 4 mai 1840.
Mylord, plusieurs pétitions ont été présentées dernièrement aux Chambres à l’effet de demander que le gouvernement français prît des mesures pour obtenir du gouvernement anglais la permission de transporter les restes mortels de feu l’empereur Napoléon, de Sainte-Hélène en France. Ces pétitions furent favorablement accueillies par les Chambres qui les renvoyèrent au président du conseil et aux autres ministres. Le conseil ayant délibéré sur la question, et le Roi ayant donné son approbation à la délibération prise au sujet de ces pétitions, hier M. Thiers m’adressa officiellement la requête du gouvernement français, demandant que le gouvernement de S.M. la Reine permît de transporter le corps du feu Empereur à Paris, faisant observer que rien ne pouvait mieux cimenter l’union des deux nations, et faire naître des sentiments plus amis de la part de la France vis-à-vis de l’Angleterre, que l’acquiescement du gouvernement Britannique à cette demande.
J’ai l’honneur, etc.
Signé, GRANVILLE.
LE COMTE GRANVILLE AU VICOMTE PALMERSTON.
(Extrait.)
Paris, 11 mai 1840.
À votre dépêche du 9 courant, qui m’informait que le gouvernement de S.M. Britannique avait accédé à la demande du gouvernement français, et donné la permission de rapporter en France les restes de Napoléon Bonaparte, j’ai l’honneur de répondre que je n’ai pas perdu un moment pour adresser une note à ce sujet à M. Thiers, et que depuis j’ai reçu une visite de Son Excellence, qui m’a chargé, d’exprimer de la part du gouvernement français au gouvernement anglais, combien il avait été sensible à la promptitude que l’on avait mise à accéder à ses désirs.
LE COMTE GRANVILLE AU VICOMTE PALMERSTON.
(Extrait).
Paris, 12 mai 1840.
M. Thiers vient de passer chez moi, en se rendant à la Chambre des Députés, et m’a informé qu’aujourd’hui même le gouvernement du Roi allait demander aux Chambres un crédit, pour le transport des restes mortels de Napoléon Bonaparte, de Sainte-Hélène en France. C’est le prince de Joinville qui commandera le bâtiment de guerre sur lequel les commissaires se rendront à Sainte-Hélène, et par lequel seront rapportées en France les cendres de l’Empereur.
Le 12 mai 1840, M. de Rémusat, ministre de l’intérieur, présenta en effet aux Chambres le projet de loi suivant :
Voici comment un des principaux journaux rend compte de cette séance remarquable.
CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
Séance du 12 mai.
M. LE PRÉSIDENT : La parole est à M. le ministre de l’intérieur pour une communication du gouvernement.
M. LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR : Messieurs, le roi a ordonné à son altesse royale monseigneur le prince de Joinville (mouvement d’attention et de curiosité) de se rendre, avec sa frégate, à l’île de Ste-Hélène (nouveau mouvement), pour y recueillir les restes mortels de l’Empereur Napoléon. (Explosion d’applaudissements dans toutes les parties de l’assemblée.)
Nous venons vous demander les moyens de les recevoir dignement sur la terre de France, et d’élever à Napoléon son dernier tombeau. (Bruyantes acclamations.) Le gouvernement, jaloux d’accomplir un devoir national (voix nombreuses : Oui ! oui !) s’est adressé à l’Angleterre. Il lui a redemandé le précieux dépôt que la fortune avait remis dans ses mains. À peine exprimée, la pensée de la France a été accueillie. Voici les paroles de notre magnanime alliée :
« Le gouvernement de S.M. Britannique espère que la promptitude de la réponse sera considérée en France comme une preuve de son désir d’effacer jusqu’à la dernière trace de ces animosités nationales qui, pendant la vie de l’Empereur, armèrent l’une contre l’autre la France et l’Angleterre. Le gouvernement de S.M. Britannique aime à croire que si de pareils sentiments existent encore quelque part, ils seront ensevelis dans la tombe où les restes de Napoléon vont être déposés. » (Profonde sensation. Bravo ! Bravo !)
L’Angleterre a raison, Messieurs ; cette noble restitution resserrera encore les liens qui nous unissent ; elle achève de faire disparaître les traces douloureuses du passé. Le temps est venu où les deux nations ne doivent plus se souvenir que de leur gloire.
La frégate chargée des restes mortels de Napoléon se présentera au retour à l’embouchure de la Seine ; un autre bâtiment les rapportera jusqu’à Paris ; ils seront déposés aux Invalides. Une cérémonie solennelle, une grande pompe religieuse et militaire inaugurera le tombeau qui doit les garder à jamais.
Il importe en effet, Messieurs, à la majesté d’un tel souvenir, que cette sépulture auguste ne demeure pas exposée sur une place publique, au milieu d’une foule bruyante et distraite. Il convient qu’elle soit placée dans un lieu silencieux et sacré, où puissent la visiter avec recueillement tous ceux qui respectent la gloire et le génie, la grandeur et l’infortune. (Vive et religieuse émotion.)
Il fut Empereur et Roi ; il fut le souverain légitime de notre pays. (Marques éclatantes d’assentiment.) À ce titre il pourrait être inhumé à Saint-Denis ; mais il ne faut pas à Napoléon la sépulture ordinaire des rois ; il faut qu’il règne et commande encore dans l’enceinte où vont se reposer les soldats de la patrie et où iront toujours s’inspirer ceux qui seront appelés à la défendre. Son épée sera déposée sur sa tombe.
L’art élèvera sous le dôme, au milieu du temple consacré par la religion au Dieu des armées, un tombeau digne, s’il se peut, du nom qui doit y être gravé. Ce monument doit avoir une beauté simple, des formes grandes, et cet aspect de solidité inébranlable qui semble braver l’action du temps. Il faudrait à Napoléon un monument durable comme sa mémoire. (Très bien, très bien.)
Le crédit que nous venons demander aux chambres a pour objet la translation aux Invalides, la cérémonie funéraire, la construction du tombeau.
Nous ne doutons pas, Messieurs, que la chambre ne s’associe avec une émotion patriotique à la pensée royale que nous venons d’exprimer devant elle. (Oui ! oui ! bravo.)
Désormais la France, et la France seule, possédera tout ce qui reste de Napoléon. Son tombeau comme sa renommée n’appartiendra à personne qu’à son pays. La monarchie de 1830 est en effet l’unique et légitime héritière de tous les souvenirs dont la France s’enorgueillit.
Il lui appartenait sans doute, à cette monarchie qui, la première, a rallié toutes les forces et concilié tous les vœux de la révolution française, d’élever et d’honorer la statue et la tombe d’un héros populaire ; car il y a une chose, une seule, qui ne redoute pas la comparaison avec la gloire, c’est la liberté ! (Bravo ! bravo ! – Manifestation prolongée d’enthousiasme.)
De bruyants témoignages d’approbation succèdent à la lecture de cet exposé de motifs. Une vive émotion se manifeste sur les traits de plusieurs députés. M. Emmanuel de Las Cases a les yeux mouillés de larmes.
PROJET DE LOI.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,
À tous présents et à venir, salut :
Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la chambre des députés par notre ministre secrétaire-d’état de l’intérieur, que nous chargeons d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
« ART.1er Il est ouvert au ministre de l’intérieur, sur l’exercice de 1840, un crédit spécial de 1 million pour la translation des restes mortels de l’empereur Napoléon à l’église des Invalides et pour la construction de son tombeau.
2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi au moyen des ressources accordées par la loi des finances du 10 août 1839, pour les besoins de l’exercice 1840. »
Au palais des Tuileries, le 12 mai 1840.
LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi,
Le ministre secrétaire d’État du département de l’intérieur,
CH. RÉMUSAT.
M. LE PRÉSIDENT. Le projet et l’exposé des motifs seront imprimés et distribués. Le projet sera renvoyé à l’examen des bureaux.
Plusieurs voix : Aux voix le projet ! Volons tout de suite !
M. LE PRÉSIDENT : Ce serait violer le règlement.
M. HERNOUX monte à la tribune. Messieurs, dit-il, je demande que, dérogeant à ses habitudes, la chambre, contrairement aux dispositions de son règlement, vole immédiatement sur la proposition du gouvernement.
Voix diverses : Oui ! oui ! Non ! non !
M. LE PRÉSIDENT. La chambre, quels que soient les sentiments qui l’animent, place toujours au-dessus de tout le respect des lois l’observation de son règlement, qui est la première garantie des lois. (Marques générales d’assentiment.)
Une voix de la droite : Aux voix la proposition !
M. LE PRÉSIDENT. Je ne mettrai pas aux voix une proposition qui est contraire au règlement. (Approbation.)
L’impression produite par la communication du gouvernement amène une suspension de la séance. Les députés quittent leur place et forment différents groupes dans l’hémicycle ; les conversations y paraissent très animées. MM. les ministres de l’intérieur et le président du conseil reçoivent les félicitations empressées et sympathiques des membres de la chambre. Après plus d’un quart d’heure d’interruption, le silence se rétablit.
Le président du conseil désirait vivement que les personnes qui formaient la mission de Ste-Hélène pussent partir de Paris le samedi 16 mai, et de Toulon vers le milieu de la semaine suivante. Mais le prince de Joinville, commandant en chef de l’expédition tomba malade ; il fallut attendre son rétablissement. Le rendez-vous fut enfin donné à Toulon pour la journée du lundi, 6 juillet.
C’est Toulon qui nous voyait partir pour chercher la dépouille mortelle de Napoléon, Toulon qui avait été témoin de l’aurore de sa gloire.
6 lundi. – Chacun se trouva successivement au lieu du rendez-vous. Le prince commandant arriva dans la matinée : il dîna, ainsi que les officiers et les compagnons d’exil de l’Empereur, chez M. le vice-amiral baron Jurien de la Gravière, préfet maritime.
L’ordre fut donné d’être à bord de la Belle-Poule le lendemain à midi.
7 mardi. – Dès midi tout le monde était embarqué : on n’attendait plus que M. de Chabot, commissaire du roi ; il arriva, et à quatre heures, le prince commanda lui-même l’appareillage. J’ai remarqué dans le cours de la campagne qu’il avait l’usage de prendre le commandement pour les appareillages, les mouillages, et dès que les circonstances devenaient un peu imposantes. La corvette la Favorite, commandée par M. Guyet, flottait auprès de nous. La brise était bonne, nous ne tardâmes pas à perdre la terre de vue : le but du voyage nous la faisait quitter sans regret. Il semblait que nous ne nous séparions pas de la patrie ; son pavillon nous ombrageait, et nous allions recueillir les cendres de celui qui l’avait faite si grande !
M. de Chabot, commissaire du roi, le général Bertrand, le général Gourgaud, M. l’abbé Coquereau et moi, étions passagers à bord de la frégate la Belle-Poule : le défaut d’espace avait obligé d’embarquer M. Marchand à bord de la Favorite.
Du 8 mercredi au 14 mardi. – Notre navigation était fort douce : les bâtiments étaient poussés par de faibles brises.
Nous fîmes promptement connaissance avec messieurs les officiers de la frégate, qui nous entourèrent de toute espèce de prévoyances et d’attentions.
La frégate la Belle-Poule, portant soixante bouches à feu, était commandée par S.A.R. le prince de Joinville ; il avait auprès de lui M. Hernoux, capitaine de vaisseau, son aide de camp, et M. Touchard, lieutenant de vaisseau, son officier d’ordonnance.
Le prince commandant a été reçu élève de deuxième classe à Brest, en 1834. Son examen, selon la forme établie, a eu lieu publiquement. Les examinateurs et les nombreux assistants se plurent alors à convenir qu’ils n’avaient point vu d’examen plus brillant ; c’était chose notoire dans toute la ville. Depuis, le prince a fait six campagnes ; celle-ci est sa septième. On connaît sa belle conduite au Mexique ; les officiers qui s’y trouvaient avec lui, disent unanimement qu’il s’y est montré brave et froid comme un ancien militaire, et qu’il serait difficile de mieux gagner des épaulettes.
M. Hernoux, son aide de camp, est membre de la Chambre des Députés ; il sort de l’École navale impériale. Quoique jeune encore, il compte aujourd’hui trente ans de service. Il commandait un bâtiment en Orient, quand M. de Rigny le distingua et le chargea plusieurs fois de missions diplomatiques. Lorsqu’après 1830 on nomma des officiers d’ordonnance auprès du Roi, M. de Rigny, alors ministre de la marine, l’appela à ces fonctions. Comme officier d’ordonnance, M. Hernoux fut employé au siège de la citadelle d’Anvers ; il se distingua sur l’Escaut. C’est à la suite de ce siège que le Roi le chargea de l’éducation nautique du prince de Joinville. Nommé député par l’arrondissement de Mantes, M. Hernoux a plusieurs fois fait partie de la commission du budget, et a été deux fois rapporteur du budget de la marine. La clarté et la force avec laquelle il a exposé ses vues, tant dans les commissions qu’à la tribune, a déterminé la Chambre à les adopter et à reporter sur le personnel une forte somme, qui jusque-là avait été affectée au matériel.
M. Touchard, chevalier de la Légion-d’Honneur, a eu de nombreuses couronnes au concours général. Il a fait plusieurs campagnes, entre autres le tour du monde sur la corvette la Bonite, où il était chargé des observations astronomiques. Le prince ne le connaissait pas personnellement : son mérite l’a fait appeler au poste qu’il occupe.
M. Charner, capitaine de corvette, était le commandant en second de la frégate. On sait que le commandant en second est chargé de tout le détail intérieur du bâtiment. M. Charner est, comme M. Hernoux, élève de l’École navale impériale ; il était à la prise d’Ancône et d’Alger ; il jouit d’une réputation très distinguée parmi ses collègues comme praticien et comme homme de savoir.
Les autres officiers composant l’état-major de la frégate étaient :
M. Le Guillou-Penanros, lieutenant de vaisseau, qui compte vingt-huit ans de service, dont vingt-trois d’embarquement.
M. Penhoat, lieutenant de vaisseau, qui compte six campagnes et plus de huit ans de mer effectifs.
M. Fabre Lamaurelle, lieutenant de vaisseau. M. Fabre a fait avec M. Baral, sur les côtes du Brésil, une campagne hydrographique qui a produit d’utiles travaux. Sur le Palinure il a eu une affaire contre Tunis. Il a accompagné le prince de Joinville à Constantine. Sa conduite brillante au Mexique lui a mérité la décoration.
M. Bazin, enseigne de vaisseau, a fait plusieurs campagnes en Orient, dans les Antilles, sur les côtes d’Afrique et d’Angleterre, à bord de l’Iphigénie, de la Didon et de la Malouine.
M. Bonie, enseigne de vaisseau. Il est ainsi que le prince de Joinville, élève du professeur Guérard qui a formé tant de sujets distingués. Il a fait plusieurs campagnes, entre autres le tour du monde sur la frégate la Vénus.
M. Chedeville, commissaire d’administration, secrétaire du conseil d’administration. Il a dix-neuf ans de service dont huit de mer.
M. le docteur Guillard, chevalier de la Légion d’Honneur. L’importante mission de l’exhumation de Napoléon ne pouvait être mieux confiée qu’au docteur Guillard, que son instruction et ses services distingués avaient déjà appelé à l’honneur d’embarquer en qualité de chirurgien major sur la frégate la Belle-Poule.
MM. de Roujoux et de Bovis, élèves de première classe, ont fait, toujours ensemble plusieurs campagnes, entre autres celle du Mexique. Ils promettent à la marine deux officiers distingués.
M. Godleap, élève de première classe, a fait plusieurs campagnes.
M. Gervais, élève de deuxième classe, décoré de la Légion-d’Honneur. Il a eu la cuisse traversée d’une balle en cuivre dans une rue de la Véra-Cruz, est tombé sans connaissance sur son commandant (le prince de Joinville) qui l’a tenu et porté dans ses bras, jusqu’à ce que des matelots soient venus pour l’enlever.
M. Jouan, id.
M. d’Espagne de Venevelles, id., fils du général.
M. Jauge, id., décoré de la Légion-d’Honneur. Il a eu aussi la jambe traversée d’une balle à la Véra-Cruz.
M. de Suremain, id.
M. Perthuis, id.
M. Bourdel, chirurgien de troisième classe.
M. Thibaut, id.
Nous voguions de conserve avec la Favorite, corvette de vingt-quatre bouches à feu. Commandant M. Guyet, capitaine de corvette.
M. Guyet, élève de l’École navale impériale, était naguère chef d’état-major de l’amiral Lalande dans le Levant. Il compte trente ans de service et de nombreuses campagnes.
Les autres officiers composant l’état-major étaient : MM. Lalia, lieutenant de vaisseau, chargé du détail ;
M. Béral de Sédaiges, enseigne de vaisseau ;
M. Narbonne, id. ;
M. de Trogoff-Coattalio, id. ;
M. Jacques dit Lapierre, id. ;
M. Gilbert-Pierre, commis d’administration ;
M. Arland, chirurgien major ;
M. Guillabert, chirurgien de troisième classe ;
M. Meynard, élève de deuxième classe ;
M. Fabre, volontaire ;
M. Fages, id. ;
15. Mercredi. – À huit heures du matin, nous apercevons Gibraltar et nous rencontrons un assez grand nombre de bâtiments allant dans toutes les directions. À midi, nous sommes par le méridien de Gibraltar ; nous apercevons bientôt la baie, des bâtiments à l’ancre et une petite partie de la ville ; puis de l’autre côté de la baie, Algésiras. Le détroit de Gibraltar a trente-six milles dans sa plus grande longueur et sept dans sa moindre largeur. Nous laissons à notre gauche Ceuta, où le gouvernement Espagnol retient aux galères les condamnés politiques ; nous serrons de près la côte d’Europe ; on y distingue de distance en distance des tours bâties par les Espagnols, comme défense contre les Maures.
Gibraltar est une énorme montagne oblongue, s’étendant du sud au nord, jointe au continent par une plaine sablonneuse très basse. La ville se trouve sur le penchant nord-est, en sorte que nous ne pouvons en apercevoir qu’une très petite portion. L’eau de la mer perd ici sa teinte transparente et prend une couleur bourbeuse.
La montagne de Gibraltar est le seul lieu de l’Europe ou il y ait des singes. Les habitants disent que lorsque la mer forma le détroit en séparant l’Afrique de l’Europe, les singes qui se trouvaient à la maraude sur cette montagne, ne purent regagner l’Afrique ; que depuis ce temps ils sont restés là. Les Anglais défendent rigoureusement qu’on les tue. Cependant lorsqu’autrefois on a travaillé aux fortifications de Gibraltar, ces animaux ont beaucoup incommodé les travailleurs en leur lançant des pierres.
La vue d’Algésiras nous rappelait un des glorieux combats de notre marine.
En 1801, l’amiral Linois se trouvait mouillé devant Algésiras avec les vaisseaux le Formidable, qu’il montait, le Desaix, l’Indomptable et la frégate la Muiron. Le 6 juillet il y fut attaqué par l’amiral anglais Saumarez, commandant une escadre de six vaisseaux et d’une frégate ; le feu commença à huit heures et demie et dura six heures sans interruption. L’escadre Anglaise désemparée malgré l’inégalité des forces, fut réduite à se réfugier à Gibraltar, abandonnant au pouvoir de la division française l’Annibal, qui s’était échoué près du Formidable.
Dans cette glorieuse action la perte des Anglais s’éleva à 1 500 hommes environ tués et blessés ; l’escadre française comptait 200 hommes tués et 300 blessés, et au nombre des premiers étaient les intrépides capitaines du Formidable et de l’Indomptable.
C’est, au dire des marins les plus expérimentés, un exempte remarquable de ce que peut une armée mouillée et embossée pour attendre l’ennemi ; et cependant une foule d’officiers, même à force égale, proscrivent cette tactique comme funeste, et sont décidés presque en toute circonstance à mettre sous voiles pour combattre.
Actuellement, surtout avec la grande facilité que la marine à vapeur a introduite dans la mobilisation des forces navales, une tactique semblable, qui condamne les vaisseaux au rôle de masses presque inertes, réussirait-elle aussi bien ? La ligne de bataille elle-même, ce point de départ de notre tactique navale, est-elle destinée à régir les dispositions de nos amiraux, elle qui date déjà de plus de deux cents ans, de cette époque où Tromp et Monk, au combat du Texel, occupaient chacun une étendue de près de quatre lieues avec leur longue file de navires rangés dans les eaux les uns des autres.
L’introduction de l’artillerie incendiaire et de la vapeur, ce moteur puissant qui ne tient compte ni du calme ni du vent debout, en rendant les effets d’un premier feu plus destructifs et plus prompts, ne forcera-telle pas à grouper les vaisseaux en peloton de combat, se soutenant vaillamment entre eux ? Cette tactique de Napoléon, que Nelson a appliquée aux combats de mer, c’est-à-dire la concentration rapide et alternative de masses destructives sur des fractions d’armée ennemie, ne produirait-elle pas aujourd’hui, employée contre nous, des résultats plus désastreux encore, si nous persévérions dans les errements de notre vieille tactique ?