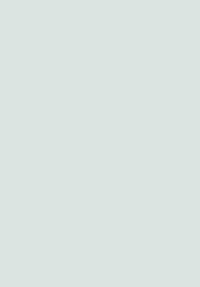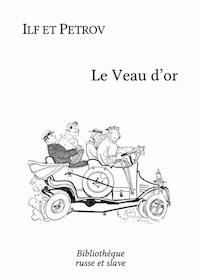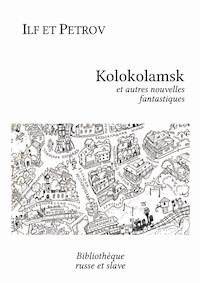
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Dans ces trois nouvelles écrites entre
Les Douze Chaises et
Le Veau d'or sous le pseudonyme de F. Tolstoïevski, Ilf et Petrov utilisent cette fois-ci le fantastique pour tourner en dérision le système communiste de la fin des années 1920 : un homme, devenu invisible malgré lui, devient toujours malgré lui héros de la lutte anti-corruption ; les chroniques de la ville imaginaire de Kolokolamsk fourmillent des prouesses et des merveilles accomplies par ses braves habitants ; et la Schéhérazade moderne, pour échapper aux licenciements causés par la lutte épique entre les camarades-chefs Sataniouk et Fanatiouk, conte chaque jour ouvrable d'édifiantes aventures d'employés soviétiques.
Traduction, notes et postface d'Alain Préchac, 2003.
EXTRAIT DE
KOLOKOLAMSK
Le docteur Letonnerre revint en septembre de Moscou, où il s’était rendu pour affaires. À son arrivée à Kolokolamsk, il boitillait et, au lieu de regagner à pied son domicile, comme il avait accoutumé de faire, prit un fiacre à la gare. La citoyenne Letonnerre fit, en le voyant, preuve d’un considérable étonnement. Celui-ci s’accrut encore lorsque la citoyenne aperçut sur la chaussure gauche de son mari la claire rayure d’un pneu.
— Je me suis fait écraser, déclara gaiement ce dernier. Ensuite, j’ai porté plainte.
Et notre docteur habile en affaires entreprit de conter à sa femme, en l’enrichissant d’une foule de détails inutiles, l’histoire de son bonheur.
À PROPOS DES AUTEURS
Ilia Ilf et
Evguéni Pétrov sont deux auteurs satiriques soviétiques ayant écrit « à quatre mains » et publié sous l'appellation collective de
Ilf et Pétrov. Ils furent extrêmement populaires en Union soviétique dans les années 1920 et 1930.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Ilf et Petrov
Файнзильберг Илья Арнольдович — Катаев Евгений Петрович
1897-1937 — 1902-1942
KOLOKOLAMSK
et autres nouvelles fantastiques
1928-1929
Traduction d’Alain Préchac, 2003.
© Bibliothèque russe et slave, 2017
© Alain Préchac, 2003, 2017
Couverture : Illustration de Konstantin ROTOV accompagnant la parution originale de Kolokolamsk dans le journal « Tchoudak » (1929).
Une personnalité lumineuse
Светлая личность — 1928
I. L’Éphélidine de Babski
IL semblerait qu’il n’existe pas de vocable un tant soit peu ignoble qui n’ait été donné à l’homme en qualité de nom de famille. Heureux celui qui a simplement hérité du nom de Mouton ! Les citoyens Lemouton ou Dumouton ne souffrent pas non plus de manière excessive. Moutonnier, en revanche, connaît une vie nettement plus difficile car on perçoit dans son nom une certaine dérision. À l’école, le jeune Moutonnier aura beaucoup plus de mal à exprimer sa personnalité que Mouton, son camarade grand et fort, Lemouton qui est bon footballeur ou Dumouton, élégant collectionneur de timbres. Quant aux citoyens Moumoute, Moutonnette et Petitmouton, chacun comprend que leur vie ne peut être qu’un enfer1.
L’empire du nom de famille sur l’existence peut se révéler sans limites. Le citoyen Moumoute survivra peut-être à la scarlatine, contractée dans son enfance, mais ne pourra éviter le métier de voleur, qui le conduira à passer ses plus belles années dans des établissements de rééducation par le travail. Qui s’appelle Moutonnette ne peut évidemment pas faire carrière. On connaît le cas d’un camarade Moutonnette qui a essayé de vaincre la malédiction patronymique en se faisant passer pour marxiste : il a fini dans les poubelles de l’Histoire. Les frères Petitmouton, eux, n’ont même pas envisagé la possibilité d’une carrière publique. Fondateurs d’une petite laiterie, ils ont sombré sans gloire dans les vagues de la NEP.
Le héros de notre histoire avait reçu des siens un nom aux consonances cristallines dans lequel il pouvait mettre une pleine confiance : il s’appelait Filiourine. Jamais le sort ne lui avait infligé les situations déplaisantes ou grotesques dans lesquelles se débattaient les Moumoute, Moutonnette et autres Petitmouton. Un soleil sans nuages éclairait l’itinéraire quotidiennement suivi par Yégor Karlovitch Filiourine.
Il brillait un peu plus fort encore que de coutume en ce 15 juillet car c’était le jour où, dans toutes les administrations publiques de Pichtchéslav, on remettait la paie de la quinzaine. Les rues pavées, illuminées par l’astre des cieux, projetaient des reflets éblouissants qui allaient se perdre sous les corniches des modestes demeures des habitants de la cité. Un « cigarettier d’État » en tablier de toile se tenait à l’entrée de la place Timiriazev. Baigné de lumière, il plissait les yeux au-dessus du plateau de verre qu’il tenait devant lui. Un des flancs du cigarettier était affublé d’une caissette en contreplaqué couleur de moutarde qui portait de chaque côté deux inscriptions, l’une brève, explicite et prosaïque — « Boîte à réclamations » —, l’autre bien plus longue et à prétentions poétiques : « Arrête, ô consommateur, ton pas ! Te plaindre de ce cigarettier ne souhaiterais-tu pas ? » La municipalité de Pichtchéslav accordait une importance extrême au bien-être de ses administrés.
À la vue du client qui venait vers lui, le cigarettier se ranima quelque peu. Filiourine lui acheta rapidement vingt-cinq cigarettes estampillées Rebut, tira de sa poche une réclamation toute prête et la glissa dans la fente de la boîte jaune moutarde. C’était là un acte que Filiourine accomplissait chaque jour car c’était un homme à la fibre civique. Parfois il se plaignait du goût âcre des cigarettes Rebut, parfois de la minceur du papier entourant le tabac, à moins qu’il ne s’en prît au tablier « antisanitaire » du cigarettier. S’il n’y avait rien à critiquer, Filiourine glissait dans la fente un mince ruban de papier sur lequel il avait tracé ces mots : « Pas d’insuffisance découverte aujourd’hui. Yé. Filiourine. »
Filiourine tira une bouffée et, s’éloignant du vendeur indifférent, traversa en biais les dalles de la place pour gagner l’ombre rafraîchissante de la statue équestre de Timiriazev.
Le grand botaniste et physiologiste russe avait été représenté sous la forme d’un cavalier galopant sur un cheval en fonte, le bras droit tendu et le poing refermé sur une rhizocarpée. Comme le savant était aussi docteur honoris causa de l’université d’Oxford, on avait placé de biais sur son honorable chef une coiffe carrée pourvue d’un gland qui lui donnait un air très crâne. Sa cape en fonte, qui tombait en faisant de gros plis, devait peser un bon quintal sur ses épaules. Puissamment maintenu par une bride tenue haut, son fier coursier semblait diriger de ses sabots pointés vers le ciel un orchestre invisible. Quant au savant, paisible chevalier des travaux des champs promu cavalier soviétique de la garde, il serrait les flancs arrondis de sa monture entre des bottes à éperons dont les étoiles rappelaient celles qui sont imprimées sur les petites carottes servant à faire la soupe.
Cela faisait un an que l’étonnant monument était venu agrémenter l’ancienne place de la Cathédrale. En l’érigeant, les Pichtchéslaviens voulaient imiter Moscou où, comme chacun sait, une statue pédestre de Timiriazev orne l’emplacement de l’ancienne porte Nicétas. En commandant au sculpteur Schatz une statue équestre, les Pichtchéslaviens avaient voulu damer le pion aux habitants de la capitale. Sans compter que la ville entière, Schatz compris, était persuadée que Timiriazev était un général de brigade héros de la guerre civile.
Schatz avait provisoirement délaissé ses fonctions de gérant d’immeuble, qu’il n’exerçait d’ailleurs qu’en raison du faible niveau des besoins artistiques de ses concitoyens, et avait mis seulement quatre mois pour couler le groupe équestre. Dans le premier état de l’œuvre, Timiriazev tenait dans son poing fermé un cimeterre. Il avait fallu attendre la venue de la commission de réception pour que l’on se rendît compte que Timiriazev était une personnalité civile. On remplaça alors le sabre par une betterave à longue queue, mais le rictus farouche du guerrier ne put être effacé : lui substituer une expression plus civile ou plus scientifique était techniquement impossible. C’est ainsi que le grand agronome demeura à galoper et labourer de ses éperons les flancs de sa monture sur le monument élevé à sa gloire au centre de l’ex-place de la Cathédrale de la ville de Pichtchéslav.
Filiourine tira de sa poche un morceau de velours, essuya la poussière de ses chaussures et s’assit sur le socle en pierre afin de se reposer. Pendant une dizaine de minutes, il resta immobile à calculer mentalement comment il allait disposer de son salaire. Sur les trente-cinq roubles qu’il venait de toucher au service de l’Aménagement du Conseil communal, six lui avaient déjà été subtilisés par des membres de la secte des collecteurs de cotisations. Et il n’allait pas tarder à avoir un entretien pénible avec madame Bezlioudnaïa, sa propriétaire.
Des bruits de claquoir venus du coin de la rue interrompirent ses tristes calculs. Filiourine leva son pur visage et tendit l’oreille. Le bruit grandissait. Des sons de crécelle s’y mêlaient maintenant, ainsi que ce qui ressemblait au fracas de meubles tombant dans un escalier.
C’était l’inventeur Babski qui venait de pénétrer sur la place, à cheval sur un gros vélo en bois. Sa barbe poussiéreuse, séparée en deux comme une culotte de petit enfant, flottait au vent au-dessus d’un épais guidon en bois de sapin. À la vue de Filiourine, Babski amorça un virage serré dans le dessein de s’arrêter, mais l’inertie de sa pesante machine était telle qu’il dut décrire autour du monument deux cercles complets, les jambes écartées, avant qu’elle ne stoppât.
— Vite ! cria Babski.
— Vite quoi ? demanda Filiourine ahuri, en battant l’air de ses cils doux et clairs.
Mais il était trop tard. Le vélo immobilisé avait pris de la bande et s’était effondré sur le côté en entraînant son passager. Babski dégagea sa jambe de la transmission faite de bouts de ficelle et s’adressa en maugréant à Filiourine :
— Je vous avais bien demandé de me tenir mon bicycle ! Je vous prie de considérer que je ne sais pas encore le maîtriser parfaitement ! Il faut améliorer un peu le système de freinage, ainsi que la roue libre.
Ils soulevèrent à deux le vélo, qui pesait une tonne, et l’adossèrent à l’un des quatre ficus en pots qui ornaient les angles du socle.
Babski étira des deux mains les pointes de sa barbe et éclata de rire. Il frappa de la paume sa machine et entreprit de faire l’article à Filiourine :
— Un prix dérisoire ! Pas plus de huit roubles de matériaux ! Je vous prie de considérer que tout est en bois ! Je vais le faire breveter. Le bicycle de Babski ! Qu’est-ce que vous en dites ?
— Qu’il faut en tirer des conclusions opérationnelles, dit Filiourine admiratif.
— Quelles conclusions ?
— Aller boire un coup.
— Ça, c’est toujours possible. Laissez-moi seulement le temps d’aller déposer une demande de brevet.
— C’est l’inventeur qui régale, fit sentencieusement Filiourine.
Sur le fond du soleil qui maintenant déclinait, la silhouette de Babski se détachait comme une motte d’un orange un peu sale. C’était un vieillard de haute taille aux épaules grassouillettes et à la barbe pleine de poussière et de détritus. On prétendait avoir vu un jour une petite souris en sauter furtivement.
Chaque ville a son fou, objet de compassion et d’affection. On en est même plutôt fier. Le « fou de la ville » arpente le boulevard à vive allure, en éructant des paroles que personne ne comprend. Il entre en coup de vent dans une pâtisserie, mais n’a pas le temps d’arriver jusqu’au comptoir que le pâtissier souriant vient à sa rencontre avec un petit gâteau aux amandes qu’il lui présente sur une soucoupe. Le fou s’empare du gâteau et ressort en courant, toujours criant. Les enfants tarabustent le fou de la ville, mais les adultes le traitent avec respect. Il est devenu à leurs yeux une sorte de curiosité touristique, au même titre que le théâtre municipal ou que le superbe boisage de l’artère principale.
Chaque ville a également son inventeur. Là aussi on a pitié de lui, mais on ne l’aime pas : il fait un peu peur. On ne sait jamais ce qui peut lui passer par la tête ! Babski était à la fois le fou et l’inventeur attaché à la ville de Pichtchéslav. Dans la journée, il hantait les administrations, auxquelles il proposait des inventions et perfectionnements sans cesse renouvelés. La nuit, il travaillait dans sa chambrette, dont la fenêtre poussiéreuse donnait sur la rue Torte ; tantôt y grondait une lampe à souder, tantôt c’était un avertisseur sonore qui gémissait.
Babski ne faisait fi de rien. Lorsqu’il en avait fini avec ses expériences sur les klaxons, il inventait un « vaccin » pour rendre les bottes ignifuges. Lorsque celui-ci avait échoué, il se creusait pendant vingt-quatre heures le ciboulot afin de programmer des coups de tonnerre pour le deux centième anniversaire du cirque local. Nouvel échec dans la mise au point de son tonitruant concert : l’infatigable inventeur s’attelait alors au « mouvement perpétuel », avec une pendulette à deux roubles et un samovar cabossé d’une capacité d’un seau et demi. Mais là non plus, la réussite n’était pas au rendez-vous.
Alors, Babski mélangea divers produits et fabriqua une savonnette expérimentale pour faire partir les éphélides, ou taches de rousseur. Il allait déjà la porter aux services pharmaceutiques, qui devaient la soumettre à des essais, lorsque l’idée de fabriquer un vélo en bois lui traversa l’esprit. Il passa trois jours à le mettre au point et le bicycle de Babski sortit de ses mains. La savonnette oubliée resta pendant tout ce temps à chauffer dans sa poche. De jaune d’œuf qu’elle était au départ, elle devint peu à peu d’un bleu azuré, mais personne ne le savait.
— Dites-moi, Babski, demanda Filiourine en aidant l’inventeur à se hisser sur l’un des pots de ficus, inventer, c’est difficile ?
Babski passa douloureusement du pot sur la selle en osier de son vélo.
— Archifacile, lui répondit-il en ahanant.
On entendit un bruit de tonnerre et la machine en bois roula à nouveau en frémissant sur les dalles de la place Timiriazev.
— Et qu’est-ce que cela rapporte, par mois ? cria Filiourine en courant après lui.
— Dans les soixante roubbb !... entendit-il à travers le fracas.
Et le bicycle de Babski disparut dans la fournaise aveuglante du soleil couchant.
Filiourine s’apprêtait à poursuivre son chemin et avait déjà fait quelques pas dans la direction de son domicile lorsqu’une petite boîte roula sous ses pieds avec un bruit métallique. Filiourine l’éleva jusqu’à ses yeux et la tourna entre ses mains. C’était une boîte de poudre dentifrice parfaitement ordinaire, mais qui contenait une savonnette du bleu le plus tendre.
« C’est Babski, à coup sûr, qui l’a laissée tomber, pensa Filiourine. Je me demande bien combien cela peut coûter ? »
En dehors du bureau, le cerveau de Filiourine fonctionnait plutôt au ralenti. Les mêmes questions lui trottaient absurdement par la tête : combien tel ou tel objet coûtait, combien on le payait moins cher à l’étranger et combien son interlocuteur gagnait. Avec les demoiselles, il se réveillait un peu et abordait des sujets émouvants, comme l’amour et la jalousie. Mais, même avec elles, les conversations sur les bancs publics ne lui réussissaient que jusqu’à la venue de l’obscurité, moment qui coïncidait avec le début de la période de silence lyrique.
La savonnette bleue rappela à Filiourine qu’il voulait se rendre aux bains. Son agenda, ce soir-là, prévoyait une soirée amicale avec « conclusions opérationnelles », c’est-à-dire bière et vodka. Aussi quitta-t-il rapidement la place pour se rendre aux Bains de la noblesse, en passant auparavant chez lui pour prendre une serviette et un gant éponge.
À Pichtchéslav, le prix moyen de la location d’une chambre était de huit à neuf roubles. Madame Bezlioudnaïa n’en demandait pas plus de quatre à Filiourine, car madame apprenait le chant et ses vocalises diminuaient sensiblement la valeur de la chambre. À ce moment de notre récit, madame était justement à son piano et beuglait avec un tel entrain en étalant ses dents en or que Filiourine réussit à passer dans le couloir sans être remarqué, ce qui lui évita de donner des explications au sujet de son loyer.
Il y avait longtemps qu’il ne l’avait pas payé car il économisait pour s’acheter un costume. Lorsqu’il ressortit en courant de la maison, tout lui souriait : les quatre roubles qu’il avait sauvés de la poche de sa logeuse aux dents d’or, la réclamation justifiée qu’il allait déposer dans la boîte des bains publics, le bain qui le débarrasserait de la crasse accumulée en deux semaines et la soirée où il se rendrait alors. Une gaieté sans pareille l’y attendait au milieu de ses collègues du service de l’Aménagement. Le dernier rayon de soleil encore large et chaud se posa sur la nuque rasée de Filiourine.
Des dizaines de milliers de personnes telles que Filiourine, qui ont la nuque rasée, le visage pur et les yeux gris, mènent la vie la plus ordinaire qui soit, vont régulièrement aux bains, paient ponctuellement leurs cotisations syndicales, tout en n’allant pas aux réunions, s’amusent consciencieusement en compagnie de leurs collègues de travail et se fixent pour règle de ne pas payer leur loyer. Mais ce n’est pas eux que le destin a choisis, pas à eux que l’Histoire a permis de sortir de l’anonymat pour des affaires grandes et merveilleuses.
Le firmament magnifiquement réglementé de l’Administration se déploie au-dessus de notre pays. Des myriades de services scintillants s’étendent d’une de ses extrémités à l’autre comme une ceinture d’étoiles ; plus nombreuses encore, les myriades des sous-services, poussière électrique, jettent les faibles lueurs de leurs voies lactées. Des nébuleuses financières luisent d’une lueur blanchâtre et clignotent avec charme, attirant à elles des regards emplis d’espoir. Des comètes aux longues queues traversent le ciel : ce sont les commissions2. Et par des nuits d’août emplies d’appréhension, des étoiles licenciées se mettent à tomber du ciel. Certains météores qui n’ont pas eu le temps de se vaporiser après combustion atteignent la terre frivole et choient directement sur le banc des accusés. Il y a aussi des étoiles chargées de mission qui errent interminablement, attirées qu’elles sont par telle ou telle organisation stellaire. Un jour ou l’autre la queue d’une comète de contrôle leur règle leur compte.
Grand est le ciel étoilé de l’appareil national, vaste le choix des constellations. Mais pour opérer les vastes transformations réservées à la ville de Pichtchéslav, le sort avait choisi une minuscule et presque invisible étoilette, dont la lueur n’avait pas encore atteint la Terre. Il avait choisi Yégor Karlovitch Filiourine, mandoliniste et locataire à la cloche de bois, modeste « enregistreur » au Conseil communal3.
En entrant aux bains de vapeur, Filiourine ne se doutait pas encore qu’il en ressortirait grandi. Aussi se comportait-il comme il faisait ordinairement : il avait choisi un banc dans un coin et entrepris de se déshabiller sans hâte. Il avait défait la ceinture en tissu de sa demi-blouse « à la Tolstoï », ôté sa cravate à nœud permanent, avec la barrette métallique qui la maintenait en place, enlevé sa chemise à plastron en piqué à rayures puis retiré son pantalon qui tintait comme un harnais, dû aux nombreuses rondelles en fer que Filiourine transportait dans ses poches pour remplacer les pièces de dix kopecks dans les distributeurs, et s’était retrouvé entièrement nu. Puis il avait passé quelque temps à se masser les épaules et les flancs, tout en laissant son corps se refroidir et en jetant des coups d’œil dédaigneux autour de lui. Il n’y avait dans les bains personne de connaissance. Ayant jeté sur l’épaule sa serviette, Filiourine prit alors la savonnette bleue de Babski et entra dans le local où l’on se savonnait.
Babski avait déposé pendant ce temps aux guichets de la direction Économique régionale sa demande de brevet, puis il avait hâtivement donné à la foule amassée à la porte de la direction des Explications concernant la supériorité du vélo en bois de sapin sur son homologue métallique, et dévalait maintenant avec fracas l’avenue du Cheval de Prjévalski. C’était l’heure crépusculaire où, entre deux rangées de tilleuls gris de poussière, se promenaient les Pichtchéslaviens. Habitués qu’ils étaient aux excentricités de l’inventeur, les citoyens accompagnaient le bicycle de regards indifférents.
En tournant au coin de la place, Babski heurta un homme à la chemise boutonnée sur le côté. La victime chancela quelque peu.
— Ah, c’est vous, camarade Lialine ! fit Babski sur un ton apaisant. Je voulais justement passer vous voir aux services pharmaceutiques.
— Vous avez encore inventé quelque chose ? grommela Lialine en frottant sa hanche endolorie.
— Absolument ! Un savon contre les taches de rousseur. L’Éphélidine de Babski ! Je vais vous le montrer. Je vous prie de considérer que la ville entière ne parle que de cela. Tenez-moi mon bicycle.
Et l’inventeur, les mains libérées, se mit à fouiller dans ses poches à la recherche de son Éphélidine. Mais ni dans la veste, ni dans le gilet, ni dans le pantalon, aucune de ses quatorze poches ne recélait la petite boîte métallique à la savonnette bleue.
— Vous me l’apporterez demain au bureau, lui dit Lialine, impatient. On étudiera la question.
— Permettez, permettez, fit l’inventeur dans tous ses états, où a-t-elle bien pu passer ? Permettez ! Où suis-je donc allé ? J’ai dû la laisser à la direction Économique. Attendez-moi ici, je reviens dans un instant !
Et ayant pris appui pour se lancer sur le directeur des services pharmaceutiques, Babski repartit à une vitesse insensée le long de l’avenue du Cheval de Prjévalski. Malheureusement pour lui, les portes étaient déjà fermées. Empli d’une profonde tristesse à l’idée de la perte de son Éphélidine, il roula alors au hasard dans les rues de la ville à grands bruits de crécelle.
Filiourine, sur ces entrefaites, se savonnait. Il avait attendu assez longtemps qu’un baquet se libérât, s’était abondamment aspergé d’eau chaude et se savonnait maintenant avec volupté, les yeux mi-clos et en faisant mousser le plus possible la savonnette bleue de Babski qui répandait une inquiétante odeur de térébenthine.
« Un savon pharmaceutique, pensait-il avec satisfaction tout en gardant les yeux fermés et en jappant de jouissance. Sûr qu’il ne coûte pas moins de quarante kopecks. »
Filiourine sentait son corps devenir léger. C’était une sensation agréable et qui faisait monter en lui une légère ivresse. Il pensait à des choses fort agréables, du genre d’un voyage autour du monde qui ne lui aurait coûté qu’un demi-rouble. Et l’impression qu’il disparaissait et se dissolvait dans la chaleur de l’établissement thermal montait en lui.
Il se produisit alors une chose des plus étranges. L’inspecteur de la milice Adamov, qui se lavait non loin de lui et venait de se savonner la tête avec du savon de ménage, regardait justement dans sa direction. Il avait déjà vu Filiourine pour des affaires administratives et il lui sembla soudain que la tête de cet homme connu de lui avait disparu et que seul son corps se lavait !
Adamov se rinça rapidement les yeux, collés par la mousse, et lorsqu’il l’eut fait constata que, dans l’angle de la pièce où Filiourine se tenait un instant plus tôt, il n’y avait plus personne. Seuls dansaient quelques flocons de vapeur trouble, tandis que le lourd baquet roulait tout seul sur le sol au plan incliné.
Le milicien Adamov fut si ahuri par ce qui était arrivé qu’il eut un réflexe professionnel : tirer de sa poche un sifflet et appeler à la rescousse tous les concierges des environs4. Mais le sifflet, avec tout le restant de son équipement réglementaire, était resté dans le vestiaire. En outre, d’autres corps nus rampaient déjà vers le baquet devenu libre. Adamov se précipita vers le récipient, s’en empara le premier et, oubliant aussitôt Filiourine, continua à se livrer aux joies du bain de vapeur.
De son côté Filiourine, qui avait toujours les yeux fermés, était allé vers le robinet. Remplissant ses mains d’eau froide, il se lava le visage. Ce qu’il vit, ou plutôt ne vit pas en rouvrant les yeux, et qui n’était rien moins que ses bras, ses jambes, son ventre et ses épaules, le plongea dans la stupeur. Terrifié, il courut sous la douche. Il sentait bien le savon glisser le long de son corps sous la petite pluie tiède qui lui tombait dessus, mais son corps proprement dit continuait à ne plus être là.
Une peur inconnue de lui jeta Filiourine vers le vestiaire, où se trouvaient ses vêtements mais aussi un miroir. Il ne put s’y voir : il avait disparu. Et tout en ne se reflétant plus dans le miroir, il savait qu’il était debout devant lui et pouvait le toucher à sa guise.
La situation où il se trouvait était affreuse, mais il n’eut pas le temps d’y penser davantage car, s’il ne se voyait plus dans le miroir, il apercevait parfaitement deux silhouettes suspectes qui venaient d’entrer dans le local, en provenance de l’entrée. Croyant le vestiaire vide, elles s’emparèrent du premier tas de vêtements venu et s’enfuirent lestement.
— Arrêtez ! leur cria Filiourine en reconnaissant le son produit par son pantalon.
Sa voix était restée la même : filiourinienne.
Furieux, il se lança à la poursuite des détrousseurs. Les voleurs filaient à toutes jambes en direction de la ville neuve.
L’enregistreur municipal devenu invisible courait derrière eux à perdre haleine.
Il s’était produit un événement aussi étonnant qu’inexplicable. Un jeune homme de vingt-six ans, employé modèle à la santé florissante, avait perdu simultanément tout ce qu’il possédait : sa demi-blouse « à la Tolstoï », sa cravate à nœud permanent et son propre corps. Il ne restait plus à Filiourine que ce dont il n’avait jamais eu besoin : son âme.
La ville, qui ne se doutait encore de rien, continuait à mener son existence ordinaire. On entendait dans le silence nocturne provenir du club des mariniers les sons énergiques de l’ouverture de Carmen, qu’un orchestre russe exécutait sur dix-sept cithares orientales.
II. « Volens-nolens »
Jusqu’à l’aube, l’enregistreur municipal invisible erra dans des rues si éloignées du centre que, même en 1928, on n’avait pas eu le temps de les rebaptiser. Il ne rattrapa pas les voleurs. Mais la poursuite de sa garde-robe avait-elle encore un sens ? Au bout de six bons kilomètres de course, Filiourine comprit enfin qu’un fantôme n’avait pas besoin d’habits. Cependant, le pire était encore à venir : il devait être au travail à neuf heures.
Il décida donc de se rendre immédiatement chez Babski afin d’exiger de lui la restitution de son corps avant l’ouverture des bureaux au service de l’Aménagement.
Une vingtaine de minutes plus tard, l’inventeur Babski se réveilla à cause du froid. Sa fenêtre était grande ouverte et le vent du petit matin chassait dans un coin de la pièce des copeaux qui s’arrondissaient en boucles.
— Camarade Babski ! entendit l’inventeur. Camarade Babski !
Babski sauta à bas du lit et courut vers la fenêtre. La rue était vide et propre. Une rosée froide, couleur de plomb, brillait faiblement à la pointe de la feuille des arbres.
— Voyous ! s’écria l’inventeur, en claquant la fenêtre. C’est quand même un peu fort !
— Camarade Babski ! entendit-il derrière lui. C’est parce que je suis allé aux bains...
Babski s’assit sur le rebord tout éclaboussé de la fenêtre et contempla, ahuri, l’intérieur de la pièce. Il n’y avait personne.
— Qui est allé aux bains ? demanda-t-il doucement.
— Moi, répondit la chaise.
Babski se leva, s’approcha de la chaise sur la pointe des pieds et, tendant l’oreille, demanda avec une extrême curiosité :
— C’est vous qui êtes allée aux bains ?
La chaise ne répondit rien. Babski entendit en revanche derrière son dos une petite toux gênée et la même voix que précédemment prononça d’un ton implorant :
— Je suis par ici, camarade Babski. C’est parce que je ne suis pas visible.
— Qui n’est pas visible ? fit l’inventeur avec irritation.
— Moi, Filiourine.
— Permettez, pourquoi donc n’êtes-vous pas visible ?
— C’est parce que je suis allé aux bains, et maintenant je dois me rendre au travail à neuf heures, mais je ne suis pas visible.
Et Filiourine se mit à donner des explications molles et incohérentes sur sa propre disparition. Peu à peu le visage de Babski s’était éclairé et animé.
— Vous dites que vous vous êtes savonné ? demanda-t-il en tirant sur sa barbe. Très intéressant, d’un point de vue scientifique !
— Mais comprenez, insista Filiourine : à cause de votre savon, je ne peux plus maintenant aller au travail !
— J’y suis pour quoi, moi ? Vous avez pris mon Éphélidine sans rien me demander. Mais que le diable vous emporte, je ne suis pas avare. Seulement dites-moi : le savon a bien fait son effet ? Les taches de rousseur ont disparu ?
— Elles ont disparu, fit l’invisible avec obséquiosité. Mais moi aussi j’ai disparu, camarade Babski. Mettez-vous un peu à ma place !
Des sanglots étouffés retentirent dans la pièce.
— Je n’y comprends rien, raisonnait à voix haute l’inventeur. Mon savon est seulement contre les taches de rousseur...
— Dites-moi, vous pourriez peut-être faire en sorte que je réapparaisse ?
— Peut-êêêtre... Il faut y réfléchir. Où êtes-vous actuellement, jeune homme ? Si c’est sur la chaise, je m’assiérai sur le lit, car je ne serais pas long à vous écraser.
— Je suis debout.
— B-bien. Restez où vous êtes. De mon côté, je vais réfléchir.
Pendant une demi-heure, la pièce résonna d’interjections et de bouts de phrase... L’inventeur semblait laisser sa barbe penser pour lui.
— Il est déjà sept heures moins le quart, remarqua en geignant l’invisible. Non seulement je n’ai pas dormi de la nuit, mais votre savon va me faire arriver en retard à mon travail.
Babski se leva, secoua à deux mains sa barbe, comme on secoue des vêtements, et prononça avec force :
— Arrêtez de me casser la tête ! Je vais peut-être porter plainte contre vous pour vol de savon ! Je ne peux pas faire en une demi-heure une découverte aussi importante que la reconstitution des corps. Même en cinq ans, je n’y arriverais peut-être pas.
Filiourine devait être dans une grande agitation car la chaise tomba et des morceaux de bois, pièces détachées du bicycle, s’envolèrent de l’établi.
— Fiche-moi le camp, voyou ! hurla Babski. Allez, du balai !
La fenêtre s’ouvrit toute seule et la voix insipide de l’invisible parvint alors de la rue :
— C’est moi qui vais porter plainte contre vous !
— Essaie un peu ! Il me vole mon savon et en plus il n’est pas content !
— Vous n’avez pas le droit de faire ce que vous faites ! se rengorgea la rue vide. Vous en répondrez comme d’un meurtre !
— Sale petit voleur ! lui cria l’inventeur, penché à sa fenêtre. C’est bien fait pour toi !
La fenêtre se referma avec fracas. Babski tourna en rond pendant une dizaine de minutes pour se calmer puis, parvenu à la conclusion que son Éphélidine avait acquis ses étranges propriétés en fermentant dans son récipient métallique, alluma son fourneau et se mit séance tenante à fabriquer une autre savonnette, en reconstituant de mémoire les ingrédients.
Après avoir bien gémi sur son sort, l’enregistreur invisible s’était mis en route le long de la rue Torte. La ville s’était maintenant éveillée. Filiourine vit passer une camionnette de la fourrière pleine de chiens errants. Les chiens, sentant sa présence, aboyèrent et glapirent.
L’heure des employés soviétiques approchait et le pauvre Invisible ne savait toujours pas ce qu’il devait faire. Il arriva place Timiriazev, où le cigarettier d’État était déjà à son poste. Tout comme la veille, son éventaire brillait et la boîte à réclamations attirait le voyageur fatigué. Mais rien de tout cela n’était désormais pour lui.
Brusquement, bien trop rapidement, tout s’était modifié dans la vie du petit enregistreur. Ou plutôt arrêté. Privé de nourriture, de boisson, de tabac, d’amour, de promotions dans le travail, de la possibilité d’éblouir les autres par sa toilette ou son apparence physique, il ne lui restait plus qu’une faculté : celle de penser. Mais elle ne lui avait jamais beaucoup servi.
Épouvanté, ahuri, il se retrouva soudain devant une grande publicité accrochée à deux poteaux. Un homme vêtu de la même demi-blouse que celle qu’il portait la veille encore courait avec, dans sa main tendue, un billet blanc de dix roubles. On pouvait lire cette légende :
Que les autres personnes aillent où elles voudront,
À la caisse d’épargne nous autres nous irons5!
« Et moi ? pensa amèrement l’invisible. Où vais-je aller ? »
Le désespoir au cœur, Filiourine se précipita chez lui. Il jeta un coup d’œil par la fenêtre et aperçut Mme Bezlioudnaïa, déjà assise à son piano, qui laissait lourdement choir sur les touches ses mains potelées. Les cloches de l’angélus se déversaient en un flot continu de sa bouche aux dents d’or : madame travaillait le son i.
« Où vais-je aller ? murmura l’invisible. Je ne peux quand même pas me rendre au travail dans cette tenue ? »
En cet instant, pourtant, à pied, à cheval ou en voiture, toute la ville se rendait au travail. Filiourine vit passer une automobile où se tenaient Caïn Alexandrovitch Dobroglassov, chef du service de l’Aménagement où il travaillait, en compagnie de ses deux fils : Athanase Caïnovitch, du service des Espaces verts, et Pavel Caïnovitch, qui travaillait à la Perception.
« Je vais y aller, décida-t-il enfin. Ce n’est quand même pas de ma faute ! Je vais tout leur expliquer. Qu’ils me fassent passer devant la commission, s’ils y tiennent ! »
Le service de l’Aménagement occupait cinq pièces dans un ancien hôtel particulier à un étage de la Millième rue. Chaque pièce possédait une grande cheminée en marbre et, comme on ne chauffait pas, c’était là que l’on conservait les petits dossiers ficelés et les gros classeurs ventrus.
Au moment où Caïn Dobroglassov arrivait au service municipal confié à ses soins, tous ses subordonnés étaient déjà réunis. Seul manquait l’enregistreur chargé du cadastre. Le chef enveloppa d’un regard critique le bureau de l’enregistreur, jeta un coup d’œil à la pendule hexagonale dont il compara l’heure à celle de sa Moser puis demanda :
— Quoi ? Filiourine est malade ?
Le chef comptable Eusée Lvovitch Ioannopolski se trouvait alors à ses côtés, occupé qu’il était à faire des annotations dans le Grand registre ; il fit remarquer qu’il n’était au courant de rien à ce sujet.
— Je ne sais pas, fit le chef d’une voix neutre. Il me semble que ce n’est pas la première fois. Volens-nolens, il faut que l’évince6.
La dernière phrase avait été prononcée avec une délectation particulière. C’était là une expression qu’il avait entendue en 1923, lorsque Pichtchéslav avait reçu la visite d’un haut responsable dans le domaine de l’aménagement des parcs publics. L’expression latino-russe avait été employée à son endroit pour cause de négligences et Caïn en avait retiré la conviction que son visiteur ne pouvait être qu’un personnage de très haut rang, peut-être même une personnalité historique7.
L’orage passé, Caïn avait décidé d’immortaliser la venue à Pichtchéslav de l’illustre visiteur. Et comme celui-ci avait parcouru la ville à bord du tramway n° 2, ce dernier fut retiré du service et mis au musée de l’Aménagement avec la plaque commémorative suivante :
DANS CE WAGON, LE 28 SEPTEMBRE 1923,
LE CAM. OBMICHOURINE S’EST RENDU À LA GARE.
Après cet excès historique, il n’y eut plus que deux wagons de tramway qui circulèrent à Pichtchéslav car ils étaient, en tout, au nombre de trois. Les Pichtchéslaviens se dirent avec effroi que, si le camarade Obmichourine prenait l’habitude d’inspecter leur administration municipale, la circulation des tramways pourrait cesser définitivement.
Caïn était depuis longtemps dans son cabinet, où il trempait sa plume dans un encrier en bronze à cent roubles dénommé Face au village (petite isba de rondins avec porte battante et Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! inscrit en caractères slavons), que son subordonné Eusée Ioannopolski était encore à se remettre de l’angoisse qui l’avait étreint.
La position qu’Eusée occupait au service était des plus instables. On pouvait l’éjecter à tout moment, quoiqu’il y travaillât avec abnégation depuis plus de sept ans. L’origine de la chose était une idée fixe entrée dans la tête de Caïn après un procès pour l’exemple qui avait eu lieu deux ans plus tôt dans la ville, où l’on avait jugé un certain Ivanopolski, administrateur du POUM8, coupable d’avoir puisé dans la caisse du magasin. Caïn s’était dès lors persuadé qu’Ivanopolski et Ioannopolski étaient une seule et même personne. À chaque réduction d’effectifs, Caïn demandait invariablement le licenciement du chef comptable en appuyant sa demande du cri : « Nous n’avons pas besoin ici d’un administrateur du POUM ! » On lui représentait alors que Ioannopolski, Eusée Lvovitch, n’avait rien à voir avec Ivanopolski, Piotr Kallistratovitch, que pendant que le second était sur le banc des accusés, le premier venait ponctuellement au travail à neuf heures du matin et que le voleur avait finalement été condamné à dix ans de prison, qu’il purgeait en travaillant au secrétariat de l’administration pénitentiaire9. Caïn se calmait alors, mais pour un temps seulement.
À la réduction d’effectifs suivante, Caïn se levait et demandait, la voix lourde de reproches : « Pourquoi Ivanopolski travaille-t-il chez nous ? Pourquoi employons-nous un administrateur du POUM ? Il faut le licencier sans perdre une minute ! » On démontrait à nouveau à Caïn qu’un abîme séparait Ioannopolski, comptable émérite, de l’escroc Ivanopolski, connu de la ville entière. Caïn regardait son interlocuteur de ses yeux blancs comme l’émail et lui demandait : « Vous avez terminé, camarade ? Maintenant dites-moi, je vous prie, pourquoi nous employons un administrateur du POUM ? Volens-nolens, il faut que je l’évince. »
Pour toutes ces raisons, Eusée Ioannopolski n’appréciait guère les perturbations qui venaient affecter le service. Les autres non plus d’ailleurs, que ce fût Lidia Fiodorovna, une vieille fille aux cheveux rares et frisés, Kostia qui était le plus jeune de tous ou encore le camarade Ptachnikov, un guérisseur pichtchéslavien qui figurait sur les listes du personnel en qualité d’« instructeur chargé de mission ».
Ce personnage mérite quelques commentaires. On trouve des employés tels que lui dans chaque ville, et même chaque administration. Ce sont généralement des étudiants en médecine qui n’ont pas achevé leurs études, ou bien des parents de médecins, parfois de simples amateurs de choses et conversations médicales. Les employés s’adressent à eux de préférence parce qu’ils sont persuadés que les médecins des assurances sociales ne valent rien et ne tiennent pas compte des dernières découvertes de la science médicale. Ils pourraient consulter des médecins privés, mais ils les considèrent comme des profiteurs qu’il vaut mieux ne pas fréquenter. Les seuls dignes de confiance seraient les professeurs de faculté, mais leurs moyens ne leur permettent pas d’avoir recours à eux. On s’adresse donc à de simples étudiants en médecine. Ceux-ci sont prodigues de conseils, ne demandent pas d’argent et, tout auréolés qu’ils sont de la gloire qui revient à leur parent ou ami médecin, passent pour d’inégalables puits de science. Tel était donc le cas de Ptachnikov, magnifique sorcier-guérisseur administratif, un homme compétent et désintéressé dont le bureau aux pieds minces voisinait avec celui de Filiourine. Une grande partie du respect qu’il inspirait venait de sa qualité de fils du cousin d’un médecin généraliste bien connu à Léningrad.
Caïn une fois calmé et enfermé dans son cabinet, Eusée tout remué par l’incident était allé trouver Ptachnikov.
— Alors ? fit ce dernier, en arrêtant la course de sa plume et en tournant vers son collègue son visage rond. Et l’adrénaline ?
— Je me suis fait faire une injection, comme vous me l’avez dit. Mon nez va maintenant très bien, mais vous savez, Ptachnikov...
Après l’avoir ausculté, puis examiné ses poches sous les yeux, Ptachnikov prononça d’un air préoccupé :
— Il vaudrait mieux, bien sûr, consulter un professeur. Par exemple Nievstrouïev.
— Mais quand même ? insista Eusée.
— Je ne sais pas. Je crois que vous avez une intoxication urinaire.
Les joues d’Eusée devinrent roses comme des fraises.
— Urinaire, vous croyez vraiment ?
— Vous savez, ce serait quand même mieux que vous consultiez Nievstrouïev. C’est peut-être nerveux.
— Pas étonnant, ici, remarqua Eusée en désignant du regard la porte du cabinet du chef. Mais vous, qu’est-ce que vous en pensez vraiment ?
— Je pense que c’est quand même une intoxication. Demandez son avis à Nievstrouïev, ou bien faites une analyse d’urine. Vous avez peut-être de l’albumine.
Eusée complètement abattu revint à son bureau, se hissa sur son haut tabouret à vis poli par les ans et reprit son report des comptes sur les pages du Grand registre.
— Et Filiourine, alors ? demanda quelqu’un, dans un coin. Il faudrait le remplacer au cadastre. Il y a déjà trois ou quatre personnes qui attendent10.
Plusieurs personnes se tenaient en effet derrière la barrière protégeant le bureau de Filiourine et jetaient des regards plutôt mécontents.
— Les « alcooloïdes », fit en ricanant Ptachnikov. Il a dû picoler.
— Certainement pas, objecta Kostia. Nous l’avons attendu hier toute la soirée. On était toute une bande, mais il n’est pas venu. Il nous a gâché la fête : il devait jouer de la mandoline et nous, on aurait dansé.
Ah, si Kostia avait su à quoi ressemblait désormais celui qui, la veille encore, agitait si brillamment le médiator ovale et produisait des sons si entraînants, la caisse ronde et striée de l’instrument pressée contre son ventre ! Qu’elle était loin de Filiourine, la valse Rêve d’automne qu’il avait eu tant de mal à apprendre en système chiffré !
— Au fait, Ptachnikov, dit Kostia inquiet, je deviens aveugle.
— Allons bon ! fit l’« instructeur chargé de mission », vous n’arrêtez pas de vous inventer des maladies.
— Si, si, je vous assure. Cela fait trois jours que j’ai des taches multicolores devant les yeux.
— Très bien, on va voir cela. Donnez-moi votre poignet. Mais vous avez le pouls normal ! Les battements sont réguliers. Vous ne perdez pas la vue. Allez plutôt demander à Dobroglassov qui mettre à la place de Filiourine : les gens attendent.
Au même instant l’enregistreur invisible, dont l’entité transparente tremblait de peur, grimpait l’escalier en fonte du Conseil municipal.
« Ah, que va dire Caïn Alexandrovitch ? » pensait-il avec angoisse.
III. « À la caisse d’épargne nous autres nous irons ! »
L’arrivée de l’invisible au service de l’Aménagement avait entraîné un incroyable charivari. Au début, on ne comprenait strictement rien. Seules émergeaient de l’ensemble la voix de Caïn et celle, fluette et tremblotante, de Filiourine.
— Ce n’est pas possible ! criait le chef.
— Je vous assure ! se défendait l’enregistreur. Demandez à Babski !
Les employés couraient d’une pièce à l’autre, le visage écarlate, et faisaient la même réponse à toutes les questions des visiteurs : « Mais allez-vous en ! Vous ne voyez pas ce qui se passe ? Revenez demain ! »
Tout s’était arrêté. On ne donnait plus de renseignements. La caisse ne fonctionnait plus et, dans la pièce de derrière, la bouilloire Titan s’était éteinte. Les employés pensaient à autre chose qu’à se faire du thé. « C’est du bureaucratisme ! » criaient les clients, qui n’y comprenaient rien.
Personne, d’ailleurs, ne comprenait rien à rien.
Les employés s’étaient massivement regroupés près du cabinet de Caïn, avec à l’arrière-garde le craintif Eusée qui ne cessait de chuchoter : « Quoi ? Qu’est-ce qu’il a dit ? C’est Filiourine qui a dit ça ? Et Caïn, qu’est-ce qu’il a répondu ? C’est à devenir fou. Quoi, on ne le voit plus du tout ? Il a renversé une chaise ? Et Caïn ? Vous savez, Caïn a tort. On n’a pas le droit de crier comme cela après un innocent. Il est vrai qu’avec son caractère soupe au lait... »
Ayant bien fait le siège de l’invisible complètement désemparé, Caïn fit soudain la remarque suivante :
— Après tout, le syndicat n’a qu’à se débrouiller.
— Je ne demande qu’une chose : qu’on étudie mon cas.
La voix de Filiourine s’élevait timidement du sol, à croire qu’il était à genoux. Mais Caïn ne se laissait pas faire aussi facilement :
— On ne peut étudier le cas que d’une personne vivante. Où êtes-vous ?
— Je suis ici.
— Vous ne pouvez pas le prouver ! Je ne vous vois pas. Je ne peux donc pas vous laisser reprendre votre travail. Adressez-vous à la sécurité sociale.
— Mais je suis en parfaite santé !
— Raison de plus. Volens-nolens, cette fois je vous évince.
Les employés s’entre-regardèrent. « Il se croit tout permis, chuchota Eusée. Il n’a pas le droit, sans l’accord du syndicat ! »
— Oui, oui, Filiourine, poursuivait Caïn. J’ai mon compte avec l’administrateur du POUM. Il faudrait encore que je garde un employé invisible ! Faites une demande d’arrêt maladie et allez-vous en. Partez, partez ! Vous voyez bien que je suis occupé.
— On m’a tué ! On m’a volé mon corps !
— Raison de plus pour vous adresser à la sécurité sociale. Elle vous donnera de l’argent pour votre enterrement.
— On n’enterre pas les personnes vivantes.
— C’est un paradoxe, camarade. Le service de l’Aménagement n’a pas de temps à perdre avec des paradoxes. Il a assez à faire avec les affaires courantes. La Commission des litiges financiers décidera de ce qu’il y a à faire. Vous êtes parti ?
Filiourine n’avait pas demandé son reste. Le mot « paradoxe » avait fait sur lui un effet désastreux. Quittant le cabinet du chef, il s’était retrouvé parmi ses collègues de travail qui s’étaient aussitôt éparpillés dans toutes les directions aux cris de : « Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? »
— Ici, près de l’arithmomètre. Regardez : je viens de soulever le presse-papiers et Caïn dit que je n’existe pas. Je suis capable de travailler.
Les questions effrayées des employés, et les réponses qui ne valaient guère mieux de Filiourine, permirent d’établir les faits suivants : l’enregistreur n’avait pas besoin de manger, ne ressentait pas le froid malgré l’état de nudité dans lequel il avait disparu, sentait son corps lorsqu’il le touchait, alors qu’il avait en principe disparu, et ne comprenait absolument pas avec quoi il venait de soulever le presse-papiers. « Ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas vrai ! » n’arrêtait-il pas de répéter.
Mais l’événement était si extraordinaire qu’on n’arrivait plus à trouver de sujet de conversation. On se mit rapidement à s’ennuyer.
— Alors, quoi de neuf au service ? demanda Filiourine, quoique la nouvelle de sa propre disparition fût le seul événement marquant depuis un an.
— Rien, répondit Eusée. On dit qu’il va y avoir une nouvelle grille des salaires.
— Cela fait trois ans qu’on en parle, fit de derrière l’arithmomètre l’invisible complètement abattu.
— Oui.
— Vous savez, on m’a aussi volé ! Je ne vous mens pas, on m’a tout pris !
— Vous avez fait une déclaration à la milice ?
— À quoi cela m’aurait-il servi ? prononça amèrement l’invisible. Je n’en ai plus besoin, maintenant...
— Vous avez tort, Yégor Karlovitch. Si tout le monde en fait autant, les voleurs se croiront tout permis !
Filiourine regarda autour de lui. Rien n’avait changé. C’était toujours le même cadre, hier encore fastidieux, mais qui lui semblait maintenant infiniment cher et irremplaçable, avec le boulier aux rondelles en bois de palmier, la perforatrice noire, les règles en laiton aux bords tranchants et le gros, le merveilleux livre du cadastre.
— Comment donc est-ce arrivé ? demanda Eusée. Racontez-nous cela en détail.
Filiourine raconta à nouveau ce qu’il avait déjà développé à Caïn. Mais comme les employés massés à la porte du cabinet du chef l’avaient déjà entendu, cela leur sembla moins étonnant la seconde fois.
— Cela arrive, cela arrive, prononça le caissier. Les gens ont beau dire, il arrive des choses bien étranges de par le monde. Ma grand-mère, par exemple, avait vu trois cercueils juste avant de mourir.
— Des histoires de bonne femme ! fit l’invisible.