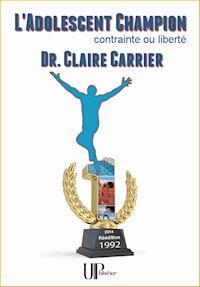
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Adolescence, sport et succès, comment tout gérer ?
Au centre de l’attention du public et des médias, le champion est désormais investi d’une fonction qui dépasse largement le champ sportif ; icône moderne, il véhicule une image de réussite sociale, particulièrement forte chez les jeunes. A « l’âge du passage entre l’enfance et l’âge adulte », l’adolescent champion doit relever un double défi : l’accès à l’identité d’adulte, accomplissement naturel de l’adolescence et l’accès à l’identité de champion, aboutissement logique de l’investissement sportif de haut niveau.
L’adolescent ne possède pas toujours le caractère et les armes pour faire les bons choix et en assumer les conséquences. Alors comment gérer et vivre ces deux phénomènes, l’un par rapport à l’autre ? Quels bénéfices l’adolescent peut-il tirer de cette expérience de pratique sportive intensive ? et surtout, comment l’accompagner dans ce choix pour que sa « carrière » sportive s’harmonise avec sa propre trajectoire de vie ?
Questions brûlantes que doivent se poser parents, accompagnateurs, enseignants, entraîneurs, médecins du sport, en fait, tous ceux et celles qui entourent l’adolescent sportif. Avec « L’Adolescent champion », le docteur Claire Carrier présente un remarquable travail d’analyse des paramètres culturels, scientifiques et fonctionnels de la gestion des jeunes sportifs. Forte de son expérience de prise en charge d’adolescents à l’INSEP, elle propose un schéma d’analyse inédit, adapté aux adolescents sportifs de haut niveau.
Un guide sous forme de questions-réponses qui permet une meilleure vision d’ensemble sur le passage à l’âge adulte et le monde sportif
EXTRAIT
Il est d’observation courante que le choix sportif de haut niveau se fait en période de préadolescence : la plupart des sélections s’adresse à des jeunes gens âgés de dix à quatorze ans, ayant déjà investi le domaine sportif. L’entraînement intensif visant la performance concerne les années suivantes, c'est-à-dire les années d’adolescence, âge du changement, du « passage » entre l’enfance et l’âge adulte. Ainsi, l’accès à l’identité adulte, accomplissement de l’adolescence comme l’accès à l’identité de champion, aboutissement de l’investissement sportif de haut niveau, sont proposés à l’individu au même moment de son développement.
Partant de ce constat, la question que nous allons développer, est celle des manières de gérer et de vivre ces deux phénomènes l’un par rapport à l’autre : interaction, intrication, utilisation réciproque ou au contraire séparation, exclusivité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L'Adolescent championcontrainte ou liberté
Dr. Claire Carrier
Du même auteur : Le champion, sa vie, sa mort, Paris, Bayard Éditions, 2002.
UPblisher.com
Édition numérique Réédition de la version 1992
Préambule 2014
Le 23 février 2014 s'achèvent les XXIIe J.O. d'hiver à Sotchi. So what ?
Passé l'éblouissement par la magnificence du spectacle, il n'y a finalement rien à en dire de plus : c'était « trop », beau, bien, grand, peu importe ! Il n'y a pas de mots pour ce qui est hors-norme humaine. Une sacralisation de la démesure technique et scientifique, moyennant finance : l'être humain devient un objet et un produit de consommation essentiellement « jetable ».
Mais que faire ? Comment comprendre et réagir à ce lent dérapage de la civilisation vers la barbarie, voire la sauvagerie ?
La réponse m'apparaît dans le constat que l'être humain vivant ne peut être dans la démesure. Au-delà d'une certaine limite, ses capacités d'adaptation, de transformation, maximales à la puberté et à l'adolescence, vers son néo-corps performant, arrivent à un seuil irréversible. Il est condamné à vivre avec ce corps devenu étranger, car désynchronisé de ses rythmes génétiquement programmés.
C'est là que la réédition sous forme numérique de mon livre « L'adolescent champion Contrainte ou liberté » publié aux PUF en 1992 s'est imposée: elle y traite des processus d'adaptation dans l'espace de sécurité qu'est la réversibilité.
Il y a 20 ans en France la pratique sportive visant la haute performance était d'abord un projet de vie : depuis la sélection, en passant par les entraînements de plus en plus exigeants, le maintien de la scolarité, des relations affectives extra-sportives, la prévision de la reconversion en fin de carrière, l'aide à la confrontation avec les médias, l'éducation citoyenne etc.
Non sans mal, ni erreurs, bien évidemment ! Mais l'essentiel est que cette intention humaniste était partagée : elle pouvait se dire, s'échanger, discuter les contrats financiers et autres relations avec le professionnalisme et même moduler des calendriers, temps de récupération après blessures, etc. C'est l'intention qui anime ma première édition de 1992.
Comme le montre l'image de la couverture de ce livre, la victoire du champion était tripartite, à la fois :
– celle mesurée par la réalité carrée des chiffres,
– celle de la place de 1er méritée par le but atteint après travail et sacrifices, dans le respect des autres concurrents honorés et fiers, reconnaissant être battus par plus fort qu'eux,
– celle plus spirituelle sublimant cette harmonie corps-esprit et enrichissant par ce résultat le patrimoine de l'humanité.
Comme dans la tradition olympique.
Cette base m'est nécessaire comme référence pour mon prochain e-book : la version abrégée et actualisée de mon livre « Le champion sa vie sa mort Psychanalyse de l'exploit » paru en 2002 chez Bayard.
Avant-propos
Perçu longtemps simplement comme le héros du stade, le producteur de performances voire le porte-drapeau de sa nation d’origine, le sportif de haut niveau apparaît aujourd’hui aussi comme un exemple de réussite sociale, spécifiquement chez les jeunes.
Cela étant, une grande partie du public et même quelquefois certains des acteurs qui contribuent à l’accès à la haute performance ignorent ou mésestiment la difficulté et la complexité de la vie quotidienne et de l’investissement de ces sportifs pour atteindre les objectifs qui fondent cette image.
Cette réalité prend encore une acuité supérieure lorsqu’elle concerne des adolescents plus sensibles à son caractère passionnel mais également moins armés pour en assumer les conséquences.
Paradoxalement, l’approche humaniste qui nous conduit à rechercher un juste équilibre entre les exigences de la haute performance et la nécessité d’une formation indispensable à l’insertion sociale et professionnelle accentue encore la difficulté pour ces jeunes sportifs qui doivent gérer au quotidien des intérêts présumés complémentaires mais souvent vécus comme concurrents.
Pourtant, nous savons aujourd’hui que la qualité de la performance ne résulte pas seulement d’aptitudes physiques et d’acquisitions techniques, mais également de l’équilibre personnel et de l’environnement psychologique du sportif.
Nous savons aussi que les temps de vie et d’apprentissage ne peuvent se découper mécaniquement entre une intense activité sportive et une hypothétique réinsertion ultérieure.
C’est dans ce contexte que le Docteur Claire Carrier intervient régulièrement à l’Institut National du Sport et de l’Éducation physique au sein d’équipes pluridisciplinaires dont la mission vise précisément à faciliter la vie quotidienne et la réalisation des projets d’excellence de près de sept cent sportifs de haut niveau appartenant aux centres nationaux de vingt-deux disciplines.
Partant de son expérience pratique, l’auteur nous présente ici un remarquable travail d’analyse des paramètres culturels, scientifiques, mais aussi fonctionnels des multiples aspects de cette gestion de l’accès à l’excellence pour ces jeunes sportifs. Je suis donc convaincu que cet ouvrage éclairera et aidera les différents intervenants du sport de haut niveau, qu’il s’agisse d’enseignants, d’entraîneurs, de chercheurs, de formateurs, de médecins, de dirigeants voire de spectateurs attentifs aux réalités humaines de la performance sportive.
C’est au nom de cette communauté que je remercie le Docteur Claire Carrier pour cette contribution essentielle dont chacun mesurera l’importance et l’utilité dans son action quotidienne.
Jacques DONZEL
Directeur de l’Institut National du Sport Et de l’Éducation physique
Introduction
Il est d’observation courante que le choix sportif de haut niveau se fait en période de préadolescence : la plupart des sélections s’adresse à des jeunes gens âgés de dix à quatorze ans, ayant déjà investi le domaine sportif. L’entraînement intensif visant la performance concerne les années suivantes, c'est-à-dire les années d’adolescence, âge du changement, du « passage » entre l’enfance et l’âge adulte. Ainsi, l’accès à l’identité adulte, accomplissement de l’adolescence comme l’accès à l’identité de champion, aboutissement de l’investissement sportif de haut niveau, sont proposés à l’individu au même moment de son développement.
Partant de ce constat, la question que nous allons développer, est celle des manières de gérer et de vivre ces deux phénomènes l’un par rapport à l’autre : interaction, intrication, utilisation réciproque ou au contraire séparation, exclusivité. Pour cela, nous nous appuierons essentiellement sur notre pratique psychiatrique et psychothérapique d’inspiration psychanalytique auprès d’adolescents sportifs de haut niveau s’entraînant dans un Centre national : nous nous distinguons, ainsi, en la complétant, de l’approche proposée par la psychologie expérimentale fondée sur des théories comportementales ou cognitivistes et dont l’objectif est l’entraînement du « mental » à la performance sportive. Au cours de nos prises en charge, l’harmonisation du projet sportif avec le projet personnel est apparue fondamentale : le principal risque encouru par nos futurs champions étant celui d’un enfermement dans le réseau des systèmes d’identité sportive, ce qui empêcherait d’épanouir leur dimension adulte.
La question ainsi posée nous a amené à étudier les paramètres définissant les critères d’adaptation d’un individu à l’objectif sportif de la performance. Ici, le « toujours plus loin » rime avec le « toujours plus vite » et sous-tend, chez l’athlète, une insatisfaction dont la dimension motivante est constamment stimulée : l’individu est inscrit dans un déséquilibre donnée à priori. C’est dire que dans ce contexte de l’extrême tant physique que psychique, les modes d’approche psychiatrique comme psychopathologiques de l’adolescent « tout-venant », se sont révélés pour une grande part inopérants. Aussi, dans l’état actuel de nos recherches, avons-nous tenté de définir « l’autre normalité » de l’adolescent soumis à une pratique sportive intensive afin de pouvoir dans un deuxième temps isoler certains éléments de fragilité psychique qu’il convient de ne pas méconnaître.
Nous avons limité notre réflexion aux athlètes pratiquant des sports traditionnels ou disciplines olympiques.
Ce travail ne concernera donc pas les « sports californiens ». D’apparition récente, ces activités d’aventure ou de vertige (parapente, chute libre, rallye automobile comme le Paris-Dakar etc…), se pratiquent en plein air. Le combat est individuel contre un adversaire surhumain : la nature devenue personnifiée. Ces « nouveaux sportifs » rejettent en bloc tout ce qui pourrait évoquer l’affrontement à l’autre qu’il soit adversaire individuel ou groupe et, en raison de cela, ne se retrouvent pas dans des centres d’entraînement.
Ce travail ne concerne pas non plus le « sport pour tous » ou les pratiques corporelles observables dans le cadre de l’Éducation physique. Dans ces derniers cas, la santé-équilibre est visée et les pratiques sportives deviennent une nécessité socialement entretenue et reconnue.
Chapitre 1 L’adolescent
La notion du passage à l’âge adulte est incluse dans le mot adolescence puisqu’il s’agit du même verbe latin « adolescere » conjugué au participe présent pour l’un adolescens, et participe passé pour l’autre adultus. Comprendre cette période transitoire de grands bouleversements psychiques comme physiques constitue une entreprise ardue. Aussi une vision plurifactorielle de cet évènement semble-t-elle être la solution la plus juste. Pour cela, nous nous attarderons sur les modèles conceptuels socio-culturels, physiologique et psychanalytique tout en sachant que leur intrication et leur interaction sont la règle. Nous avons retenu ces trois axes de lecture du processus de l’adolescence car ils constituent, aussi, des champs privilégiés pour la confrontation avec l’investissement sportif de haut niveau.
A/ ASPECTS CULTURELS : NÉCESSITÉ ET SENS DES RITES INITIATIQUES
Cet angle de vue se place au niveau de l’inscription socio-culturelle de l’adolescence tel qu’elle a été définie par Haïm A. en 1970 : « Période au cours de laquelle, sous l’effet de la maturation sexuelle dans ses aspects biologiques, psychologiques et sociaux, le sujet procède au remaniement de l’image de lui-même et des autres, et du système relationnel de son Moi avec le milieu, jusqu’à l’organisation définitive de sa personnalité. » Il existe une grande variabilité dans durée selon les sujets, et actuellement plusieurs périodes sont évoquées : la préadolescence (environ 10-15 ans), l’adolescence (16-19 ans), la poste-adolescence (environ 18-24 ans).
Une lecture historique que nous propose F. Tétard fait apparaître le terme adolescence autour des années 1950. L’utilisation de ce mot, emprunté à la psychologie, pour désigner certains de ceux qui, jusqu’alors, étaient indifféremment regroupés sous le vocable de développement. Il donne accès à la possibilité d’une discrimination entre un « normal » et un « pathologique ». Ceci laisse à penser que la période de l’après-guerre a dû réagir pour repérer en termes de santé mentale les caractéristiques de cette période de la vie d’un individu en introduisant une nuance entre jeunesse et adolescence.
Cependant, certains aspects, actuels pourraient être compris comme un nouveau mouvement historique vers la disparition de l’adolescence : « l’écart qui existe entre les jeunes et les moins jeunes tend à se réduire… En effet, la culture originale revendiquée par les jeunes au cours de la dernière décennie, fait désormais partie du patrimoine de toutes les générations : la liberté sexuelle, le droit à la parole, les formes d’expression dans lesquelles la vie privée et la vie politique se mêlent profondément sont des valeurs maintenant reconnues par tous » (conférence générale de l’UNESCO, 21e session, 1981).
Bruner nous précise que l’originalité de nos sociétés occidentales actuelles est l’innovation dans nos traditions culturelles, de la place faite à « une génération intermédiaire, qui a le pouvoir de proposer un modèle de forme nouvelle de conduite ». En effet, la communauté des adultes, par la complexité des tâches et l’abstraction de plus en plus grande des fonctions de chacun, s’avère incapable de proposer aux enfants une série de modèles identificatoires et un système de valeurs pédagogiques, professionnelles, morales… qui tiennent compte des changements permanents. Dans ces conditions, l’adolescence constitue un relais nécessaire entre le monde des enfants et celui des adultes. En effet, elle propose de nouveaux styles de vie mieux adaptés à ce qui est perçu comme des conditions nouvelles et instables, et des changements qu’elle affirme à tort ou à raison, percevoir mieux que ceux qui se sont adaptés à l’état de chose antérieure.
On assiste donc à une sorte de renversement de perspective : le monde traversant des changements permanents, l’adolescence devient une sorte de modèle social et culturel tant pour les enfants que pour les adultes qui s’y réfèrent. Ainsi, l’idéal culturel est de rester adolescent comme nous le proposent certains slogans publicitaires tels celui de certains « jeans » : « Un petit bouton pour rester adolescent ». L’adolescent lui-même est donc censé être un « maître à penser » de référence tout en vivant dans le même temps sa propre problématique. Modèle et acteur, il devient une sorte de porte-drapeau d’un nouveau culte, celui d’une période immobile où tout se joue tout de suite, dans l’instant, sans vieillir. Par ailleurs, la rapidité des changements d’une génération d’adolescents à la suivante renforce la nécessité d’une référence au groupe de pairs aux prises avec les mêmes situations et se confortant réciproquement.
Si, dans nos sociétés avec « écriture », le modèle de l’adulte est resté l’adolescent, comment ont évolué chez nous les rites initiatiques toujours en vigueur dans les cultures de tradition orale ? En effet, au-delà de leur diversité, on ne peut qu’être frappé par leur constance. C’est dire l’urgence à donner un sens à ce passage de l’enfance à l’âge adulte. Ces rituels sont une réponse et traduisent le souci des adultes de contenir et organiser le parcours de l’adolescent quittant l’espace familier de son enfance pour aborder l’étrangeté de l’extérieur. Ces rites sous-entendent, par leur déroulement même, la différence des sexes et des générations. Qu’est devenu cet accompagnement, ce « passage », dans nos cultures où règne une sorte de confusion de générations mettant à distance la rencontre des adolescents avec les adultes ? Peut-être que certains mouvements de révolte, voire de violence, des adolescents peuvent être reliés à cette fragilité de l’organisation actuelle de notre société. Poussés par un besoin d’opposition pour affirmer un sentiment d’existence, certains adolescents peuvent rechercher ou élaborer eux-mêmes des groupes au fonctionnement rigide souvent ritualisé qui les rassurent. Nous pouvons poursuivre avec P. Jeammet : « Le rite aurait une portée essentielle sur l’économie psychique des adolescents : il répond à une situation de tension psychique intense liée à des contenus de désirs multiples et même contradictoires, ressentie comme menaçante par les individus, tension que le groupe reprend à son compte et à laquelle il se charge de donner un sens. »
Suivant le fil conducteur de cet auteur, nous discuterons l’hypothèse de la valeur du rituel de la compétition comme phénomène initiatique.
B/ MODÈLE PHYSIOLOGIQUE : RAPPEL DES TRANSFORMATIONS PUBERTAIRES
Le dictionnaire Littré définit ainsi la puberté : « Âge où les individus deviennent aptes à se reproduire. Dans le langage physiologique, série de phénomènes d’accroissement qui accompagnent la première maturation et chute d’ovule chez les filles, et la première production de spermatozoïdes chez les garçons. » Elle se fonde sur la maturation des glandes sexuelles, elle-même dépendante d’un mécanisme régulateur hypothalamo-hypophysaire (qui se trouve dans le système nerveux central) dont la présence dans le plasma de gonadotrophines hypophysaires à un taux supérieur à celui observé à l’âge pré-pubère, signale le début.
La sécrétion d’androgènes et d’œstrogènes qui en découle tient sous son contrôle l’apparition des caractères sexuels secondaires. Il existe une corrélation précise entre le déclenchement de la puberté et la maturation d’ensemble de l’organisme dont l’âge osseux (établi d’après les critères de Greulich et Pyle sur une radiographie du poignet gauche) est un bon témoin. Elle débute entre douze ans et demi/treize ans chez le garçon et entre dix ans et demi/onze ans chez la fille. Dans les deux cas elle s’étend sur 4 à 5 ans.
Nous nous contenterons ici de rappeler le déroulement de la puberté normale en reprenant la description clinique de la succession des stades définie par Tanner.
Chez le garçon : elle est annoncée par l’augmentation du volume testiculaire auquel succès le développement des caractères sexuels secondaires :
Le stade I est le stade pré-pubère
Le stade II se caractérise par l’augmentation du volume des testicules qui précède de six mois les autres signes :
Le stade III survient environ un an plus tard. Il se produit un élargissement des aréoles. La taille de la verge et celle du scrotum augmentent. Le scrotum se plisse et se pigmente. Les poils pubiens apparaissent ;
Le stade IV est marqué par un développement important de la verge, des testicules et du scrotum. La pilosité axillaire apparaît tandis que la pilosité pubienne devient triangulaire ;
Le stade V signe le passage à l’état adulte. La verge, le scrotum et les testicules ont leur aspect définitif ainsi que la pilosité axillaire. La pilosité pubienne est encore triangulaire. Elle deviendra losangique plus tard. Celle du visage, du tronc et des membres se complètera également à l’âge adulte. Les premières éjaculations surviendront à une date variable, autour de 15-16 ans.
Au cours de la puberté, les muscles se développent et le tissu graisseux qui diminue va se répartir à la moitié supérieure du corps. Sous l’effet des androgènes (hormones qui assurent le développement des caractères sexuels primaires et secondaires mâles) et de la STH (hormone de croissance) le gain statural est en moyenne de 8,5 cm la première année et l’année de croissance maximum de 7 à 12 cm. Sur le plan morphologique, sous l’action des androgènes on aboutit au type masculin ou androïde avec un diamètre des épaules supérieur à celui des hanches.
Chez la fille : seuls les caractères sexuels secondaires sont cliniquement observables. Ils témoignent d’une imprégnation hormonale mixte, œstrogénique et androgénique (d’origine ovarienne et surrénalienne) :
Le stade I est le stade pré-pubère. On note la présence d’un duvet pubien ;
Le stade II voit l’apparition du bourgeon mammaire, le sein se soulève l’aréole s’élargit et se pigmente. La pilosité des grandes lèvres apparaît. La vulve s’horizontalise ;
Le stade III se caractérise par le développement des seins. La pilosité s’étend et atteint le pubis. Les lèvres augmentent. La muqueuse vaginale est sécrétante ;
Le stade IV : les seins ont achevé leur développement. La pilosité pubienne devient triangulaire en s’étendant latéralement. La pilosité axillaire est moyenne. Les organes génitaux externes ont atteint leur développement définitif ;
Le stade V est marqué par la survenue des premières règles environ deux ans après le début de la puberté physiologique. Les cycles restent irréguliers et anovulatoires (sans possibilité de reproduction) pendant les premiers mois. Les organes génitaux internes se développent : le volume de l’utérus, notamment, prend de l’ampleur.
À l’inverse du garçon, la fille a un tissu graisseux qui augmente au détriment des muscles. Il se répartit sur la moitié inférieure du corps. Les stéroïdes (hormones) associés à la STH provoquent la fameuse poussée de croissance pubertaire qui, l’année où elle est maximale, peut correspondre à un gain statural de 6 à 11 cm.
Sur le plan morphologique, la cambrure des reins se creuse, les hanches s’élargissent, et avec le tissu graisseux qui siège sur la moitié inférieure du corps on aboutit au type féminin ou gynoïde.
Au terme de la puberté l’organisme est adulte c’est-à-dire capable de procréer. Cette date survient bien avant la majorité légale fixée en France à 18 ans pour les garçons comme pour les filles.
C/ MODÈLE PSYCHANALYTIQUE : ACCÈS À UNE AUTONOMIE DE SUJET
Le point de vue psychanalytique pose a priori la possibilité de comprendre l’adolescence comme un processus intrapsychique spécifique relativement homogène selon les sociétés. Ce constat met l’accent sur la massivité de ce processus qui englobe le corps, la psyché et la place symbolique de l’adolescent dans la société. Il se réfère à l’obligation pour tout individu d’effectuer un véritable « travail » de remaniement et d’élaboration de l’équilibre psychique de la période de latence, du fait de la pression des exigences internes comme externes. Celles-ci peuvent être rassemblées autour des deux grands axes : l’un somato-psychique lié aux transformations biologiques de la puberté et l’autre symbolico-culturel lié à l’accès à une identité sexuée adulte et à des fonctions de production dans le travail comme de reproduction dans une filiation. Il s’agit donc d’un phénomène naturel dont la mission essentielle est de régler la menace de l’inceste rendue possible par la maturation biologique.
De ce point de vue, cet état-adolescence est lu comme étant une situation universelle essentiellement organisée autour d’une notion dynamique : la permanence des changements affectant l’économie psychique individuelle.
Poursuivant avec P. Jeammet, nous pouvons remarquer que sont inhérents aux processus de l’adolescence :
Une redéfinition des limites entre l’adolescent et son environnement, entre l’espace psychique interne et le monde externe, redéfinition autour de laquelle se jouent et son identité et ses possibilités d’autonomie :
Une difficulté à envisager et à imaginer la notion du changement et de la transformation dans lesquels ils sont totalement impliqués ;
Un questionnement sur la relation et l’échange avec les autres très chargé d’une tension violente potentielle.
Bien évidemment, ces trois problématiques sont intriquées et interagissent les unes avec les autres. Cependant, nous allons les étudier séparément afin de pouvoir en déterminer les particularités.
1) Redistribution des limites entre l’adolescent et ses proches
À ce point de notre réflexion, nous sommes amenés à évoquer la question du Moi. Cette instance est décrite par S. Freud dans sa deuxième topique du fonctionnement psychique. Elle est chargée d’un double rôle : celui de l’adaptation, de la régulation à la réalité à partir des sensations corporelles et celui de la lutte contre l’angoisse liée aux conflits grâce à certaines opérations psychiques inconscientes appelées mécanismes de défense.
Entre 6 et 10 ans, donc chez l’enfant pré-pubère, la permanence de la présence des parents et leurs regards posés sur leur enfant suffit la plupart du temps pour assurer le sentiment de continuité de l’enfant. Son Moi est largement soulagé du poids des conflits qui l’affectent par le soutien que lui apporte la simple présence de ses parents quel que puisse être, par ailleurs, leur rôle dans la genèse desdits conflits. C’est le rôle essentiel de la phase de « latence » période du développement psycho-affectif qui, dans une compréhension psychanalytique, précède celle de l’adolescence. Cette étape est caractérisée par un « travail » de refoulement des conflits (avec, en particulier, une sorte de « désexualisation » des relations) s’équilibrant avec l’investissement de nouvelles activités. C’est un moment relativement serein, extérieurement aconflictuel, durant lequel l’enfant éprouve le plaisir de satisfaire la richesse de ses possibilités d’acquisitions intellectuelles, psycho-motrices et relationnelles et dont l’absence ou les difficultés de déroulement gênent considérablement l’accès à l’adolescence.
Ainsi, nous pouvons considérer que, durant cette période, les parents ont une fonction de « pare-excitation » pour leurs enfants. Ce terme fait partie du vocabulaire initial de S. Freud qui lui donnera ultérieurement une extension le situant dans le rôle purement fonctionnel de limitation des excitations et de leur diffusion. En ce sens, à la suite d’auteurs comme D.W. Winnicott, E. Kestemberg, nous le retenons comme relatif à la fonction contenante, organisatrice, protectrice et explicative, liante de la mère dans ses premiers échanges avec son bébé.





























