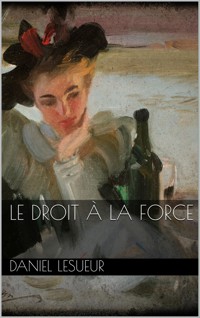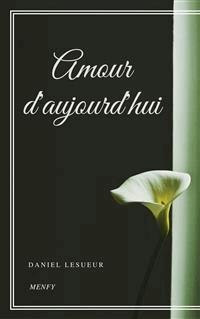0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Daniel Lesueur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Philippe Sauval est le fils du garde-chasse du Marquis de Peyralès. Enfant, il a souvent joué avec la fille du marquis, Geneviève de Peyralès ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
L'amant de Geneviève
Daniel Lesueur
Partie 1
Chapitre1
Il y avait bien trois minutes que M. le maire avait achevé son discours, que, tout rouge dans son étroit faux-col, tout ému de sa propre éloquence, il s’était lentement rassis, et cependant les petites mains des écoliers applaudissaient encore. Le bruit joyeux, que les habiles rendaient plus sonore en creusant légèrement leurs paumes, éclatait et remplissait la petite classe, décorée de feuillage pour ce grand jour de la distribution des prix; il s’échappait parles hautes croisées ouvertes sur la campagne et s’en allait se perdre dans l’air alourdi et dans les rayons du mois d’août.
Certes, il avait été très beau le discours de M. le maire; il avait roulé sur les bienfaits de la science, sur les devoirs du citoyen ; pas une phrase qui n’y présentât l’une ou l’autre des figures de rhétorique les plus savantes et les plus compliquées. Mais si l’on regardait son auditoire, tous ces bambins aux joues brunies dont l’aîné n’avait pas douze ans, on avait peine à se persuader que les hautes considérations seules eussent excité tant d’enthousiasme. On aurait même pu supposer sans trop d’irrévérence que les bravos s’adressaient au silence du fonctionnaire plutôt qu’à sa parole… Enfin tout avait donc été dit! Les meilleurs élèves, debout sur l’estrade et très intimidés, avaient récité des vers, et les autorités du village, non moins embarrassées peut-être, avaient solennellement débité de la prose. Maintenant, M. Forest, le maître d’école, prenait en main la liste des noms ; le maire examinait avec intérêt les beaux livres bleus et roses dont quelques-uns avaient des tranches dorées qui brillaient comme des flammes. Un autre monsieur, qui souriait et cherchait à se rendre utile, s’occupait à démêler les couronnes; les fils de fer s’accrochaient; c’était une opération très délicate. Bien des grands yeux ardents se fixaient sur ces couronnes de papier récalcitrantes, et sur ce monsieur, qui maniait tant de gloire avec un air tout naturel.
M. Forest mit bien haut son papier, et toussa légèrement pour éclaircir sa voix. Le maire se leva de nouveau; il tenait un grand volume et une couronne d’or; c’était le prix d’excellence.
On savait bien qui allait être nommé et tous les yeux se tournaient déjà vers ce favorisé du sort, quand soudain quelque chose d’extraordinaire les dirigea vers la porte.
Il s’était fait du bruit au dehors; une voiture s'était arrêtée devant la maison d’école. On entendait les chevaux qui secouaient leur mors, le claquement d’une portière qui se refermait. Presque aussitôt, sur le seuil de la salle, dans le reflet blanc de la route, un homme parut qui tenait une petite fille par la main.
C’était le marquis de Peyralès et Geneviève, son unique enfant. A cause de son nom et de sa position dans le pays, surtout par principe et par conviction, le marquis avait cru de son devoir d’assister à la distribution des prix de l’école du village.
Il gravit l’estrade, serra la main du maire et celle du maître d’école, et s’excusa de venir un peu tard. Puis il se tourna vers les enfants qui, désappointés, s’apprêtèrent à essuyer un autre discours. Leurs craintes furent bientôt dissipées. M. de Peyralès les fit rire en leur montrant qu’ils étaient compris ; il ajouta :
— Mes enfants, je n’ai rien à vous dire. Le véritable enseignement de cette journée n’est pas dans nos paroles : il est ici.
Et son geste indiquait les livres et les couronnes.
M. de Peyralès parlait d’un ton lent et froid. C’était un homme d’une quarantaine d’années, au front dépouillé, au regard court et incertain du myope. Il avait des favoris châtain clair qu’il portait taillés à la façon des magistrats. Ses lèvres rasées se fermaient avec une expression d’amertume. Il était en grand deuil, car il venait de laisser derrière lui, à Paris, dans le caveau de leur famille, le corps glacé de sa jeune femme. Il avait aimé celle-ci pendant onze ans autant qu’il est possible d'aimer.
L’enfant qui se pressait à son côté, et qui, depuis leur entrée, n’avait pas quitté la main de son père, était une petite créature adorable. Elle avait le teint pâle et l’air un peu délicat; de grands yeux bleus, assez enfoncés dans l’ombre, des sourcils; le nez, la bouche, l’ovale du visage très purs, et des masses de cheveux brun foncé à reflets de cuivre. Elle était vêtue, à la mode anglaise, d’une espèce de fourreau à larges plis, très court; une ceinture entourait au-dessous de sa taille son corps gracieux, et un grand chapeau marin, placé très en arrière, laissait voir une frange épaisse de ses cheveux qui lui retombait sur le front. Ses vêtements étaient tellement garnis de crêpe que c’est à peine si l’on y distinguait une autre étoffe.
Dans un coin de l’estrade se trouvait un fauteuil inoccupé, semblable à celui du maire. On avait bien espéré que M. de Peyralès daignerait assister à la cérémonie, et ce siège d’honneur lui était destiné. Il s’assit ; sa petite fille se plaça sur une chaise, tout près de lui.
La distribution allait enfin commencer.
— Prix d’excellence, lut M. Forest, décerné, à l’élève qui, par sa conduite et son travail, s’est le plus distingué pendant tout le cours de l’année scolaire… Philippe Sauval.
Un jeune garçon d’une douzaine d’années se leva, et, passant devant ses camarades qui applaudissaient de toutes leurs forces, il monta sur l’estrade.
— Tiens ! dit Geneviève tout bas en se penchant vers son père, c’est Philippe. Qu’il est grand ! Oh ! je suis contente qu’il ait le prix.
Elle le regardait venir, et s’étonnait beaucoup. Le fils du garde-chasse de son père ne ressemblait en rien aux autres petits paysans. Elle lui trouvait tout à fait l’air des jolis cavaliers qui la faisaient danser aux matinées d’enfants, alors que sa chère maman vivait encore, et qu’elle-même avait des robes blanches et des ceintures roses, et n’avait jamais porté de noir.
Cette réflexion attendrissait Geneviève, et, lorsque Philippe eut la couronne sur le front, elle le trouva si charmant et son triomphe si glorieux, que touchant le bras du marquis :
— Puis-je applaudir aussi, papa? demanda-t-elle.
Philippe Sauval reparut souvent sur l’estrade. Quand tous les prix de sa division eurent été distribués, il avait dans les bras tant de livres et de couronnes qu’il ne pouvait plus les porter. Ses voisins, moins intelligents, moins studieux, moins heureux que lui, en particulier ceux qui n’avaient obtenu aucune récompense, se disputaient l’honneur de lui aider. La supériorité de Philippe sur eux était trop marquée pour qu’ils pussent être jaloux de lui. Il était bon camarade et on l’aimait. Puis en tenant ses beaux livres et ses couronnes, il semblait que l’on prit une petite part momentanée à son succès.
La distribution des prix continuait ; c’était le tour des petites classes. Des bébés, trop tôt sortis des robes, avec des culottes trop larges tombant jusque sur leurs gros souliers, montaient à présent sur l’estrade, gauchement, butant contre chaque marche, très fiers, mais si timides qu’ils avaient envie de pleurer. Dans le fond, leurs mères fondaient en larmes ; tandis que leurs pères, qui trouvaient honteux pour des hommes de se montrer émus, passaient le revers de leurs manches sur leurs yeux et disaient : — Tout de même, le petit gars ! — lorsqu’ils redescendaient avec une couronne posée de travers sur leurs cheveux ébouriffés.
Le marquis de Peyralès, très grave, battait machinalement des mains, tendait un livre, disait un mot d’encouragement, et faisait les plus grands efforts pour ramener à chaque instant sa pensée qui s’échappait, qui s’en allait à Paris, au cimetière, aux années enfuies, à l’avenir sombre. Une chose lui rendait cependant l’attention moins difficile : c’était la présence de Geneviève. Cette enfant était tout désormais pour son cœur. Quant à son esprit, il le nourrissait de hautes pensées et d’importants travaux. M. de Peyralès était à la fois un homme politique et un écrivain. Sa fille et ses manuscrits, voilà ce qui représentait sa vie même. En dehors, il n’y avait rien.
La petite Geneviève s’était d’abord amusée, mais elle finissait par trouver que cela durait trop longtemps. Les écoliers, en allant et venant, piétinant sur place, soulevaient la poussière. Elle la voyait danser, toujours plus épaisse, dans un large rayon de soleil qui s’avançait vers elle à mesure que l’après-midi s’écoulait; elle redoutait le moment où ce rayon pourrait l’atteindre, et elle se disait qu’une robe noire en été, cela tient vraiment bien chaud !
Enfin le maître d’école se tut; la liste monotone des noms était terminée.
Mais sur la table, recouverte d’un drap vert, où traînaient des bouts de faveurs et des feuilles de chêne artificielles, il restait encore une dernière récompense. Celle-ci, comme l’annonça le maire, était la plus glorieuse de toutes. Les élèves la décernaient eux-mêmes, par vote, à celui d’entre eux qu’ils trouvaient le plus méritant. C’était M. de Peyralès qui l’avait instituée. Elle consistait en une médaille d’or.
— Il s’est présenté cette année une circonstance curieuse et qui double la valeur du prix que nous allons décerner, dit M. le maire en élevant l’écrin de velours grenat.
M. de Peyralès eut un mouvement de curiosité. Geneviève recula sa chaise que le soleil atteignait, puis, involontairement, se tourna vers Philippe: ce devait être lui qui aurait la médaille.
Le petit garçon essayait de ne pas paraître attendre que son nom fût prononcé. Son regard se perdait dans le vague, au-dessus de l’estrade, au-dessus du buste de la République, un mauvais plâtre sur un fond de drapeaux fanés. Par le châssis entr’ouvert, il apercevait un coin du ciel ; la lumière au dehors était si éclatante que l’azur paraissait d’argent. Et Philippe s’éblouissait à regarder là haut, pour se donner une contenance; pendant que, malgré lui, le feu de la joie s’échappait de ses yeux, avivé par une ambition ardente qui venait de se développer en lui tout à coup, et qui dépassait déjà les murs de l’humble salle d’école.
Le maire avait fait une pause, pour se ménager un effet. On entendait les chevaux du marquis, piaffant, s’irritant sous les piqûres des mouches et du soleil, au delà du jardinet d’entrée, et la voix du cocher qui s’efforçait de les calmer.
—Cette récompense extraordinaire, continua le président de la cérémonie, a été pour la première fois adjugée à l'unanimité. Pas un suffrage n’a fait défaut. Un si honorable gage d’estime appartient à Philippe Sauval. .
Les bravos éclatèrent. Maintenant ce n'étaient plus les enfants seuls qui battaient des mains; les pères, les mères en faisaient autant. Les messieurs gantés, dont la présence rendait cette journée solennelle, hochaient la tête l’un vers l’autre et répétaient: — Bien, très bien… Le maire voulut que M. de Peyralès remît l’écrin lui-même. Celui-ci refusa. Alors Geneviève tendit les mains en suppliant; des larmes d’enthousiasme roulaient sous ses longs cils.
— Oh! papa… murmura-t-elle.
Quel plaisir elle aurait eu à donner la médaille!
— Toi? Oh! non, dit son père. Tiens, tu le couronneras, si tu veux.
Il souriait en lui tendant la guirlande raide et empesée de papier gaufré.
Mais quand Geneviève l’eut dans les mains, elle se repentit de son mouvement; elle se sentit devenir toute rouge; elle aurait voulu disparaître. Elle allait rendre la couronne à son père lorsqu’elle vit celui-ci qui déjà parlait à Philippe ; il le félicitait presque avec chaleur. Tout aussitôt, le jeune garçon fut devant elle; et, comme elle levait sur sa grande taille des yeux timides, mouillés d’admiration, de soudaine sympathie, il s’inclina, ému lui-même, afin qu’elle pût poser les lauriers sur son front.
— Eh bien, mon vieux Sauval, n’es-tu pas fier de ton petit-fils ? Et vous, Marguerite, êtes-vous contente? Il vous fait honneur, votre Philippe !
Tout en parlant ainsi, M. de Peyralès serrait la main d’un vieillard en costume de garde-chasse, et se tournait ensuite vers une femme encore jeune, aux yeux gonflés d’émotion, à la figure radieuse, qui portait à deux bras dans le pan de son châle toutes les couronnes que son fils lui avait apportées.
Philippe, debout près d’eux, regarda son grand-père. Peut-être que celui-ci allait enfin sourire. Il était le seul qui restât sombre et indifférent dans cette belle journée; mais quand M. le marquis lui-même avait parlé, il était impossible qu’il ne ressentit pas quelque satisfaction, quelque orgueil.
Le vieux paysan, sa casquette de chasse à la main, se courba très bas.
— Monsieur le marquis est bien bon, répondit-il.
— Non, Sauval, il n’est pas question de bonté. Ton petit-fils est un enfant studieux et intelligent. Il est récompensé aujourd’hui ; j’en suis bien aise.
Et M. de Peyralès ajouta, contemplant la charmante physionomie, si frappante, si distinguée, de Philippe, et songeant peut-être à quelques-uns de ses amis :
— Plus d’un marquis te l’envierait.
Sauval se redressa, l’air dur.
— Oui, mais combien de paysans voudraient d’un savant pour leur fils?… Ah ! monsieur le marquis, chacun sa place. Excusez-moi, vous me vouliez du bien ; mais votre compliment me fait peine et m’effraie.
M. de Peyralès réprima un sourire à ce mot de savant. La science que l’on pouvait acquérir à l’école dirigée par M. Forest, ne lui paraissait pas devoir inquiéter même le rigide Sauval. Il dit quelque chose dans ce sens au vieillard, tandis que Marguerite, qui connaissait son beau-père et qui en avait peur, se dérobait à la conversation, se mêlant aux paysannes dont elle embrassait les marmots.
Philippe non plus n’écoutait pas le marquis. Les injustes paroles de-son grand-père avaient amené des larmes dans ses yeux, et, comme il se détournait pour les cacher, il avait rencontré le regard de Geneviève plein de compassion et d’étonnement.
— Ne pleure pas, dit la petite fille avec chaleur. Tout le monde t’admire, papa aussi, tu dois être très fier. Tant pis si le vieux Sauval n’est pas content !
— C’est mon grand-père, fit le jeune garçon, dont les sanglots étaient près d’éclater. Voyez-vous, mademoiselle Geneviève, c’est que vous ne savez pas… Je m’étais promis de faire tant qu’il changerait d’idée. Je me disais qu’enfin, si j’avais la médaille… Eh bien, il ne m’a pas embrassé!
— C’est drôle d’être fâché parce que tu travailles.
— Ce n’est pas tout à fait cela, dit l’enfant, qui réfléchit un peu, cherchant à bien faire comprendre la pensée de son aïeul. Mon grand-père craint que je ne préfère l’étude à notre métier, au service de nos maîtres, et que je n’aime les livres plus que les bois de Peyralès. Mais il se trompe… Oh! ajouta Philippe en relevant les yeux, je voudrais bien lui persuader qu’il se trompe.
M. de Peyralès emmena Geneviève. Il l’avait déjà mise en voiture, lorsqu’il songea soudain à prier le maire et le maître d’école de dîner le soir au château. Comme il tournait sur ses talons, sa fille le rappela.
— Papa, papa, invitez Philippe aussi, je. vous en prie.
Le marquis s’arrêta, surpris.
— Mais oui, dit-il, pourquoi pas ? C’est une bonne idée que tu as là, minette.
Il rentra dans le jardin.
— Dites-lui d’apporter tous ses prix… Qu’il les apporte tous, n’est-ce pas? cria encore la voix de la petite.
Un instant après, les prix, les couronnes, la médaille, et Philippe lui-même, étaient installés sur la banquette de devant, dans le landau, en face de M. et de mademoiselle de Peyralès.
La route que l’on suivait tournait et gravissait une colline large et assez élevée, couverte .de bois et constituant le domaine du marquis. Le village était en bas, le château en haut. Pour aller à pied de l’un à l’autre, on pouvait couper par des sentiers rapides; à cheval ou en voiture, il fallait faire un grand détour; on montait, en se dirigeant toujours à droite, jusqu’au sommet; la côte était raide, et l’on allait au pas. Alors se présentait une grille donnant accès dans le parc; on y entrait tournant à gauche, et, désormais sur un terrain horizontal, on pouvait arriver au galop devant la maison d’habitation.
Tous les matins, à neuf heures, pour aller à l’école ; tous les soirs, à quatre heures, lorsqu’il en revenait, Philippe suivait aussi cette longue route carrossable. Mais une fois dans le parc, la grille franchie, il ne tournait pas à gauche vers le château; il allait devant lui, parcourant une allée qu’un mur et un saut-de-loup séparaient de la route, et il arrivait ainsi à la maison du garde-chasse, aux confins des terrains cultivés.
Que de fois, quand il était plus jeune, la course avait paru longue à ses petites jambes ! Aucun de ses camarades ne remontait de ce côté ; tous demeuraient en bas, dans le village. Oh ! le triste chemin, en hiver, quand la nuit venait, quand la vallée se faisait peu à peu toute noire, et que les branches des arbres craquaient lugubrement… Il avait eu peur, bien souvent, tout petit, à sept ou huit ans, le long de cette côte. Mais il n’aurait pas osé le dire à cause de son grand-père qui l’eût grondé bien fort voulant qu’il fût un homme. En revanche, dans les beaux jours, les distractions ne manquaient pas, et la distance était comme diminuée. Alors l’école ou la maison se laissait voir trop tôt, et l’on arrivait après l’heure, en cachant, suivant la saison, soit un attelage de hannetons, soit un pied de fraisier sauvage, soit des noisettes qui sentaient bon à travers leurs enveloppes fraîches.
Philippe songeait à tout cela tandis que, pour la première fois, il parcourait cette route en voiture, et qu’il se tenait droit, sans embarras et sans gaucherie, avec une distinction qui lui était naturelle, dans le bel équipage du marquis de Peyralès.
Il aimait ce chemin ; il avait fini par l’aimer même en hiver. Petit, il s’y était lassé et il y avait joué; plus tard, il y avait rêvé… De ces rêves d’enfant qui sont plus vastes et plus beaux que le monde; si beaux, que le splendide château devant lequel Philippe descendit n’était rien auprès, et que le petit garçon y entra tout naturellement, sans éprouver plus de gêne que s’il fût né fils de marquis.
M. de Peyralès, à table, remarqua les bonnes manières de l’enfant ; elles contrastaient avec la maladresse du maire, un gros fermier qui taillait son pain avec son couteau, s’ébahissait du nombre et de la forme des verres, et remerciait tout haut les domestiques.
Philippe observait la façon dont s’y prenaient ses hôtes et les imitait avec grâce ; dans le doute il faisait comme le proverbe le conseille, il s’abstenait. Il écouta la conversation, ne la comprit pas toujours, mais vit avec plaisir que le marquis semblait fort attentif à tout ce que disait M. Forest et partageait en général les opinions de celui-ci.
Philippe aimait profondément son maître.
On pouvait dire que M. Forest avait créé l’école du village ; avant lui, les élèves n’y venaient pas. Ce jeune homme patient et dévoué avait entrepris une véritable campagne contre les paysans à tête dure, à cerveau étroit, qui trouvaient raisonnable d’envoyer leurs fils aux champs plutôt qu’à l’école, et il les avait conquis. La vallée entière s’était soumise. Seule, la colline avait tenu bon. Le vieux garde-chasse, esprit sauvage et triste, possédant au plus trois idées, mais y tenant comme aux garennes et aux halliers de Peyralès, n’avait cédé qu’à l’influence de ses maîtres. La marquise, en particulier, cette jeune femme qui venait de mourir, avait insisté pour que Philippe reçût quelque instruction; l’intelligence précoce de l’enfant l’avait frappée ; et si celui-ci, à douze ans, fort et bien développé pour son âge, maniant le fusil comme son grand-père, passait encore son temps à tracer des cartes géographiques et à composer des rédactions d’histoire, c’était parce que madame de Peyralès, au moment de partir pour Paris l’automne précédent, avait dit au garde qui la suivait tout attristé sur le quai de la petite gare :
— Vous me le promettez, n’est-ce pas, mon vieux Sauval?
Le dîner terminé, on sortit sur la terrasse. Geneviève et Philippe examinèrent les livres, debout devant une table de jardin que la petite fille avait fait porter très loin, dans l’angle de la balustrade, par cette manie qu’ont les enfants d’être bien chez eux pour jouer ou pour traiter avec gravité de leurs affaires particulières. M. de Peyralès offrit des cigares, et, en face du beau spectacle de la vallée que le soleil abandonnait, il se mit à parler d’agriculture. Ce n’était pas que cette question lui fût particulièrement familière; il songeait moins à briller qu’à placer le maire sur un terrain où celui-ci ne trébuchât pas lourdement. Mais on aurait dit que les murailles du château pesaient sur les idées du pauvre homme ; il bredouilla, même en parlant des récoltes. Alors, considérant que sa pipe lui semblerait préférable aux panatellas du marquis, et qu’il avait assez souffert pour l’honneur de la commune, il prit congé. M. de Peyralès, resté seul avec le maître d’école, aborda un sujet intime et qui le préoccupait fort, l’éducation de Geneviève.
— J’ai eu grand tort, dit-il au jeune homme. J’aurais dû confier l’instruction de cette enfant à sa mère; je me suis aperçu trop tard que la marquise s’y serait entendue à merveille. Aujourd’hui, Geneviève posséderait les éléments indispensables et je pourrais à mon tour semer sur ce bon fonds. Mais je me défiais des femmes. Je voulais, sans faire de ma fille un bas-bleu, l’empêcher de devenir une poupée ou un perroquet. Je lui voyais tant de précieuses dispositions! Mon but principal était d’élargir son esprit et d’élever son cœur; l’étude n’était qu’un moyen. Eh bien, je suis désolé, j’ai fait fausse route, j’ai commencé trop tôt. Ma petite Geneviève ne pourra jamais, comme les autres enfants, apprendre une leçon. Elle se met à pleurer devant un livre; elle n’accepte, en fait de connaissances, que celles que je puis lui communiquer en causant avec elle. Je le vois bien, elle finira par en avoir trop et trop peu. Elle connaît l’Iliade, l’Odyssée, les entretiens de Socrate et la constitution de Sparte, mais elle ne sait pas l’orthographe !
M. Forest fit observer que mademoiselle de Peyralès était encore bien jeune.
— Elle aura bientôt onze ans, dit le père. Mais voyez-vous, monsieur Forest, c’est justement ce qui me tourmente. Elle est trop petite pour moi. Si je continue à m’occuper d’elle, je ne ferai qu’empirer le mal. Vous le savez, on veut que je passe pour un érudit, pour un cerveau profond… Tout instruit que je puisse être, je me sens incapable d’enseigner la grammaire à une enfant, à moins que ce ne soit peut-être au moyen du latin. Quant à l’arithmétique, j’ai honte de le dire, mais je crois que Geneviève ne mettra jamais dans sa tête la table de multiplication.
M. de Peyralès prononça ces paroles d’un ton chagrin, et pourtant le regard qu’en même temps il dirigea sur sa fille était plein d’orgueil. Elle était si fine et si fière. Elle paraissait si jolie, là-bas, au bout de la terrasse, dans le rayonnement du soir d’été, cette petite créature, svelte sous le crêpe noir, qui ne saurait jamais combien font huit fois neuf. Elle baissait la tête en riant, tandis qu’une dernière caresse du soleil posait une flamme rouge dans sa chevelure sombre.
— Eh bien, malgré tout, reprit son père qui, après l’avoir contemplée un moment, sembla se réveiller d’un rêve, malgré tout, je n’ai pas ramené d’institutrice avec moi. Jamais je n’aurais pu me décider à choisir. Ma position de veuf m’embarrassait aussi… Je n’aime pas à voir les enfants entre les mains de personnes âgées, Geneviève a sa nourrice qui la soigne, qui ne lui enseigne rien ni de bon ni de mauvais, et qui la conduit le dimanche à l’église. Puis elle a son père, qui n’ose plus tenter de l’instruire. Que va-t-elle devenir? Donnez-moi donc un conseil, monsieur Forest.
Le jeune maître d’école fut étonné. Il fallait que le froid, l’indépendant, l’orgueilleux marquis de Peyralès eût bien confiance en lui, fût en proie à une inquiétude bien vive, pour lui parler comme il venait de le faire. Il osa dire sa pensée.
— Monsieur le marquis, répondit-il, j’aurais cru manquer au respect que je vous dois en prenant sur moi de vous indiquer une ligne de conduite quelconque. Mais puisque vous me faites l’honneur de me questionner, je sens qu’il est de mon devoir de vous parler avec une entière franchise. Pardonnez-moi si je me trompe et si vous découvrez de la présomption dans mes paroles. Ces éléments qui sont la base de toute instruction solide, et que vous désespérez d’enseigner à mademoiselle Geneviève, je m’exerce, depuis des années, à les faire pénétrer dans les esprits les moins disposés à s’ouvrir, les moins bien doués, les plus rebelles. J’ai tant retourné ces principes, je me suis tellement efforcé de les rendre simples et attrayants, qu’a ce point de vue je serais difficilement dépassé. Voulez-vous me permettre de les placer sous les yeux de mademoiselle Geneviève. Il me semble que je parviendrais à les lui faire trouver presque aimables. Pour moi, ce serait une tâche bien douce, dont la pensée m’inspire une sorte d’enthousiasme. Restant sous votre direction, vous consultant sans cesse, ayant compris vos vues, animé de vos intentions, je ne pourrais pas entraver votre œuvre, ni détourner cette jeune intelligence de la voie que vous désirez lui voir suivre.
M. de Peyralès prit la main du jeune homme et la serra d’une chaude étreinte.
— Ah! je vous remercie, dit-il, j’accepte. Vous commencerez demain.
A ce moment, Geneviève et Philippe, qui s’étaient fatigués de leurs livres, passaient en courant sur le sable jaune de l’allée au-dessous de la terrasse.
— Geneviève ! appela le marquis.
Elle gravit les marches et arriva tout essoufflée.
— Geneviève, dit son père, n’aimerais-tu pas à prendre tes leçons avec M. Forest pendant que nous sommes à la campagne?
— Oh! fit l’enfant, je le veux bien. Philippe m’a dit qu’il est si intéressant!
Les deux hommes sourirent.
— C’est que Philippe aime bien l’étude, dit M. Forest sérieusement.
Le joli front de Geneviève s’assombrit. Mais, tout à coup, frappée d’une idée merveilleuse :
— Eh bien, moi aussi, déclara-t-elle, j’aimerai l’étude, si Philippe travaille avec moi.
— Philippe ne peut pas travailler avec toi, répondit le marquis, dont toute la froideur reparut dans la voix et sur le visage. Philippe sait tout ce qu’il a besoin d’apprendre. Maintenant son grand-père veut le conserver auprès de lui pour en faire un bon garde-chasse.
M. Forest n’intervint pas, mais son regard chercha, plein d’anxiété soudaine, l’élève préféré qu’il allait perdre. Philippe jouait avec un chien; il arrondissait les bras en joignant les mains, et sifflait la petite bête qui, dressée à le faire, sautait dans ce cerceau naturel.
— Ah ! reprit Geneviève, dont les lèvres tremblaient comme si elle allait pleurer, son grand-père est ignorant ; il ne peut pas juger. Maman le disait souvent. C’est elle qui persuadait au vieux Sauval qu’on ne doit pas rester dans les bois, sans rien apprendre, ainsi qu’un loup… Elle était bien contente que Philippe fit des progrès. Oh ! si elle était ici, comme elle serait heureuse qu’il ait eu la médaille, et le prix d’excellence, et tous les prix! Et bien sûr, bien sûr, elle lui permettrait d’étudier avec moi.
N’obtenant pas de réponse, elle continua de supplier, avec sa petite voix touchante. Quand elle avait prononcé le nom de sa mère, les larmes s’étaient échappées de ses yeux; elle ne les essuyait pas, sachant leur force. M. de Peyralès était devenu pensif.
— Soit, dit-il enfin; je le permets pour cet été. Mais il faut encore que M. Forest n'y voie pas d’obstacle et que le père Sauval y consente. Puis, tu m’entends bien, Geneviève : le jour où je ne serai pas satisfait de tes progrès, je te retirerai ton compagnon.
Il n’eut pas le temps d’achever son discours. Geneviève s’était jetée dans ses bras et le remerciait avec transport. Elle l’embrassait, lui faisait mille caresses, et le prenait à témoin de résolutions telles que, si elle eût dû les tenir, elle eût épuisé avant deux mois le bagage scientifique, point à dédaigner pourtant, de M. Forest.
— Philippe, Philippe, écoute. Nous allons étudier ensemble… tout l’été! Papa l’a dit. C’est M. Forest qui nous donnera des leçons. Tu es content, n’est-ce pas? Viens dire à papa que tu es content.
Le petit garçon cessa de jouer, et releva la tête en devenant très rouge. Il regarda Geneviève, puis M. de Peyralès et M. Forest. Sur un signe du marquis, il monta les degrés de pierre; il allait doucement, écartant le chien qui sautait après lui; son embarras était visible.
Mais quand il sut que ce n’était pas une plaisanterie de la petite fille, qu’on lui laissait encore ses chers livres d’étude, et qu’il travaillerait tous les jours au château, entre ce maître qu’il admirait et cette ravissante compagne, sa joie fut si intense qu’il en devint tout pâle. Il s’appuya sur le dossier d’une chaise et porta une main à sa poitrine comme s’il souffrait.
M. de Peyralès et le maître d’école échangèrent un coup d’œil.
— Tu ne tiens pas à devenir garde-chasse, n’est-ce pas ? demanda presque brusquement le marquis.
Philippe, dont l’émotion s’apaisait, hésita un instant. Il semblait surpris de la question comme s’il ne se la fût jamais adressée à lui-même.
— Mon grand-père, dit-il enfin, m’a appris que le premier devoir des Sauval avait toujours été de bien servir les marquis de Peyralès.
L’enfant prononça ces mots avec une certaine dignité ; on aurait dit qu’il affirmait la noblesse de sa famille, l'appuyant sur un dévouement héréditaire.
— Et toi? insista le marquis.
— Moi, dit Philippe, moi?…
Il n’osait pas continuer, un regard de Forest l’encouragea.
— J’ai réfléchi là-dessus cette après-midi, reprit-il, et je songeais qu’on peut être utile à ses maîtres de différentes manières; que la meilleure n’est sans doute pas de protéger leurs lapins.
L’expression d’indifférence et de hauteur que portait le visage du marquis, se chargea d’une curiosité tout au plus bienveillante.
— Et quelle meilleure manière as-tu trouvé, mon petit ami? interrogea-t-il.
Peut-être Philippe aurait-il pu répondre; peut-être n’avait-il, au contraire, nulle idée bien distincte. Ce n’était qu’un enfant. Il garda le silence.
M. de Peyralès le considéra encore pendant quelques secondes, de l’air avec lequel on considère dans un musée un objet bizarre dont on ne connaît ni la provenance ni l’usage; puis, il se leva, disant avec sécheresse :
— Eh bien, sois ici demain à neuf heures. Informe ton grand-père que c’est moi qui le désire.
Il changea de ton en se tournant vers le maître d’école.
— Monsieur Forest, vous me rendrez un grand service. Entreprenez cette petite savante qui ne peut pas conjuguer un verbe. J’augure de votre talent et de votre patience les plus heureux résultats.