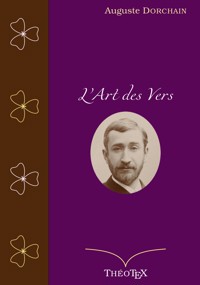
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
A l'occasion de sa mort, Auguste Dorchain (1857-1930) fut appelé par Émile Delval le dernier Poète Parnassien, formule ostensiblement panégyrique, qui n'en recouvre pas moins une réalité observable aujourd'hui, à savoir que l'élément constitutif fondamental de la poésie française d'autrefois, le VERS, n'existe plus. Pour l'internaute lambda, ce mot n'évoque plus qu'une ligne de longueur sensiblement inférieure à la largeur de l'écran, éventuellement suivie d'autres semblables, et de signification suffisamment vague, pour échapper à toute critique. C'est pourquoi le traité de prosodie de Dorchain, est un outil remarquable pour ceux qui cherchent à comprendre et à goûter la poésie classique. Par de nombreux exemples, il établit de manière convaincante que les règles de la versification française ne sont pas arbitraires, mais fondées sur l'acoustique de notre langue, et sur la psychologie de l'âme humaine. Le rythme syllabique, la rime, la césure, la strophe, y font tour à tour l'objet d'une étude approfondie, et de remarques inédites. En écrivant l'Art des Vers, l'auteur se sentait certainement pressé de léguer aux générations à suivre, qui parleraient encore le français, un précieux testament spirituel. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1921.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322471126
Auteur Auguste Dorchain. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]La plus haute dignité de l'homme est dans l'aspiration. L'heure à laquelle il se sent le plus noblement un homme est celle où, se détachant de son étroite personnalité, il aspire à une vie supérieure dont sa conscience ne lui fournit que des éléments confus encore, dont ses sens ne lui révèlent dans le monde qu'une grossière ébauche, — à une vie où il y aurait plus d'ordre et plus de lumière, plus de joie, plus d'harmonie et plus d'amour. C'est de ce besoin que sont nés tous les arts, par lesquels l'artiste exprime pour lui d'abord, suscite et satisfait ensuite, chez les autres, cette aspiration sublime. Ainsi naquirent l'architecture, la statuaire, la peinture, la musique, la poésie enfin, dont on peut dire que, dans son sens le plus large, elle n'est pas à proprement parler un art, étant plutôt, caché au fond de tous les arts, ce principe d'aspiration lui-même, mais qui devient pourtant un art distinct, et le plus grand de tous, lorsqu'elle prend pour organe le Verbe ordonné selon des lois fixes et certaines, c'est-à-dire lorsqu'elle se confond avec ce dont je dois vous entretenir à cette place : l'Art des Vers.
L'Art des Vers ! Essaierai-je de le définir ? A quoi bon ! J'aime mieux vous en faire sentir, par un exemple, toute la grandeur, toute la portée.
Recueillez-vous une minute ; fermez l'oreille aux bruits qui montent de la rue ; oubliez quelques soucis médiocres ; laissez tomber au fond de vous, comme une lie, tout ce qui, depuis votre réveil, — lecture d'un inutile journal ou d'un vain livre, conversation oiseuse, visite frivole, — a pu vous encombrer, vous salir, vous disperser au moins l'esprit. Puis, allez à votre bibliothèque ; prenez, sur un rayon, les Orientales de Victor Hugo ; ouvrez-les à la trente-septième pièce, et, avec lenteur, en articulant chaque syllabe, en respectant les points et les virgules comme vous feriez des pauses et des soupirs d'une musique notée, lisez ce poème en deux strophes : Extase.
Qui sommes-nous, à présent, et où sommes-nous ? Pourquoi ce frisson qui nous a traversé le cœur, cette larme lumineuse qui nous est montée aux yeux ? Par quel miracle nous sentons-nous, tout à la fois, descendus à de telles profondeurs en nous-mêmes, et montés à de telles hauteurs loin de nous-mêmes ? … De par l'incantation du poète, en effet, voici d'abord que les mots, — mots si simples, si fatigués par un long usage : flots, cieux, étoiles, monts, bois… qui n'appelaient plus à notre esprit que l'idée sèche et terne des choses, — ont repris tout à coup leur entière vertu évocatoire, leur pouvoir d'éveiller en nous des émotions et des images, en même temps que des représentations abstraites. Un voile — le voile de l'accoutumance — a été comme tiré, qui nous cachait la beauté du monde ; et il semble que nous nous retrouvions devant ce spectacle avec des yeux et un cœur vierges, tant ce que notre subconscient avait retenu de nos impressions anciennes est remonté tout à coup à notre conscience dans une plénitude et une fraîcheur de découverte.
Ce n'est pas tout : voici qu'en même temps, le poète nous arrache à la vie terrestre et nous plonge dans la vie solidaire de la création. Cent fois, peut-être, devant la mer et le ciel, nous avions agité en nous l'énigme de l'univers, nous demandant si ces lames qui déferlent et ces étoiles qui gravitent, depuis des millions de siècles et pour des millions de siècles encore, obéissent, ou non, à une cause intelligente, pour des fins intelligentes. Même si, dans un sens ou dans l'autre, nous avions incliné notre raison devant les raisonnements des philosophes, c'avait été sans cet élan et cette volupté que donne seul un acte d'amour, un acquiescement de tout l'être. Mais, ce soir, le poète regarde avec nous les mêmes astres et les mêmes vagues ; il ne décrit pas, il ne raisonne pas, il n'analyse pas : il voit, il sait, il croit… et aussitôt, ne fût-ce que pour une seconde, il nous ébranle et nous illumine d'un éclair de certitude par lequel nous connaissons, dépassant l'émotion purement humaine, la grande émotion cosmique et religieuse, celle-là même qu'il a ressentie : l'Extase.
Pour y atteindre et pour nous y conduire, que lui a-t-il fallu ? Une centaine de mots, en deux strophes. Composantes infimes, sublime résultante. Entre ceci et cela, qu'y a-t-il donc ? Rien que cette chose : l'Art des Vers.
De cet art, une partie seulement peut être enseignée d'une façon précise et complète : c'est celle qui, dans l'art d'écrire en général, correspondrait, en toute modestie, à la grammaire : c'est la versification ou prosodie. Les lois de la versification, en effet, — lois dont l'observation seule distingue le vers, fût-ce le moins lyrique, de la prose, fût-ce la plus harmonieuse, — sont depuis longtemps codifiées, dans ce qu'elles ont d'essentiel, d'après la tradition de quatre siècles de chefs-d'œuvre ; et, quels que soient le génie particulier du poète et la nature spéciale du poème, elles sont appliquées toujours. Je pourrai donc vous les enseigner, telles qu'elles m'ont été transmises, ou à peu près telles, car l'évolution d'une prosodie n'est jamais complètement terminée, et il se peut que je sois conduit à vous donner comme légitimes — non pour ébranler, mais pour fortifier, au contraire, le vers traditionnel — quelques-unes des libérations ou des contraintes nouvelles que l'on nous propose.
Mais tout l'art des vers n'est point dans ces règles dont le respect est la condition obligatoire, non la seule et suffisante cause de l'émotion poétique. Il y a d'autres éléments, mystérieux et incodifiables, que l'inspiration seule révèle à chaque poète, et pour chacun de ses poèmes. Ceux-là, que nul ne saurait vous enseigner par principes, je voudrais, du moins, vous en faire sentir la présence et l'action dans cette première causerie, afin de mieux circonscrire mon sujet pour les suivantes, et de vous donner dès aujourd'hui, fût-ce encore par un seul exemple, une idée de ce que devrait être un « art des vers » intégral, s'il était possible à quelqu'un de l'écrire.
Ne cherchons pas un autre texte que nos deux strophes de tout à l'heure, et relisons-les ensemble pour tâcher, cette fois, de saisir les raisons de l'enchantement extraordinaire qui en émane et qu'aucune prose, en si peu de mots et en si peu de lignes, ne serait capable de nous procurer jamais.
Déjà, dès après la première lecture, nous nous rendons compte, au moins vaguement, que le pouvoir exceptionnel de ce langage est dû à une musicalité supérieure à celle de la prose, je veux dire à une certaine symétrie de cadences, à un certain battement régulier du rythme, qui le rapproche de la mesure musicale. Et parce qu'il participe des mêmes causes, le vers participe des mêmes effets. La prose exprime entièrement et suggère à peine ; la musique exprime à peine et suggère infiniment : le vers, lui, à tout le pouvoir d'expression des mots, peut joindre, dans une certaine mesure, le pouvoir de suggestion des notes, l'égaler même quelquefois. Lui seul est à la fois pensée et mélodie. Aucun langage humain ne le surpasse.
Si, ayant senti cette régularité rythmique du vers, nous commençons à en faire l'analyse, nous nous rendons compte aisément qu'elle consiste en un nombre limité de syllabes dans chaque vers, en un partage symétrique de ces syllabes dans l'intérieur du vers, et en un retour des mêmes sons à la fin de deux vers qui se correspondent : numération, césure et rimes, dont les lois sont tout l'objet de la versification, du métier des vers.
Mais on peut supposer le même sujet traité par un autre auteur, jeté dans le même moule de strophe en des vers aussi correctement soumis à toutes ces règles de la prosodie que le sont ceux de Victor Hugo, sans qu'à aucun degré, pourtant, l'émotion poétique ne naisse. Et c'est ici que le mystère commence, ou, plutôt, l'impossibilité de formuler des règles qui permettraient à quiconque les observerait en ses vers de faire, par cela seul, naître cette émotion. Tout ce que nous pouvons, c'est essayer de retrouver les voies secrètes qu'un instinct mystérieux, à peine contrôlé par une volonté consciente, a fait suivre au génie pour en arriver où il nous mène. Essayons.
Et, d'abord, est-ce par la rareté, par l'inattendu des vocables qu'il cherche à nous ébranler les sens et la pensée ? Non, j'ai dit qu'il employait ici les mots les plus courants de la langue. Il sait, il est vrai, que ce sont précisément ceux-là qui peuvent, grâce à la magie du rythme, reprendre leur signification la plus vaste.
Est-ce par la hardiesse des coupes dans le vers, par cette désarticulation apparente dont il a su tirer ailleurs de si extraordinaires effets ? Non, car pour exprimer ici cette sorte de respiration universelle, il lui faut un rythme aussi simple que le battement d'un cœur, que le soulèvement et l'abaissement d'une poitrine. Et il s'en tient donc aux coupes les plus classiques.
Est-ce par l'exceptionnelle qualité des rimes ? Non plus, car il se garderait bien d'arrêter l'attention sur un signe de virtuosité quelconque. Les rimes sont, prises en elles-mêmes, des plus banales, et plusieurs ne sont pas même ce que l'on appelle des rimes riches.
Et sans aucun de ces secours, en douze vers, le poète a su faire tenir le sentiment de l'immense, exprimer ce qui touche presque à l'ineffable. Le miracle n'en paraîtra que plus grand. Mais, puisque le secret n'en est pas là, poursuivons notre recherche et reprenons les vers un à un :
En ce premier vers, qu'on ne saurait imaginer d'une simplicité plus parfaite, tout, déjà, est évoqué et posé : l'homme, le lieu, l'heure. Et ce vers, ralenti au milieu par une large pause, prolongé infiniment comme par un point d'orgue, grâce au dernier mot, « étoiles », est si grand qu'il pourrait faire, à lui seul, équilibre à tous les développements dont il plairait au poète de le faire suivre. Mais supposez, une minute, qu'il ait ainsi commencé la pièce :
Ce serait le même sens, et, pourtant, il n'y aurait plus rien là, absolument plus rien de ce qui est la poésie. Flots et étoiles sont les deux mots essentiels de la pièce, ceux dont l'apposition ou l'opposition vont former toute l'architecture du poème ; or, dans le vers du maître seulement, flots est à l'hémistiche, à la place en vue, et la virgule qui suit semble séparer les deux éléments, la mer et le ciel. Dans la seconde moitié du vers supposé, sur quatre mots il y en a deux, sous et un, qui sont parmi les plus sourds de la langue ; et le dernier mot, étoilé, outre qu'il termine sèchement le vers, par une cassure nette, présente deux fois à l'oreille le son de é bref, ce qui diminue encore sa qualité musicale et le rend d'autant moins moelleux, d'autant plus martelé. Dans la seconde moitié du vers de Victor Hugo, au contraire, grâce à l'e muet de une, et à la délicieuse allitération formée par les n de deux consonnes qui se suivent — une nuit, — écoutez comme la voix glisse avec douceur, pour s'appuyer seulement, pour s'épanouir sur la seconde syllabe d'étoiles, et s'éteindre enfin en se prolongeant sur la syllabe muette qui termine le mot et le vers après avoir caressé l'oreille par la succession de six sonorités différentes.
Comparez !
Passons au second vers. Le poète va-t-il chercher à préciser, par un détail, par une chose vue et dépeinte, le tableau que forme le premier vers ? Un autre n'y aurait pas manqué. Lui, c'est tout le contraire qu'il fait : il n'ajoute pas un trait à son indication déjà toute schématique, il en efface :
Car il veut nous mener, le plus vite possible, du concret à l'abstrait, des choses extérieures aux intérieures, pour nous conduire enfin des intérieures aux supérieures. Et notez, en passant, l'élégance de ce second vers, parallèle au premier par la virgule médiane et par la correspondance des objets, mais parallèle par renversement, pourrait-on dire, puisque, ici, le ciel est dans le premier hémistiche et la mer dans le second : parallélisme de deux gammes dont l'une, montante, serait jouée de la main gauche, l'autre, descendante, de la main droite.
ce monde réel déjà réduit à sa plus simple expression par le vers précédent. Quel est ici, le mot essentiel ? C'est plus loin, et vous voyez que le poète l'a placé à l'endroit du vers qui est nécessairement le plus accentué, à l'hémistiche.
Et, maintenant, le poète veut évoquer toutes ces voix qu'il entend de l'âme, précisément parce qu'il a dépassé le monde sensible… Mais il est déjà au quart de son poème ; comment, sans en détruire les justes proportions, les fera-t-il chanter toutes, en peu de mots ? …
Cette conjonction et, répétée trois fois, par l'indéfini qu'elle donne à l'énumération, y aura suffi : deux fois dans la première moitié du vers, pour des voix particulières, une fois dans la seconde, pour le chœur entier… Je crois voir le chef d'orchestre faisant partir, d'un signe à gauche, les violons, puis d'un signe à droite, les cuivres, et, d'un geste plus large, enfin, des deux mains étendues, déchaînant à la fois tous les instruments de l'orchestre.
Les déchaînant ? Les appelant plutôt, non dans toute leur force, mais dans toute leur douceur, en sourdine. Car ce sont, ici, des voix qui chantent dans le silence et comme en ajoutant encore à la majesté du silence :
Et ici, instinctivement, le poète a employé des mots où trois syllabes de suite sont formées avec la lettre u, celle qu'il est impossible de chanter sur une note haute et forte, celle qu'on ne peut prononcer autrement que les lèvres serrées, et sans presque donner de son !
Essayez un peu d'allonger ce dernier vers pour le mettre à la mesure des autres, par exemple, de dire :
O surprise ! il semble qu'en y ajoutant ces épithètes, au lieu de l'allonger, vous l'ayez raccourci ! Il est plus long par la durée, il est plus petit pour l'imagination, pour la pensée ; car il n'éveille plus, disjoint ainsi par des mots parasites, aucune idée de grandeur. Tel qu'il était, au contraire, concentré, réduit aux quatre substantifs parallèles qui sont l'armature de la strophe, voyez comme il boucle cette strophe en rattachant le dernier vers au premier, et comme il la conclut en la concentrant !
Mais nous en sommes déjà à la moitié du poème ; et le sujet n'en est qu'à son exposition ; et le poète n'a plus que six vers pour le conduire à son terme, quand il y faudrait, pourrait-on croire, plusieurs strophes encore. Nullement. Six vers suffiront. Voyez : le poète n'a pas laissé retomber le mouvement initial ; il a bien mis un point à la fin de la première strophe ; mais voici qu'il repart avec cette conjonction et, conjonction qui enchaîne la seconde strophe à la première, et qui, en deçà même du point final de celle-ci, va rejoindre le vers où, déjà, elle se trouvait trois fois,
pour ne plus faire, des deux strophes, qu'une seule phrase musicale destinée à s'élargir et à croître jusqu'à la fin en sonorité et en majesté :
Dans ce second vers, le poète, par une opération naturelle à la poésie, a fait une transposition d'un sens à un autre : il a transposé l'impression visuelle en une impression auditive. Aux bois et aux monts qui les interrogent, les flots et les astres doivent répondre : il leur faut donc une voix. Les astres brillent à des degrés divers, selon leur éloignement ou leur grandeur, et ils forment, là-haut, des groupements qu'on appelle des constellations : eh bien, les scintillements plus ou moins intenses des étoiles vont devenir des voix plus ou moins sonores, et les mille figures des constellations deviendront mille harmonies perceptibles, non plus aux yeux, mais à l'oreille :
Que disaient-elles ? Est-ce que leur réponse va remplir les trois vers qui nous restent ? Non, la réponse des flots serait oubliée et, de plus, l'équilibre entier du poème serait rompu. Le poète l'a senti : par une inspiration géniale, par une hardiesse sans exemple, il arrête un instant ici sa phrase, il la suspend comme dans le vide, il va, descendant des cieux vers la mer, recueillir à son tour la réponse des vagues, et alors seulement, il la réunit à celle des étoiles dans un unisson prodigieux, — au moyen de ce simple mot de rappel : « Disaient » — pour les balancer ensemble, fumées confondues de deux encensoirs, vers Celui dont, par un suprême artifice, il retarde encore de dire le nom jusque dans le dernier vers même, afin que, de ce dernier vers, ce nom soit le dernier mot, comme il est, à ses yeux, le dernier mot de la création et de l'humanité :
Tel est le mystère du génie. Aucun chemin tracé sur une carte, et que je puisse vous montrer du doigt, ne mène à de pareilles cimes. On peut voir seulement après coup, je le répète, par quelle route le poète est passé pour nous y conduire, guidé par une logique transcendante et qui se joue des ordinaires procédés logiques. C'est un de ces itinéraires que je viens de parcourir avec vous sur les pas d'un grand maître. Si vous m'y avez suivi jusqu'au bout avec attention, il me semble que déjà vous aurez avancé quelque peu, non dans la connaissance, mais dans l'amour de l'art des vers et dans le désir d'en entreprendre l'étude. Et, moi-même, je me sentirais un peu rassuré à la pensée que cette partie mystérieuse de notre art dont je ne pourrai vous instruire par des préceptes, je saurai peut-être, du moins, vous en communiquer l'intuition par des exemples, si vous conveniez que, par celui-ci, j'ai déjà commencé de le faire.
J'ai voulu vous montrer d'abord par quel miracle l'art des vers réalise pleinement et fixe éternellement cette aspiration sublime de l'âme humaine, la Poésie. Bientôt je commencerai, de cet art, à vous enseigner les règles certaines et précises, tout en essayant de vous communiquer en chemin, par la beauté des exemples, l'instinct des lois mystérieuses qui ne peuvent être réduites en formules et en préceptes. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire pourquoi j'ai entrepris cet ouvrage, et ce que j'en attends pour vous tous qui le lirez, si vous voulez bien le lire avec l'attention, avec la piété que je saurai mettre à l'écrire.
J'en attends pour vous, ô mes chers lecteurs, et, par surcroît, pour moi-même, un élargissement et un ennoblissement, une consolation, une pacification, une illumination de tous les jours de la vie. En quelque obscurité de condition que le hasard vous ait fait naître, à quelque médiocrité de fortune que vous vous trouviez attachés, je vous promets, — si, par l'initiation à leur art, vous arrivez à comprendre, à pénétrer, à vous assimiler pleinement le génie des poètes, — je vous promets de vous ouvrir des sources de joie, grâce auxquelles plus d'un éclat vous paraîtra pâle et plus d'une grandeur petite. Car, en étant à même de communier ainsi avec les poètes, vous aurez atteint, vous aurez égalé la vie supérieure que les plus nobles esprits et les plus grands cœurs de tous les siècles auront vécue aux heures les plus hautes et les plus généreuses de leur passage parmi les hommes. Écoutez Lamartine, à la huitième vision de la Chute d'un Ange :
Oui, voilà bien à quelle plénitude de vie vous vous trouverez associés par le commerce intime avec les poètes. Au milieu de ces vers admirables, il en est un, bien simple, que je n'ai pu transcrire sans que de chers souvenirs me remontassent au cœur, c'est celui-ci :
Et ce qu'il me rappelle, c'est l'éveil en moi du sens poétique, c'est la révélation de la Poésie telle qu'elle me fut faite, en mon plus jeune âge, sur les genoux maternels. Et j'ai tant dû à cette initiation première qu'en essayant d'initier autrui à tout ce que contient le langage des vers, il me semblera que c'est une dette que je paye. Oh ! le « Petit oreiller » de la tendre Marceline Desbordes-Valmore !…
Que de fois il fallut que ma mère me les répétât, ces doux vers, jusqu'à la prière finale :
Et lorsque je les sus par cœur, ce me fut encore une récompense que de les lui entendre redire, si j'avais été sage. Et ce fut la clé d'or qui m'ouvrit à jamais la porte des rêves. A présent, Corneille peut venir, avec le Cid, soulever d'enthousiasme héroïque le petit collégien qui pleurait de tristesse derrière les barreaux de sa prison. Et vous pourrez lui donner bientôt les Méditations de Lamartine ; il les cachera, comme un trésor volé, dans le fond de son pupitre, d'où il les tirera, vingt fois par jour, pour les lire, relire et apprendre, pour transformer en mélancolie délicieuse et consolée sa morne détresse de tout à l'heure. Et quand il sera devenu un homme, — et ici je ne parle plus de moi, mais de vous peut-être, — quand il se demandera comment il a échappé à certaines souillures, protégé contre les vents mauvais la pure flamme de l'amour, élevé dans son cœur un autel à la pitié, gardé l'espérance, évité un peu de mal, fait un peu de bien, il vous dira qu'il le doit surtout aux poètes. Les autres enseignent, mais l'oreille peut les entendre sans que l'esprit les écoute et que le cœur les croie : eux, les poètes, par le magique pouvoir du rythme, ils appellent, ils retiennent, ils insinuent, ils pénètrent. Comme une religion par le moyen des mythes, la Poésie prend des idées et les transforme en sentiments par le moyen des images, lesquelles sont des actions commencées, comme les actions sont des images réalisées ; car, entre l'idée pure et l'action, il y a un abîme que l'ébranlement de la sensibilité peut combler seul. Et c'est pourquoi la Poésie, souveraine maîtresse des images, est, pour ceux qui la comprennent et qui l'aiment, la souveraine maîtresse de la vie intérieure, prête à se réaliser en actes.
Les anciens le connaissaient bien, le pouvoir éducatif et comme religieux de la Poésie. Rappelez-vous ce que dit Platon au troisième livre de sa République, où, selon l'habitude des Grecs, il appelle « musique » la réunion de tous les arts du rythme : poésie, musique et danse : « La musique est la partie principale de l'éducation, parce que le nombre et l'harmonie s'introduisant de bonne heure dans l'âme du jeune homme, s'en emparant, y font entrer à leur suite la grâce, la beauté et la vertu. Et cela, dès l'âge le plus tendre, avant que d'être éclairé des lumières de la raison ; et, quand la raison sera venue, il s'attachera à elle aussitôt par le rapport secret que cet art aura mis entre la raison et lui. »
Et Pindare a dit en une de ses odes : « La Poésie fait la paix dans le cœur de l'homme et dans le monde. Elle désarme Arès et éteint le feu du ciel ; elle endort l'aigle même sur l'égide de Zeus, que baigne un nuage d'harmonie. » Magnifique image de cette vertu pacifiante de la Poésie qui fait de l'amour jusques avec de la haine, et du calme jusques avec de la colère, en les ordonnant par la vertu d'une harmonieuse cadence. Et c'est encore un parfait symbole de la Poésie éducatrice et pacifiante, que ce temple d'Éphèse évoqué par Victor Hugo dans son poème des Sept Merveilles du Monde :
Dans ces vers profonds et superbes, le beau n'est pas seulement devenu le vrai, il est devenu le bien ; il s'est transmué en justice, en fraternité, en amour.
Oui, les chefs-d'œuvre sont les vrais éducateurs des peuples ; leurs plus vrais législateurs, ce sont, et surtout ce devraient être leurs poètes, en qui l'on retrouverait, tout le reste fût-il détruit, l'essentiel de ce qui aurait été pensé, senti, voulu, agi par la race. Toute la Grèce est dans Homère ; Dante et Pétrarque ont fait l'Italie ; et quant à Shakespeare, écoutez ce qu'en dit le grand Anglais Carlyle :
« Si l'on nous demandait : « Voulez-vous abandonner votre empire indien où votre Shakespeare ? », réellement ce serait une grave question. Des personnages officiels répondraient sans doute en langage officiel ; mais nous, pour notre part, ne serions-nous pas forcés de répondre : « Empire indien ou pas d'empire indien, nous ne pouvons faire sans Shakespeare. L'empire indien s'en ira, en tout cas, quelque jour ; mais ce Shakespeare ne s'en va pas, il dure à jamais pour nous ; nous ne pouvons abandonner notre Shakespeare… Nous pouvons l'imaginer comme rayonnant en haut sur toutes les nations d'Anglais dans mille ans d'ici. De Paramatta, de New-York, en quelque lieu que soient des hommes anglais et des femmes anglaises, ils se diront les uns aux autres : « Oui, ce Shakespeare est à nous ; nous l'avons produit, nous parlons et pensons par lui… » Oui, vraiment, c'est une grande chose, pour une nation, que d'arriver à avoir une voix articulée, que de produire un homme qui exprimera mélodieusement ce que son cœur à elle pensea. »
Eh bien ! nous aussi nous les avons, nos Homère, nos Dante, nos Pétrarque et nos Shakespeare, qui expriment et qui exaltent « mélodieusement » le génie particulier de notre race, qui sont notre lien national et qui, de plus, par un rare privilège, sont plus qu'aucuns poètes du monde les miroirs de l'homme universel et les annonciateurs de l'humanité future.
Or, quel culte leur vouons-nous ? Hélas ! …
Il n'est pas d'humble « fraülein » qui, en quittant l'Allemagne pour aller servir, n'emporte dans sa malle l'Hermann et Dorothée de Goethe, ou les poésies de Schiller. Il n'est presque pas de maison anglaise où il n'y ait un Shakespeare ; et plus d'une pauvre « miss », venue en France pour élever nos enfants, rouvre chaque soir son Tennyson, et, par les Idylles du Roi ou la Princesse, reste en communication consolante avec l'âme de sa patrie, et avec un peu d'idéal.
Connaissons-nous bien, nous qui avons étudié, qui sommes des savants presque, tout ce que renferme de consolation et de joie, d'héroïsme et d'amour, le trésor de Corneille et de Racine, d'André Chénier, de Lamartine et de Victor Hugo, sans vouloir parler des vivants ? Dans combien de bibliothèques bourgeoises ne chercherait-on pas en vain un Alfred de Musset, un Leconte de Lisle, un Sully Prudhomme ? Il est des villes entières où l'on ne trouverait pas un seul volume des poètes modernes, à côté des vieux classiques jamais rouverts depuis le collège… Quant au peuple, il ne sait même pas les noms des uns ni des autres !
Et pourtant, on lit… Mais que lit-on, pour que l'obscénité monte, pour que la haine grandisse, pour que la volonté se dissolve, pour que la notion de l'amour se déprave, pour que le sens du bien et du mal aille en s'émoussant ?
Nul recours que dans les poètes, en qui, pendant des siècles, se sont concentrées les tendresses, les puretés, les énergies, les espérances de notre race, avec le pouvoir de les répandre, au moindre appel, sur la multitude des âmes.
Eh bien ! cette vertu de concentration et ce pouvoir d'expansion, la Poésie le doit à ces lois magiques, à cet art des vers sans la connaissance duquel les vers ne sont que des lignes inégales et vaguement sonores. Pour qui ne connaît point cet art, les vers semblent même, ô erreur ! avoir entravé la pensée ; pour qui le connaît, au contraire, ils l'ont délivrée, ils ont — et ils le pouvaient seuls — ouvert à son libre vol les perspectives infinies.
Apprenons ensemble l'art des vers. Le chemin que nous aurons à suivre sera quelquefois aride ; mais vous savez, à présent, à quels jardins enchantés il peut nous conduire : partons.
Avant de vous enseigner les règles précises et en quelque sorte mécaniques de la versification, je voudrais pourtant encore vous faire comprendre qu'elles ne sont point une création arbitraire des métriciens, ou, comme on disait autrefois, des « législateurs du Parnasse », mais que c'est sur des lois profondes, sur des besoins essentiels de l'esprit que notre art fonde sa certitude et sa dignité. Après, vous supporterez moins impatiemment, je l'espère, ce que l'étude de ces règles pourra présenter d'un peu aride, et, surtout, vous serez pour jamais en garde contre l'insanité de certaines réformes que quelques-uns voudraient introduire dans notre prosodie traditionnelle et qui ne tendraient à rien moins qu'à la détruire.
Si j'essaye de définir ce qu'est la versification, ce qu'est le vers, je ne trouve rien de mieux que d'emprunter les termes de ma définition aux deux ou trois formules assez proches l'une de l'autre, que Sully Prudhomme nous en a données dans les diverses pages qui composent son Testament Poétique, et je dirai : La versification est l'art de faire bénéficier le plus possible le langage des qualités de la musique, c'est-à-dire dans toute la mesure compatible avec la claire intelligence du sens : le vers est donc un verbe musical qui soulève et soutient la pensée sur les ailes du rythme, mais en excluant la note pour ne pas s'identifier au chant, où l'expression intellectuelle est détrônée par l'expression émotionnelle.
On voit assez, par là, ce qui distingue les vers de la musique. On voit moins bien, peut-être, ce qui les distingue de la prose ; car, enfin, la prose aussi peut être soulevée et soutenue par un rythme, c'est-à-dire par une succession de cadences flatteuses à l'oreille et qui ajoutent un plaisir musical au plaisir de l'entendement. Plus un écrivain véritable a de choses émues ou élevées à nous dire, plus sa phrase tend à se rythmer, à se dérouler avec mélodie. Soit, mais elle se déroule — et cela en est le caractère essentiel — en rythmes inégaux et perpétuellement variables, qui procurent à l'oreille un seul plaisir : celui d'une surprise incessamment renouvelée.
Certes, ce plaisir musical, dans sa parfaite concordance avec le développement de la pensée, est déjà considérable ; il n'est pourtant pas la jouissance la plus musicale possible que puisse donner le langage, celle que vous annonçait la définition de tout à l'heure comme étant le privilège de la seule forme versifiée. La versification seule, en effet, dans tous les pays du monde, et depuis qu'il y a des poètes, peut donner, à l'esprit et à l'oreille, cette double jouissance : la surprise dans la sécurité, jouissance causée elle-même par la réalisation de la variété dans l'unité, de la liberté dans la discipline. Et comment cela ? En soumettant le langage, ainsi que fait la musique, non plus à des rythmes incessamment variables, mais à des rythmes égaux. En musique, l'élément de sécurité sera fourni par le battement régulier de la mesure, à laquelle l'esprit et l'ouïe s'abandonneront, se confieront avec délices pour jouir d'autant mieux des surprises de la mélodie. En versification, la sécurité viendra du nombre régulier des syllabes du vers, du retour régulier de la rime, tandis que la variété des rimes au bout du vers et les souples modulations des syllabes accentuées ou atones dans l'intérieur du vers, apporteront au lecteur, joint à cette sécurité délicieuse, l'enchantement d'une perpétuelle surprise.
Est-ce un besoin puéril et artificiel, ce désir de sécurité, satisfait par le rythme des vers, qui s'ajoute au désir de surprise si complètement satisfait déjà par la prose ? Des prosateurs orgueilleux et peu sensibles à la poésie voudraient bien nous le faire croire. Ils traiteraient volontiers d'enfantillage cette attente de la mesure égale et de l'écho de la rime… Elle est, au contraire, comme je le laissais prévoir en commençant, la manifestation d'une des tendances les plus essentielles de l'esprit, celle qui, par exemple, dans le monde de la pesanteur, nous fait chercher l'équilibre, dans le monde de la vision, la symétrie ; celle aussi qui, dans tout le domaine de l'art et de la pensée, nous pousse à circonscrire, à ordonner, à harmoniser l'objet de notre création ou de notre étude pour jouir ou comprendre davantage, avec un moindre effort. Le rythme poétique étant, nous le verrons bientôt, un de ces moyens d'atteindre, par le moindre effort, aux plus hauts sommets de l'exaltation humaine, l'homme n'a rien inventé dont il ait le droit de se montrer plus fier.
D'où vient-il, ce rythme poétique ? Quelles sont-elles, ces cadences régulières qui constituent le vers français ? Ce sont, tout simplement, quelques-unes des innombrables cadences de la prose, mais choisies et régularisées, à l'exclusion des autres, parce qu'elles flattaient plus particulièrement l'oreille, soit en elles-mêmes, soit par leur répartition, soit par leur assemblage entre elles.
Voulez-vous assister, en théorie, à la naissance du vers français, issu de la prose ? Je vous ai dit, tout à l'heure, que le prosateur, dans l'émotion ou l'élévation de la pensée, avait une tendance à rythmer davantage ses périodes ; j'aurais pu ajouter que parfois même, inconsciemment, il les rapprochait de tout ce qui constitue le rythme poétique. Vous en jugerez par deux exemples, pris chez deux de nos plus grands écrivains en prose ; je tirerai l'un de Michelet, l'autre de Jean-Jacques Rousseau.
Voici le passage de Michelet où, dans son livre de L'Amour, il fait parler à la veuve l'âme de l'époux disparu. Chose étrange ! pour exprimer, par des caresses verbales, une infinie et mélancolique tendresse, il fait, sans le vouloir, parler cette Ombre aimante, soit en vers blancs, en vers non rimés, soit en cadences qui sonneront comme des vers si on les prononce à la façon de la prose, c'est-à-dire en glissant sur les e muets, ceux que j'indiquerai en italique :
« C'est trop veiller, c'est trop pleurer, chérie !… (Vers de 10 syllabes.) Les étoiles pâlissent (6) ; dans un moment, c'est le matin (8). Repose enfin. La moitié de toi-même (10), dont l'absence te trouble et que tu cherches en vain (12), et dans tes chambres vides et dans ta couche veuve (12), elle te parlera dans les songes (8). »
Mais voici mieux encore : un paragraphe entier composé de six vers très réguliers, tous de huit syllabes :
« Oh ! que j'avais donc à te dire ! — Et vivant, je t'ai dit si peu… — Au premier mot, Dieu m'a repris. — A peine ai-je eu le temps de dire : — « J'aime. » Pour te verser mon cœur, — j'ai besoin de l'éternité. »
Et je décomposerai en quatre vers, pour les yeux, le paragraphe suivant, formé de vers de 10, 7 et 12 syllabes :
Remarquez le rapprochement des deux derniers, 12 et 10 syllabes, qui forment ensemble une si heureuse cadence.
Que manque-t-il donc à ces lignes rythmées de Michelet pour qu'elles soient tout à fait des vers ? Rien que la rime, par qui le rythme poétique est plus fortement marqué, affirmé, pour le moindre effort de la mémoire.
La rime ? C'est elle que nous allons voir s'ébaucher à son tour dans la prose de Jean-Jacques, dans une phrase d'une admirable cadence, que je tire de la Nouvelle Héloïse. Et, pour que vous goûtiez mieux cette phrase, je transcrirai d'abord celles qui la précèdent et qui en éclairent le sens :
« Vos feux, je l'avoue, ont soutenu l'épreuve de la possession, celle du temps, celle de l'absence et des peines de toute espèce ; ils ont vaincu tous les obstacles, hors le plus puissant de tous, qui est de n'en avoir plus à vaincre et de se nourrir uniquement d'eux-mêmes. L'univers n'a jamais vu de passion soutenir cette épreuve : quel droit avez-vous d'espérer que la vôtre l'eût soutenue ? »
Écoutez maintenant :
« Le temps eût joint, au dégoût d'une longue possession, le progrès de l'âge et le déclin de la beauté : il semble se fixer en votre faveur par votre séparation ; vous serez toujours, l'un pour l'autre, à la fleur des ans ; vous vous verrez sans cesse tels que vous vous vîtes en vous quittant ; et vos cœurs, unis jusqu'au tombeau, prolongeront dans une illusion charmante votre jeunesse avec vos amours. »
Voyez comme les deux premiers rappels de sonorités : possession et séparation, sont placés à deux endroits où le sens et la ponctuation exigent que le lecteur respire. Voyez, ensuite, comme les deux autres homophonies : ans et quittant, sont symétriquement placées à la fin de deux membres de phrase sensiblement égaux. Et jugez si Jean-Jacques — lequel, vous le savez, ne couchait jamais une phrase sur le papier sans l'avoir fait passer vingt fois par l'épreuve de son oreille — n'a pas voulu, à quatre reprises, grâce à ces sortes de rimes, nous rendre plus sensible, avec un effort moindre, la merveilleuse architecture sonore de sa période, et comme retenir ainsi, comme suspendre, pour mieux exciter notre attente, le déroulement adorable de sa mélodie.
[Et remarquons-y ce vers de douze syllabes, si délicieusement coupé à la façon romantique, en 4 + 6 + 2.
Voilà donc, trouvés d'instinct par les prosateurs, les éléments qui constitueront, chez les poètes, la forme versifiée. Toutefois, chez les prosateurs, l'usage de ces rythmes poétiques et de ces rappels de sons, celui même de cadences plus éloignées du vers, mais encore volontairement musicales, n'est agréable que s'il est discret et rare. A l'état de procédé, appliqué à tout un ouvrage, cette recherche devient vite insupportable. La « prose poétique » est un genre bâtard. Les Incas de Marmontel sont illisibles. Le Télémaque lui-même porte la peine d'avoir été écrit ainsi. De Chateaubriand, nous admirons plus que jamais les Mémoires d'Outre-Tombe, dont le grand style n'est lyrique que par intermittence ; mais nous ne goûtons plus que quelques chapitres des Martyrs, et nous ne lisons plus du tout les Natchez, où le lyrisme en prose est continu. Et que dirions-nous s'il nous fallait entreprendre la lecture de l'Ipsiboë, du vicomte d'Arlincourt, ou du Tristan le Voyageur, de M. de Marchangy ? Croyons-en là-dessus, comme sur beaucoup d'autres choses, Victor Hugo :
Que dites-vous, en passant, de ce chapitre d'Art poétique emprunté aux Quatre Vents de l'Esprit ? Il manquait à celui de Boileau, mais je crois qu'il n'y pourrait pas être intercalé sans dommage pour les vers, excellents, mais plus pleins de sagesse que de lyrisme, du bon Nicolas.
Oui, la prose est faite avant tout pour la marche, non pour le vol, et les procédés lyriques ne doivent point s'y étaler avec affectation, plutôt s'y cacher, comme l'écrit Victor Hugo. Mais prenez à la prose ces accidentelles cadences lyriques, et faites-en des vers en les régularisant, répétant et assemblant ; prenez-lui ces accidentelles rencontres de mots sonnant de même, pour en constituer de franches rimes ; ajoutez, enfin, celles-ci à celles-là, — et vous aurez le plus magnifique, le plus souple, le plus complet instrument d'expression qui ait été mis jamais, dans aucune langue, à la disposition des poètes. Il pourra leur servir à voler aussi haut qu'ils le voudront, et à marcher aussi, pour peu qu'ils le veuillent. Il ne sera pas seulement le verbe de l'ode sublime ou de l'épopée, mais aussi celui de la poésie légère et du conte familier. Il rendra plus joyeux le rire de la comédie, plus tragique la terreur ou la pitié du drame. Il fera plus définitives, et plus transmissibles, jusqu'aux formules où se concentrent l'expérience de la vie et les décrets du bon sens ; car où il n'y aura plus transfiguration et aspiration, il y aura, grâce à lui, beauté encore, parce qu'il aura introduit, dans les moindres choses, une image, un reflet de l'harmonie et de l'ordre universels.
Les lois de ce langage merveilleux, le vers, dont vous savez à présent l'origine profonde et les affinités avec les langages voisins, la musique et la prose, c'est dans notre prochain entretien que nous commencerons de les étudier ensemble.
De notre première causerie, vous avez retenu que la fonction du vers était de communiquer au langage parlé le plus grand pouvoir musical dont il soit susceptible.
Vous avez compris que ce pouvoir exceptionnel était obtenu en ajoutant, — comme fait la mesure dans la musique, — un élément de sécurité pour l'oreille et pour l'esprit, à cet élément de surprise qui est seul donné par le langage ordinaire, et que cet élément de sécurité était dû à l'emploi systématique, dans la versification, d'un petit nombre de cadences régulières, substitué à l'emploi capricieux des rythmes innombrables et irréguliers de la prose.
Enfin, vous avez commencé de voir que cette régularisation du rythme était assurée par le nombre fixe des syllabes donné au vers et par le retour de la rime. Elle l'est, de plus, dans les vers les plus longs, par l'usage de la césure, repos de la voix à l'intérieur de ces vers, destiné à en rendre la cadence plus sensible encore à l'oreille.
Nombre fixe de syllabes, rime, césure : trois procédés qui concourront merveilleusement à créer et à satisfaire, tout ensemble, l'attente de l'oreille, à lui donner, avec un moindre effort de la mémoire auditive, cette joie du retour attendu, ce plaisir de l'identité retrouvée par où la poésie se rapproche encore de la musique, où tout, en effet, conspire à cette satisfaction, depuis le refrain de la vieille romance jusqu'au « leitmotive » du nouveau drame lyrique, aussi bien que les transformations et variations d'un même thème dans la sonate ou dans la symphonie.
Nous allons étudier, successivement, ces trois procédés qui assurent la fixité, l'unité du vers français. Mais, avant d'entamer cette étude et pour l'entière clarté de tout ce qui va suivre, il faut que je vous montre brièvement ce qui, sous ces éléments mécaniques, extérieurs et comme visibles, est ce que l'on pourrait appeler l'essence profonde, l'âme cachée du rythme en général et du rythme poétique en particulier, dans notre langue.
Au cours de notre précédent entretien, j'ai, pour ne pas m'attarder à une définition plus précise, appelé rythme « une cadence agréable à l'oreille », sans chercher d'où cet agrément pouvait venir. Une phrase de Cicéron nous le dira très clairement : « Il n'y a pas de rythme de ce qui est continu : dans les gouttes d'eau qui tombent, nous pouvons, parce qu'il y a des intervalles entre elles, noter un rythme ; dans le fleuve qui coule, nous ne le pouvons point. » Pour qu'il y ait rythme, il faut donc qu'il y ait discontinuité. Comment se manifestera-t-elle dans le langage ? Sera-ce seulement par la séparation des phrases, des membres de phrases et des mots ? Non, ce sera aussi, ce sera d'abord par la différence de prononciation des syllabes, prononciation inégale en durée ou inégale en intensité.
Dans les langues anciennes, dans le latin, par exemple, c'est principalement la durée respective des syllabes qui détermine l'inégalité, donc, le rythme : certaines syllabes sont longues, les autres sont brèves ; celles-ci se prononcent deux fois plus vite que celles-là ; une longue vaut donc deux brèves, comme, en musique, une blanche vaut deux noires ; et ainsi, le vers latin sera tout naturellement formé d'une certaine combinaison de pieds, c'est-à-dire de mesures quasi musicales, égales entre elles en durée, mais composées diversement de longues et de brèves, comme une mesure musicale le serait, soit de deux blanches, soit d'une blanche suivie de deux noires, soit de deux noires suivies d'une blanche, etc. Cette valeur différente des syllabes en durée est ce qu'on appelle leur quantité métrique ou, tout simplement, leur quantité.
Scander un vers latin ou grec, c'est, en le lisant, marquer ces mesures, ces pieds composés de syllabes longues (¯) et de syllabes brèves (˘). Ainsi, prenons le grand vers de Lucrèce et de Virgile, l'hexamètre, c'est-à-dire le vers de six mesures. Trois éléments le constituent tout comme notre vers à nous, mais avec ces différences, qui sont des équivalences :
1o Au lieu du nombre fixe de syllabes, il a le nombre fixe de pieds ;
2o La césure consiste, non comme pour notre alexandrin classique, par exemple, en un repos de la voix à la sixième syllabe, mais dans l'obligation de placer au commencement du troisième pied une syllabe qui soit la dernière d'un mot dont le début se trouve au pied précédent.
3o Au lieu que la fin du vers soit indiquée par une rime, elle l'est par l'emploi obligatoire, à la cinquième mesure, du pied de trois syllabes nommé dactyle, composé d'une longue et de deux brèves (¯ ˘ ˘), et à la sixième, d'un pied de deux syllabes, soit un spondée, composé de deux longues (¯ ¯) soit un trochée composé d'une longue et d'une brève (¯ ˘).
Cela rappelé, — que je tenais à dire pour montrer que dans toutes les langues, le vers n'existe que fondé sur un certain nombre d'appuis fixes pour l'oreille, — scandons les trois premiers vers de la première Églogue de Virgile :
Vous allez voir pourquoi j'ai fait cette petite incursion dans la prosodie latine.
Le vers français pouvait-il être, comme le vers latin, un vers mesuré, métrique ? Cela revient à nous demander ceci : dans notre langue, les syllabes ont-elles une quantité ? Les unes se prononcent-elles, toujours, deux fois plus rapidement ou deux fois plus lentement que les autres ? Non, certes : rien de plus incertain, de plus variable, chez nous, que la quantité des syllabes ; ce n'est point de là que naît le rythme, même dans notre prose ; et, à plus forte raison, ne pourrait-on point appuyer, là-dessus, un système de versification. Quelques érudits, pleins de grec et de latin et trompés par des analogies chimériques, — tel le poète Baïf, au seizième siècle, — l'ont en vain tenté : ils bâtissaient sur un sable toujours croulant et fuyant. Ils oubliaient, du reste, que notre langue était sortie, non du latin de Virgile ou d'Horace, mais du latin de décadence, où la quantité était déjà si oubliée que les vers s'y faisaient, non plus d'après la prosodie des poètes du siècle d'Auguste, en mesurant les syllabes, mais d'après un système très approchant du nôtre et qui est devenu le nôtre : 1o en les comptant ; 2o en y établissant des points de repère, au moyen des accents toniques (nous allons voir ce que c'est) ; et 3o quelquefois même, en les rimant : ainsi, dans le Dies iræ liturgique :
J'ai parlé d'accent tonique, et souligné, dans ces six vers, les syllabes sur lesquelles il porte. Si vous vous rappelez l'air chanté à l'église sur ces paroles, vous constaterez que ces syllabes sont celles où la voix appuie le plus fortement, et non pas toujours celles qui ont le plus de durée. Les syllabes toniques, par rapport aux syllabes atones (celles sur lesquelles la voix glisse au lieu de les frapper), ne sont donc pas comparables aux longues, en face des brèves : il ne s'agit plus de la durée, il s'agit de l'intensité différente du son des syllabes.
Mais, si vous n'avez pas présente à la mémoire cette musique, dont je ne vous ai parlé que parce qu'elle suit exactement la distinction des syllabes de ce texte en toniques et en atones, fiez-vous à la façon dont je les ai différenciées les unes des autres, et lisez seulement les vers en appuyant davantage sur les syllabes soulignées. Que constaterez-vous ? Un plaisir de l'oreille qui ne sera pas seulement celui donné par la longueur égale des vers (tous de huit syllabes), et celui procuré par le triple retour de la rime dans chaque strophe, mais un autre encore : celui qui résulte du balancement des syllabes accentuées, alternant avec les syllabes non accentuées.
Passons, maintenant, à notre langue. Toutes les fois que nous parlons, il arrive que, sans y penser, nous appuyons plus fortement sur certaines syllabes, plus faiblement sur certaines autres. Est-ce au hasard et par caprice individuel ? Non ; et, si l'on y regarde d'un peu près, on s'aperçoit aussitôt que l'on obéit, d'instinct, à une loi, qui est à la fois très rigoureuse et très simple, et qui se peut formuler en deux articles :
1o Dans les mots de plusieurs syllabes, l'accent tonique, c'est-à-dire le son de voix le plus intense, tombe toujours sur la dernière, quand elle n'est pas formée avec un e muet (espoir, nous viendrons), et sur l'avant-dernière, lorsque c'est avec un e muet que la dernière est formée (espérance, ils viennent).
2o Quant aux monosyllabes, — et notamment ceux qui, comme les articles, les pronoms, les prépositions, les temps des verbes auxiliaires, n'ont qu'une valeur purement grammaticale, — ils gardent ou perdent l'accent tonique, selon les cas, en se fondant, pour ainsi dire, au point de vue de la prononciation, avec le mot qu'ils précèdent ou avec celui qu'ils suivent. Ainsi dans : nous sommes, il viendra, la lumière, le soleil, il est parti, les monosyllabes nous, il, la, le, est n'ont pas d'accent tonique parce qu'ils forment comme la première syllabe d'un mot composé. Mais ces mêmes monosyllabes reprendront leur accent quand je dirai : Y sommes-nous ? — Vient-il ? — Nous l'aimons tel qu'il est. — Amenez-le, parce qu'ils forment alors comme une syllabe finale.
Eh bien, c'est de l'obéissance instinctive à cette loi, d'une simplicité si grande, que naît le rythme du langage. En voulez-vous la preuve ? Prenons une phrase dont la cadence vous semble, dès le premier abord, flatteuse à l'oreille, celle-ci, par exemple, des Maximes de La Rochefoucauld : « Le soleil, ni la mort ne se peuvent regarder fixement. » Et essayez un peu de la prononcer en égalisant toutes les syllabes, sans porter plus fortement la voix sur les unes que sur les autres : « Le so-leil-ni-la-mort-ne-se-peu-vent-re-gar-der-fi-xe-ment. » C'est abominable : aucune cadence, plus trace de rythme ! Mais, au contraire, conformez-vous aux deux règles ci-dessus et lisez : « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. » Et toute la beauté musicale de la phrase, comme par enchantement, reparaîtra.
S'il en est ainsi dans la prose, jugez du rôle que l'accent tonique doit jouer dans les vers !
Il a joué d'abord, dans le vers français, au point de vue historique, le rôle de créateur, ni plus ni moins. Dans une langue balbutiante et où n'existait plus la quantité des syllabes, il fut le seul fondement du vers primitif, tel qu'il nous apparaît dans deux des plus vieux monuments de notre poésie : la Vie de Saint-Léger et la Passion, qui datent du dixième siècle. Qu'est-ce, en effet, que ce vers primitif ? Un assemblage de huit syllabes, dont la dernière est obligatoirement frappée d'un accent qui en détermine l'étendue pour l'oreille. Mais aussitôt, on cherche à frapper l'oreille davantage, à lui marquer, mieux encore, la mesure du vers, et l'on est tout naturellement conduit, de cette accentuation obligatoire de la dernière syllabe, à une ressemblance de son entre cette finale et celle du vers ou des vers qui suivent. Ce sera d'abord l'assonance, espèce d'ébauche de la rime, où le son n'est encore rappelé que par la similitude de la voyelle :
« Ami, lui dit Jésus le bon — pourquoi me trahir dans ton baiser ? — Mieux vaudrait que tu ne fusses pas né — que de me trahir par convoitise. » (La Passion.)
Mais déjà, au milieu des simples assonances, on rencontrera de vraies rimes, plus ou moins parfaites ; ainsi, dans la Vie de Saint-Léger :
Ce qui peut se traduire très exactement par :





























