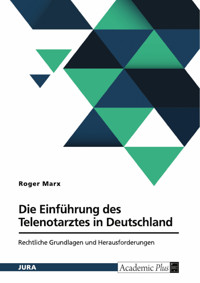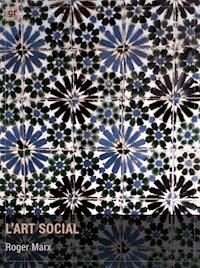
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: gravitons
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Un texte prônant la démocratisation de l'art.
Véritable manifeste contre la spécialisation et l'élitisation, cet ouvrage prône la reconnaissance des art décoratifs et l'intégration de l'art dans toutes les sphères de la société. Son approche moderne de la création artistique, mêlée aux activités professionnelles et aux convictions de son auteur, fait de "L'Art social" un jalon dans l'histoire sociale de l'art.
Cet ouvrage présente les visions réformatrices de Roger Marx.
EXTRAIT
Quand l'art se mêle intimement à la vie unanime, la désignation « d'art social » seule peut lui convenir. On ne saurait restreindre à une classe le privilège de ses inventions ; il appartient à tous, sans distinction de rang ni de fortune.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Nancy, 28 août 1859 – Paris, 13 décembre 1913
Roger Marx était un homme de lettres et critique d’art français, inspecteur général des Musées des départements au Ministère des Beaux-arts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L'Art social
Roger Marx
Préface d'Anatole France
2e édition ISBN 979-10-95667-07-0 Copyright © gravitons 2015 Tous droits réservés
Cela fait un siècle, depuis l'édition d'Eugène Fasquelle, que L'Art social de Roger Marx ne fut édité. Critique d'art, fonctionnaire et collectionneur, Marx occupa des postes importants au sein des institutions des Beaux Arts de la Troisième République, et put ainsi mettre en place nombreuses de ses visions réformatrices.
La présente édition est basée sur Roger Marx, L'Art social, Paris : Bibliothèque-Charpentier, E. Fasquelle, 1913.
Préface
Livre de doctrine et de combat, d'initiatives et de réformes, de philosophie et d'art, d'esthétique et de sociologie, tel nous est apparue l’œuvre nouvelle de Roger Marx, le livre qu'il a pu intituler heureusement L'Art social.
Ce livre évoque pour nous une heureuse alliance de justice et de beauté, il nous invite à croire au progrès désirable qui donnera aux hommes la plus belle des libertés, celle de penser et de sentir.
De quel droit une minorité de privilégiés, doués par les hasards de la naissance d'une éducation perfectionnée et d'une sensibilité particulière, dérobaient-ils aux artisans et au peuple les richesses incomparables qui composent le patrimoine de l’humanité et donnent à qui les pratique des jouissances infinies ? N'est-ce pas refuser les joies esthétiques à ceux-là mêmes qui, patiemment et longuement, travaillèrent et souffrirent pour les créer, les conquérir ou les conserver ?
Injuste et malheureuse, telle nous est toujours apparue cette distinction entre les destinées sociales qui ne provient pas de la nature.
L'expansion des beaux-arts et des arts décoratifs résulte de la constitution intime des sociétés ; il est digne de l'humanité de permettre à tous les êtres pensants de participer aux nobles émotions provoquées par les œuvres d'art ; il est louable de vouloir enrichir la vie des humbles, en leur apprenant à comprendre et à aimer les beautés de l’art et de la nature.
À l’imitation de la sève qui nourrit le tronc et les branches de l’arbre et fait la fraîcheur du feuillage, l’éclat des fleurs, le savoureux parfum des fruits, les leçons de beauté comprises par les artisans enrichiront leur esprit appauvri par de décevants labeurs, et ces saines visions donneront à leurs pensées un tour plus harmonieux.
Et c'est à cette œuvre utile et bonne que Roger Marx, avec l’autorité de sa haute conscience et de son grand talent, s'est consacré depuis vingt-cinq années.
Dans les excellentes pages de ce nouveau livre, Roger Marx nous présente, sous un heureux jour, le rôle civilisateur et éducateur de l’Art dans la société moderne. Il nous le montre utile à tous les progrès, réclame pour lui l'aide du machinisme, la division du travail, toutes les applications des inventions scientifiques, inventions que des esprits chagrins ont voulu dénoncer et combattre comme des tares. Roger Marx, en contradiction avec Ruskin, les place au premier rang des nécessités esthétiques ; il nous les présente comme un adjuvant indispensable de réussite pour qui veut réaliser ce merveilleux problème : l’Art pour tous, dans tout et par tous.
Comme Emerson en Amérique et Morris en Angleterre, Roger Marx est en France le grand apôtre de l’art social. II a préconisé le principe d'une exposition internationale d'art décoratif, il a fait ouvrir aux arts les portes de l'école, obtenir l’entrée des artisans aux Salons annuels ; nous lui devons l’idée des plus beaux symboles qui décorent aujourd'hui notre monnaie.
Nous lui avons une grande reconnaissance de ce qu'il a combattu en faveur des arts décoratifs pour leur rendre leur place à côté des beaux-arts.
Par quelle aberration concevait-on autrefois des arts supérieurs et des arts inférieurs ? Fallait-il donc entendre que les arts industriels, trop engagés dans la matière, ne s'élevaient point à la beauté pure ? De cette distinction malheureuse les arts industriels furent appauvris, avilis et du même coup les beaux-arts, isolés et privilégiés, se virent exposés aux dangers de l’isolement et menacés du sort des privilégiés.
Il faut louer hautement ceux qui détruisent ces préjugés. Désormais nous croirons qu'il n’y a pas deux sortes d'art : il n'y a qu'un art, qui est à la fois industrieux et grand, un art qui s'emploie à charmer la vie, en multipliant autour de nous de belles formes exprimant de belles pensées.
On lira avec grand plaisir les chapitres consacrés aux fondateurs de l'art social moderne en France : Gallé, Chéret, Lalique, les lignes où sont peintes les féeries colorées de la Loïe Fuller. De telles pages font éclater la valeur de l'écrivain et attestent la persistance de ses vues et le succès de ses entreprises ; elles prouvent qu'en lui l’esthéticien et le philosophe se joignent à l'artiste pour bien juger et pour bien dire.
Mais il me faudrait trop ajouter à ces remarques pour juger utilement et complètement la tâche de l'artiste, du littérateur et du critique, et pour louer comme il convient le nouveau livre et l’œuvre tout entière de Roger Marx ; il faudrait rappeler ses campagnes généreuses en faveur du bien et pour le beau, citer toutes les œuvres qu'il a fondées, celles qu'il a préconisées, celles qu'il a su mener à bien sans découragement, à travers des obstacles qui semblaient insurmontables.
Apôtre inlassable, sachant lutter mieux que tout autre pour faire passer ses idées dans l'action et dans la pratique, il ne s'est jamais donné plus complètement que dans son effort pour mêler l’art consolateur à la vie quotidienne, pour en orner les existences les plus humbles, pour en revêtir la société entière.
Afin de résumer tout ensemble son labeur, ses tentatives et ses réussites, j’appliquerai à son esprit combatif cette phrase définitive d’Emerson : « Béni soit celui qui agite les masses, dissout la torpeur et fait naître le mouvement ! »
Anatole France
L'Art social
Aucun mystère n'enveloppe plus aujourd'hui les origines de l'art. Les savants, d'accord avec les folkloristes, lui reconnaissent, dès ses débuts, à toutes les époques et sous toutes les latitudes, les mêmes fins utilitaires. Pour établir la genèse des sentiments esthétiques, il faudrait, dira le philosophe, dresser le répertoire des besoins et des désirs humains. Moyen d'action, langue universelle et écriture figurée, expression visible et durable de l'état des esprits et des mœurs, l'art renseigne l'histoire, stimule les énergies individuelles, et le partage des émotions qu'il suscite établit entre les hommes une solidarité étroite, des raisons permanentes de sympathie et d'union.
Parmi tant de systèmes recommandés pour en classer les manifestations, le plus simple les rangera selon les satisfactions offertes à l'activité de nos sens et de notre pensée. Depuis la Renaissance, les ouvrages conçus sans but défini se sont éliminés du concert des arts, auparavant indivisibles. Il n'entre pas dans notre dessein de rabaisser le mérite de ces créations ; on remarquera seulement que, au point de vue sociologique, la portée s'en trouve forcément restreinte. Elles sont extérieures à notre existence ; elles intéressent la sensibilité, mais pas toujours la raison. L'art social, au contraire, s'exerce en fonction de la vie ; il s'y mêle, il l'imprègne, il la pénètre ; à la beauté apparente, pittoresque ou plastique, s'ajoute chez lui une beauté intime, que l'on appellerait volontiers la beauté de finalité.
Dans la diversité de ses règnes et de ses productions, la nature fait voir sous quelles espèces harmonieuses s'accomplit la loi primordiale d'adaptation des moyens à la fin. Ses exemples enseignent la méthode à suivre pour réaliser les conceptions qu'elle suggère, pour combiner les éléments et animer la matière ; mais la nature n'est pas seulement la source de toute inspiration, le modèle éternel offert aux inventions de notre industrie. Par les spectacles présentés à nos regards, par les conditions de notre existence si exactement régies, elle intervient comme une dispensatrice souveraine de force, comme le facteur essentiel du progrès. Les mutilations qu'on lui inflige ne servent qu'à mieux accuser le prix de ses bienfaits ; la conscience devient plus claire des liens qui unissent l'être au milieu ; la même piété s'émeut et défend, au nom du même idéal, le sol et l'édifice, l'espace libre « poumon de la cité » et les vieilles pierres qui en racontent l'histoire. N'est-il pas vrai d'ailleurs que les ouvrages de l’art et de la nature constituent un tout immorcelable ? Leur réunion forme les traits qui composent la figure de la terre natale.
Protéger les sites, les monuments, c'est sauvegarder le patrimoine de la nation et par là même affirmer le droit de tous à la jouissance de la beauté. Droit imprescriptible dont l'exercice s'impose et déroute. L'Antiquité et le Moyen Âge n'avaient pas mis en question la communauté du sentiment esthétique ; nous ne revenons à leurs vues qu'après de longs détours et avec beaucoup de peine. L’intuition a trop de part dans ce sentiment pour qu'il soit juste d'en réserver l'apanage à une sélection préétablie. L'intelligence spontanée de l'art résulte d'un don natif départi au gré de l'esprit qui souffle où il veut ; mais de ce que l'étude peut, à la longue, en procurer la connaissance, on a faussement induit l'inaccessibilité du beau ; par surcroît, une faveur détestable, aveugle, vouée aux créations abstraites et inutiles, a rétréci le champ de l'art et rendu sa notion inséparable de l'idée de luxe et de haute culture. C'est contre quoi Tolstoï s'est révolté : « Nous sommes habitués, dit-il, à ne comprendre dans l'art que ce que nous voyons dans les Salons, les musées ; que ce que nous entendons dans les concerts. Ce n'est là qu'une infime partie de cet art qui est un trait d'union entre les hommes. Notre existence est remplie de toutes sortes d'œuvres artistiques, depuis la berceuse, les jouets d'enfant, l'ornementation des vêtements, jusqu'aux offices religieux et aux processions solennelles. Nous appelons art non pas la forme d'activité qui traduit nos sentiments, mais seulement une partie de cette activité. »
Rien de plus sensé que cette remise au point ; vérifiée par les faits, elle s'accorde avec les aspirations de l'idéal qui fut de tout temps le nôtre. Quand un Melchior de Vogüé ou un Suarès cherche à le définir, c'est la qualité humaine qu'il lui concède en premier lieu et dont il lui fait le plus d'honneur. Connaissant son origine, nous savons quels en sont les composants, ce qu'elle doit aux grâces vives de l'hellénisme, à la logique latine, au mysticisme chrétien. Par le rayonnement de ce don auguste, notre civilisation s'est fait aimer et a prévalu sur les âmes étrangères ; ce serait contredire notre tempérament et l'histoire que borner l'effusion d'une générosité jalouse de rendre la vie meilleure et plus douce pour tous. Les peintres primitifs de la France, quoi que l’on prétende, ne valaient pas ceux de l'Italie ni des Flandres ; vers la même époque, nos artisans remportent dans le façonnage des objets usuels destinés au service religieux ou civil, militaire ou domestique ; ils y prouvent une cordialité qui ne rehausse pas moins leur travail que la délicatesse du goût et la vivacité de l'esprit.
Ce sentiment esthétique appliqué à la vie collective a pu s'altérer, il ne s'est pas aboli ; les émotions heureuses qu'il cause sont réclamées à des titres nouveaux. L'instinct du mieux, la volonté de hâter un bien-être auquel tous tendent par des moyens différents, mais avec des droits pareils, ravive les désirs dont les artisans du Moyen Âge avaient eu la conscience latente et qu'ils s'étaient employés spontanément à contenter. Le nécessaire d'abord, puis l'utile, l'agréable enfin, demandait, vers le milieu du xixe siècle, Cabet dans son Voyage en Icarie. En vertu d'une progression normale et d'un enchaînement logique, le besoin de beauté procède des satisfactions accordées aux nécessités premières d'assistance, d'hygiène et de confort : « La joie des yeux est un élément de la santé. » Voilà une belle parole : elle est d'un économiste.
Ainsi l'évolution des sociétés ne va pas à l'encontre de l'amour et du respect de la beauté. Les variations dont elles sont l'objet n'affectent l'art que d'une façon superficielle ou transitoire ; il fait fatalement son bénéfice du progrès commun à l'humanité. Les découvertes de la science, qui semblent d'abord opposées à son essence, finissent toujours, judicieusement utilisées, par tourner à son profit. Il faut se consoler d'acquérir, en échange de menues pertes, des avantages durables et chers au plus grand nombre. Varier n'est pas déchoir. Les arts ne disparaissent pas, ils se métamorphosent ; le fait qu'ils se répandent n'implique nullement qu'ils s'abaissent. On a médit à satiété de la photographie et des procédés de gravure qui en dérivent ; ils n'ont atteint que les copistes sans troubler les créateurs ; en somme, nulle découverte n'a secondé plus efficacement la formation du goût et la culture esthétique.
Parmi les hérésies ruskiniennes, les plus pénibles sont celles où ce noble esprit se déjuge et se dément, comme il lui arrive mainte fois d'ailleurs. Il rêve à des destins préférables et sa conception de la vie est la plus immobile qui se puisse imaginer. Ce révolutionnaire est l'ennemi né de la pensée et de la civilisation modernes. Les réformes qu'il préconise ne s'admettent pas sans les innovations qu'il réprouve. Vous le croyez avide de beauté pour chacun, et jamais Ruskin ne s'est montré si violent, si partial que dans ses diatribes contre la machine, auxiliaire de tout effort, agent de toute diffusion. Il n'a pas compris que la conquête des forces asservies au commandement des hommes allait soulager leur peine, accroître leur pouvoir, élargir leur existence. « Le travail se spiritualise, gagne en élévation : à la créature de fer et d'acier la partie matérielle de la besogne ; à la créature de chair et d'esprit de combiner, de régler... »
Si cosmopolite qu'il semble, Ruskin partage avec sa nation et sa race l'enthousiasme pour les prouesses de la vigueur musculaire. Sa prédilection reste indifférente à la sagacité qu'exige la conduite d'une machine, outil perfectionné, plus complet que nul autre, instrument docile des volontés affranchies. Il se fâche à l'idée d'une compatibilité possible entre le culte de la beauté, la dignité de la vie et l'emploi des procédés mécaniques ; pourtant seule la locomotion à vapeur, contre laquelle il proteste, lui permettra de se réaliser intégralement dans ses livres ; ainsi, sans l'aide du tour à réduire, un Chaplain, un Roty, un Charpentier n'auraient traduit qu'une faible partie de leurs conceptions, au plus grand préjudice de l'art et de la pensée.
Le mépris hautain du progrès s'accompagne chez Ruskin d'une dévotion au passé qui confine au paradoxe, à la manie ou au dilettantisme. Gardons-lui moins rancune de ses visées rétrogrades, de son système de l'imperfection nécessaire, que de la tendance décidée à sacrifier l'inspiration au métier. Ici la méprise est flagrante. Le souci de l'interprétation l'entraîne à négliger la prépondérance du modèle. Dans son esprit le départ s'établit mal entre la suprématie de l'inventeur et la subordination des moyens d'expression, sujets à différer. Un abus fréquent met en conflit le travail à la main et le travail à la machine ; ils peuvent, ils doivent coexister, soit qu'ils remplissent des missions distinctes, ou que, dans un même dessein, ils se totalisent. Leur pratique simultanée est indispensable pour mieux répartir des joies que notre altruisme veut étendre à tous ; elle saura élargir le champ d'emploi des énergies et, par la diversité des aptitudes qu'elle demande, assortir la nature de la tâche aux facultés de l'individu.
Les objections formulées par Ruskin contre la division du travail ne laissent guère moins de part à l’erreur. Son lyrisme s'échauffe et s'emporte sur de simples apparences ; il conclut de l'accidentel au général, du présent au définitif ; les compensations que le fait économique porte en soi lui échappent, je veux dire les avantages dont l'art bénéficiera tôt ou tard, dans le même sens de vulgarisation bien entendue. La division du travail lui apparaît d'un point de vue spécial ; elle n'a pas cessé d'être, comme à l'époque des cathédrales et au temps de Lebrun, la condition d'élaboration ordinaire de l'œuvre collective, l'orchestration plus ou moins heureuse des activités ; et alors ses effets comptent selon l'autorité de la volonté directrice, la distribution des parties, la convenance de chacun à sa besogne, la soumission et l'entente de tous en vue du résultat final.
À qui réserver le titre de « héros » ?, demande Carlyle. À ceux qui transforment la société en éternelle métamorphose. Leur rôle ne saurait être tenu sans le secours des forces neuves dont dispose le progrès. Si un trait commun rapproche Émile Gallé, Jules Chéret et René Lalique, il est fourni par ceci, qu'ils ont accepté la division du travail et que les procédés mécaniques ou chimiques ne leur sont demeurés ni étrangers, ni hostiles. Dans tous les ordres, ils ont fait leur bien de chaque acquisition et le contentement de créer s'accroît chez eux de ce qu'y peuvent ajouter des facilités de réalisation et de diffusion décuplées par le génie moderne.
Nos architectes sont rarement des « héros », selon la définition de Carlyle, bien qu'il leur incombe de fixer dans la pierre les vicissitudes de l'histoire. En ce qui les concerne, la théorie de l’art pour l'art reste sans emploi. Le respect de la destination constitue la raison première de leur ouvrage et la condition éliminatoire de son mérite. Chaque problème que posent les temps nouveaux commande une solution particulière ; le passé ne saurait la fournir et nos vœux appellent le règlement qui interdirait de construire selon le mode antique des édifices promis à une fin ignorée des Grecs et des Romains. Devant l'impuissance à innover, le regard se tourne vers les ingénieurs ; ce sont gens absorbés par la préoccupation exclusive de l'utile, assure-t-on. J'entends. Mais, du moment où un édifice n'existe qu'à la condition de répondre à sa fonction, les qualités de l'ingénieur sont préalablement requises chez l'architecte, et si la conception de l'ingénieur trouve, pour se formuler, des voies harmonieuses, elle atteint de soi-même à la beauté. Il y a toujours quelque égoïsme dans le labeur doctoral et stérile où aboutit l'érudition patiente, mais le souci généreux de l'intérêt collectif aide à fructifier la recherche de l'agrément et de la grâce. L'enthousiasme ne risque guère d'être provoqué par la parure surannée dont se surcharge la façade d'un palais sans caractère ; il s'éveille et grandit à la vue du simple pont de fer audacieusement jeté sur un ravin et dont les formes légères fendent l'espace, pareilles aux ailes éployées de l'oiseau dans son vol. D'ailleurs, les matériaux et les procédés qui changent, les aménagements plus compliqués laissent prévoir l'opportunité d'ingénieurs architectes ou d'architectes ingénieurs. À quoi bon s'embarrasser de terminologies subtiles, de distinctions spécieuses, oiseuses ? Que la connexité des efforts précise le but proposé au constructeur : il doit concilier le spirituel et le matériel, accorder de nobles ambitions avec de vulgaires commodités, réjouir la sensibilité après avoir satisfait la logique. Lourde charge qui n'écarte le tribut d'aucune connaissance, qui requiert l'inclination aux idées générales (tant les facultés mises en jeu diffèrent) et à l'humilité (tant la volonté est contrainte de se plier aux exigences du milieu, des mœurs et des hommes). C'est seulement en se pénétrant de son sens social que l'architecture pourra éviter l'abstraction ou la réminiscence, et devenir l'expression de l'idéal commun et du désir d'autrui.
Le programme utile lui a été dès longtemps tracé : « L'avenir est splendide devant nous, écrivait P.-J. Proudhon. Nous avons à édifier trente-six mille maisons communes, autant d'écoles, des ateliers, des manufactures, des fabriques, nos gymnases, nos gares, nos entrepôts, nos magasins, nos halles... Nous avons à créer quarante mille bibliothèques, des observatoires, des cabinets de physique, des laboratoires de chimie, des amphithéâtres d'anatomie, des musées, des belvédères par milliers... Nous avons la France à transformer en un vaste jardin mêlé de bosquets, de bois taillis, de hautes futaies, de sources, de ruisseaux, de rochers... » La suite des années a fait plus clairement ressortir quels établissements réclament les besoins de la vie publique et privée, ouvrière et intellectuelle. La question est moins dans l'évidence de ces nécessités que dans les voies suivies pour y parer. Réfléchissez à la manière dont l'État, la ville, la commune, les particuliers entendent et traitent l'architecture, à la façon dont elle s'enseigne le plus souvent et dont on la pratique, puis dites si sa décadence n'est pas la résultante d'une conception erronée, d'une pédagogie formulaire, dune routine administrative en opposition avec l'esprit de découverte, souverain bien de l'humanité et origine de tout progrès ?
Le mal a sa répercussion sur les arts qui s'ordonnent en vue de la vie. L'architecture les encadre, et il leur arrive de s'y lier si intimement qu'il devient impossible de les en distraire. Un vieil adage ne veut-il pas que, pour orner le monument, la tenture, tissée ou peinte, fasse corps et s'identifie avec lui ? L'harmonie naît de la subordination des parties au tout. Dans la rue, dans le palais, dans l'église, comme dans la maison, chaque élément de décor fixe conserve le caractère architectonique. Le même caractère s'attache à la décoration mobile dans la mesure où elle participe à la constitution d'un ensemble ; les ornements de la personne et de la demeure, dès qu'ils s'expriment par le relief, relèvent de l'architecture, plus ou moins lointainement.
Si nous voyons en elle le premier des arts utiles, niera-t-on qu'elle contienne les autres en puissance ? Tous ont une destinée commune et suivent une gravitation parallèle. Ils sont semblables à des fruits jadis naturels et qui auraient dégénéré, avec le temps, en produits de culture. La mémoire supplée au don, l'acquis à l'innéité, l'esprit imitatif à l'esprit inventif. Cependant de l'expérience des siècles une leçon se dégage : les principes seuls sont immuables ; les applications en paraissent d'un âge à l'autre caduques et hors d'intelligence. Plus les créations de l'art servent intimement les besoins de l'homme, plus elles doivent se modifier selon ses conditions d'existence toujours changeantes. Elles n'y parviennent pas d'emblée. La science a beau transformer la vie, les inventions nouvelles gardent longtemps les dehors de celles-là mêmes qu'elles ont mission de remplacer : les coupés des diligences ont suggéré les agencements des wagons de chemin de fer pour lesquels il eût été loisible de concevoir des dispositions différentes ; hier seulement la flamme électrique des lampes portatives descend et se diffuse sur nos tables, au lieu de pointer en l'air, comme jadis la couronne de lumière, en haut de la mèche fumeuse, à l’époque des quinquets à huile.
Que de liens étroits nous enlacent au passé ! La douceur de l'habitude, la crainte de l'inconnu, la répugnance à l'effort que réclame toute innovation pour être réalisée ou simplement admise. Notre paresse feint de tenir pour définitifs et intangibles les résultats acquis ; vouloir y ajouter semble un attentat à l'ordre établi, comme si l'immobilité ne marquait pas un arrêt, sinon un terme, à l'évolution des intelligences et des sociétés ! Il va de soi que ces mutations nécessaires ne sauraient s'accomplir à l'aventure ; un équilibre doit être cherché, trouvé, entre la lettre qui change et l'esprit qui demeure ; les obligations fondamentales de la raison ne sont pas seules en cause, mais aussi les modalités du goût qui restent dans la dépendance du climat et du tempérament.
Prise dans son ensemble, la régénération de l'art social a rencontré les entraves que pouvaient susciter l'hostilité, la sottise ou l'indifférence. Elle s'est poursuivie néanmoins contre le sentiment général, en vertu de l'impulsion obscure qui assure toujours le triomphe du progrès. L'État l'a ignorée ou, du moins, n'en a pas mesuré la signification. Le sort de l'architecture moderne l'inquiétait assez peu ; à plus forte raison, juge-t-il les installations intérieures indignes de son attention. Parer la vie de beauté, qu'importe ? De nouveau, la peinture et la sculpture confisquent toute l'estime et absorbent tous les crédits aux dépens des arts utiles. L'avenir sera surpris que, après avoir construit à grands frais tant de monuments affectés à des services publics, nous n'ayons pas compris la nécessité de les aménager, selon une donnée moderne, avec l'aide de talents éprouvés et sûrs. Pourquoi commander un tableau, un bas-relief, une statuette, plutôt qu'une cheminée, un ameublement, une pendule ou un lustre ? Pourquoi ne pas tenir à jour et enrichir par des acquisitions, faciles aujourd'hui, plus tard onéreuses, le fonds et les collections du Garde-meuble national ? Dans chaque bâtiment civil le moindre détail, depuis la serrurerie des portes jusqu'aux lambris des murs, depuis le tapis du parquet jusqu'à la guipure des fenêtres, peut devenir le texte d'une recherche originale, féconde. Quelle belle initiative à prendre, et si riche de conséquences heureuses ! On ne verrait plus un cadre vétuste donné à des idées modernes, ni un ministre du Travail et de la Prévoyance sociale meublé dans le style de la monarchie de Juillet. L'exemple venu de haut entraînerait les volontés hésitantes ; sollicités de concourir à de vastes ensembles, les maîtres puiseraient une émulation certaine et des gages de succès dans les occasions enfin données de s'employer et de produire.
Mais, objecte-t-on, l’État a ses manufactures, survivance de l'ancien régime, épave incohérente du luxe de la Cour. L'État imprime, tisse, bat monnaie, tient fabrique et boutique de porcelaine. Entre ces divers établissements aucun lien, aucune entente, pas une trace de direction homogène dans un sens précis. En l'absence de tout conseil compétent, le prestige de l’art se retire des destinées que suivent présentement l'administration des Monnaies et l'Imprimerie nationale. Pour les manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais, on se demande par quel privilège, ou quel hasard, la tapisserie et la céramique s'y trouvent soutenues à l'exclusion d'autres arts aussi dignes de la sympathie et des subventions de l'État. Relisez l'édit du Roy qui institue les Gobelins (1668). Il porte textuellement : « Le Surintendant de nos Bâtimens et le directeur sous lui tiendront la manufacture remplie de bons Peintres, Maistres Tapissiers de Haute lisse, Orfèvres, Fondeurs, Graveurs, Lapidaires, Menuisiers en ebène et en bois, Teinturiers et autres bons ouvriers en toutes sortes d'Arts et Métiers qui sont establis et que le Surintendant de nos Bâtimens estimera nécessaire d'y establir. » L'intérêt des pouvoirs publics s'explique mal, restreint à deux techniques spéciales ; on veut le voir encourager impartialement l'unanimité des artisans. Cela a été le rêve du xixe siècle que cette « grande manufacture » ouverte à tous les arts : les projets de Talma (1800) et de Duruy (1866) en avaient fait une école ou un collège ; elle devient établissement d'enseignement et de production avec Melchior de Vogüé (qui désigne, en 1889, Émile Gallé pour la gouverner) ; telle avait déjà été, trente ans plus tôt, la conception de Léon de Laborde lorsqu'il attribuait comme mission à la grande manufacture « de centraliser sous une direction supérieure toutes les industries qui peuvent recevoir de l'art une impulsion utile afin de former une école pratique des arts appliqués ».
D'après Léon de Laborde, l'intervention de l'État au profit de la nation doit revêtir le double caractère d'une initiative et d'une protection. Dans quelle mesure des administrateurs assujettis à la consultation du précédent ne s'effrayeront-ils pas de la hardiesse des initiatives, et d'autre part comment concilier l'instabilité gouvernementale, la crainte des responsabilités qu'on élude, avec les devoirs d'une protection éclairée, régulière, suivie ? Depuis le début de la troisième République, le transfert et la reconstruction de l'École des arts décoratifs n'ont pas cessé d'être réclamés dans l'intérêt matériel et moral du pays, au nom de l'hygiène même. Rien encore n'a été fait. Le jour où s'est ouvert le musée installé au Pavillon de Marsan, nous avons indiqué 1 à quel point son fonctionnement répondait peu aux espoirs fondés, aux engagements pris, et combien il importait de le ramener à la destination utilitaire qui lui avait été originellement assignée. Quant à l'enseignement chargé de préparer et de seconder le mouvement de rénovation, ses méthodes ne semblent guère pertinentes aux besoins de nos arts, métiers et industries. Lui aussi ne peut se soustraire à la loi des époques, de l'évolution, des contingences ; sa base est l'écriture de la forme ; les notions élémentaires du dessin une fois rendues obligatoires pour tous, l'enseignement se préoccupera de dégager les facultés individuelles pour sérier les aptitudes et les porter à leur maximum d'expansion. Il ne sera ni centralisé, ni uniforme ; il se guidera souplement, dans chaque région, sur les industries particulières qu'il a charge d'entretenir, de restaurer ou de provoquer.
Certains ont attribué à la crise de l'apprentissage la déchéance des métiers ; au Parlement même, les meilleurs esprits se sont alarmés et une législation récente apporte au mal un remède provisoire et insuffisant. M. Paul-Boncour réclame pour l'apprenti un enseignement reconstitué avec le concours de la loi, de l'école et du syndicat. D'accord, si l'industriel consent à rompre avec les errements habituels, si le père montre moins d'âpreté à tirer un revenu de l'enfant, si la chambre syndicale devient le substitut de l'ancienne corporation. « L'apprentissage et l'école ne peuvent être séparés, continue excellemment M. Paul-Boncour ; l'apprentissage sans l'école, c'est la pratique sans art et sans goût ; l'école sans l'apprentissage, c'est la théorie sans la pratique. » Comment combiner les deux enseignements ? La Ville de Paris l'a tenté sans grand succès, en ouvrant des écoles professionnelles ; mais il n'est, pas de véritable instruction pratique en dehors de l'atelier, et l'initiative privée s'est montrée avisée en instituant des bourses d'apprentissage destinées aux lauréats des établissements d'enseignement ; pour l'école du demi-temps (qui partage les heures du travail de l'apprenti entre l'école et l'atelier), nous la verrions, non sans intérêt, reprendre un système d'éducation instauré par Lebrun aux Gobelins et adopté plus près de nous, dans sa fabrique même, par Émile Gallé.
Viendrait-on à découvrir la solution du problème, la question de l'adaptation de l'enseignement aux nécessités modernes, envisagée sous un rapport unique, ne se trouverait pas de ce fait tirée au clair. Prenons garde de retomber dans les errements de Ruskin. Est-il besoin de répéter que les dons de la main sont moins rares que les dons de l'esprit, que l'habileté s'acquiert, et que le pouvoir d'inventer n'appartient qu'à la vocation ? Si un ouvrage bien conçu et mal exécuté semble de pauvre valeur, il est permis d'entrevoir pour lui la possibilité d'une interprétation autre, convenable, tandis qu'une invention médiocre reste vaine sans rémission, quelle que soit la perfection technique apportée à la traduire. Composer, exécuter impliquent la possession de facultés dissemblables qu'il plaît de rencontrer réunies chez un même individu ; toutefois, c'est une trop peu commune aventure pour que l'enseignement néglige de favoriser la production de modèles qui ne seront pas interprétés par leurs auteurs et la réalisation d'ouvrages dus à des artisans qui ne les auront pas imaginés2. Auquel cas la tâche se distribue ainsi : à l'inventeur de concevoir avec la préméditation et la connaissance des ressources techniques ; à l'artisan d'œuvrer avec une intelligence du modèle qui ne se relâche à aucun instant durant le cours du travail.
L'expérience a montré comment le résultat justifiait les moyens et quel succès récompensait la collaboration d'activités qui se rejoignent et se complètent. M. Eugène Gaillard et M. Charles Plumet ne sont ni menuisiers ni ébénistes et les meubles dont ils ont fourni les plans et les coupes comptent parmi les seuls de cette époque qui soient promis à la pérennité. Les incursions de M. Bracquemond, de M. Aubert, de M. Grasset, de M. Dufrêne, de M. Prouvé dans des arts différents, n'apparaissent ni moins précieuses, ni moins louables. Combien de forces isolées resteraient impuissantes qui arrivent de la sorte à s'unir avec profit ! L'économie politique enseigne à priser la vertu de l'association d'après le degré où elle réduit le déchet dans le rendement de l'effort.
Si l'art se répand, ses procédés doivent varier et s'ajuster à l'état des classes différentes auxquelles il s'adresse. La mise au jour d'ouvrages à exemplaire unique satisfait les exigences particulières du mécénat ; ils ont la haute portée d'un enseignement ; dans l'ensemble de la production ils n'interviennent qu'à titre exceptionnel. M. Eugène Gaillard pose en axiome que « un objet n'est d'art appliqué qu'à la condition d'être susceptible de répétition indéfinie sans déperdition appréciable de ses qualités essentielles » et que « la valeur s'en trouve accrue s'il est capable d'être vulgarisé par les moyens industriels ». M. Grasset, de son côté, se flatte « de voir l'art se relever plus haut que jamais grâce à un emploi plus complet de la machine ». D'où diverses sortes de production – manuelle, mécanique, industrielle – qui utilisent les capacités respectives de l'artiste, de l'artisan, de l'ouvrier et auxquelles doivent nécessairement correspondre des ordres d'enseignement distincts.
Nous ne manquons pas de talents pour traiter somptueusement la matière et il serait injuste de ne pas honorer les initiateurs grâce à qui l'art anoblit le luxe. Cependant la beauté dont se pare l'objet d'usage est mieux aimée, plus enviable. La civilisation hellénique, qui reste exemplaire, a donné la mesure de son affinement dans le charme prêté aux moindres ustensiles de la vie. L'imagination se prend parfois à supposer de quelle manière ce « peuple de marchands et de poètes » se fût comporté à l'égard des découvertes modernes. Avant tout, les avantages assurés par une liberté plus grande l'eussent trouvé sensible. (Si le ciseau et la navette marchaient seuls, il n'y aurait plus d'esclaves, prétendait Aristote.) Puis les Grecs se seraient réjouis des facultés d'expression plus vastes offertes à leur génie aimable et vif. Pour la subtilité attique c'eût été un jeu de plier des ressources neuves aux convenances des aspirations séculaires et des besoins journaliers. La mesure, la simplicité, la délicatesse auraient présidé à ces accommodements ; ni la vérité, ni la grâce naturelle n'en auraient été bannies, ni l'esprit qui a sa place partout.
Chez nous, à partir de l'instant où l'industrie s'est vue dotée d'un pouvoir de diffusion inconnu, l'ambition a grandi de lier l'art à son progrès et d'en reculer les limites aussi loin que s'étendent les procédés qui multiplient et vulgarisent. Des rapports imprévus se sont établis entre des forces qui s'ignoraient ; la mécanique, la chimie, la physique, l'électricité ont généralisé les applications de l’art à la production courante. En admettant la collectivité au partage de joies naguère réservées à un groupe, la science restait docile au rôle qui fait d'elle, devant l'histoire, le plus puissant agent de transformation sociale.