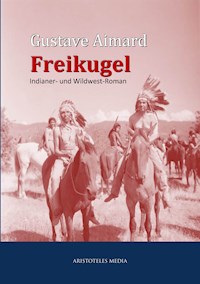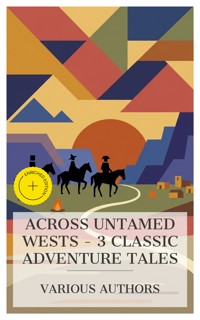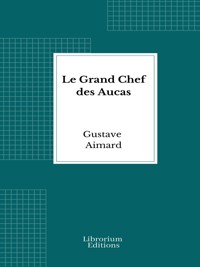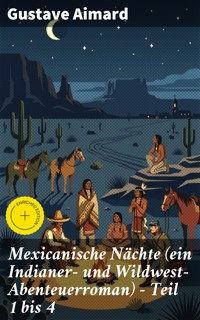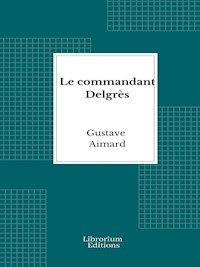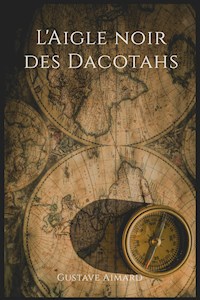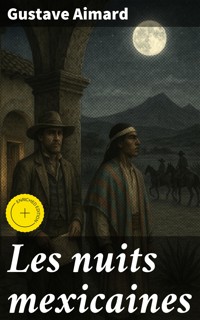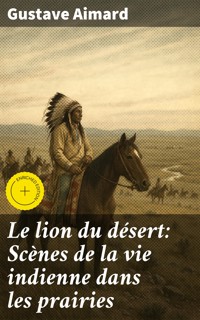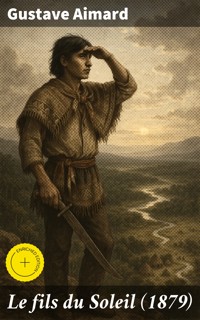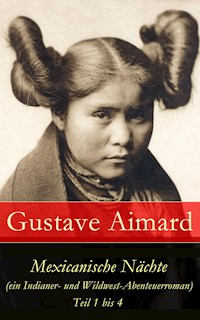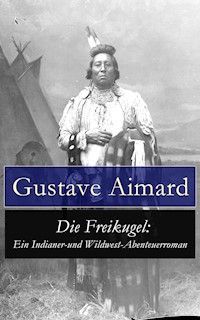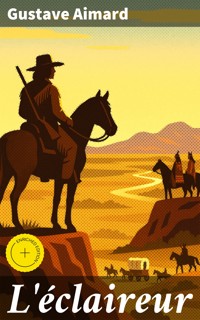
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
L'Éclaireur, écrit par Gustave Aimard en 1865, s'inscrit dans le contexte littéraire du roman d'aventure et de la littérature coloniale française, magnifiant l'exploration et la conquête des territoires inconnus. Ce roman illustre l'odyssée d'un jeune héros, chargé de guider une expédition à travers les vastes étendues de l'Ouest américain, symbolisant à la fois la bravoure et l'esprit pionnier. Le style d'Aimard, riche en descriptions saisissantes et en dialogues vivants, capte l'essence des paysages majestueux et des dangers inhérents à une telle aventure, tout en intégrant des thèmes de fraternité et de loyauté qui résonnent avec le lecteur. Gustave Aimard, né en 1818, se distingue par son impressionnante connaissance des cultures autochtones et des mœurs de l'Ouest grâce à ses propres voyages. Fort de cette expérience, il parvient à infuser son œuvre d'une authenticité rare, reliant ses expériences à une passion dévorante pour l'inconnu. Aimard appartient à la vague des écrivains qui, au XIXe siècle, souhaitaient éveiller l'intérêt du public pour les réalités des territoires lointains, tout en véhiculant une vision romancée de la conquête de l'Ouest. Je recommande vivement L'Éclaireur pour ceux qui aspirent à une aventure palpitante aux confins de l'Amérique. Ce livre captivant, à la fois informative et au style enchanteur, offre un aperçu unique de l'époque et des défis des explorateurs. Que vous soyez amateur de récits d'aventure ou passionné par l'histoire des conquêtes, L'Éclaireur saura émerveiller et instruire ses lecteurs. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction succincte situe l'attrait intemporel de l'œuvre et en expose les thèmes. - Le Synopsis présente l'intrigue centrale, en soulignant les développements clés sans révéler les rebondissements critiques. - Un Contexte historique détaillé vous plonge dans les événements et les influences de l'époque qui ont façonné l'écriture. - Une Analyse approfondie examine symboles, motifs et arcs des personnages afin de révéler les significations sous-jacentes. - Des questions de réflexion vous invitent à vous engager personnellement dans les messages de l'œuvre, en les reliant à la vie moderne. - Des Citations mémorables soigneusement sélectionnées soulignent des moments de pure virtuosité littéraire. - Des notes de bas de page interactives clarifient les références inhabituelles, les allusions historiques et les expressions archaïques pour une lecture plus aisée et mieux informée.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
L'éclaireur
Table des matières
Introduction
Sur la frontière, l’art de voir avant les autres décide de la vie, de la mort et de la route à suivre. Dans L’éclaireur, Gustave Aimard propose un roman d’aventures inscrit dans la tradition du récit de frontière, publié au XIXe siècle et campé dans les vastes étendues nord-américaines. Les pistes, les campements et les horizons ouverts servent de scène à des trajectoires humaines tendues par l’urgence et la ruse. L’ouvrage se situe dans la lignée de l’auteur, connu pour ses fresques de trappeurs, guerriers et voyageurs. Il combine souffle épique, précision des gestes et fascination pour les espaces où se redessinent les règles.
Figure marquante du roman d’aventures français au XIXe siècle, Aimard fait de la frontière nord-américaine un laboratoire narratif où l’épreuve du terrain révèle les caractères. L’éclaireur s’inscrit pleinement dans cette veine, portée par un imaginaire de grandes distances, de pistes incertaines et d’alliances mouvantes. Publié dans un siècle avide de récits populaires et d’explorations, le livre exploite des décors et des situations qui ont nourri l’attrait européen pour les mondes lointains. On y perçoit une attention constante aux déplacements, aux repères naturels, aux signes ténus qui, dans ces paysages, séparent le péril du salut et guident la décision.
Sans dévoiler l’intrigue, la prémisse met en scène un éclaireur aguerri, dont l’expérience et l’œil composent une sorte de boussole humaine pour des groupes confrontés aux aléas d’une zone frontalière. La marche dans des territoires peu sûrs, la lecture des traces, l’anticipation de mouvements ennemis ou hostiles rythment un récit fait d’approches, de reconnaissances et de replis calculés. Le lecteur suit des figures typiques du monde des pistes et des campements, prises entre la nécessité d’avancer et la prudence. La dramaturgie naît d’un constant décalage entre ce qui se voit et ce qui se prépare, moteur discret du suspense.
La voix narrative conjugue un sens du détail concret avec une énergie soutenue, alternant descriptions de paysages et séquences d’action resserrées. Aimard privilégie un style direct, visuel, où la topographie, la lumière et les signes du vivant deviennent des éléments de stratégie. Le ton, grave sans emphase inutile, s’autorise des élans lyriques devant la nature, puis se durcit à l’heure des confrontations. Cette oscillation donne à la lecture un mouvement ample, fait d’élans et d’arrêts, comme la progression d’une piste difficile. L’économie des chapitres et l’ordonnancement des scènes visent la clarté, tout en ménageant des attentes efficaces.
Par ses situations, L’éclaireur explore des thèmes durables: la frontière comme espace d’épreuve, la survie comme art, la loyauté éprouvée par l’intérêt, ainsi que la tension entre justice personnelle et ordre collectif. Le motif du regard — voir sans être vu, interpréter des signes — organise la réflexion sur la connaissance et l’erreur, sur ce que l’on croit savoir d’autrui. Le livre interroge aussi la coopération contrainte entre groupes aux objectifs divergents, où s’inventent des codes provisoires. La nature, à la fois ressource et piège, impose un rythme moral: elle récompense l’attention, sanctionne l’arrogance et modèle les choix.
Si son cadre appartient au XIXe siècle, l’ouvrage parle encore aux lecteurs d’aujourd’hui par sa méditation sur les frontières, matérielles et mentales. Il met en scène la vigilance comme compétence, la circulation des savoirs situés et le coût des décisions prises sous pression. On y lit une invitation à interroger les représentations héritées des rencontres interculturelles, et à mesurer la force des imaginaires de l’ailleurs dans la littérature populaire. La dynamique du groupe, la gestion du risque, la relation à l’environnement et la question de l’orientation résonnent avec des préoccupations contemporaines, qu’il s’agisse d’éthique, de mobilité ou d’écologie.
Lire L’éclaireur, c’est entrer dans un théâtre d’ombres et de traces où la stratégie se nourrit d’attention au monde. Le roman offre le plaisir d’une aventure vive, l’acuité d’un regard tourné vers le terrain, et l’épure d’une intrigue mue par la nécessité d’avancer. Il donne surtout une figure, celle de l’éclaireur, dont la compétence fait lien entre nature et culture, instinct et calcul. Cette silhouette, encore parlante, permet de réfléchir à nos propres manières d’anticiper, de coopérer et de franchir des seuils. Ainsi l’ouvrage demeure une porte d’entrée accessible et stimulante vers l’univers d’Aimard et ses frontières.
Synopsis
Roman d’aventures de l’écrivain français Gustave Aimard, L’éclaireur s’inscrit dans son cycle de récits consacrés aux confins nord-américains au XIXe siècle. Le livre met au premier plan un guide de frontière, chargé d’ouvrir la voie à travers des espaces vastes et disputés. Dès l’ouverture, la marche d’un petit groupe sous sa conduite permet d’exposer le décor: pistes incertaines, distances trompeuses, menaces diffuses. L’éclaireur apparaît comme l’artisan d’une progression méthodique, dont la prudence se heurte aux impatiences de compagnons aux intérêts divergents. Le récit établit ainsi une tension continue entre la nécessité d’avancer et l’exigence de survivre.
La figure de l’éclaireur se précise par ses compétences: lecture des traces, sens des vents et des eaux, connaissance des humeurs humaines. Ces aptitudes fondent son autorité, mais ne suffisent pas à éteindre les rivalités latentes au sein de la caravane. Des gestes mesurés—choisir une halte, trancher un désaccord, contourner un passage risqué—révèlent une éthique de responsabilité. Par touches successives, Aimard décrit la solitude d’un métier voué à prévoir l’imprévu, tandis que la frontière, labyrinthe d’indices fragiles, met à l’épreuve l’endurance physique et la clarté de jugement, sans jamais offrir de certitudes durables.
Au fil de la progression, les obstacles naturels—temps changeant, rareté de l’eau, reliefs accidentés—croisent des périls humains: banditisme, raids opportunistes, tensions entre groupes en concurrence. L’éclaireur doit arbitrer entre vitesse et discrétion, détour et raccourci, protection rapprochée et reconnaissance lointaine. Les avancées partielles sont aussitôt menacées par de nouveaux imprévus. Cette dynamique met en lumière le thème central du roman: la frontière comme espace d’équilibres instables, où chaque décision engage la sécurité collective. Le récit insiste sur la nécessité de la discipline et sur la valeur d’une expertise patiemment acquise.
Un développement décisif survient lorsque des intérêts incompatibles se heurtent, faisant basculer une coexistence précaire. Qu’il s’agisse d’une erreur d’appréciation ou d’une manœuvre délibérée, l’incident fragilise la cohésion du groupe. L’éclaireur doit alors recomposer l’itinéraire, étendre la surveillance et revoir les priorités. Sa capacité à rester lisible pour ses alliés tout en demeurant opaque aux adversaires devient l’enjeu. Le roman explore, sans appuyer de spectaculaire inutile, l’économie de la confiance: qui parle vrai, qui suit, qui protège—et à quel prix. La prudence acquiert un relief dramatique sans verser dans l’héroïsation naïve.
Les rencontres avec des communautés autochtones et d’autres acteurs de la frontière donnent lieu à des échanges tendus, des négociations, parfois des accommodements fragiles. Aimard dépeint la complexité d’intérêts qui s’entrechoquent: droit de passage, zones de chasse, représailles et trêves. L’éclaireur, intermédiaire autant que pisteur, tente d’éviter l’irréparable en lisant des signes culturels aussi attentivement que les empreintes au sol. Le récit pose, par la situation même, des questions d’éthique et de responsabilité: jusqu’où peut-on composer avec la violence ambiante, et que vaut la parole donnée lorsque les règles changent d’un territoire à l’autre?
À mesure que s’accumulent les incidents, un faisceau d’indices laisse entrevoir un resserrement de la menace. Les trajectoires se recoupent, des pistes croisées signalent surveillances et filatures. La topographie devient stratégique: gués, défilés, hauts-plateaux où l’on peut observer sans être vu. Le groupe doit choisir entre s’exposer pour gagner du temps ou se dissimuler au risque d’être immobilisé. L’éclaireur porte la charge morale de ces arbitrages. En toile de fond, l’ouvrage suggère que la maîtrise du terrain n’annule pas la part d’aléa, et que la clairvoyance consiste souvent à limiter les pertes plutôt qu’à triompher.
Sans livrer ses ultimes développements, L’éclaireur se lit comme une méditation romanesque sur la survie collective, la circulation de l’autorité et la fragilité des pactes en pays de frontières. Aimard assemble aventure, observation des usages de la prairie et réflexion sur la violence réglée ou débridée. La figure du guide en ressort comme un symbole ambivalent: garant de l’orientation et témoin des limites du contrôle humain. Par sa tension contenue et son attention aux gestes concrets, le roman conserve une résonance durable, interrogeant le mythe de la conquête et la part de lucidité exigée pour habiter l’incertitude.
Contexte historique
Publié en France dans les années 1850–1860, L’éclaireur s’inscrit dans la vogue des romans de frontière qui, à la suite de James Fenimore Cooper, transposent pour le lectorat européen les conflits nord-américains. L’époque est celle du Second Empire en France, des journaux à grand tirage et du roman-feuilleton, qui favorisent des récits d’aventure situés loin de Paris. Le cadre géographique convoqué par Aimard correspond aux marges entre États-Unis et Mexique, espace de circulation des chasseurs, pisteurs et cavaliers. La figure de l’éclaireur y incarne un savoir du terrain utile aux armées et aux convois, révélant une médiation entre sociétés concurrentes.
Entre 1836 et 1853, la frontière nord du Mexique est profondément remaniée. La République du Texas se sépare du Mexique (1836), est annexée par les États-Unis (1845), puis la guerre américano-mexicaine (1846–1848) se conclut par le traité de Guadalupe Hidalgo, qui cède la Californie et un vaste Sud-Ouest aux États-Unis. L’achat Gadsden (1853) complète le tracé. Ces transferts territoriaux créent des zones disputées, des postes militaires nouveaux et des routes commerciales réorientées. Le roman s’en nourrit en situant ses péripéties sur des espaces fraîchement redéfinis, où la légitimité juridique est fragile et où l’expertise des pisteurs conditionne la survie des voyageurs.
Les nations autochtones dominent alors de vastes territoires: Comanches et Kiowas sur les Grandes Plaines méridionales, Apaches et Navajos dans les déserts et sierras du Nord mexicain et du Sud-Ouest américain. Leurs raids et contre-raids avec communautés hispano-mexicaines, colons anglo-américains et troupes régulières rythment la vie frontalière. Traités locaux, échanges commerciaux et captivités coexistent avec expéditions punitives. Aux États-Unis, la politique de réserves se met progressivement en place; au Mexique, les presidios et pactes régionaux tentent de contenir les incursions. L’œuvre reflète les perceptions européennes de son temps, souvent schématiques, en insistant sur la maîtrise du terrain et la mobilité guerrière.
Après l’apogée du commerce des fourrures, l’économie frontalière se réoriente vers l’élevage, le convoyage et l’exploitation minière. Le Santa Fe Trail relie Missouri et Nouveau-Mexique; le Camino Real de Tierra Adentro relie Mexico à Santa Fe, tandis que des pistes secondaires desservent Chihuahua et Sonora. Caravaniers, muletiers et diligences transportent marchandises, numéraire et informations, exposés aux salteadores et aux embuscades. Les mines d’argent du nord mexicain et divers placers attirent des aventuriers, aux côtés de rancheros et de commerçants. Le roman exploite ce réseau de routes et d’intérêts, montrant comment la protection des convois dépend de guides, traqueurs et alliances de circonstance.
Dans les années 1840–1860, une chaîne de forts américains se déploie au Texas et au Nouveau-Mexique (Fort Brown, Fort Union, Fort Davis, entre autres), tandis que les Texas Rangers assurent des missions de reconnaissance et de poursuite. Côté mexicain, les presidios et gardes nationales des États du nord tentent de sécuriser les routes. Dans ce dispositif, éclaireurs et guides — parfois autochtones ou métis — servent de passeurs d’informations, de négociateurs et de pisteurs. Le récit met en avant cette expertise empirique, qui concurrence l’autorité formelle, et souligne la dépendance des armées et des civils envers des intermédiaires capables de lire un territoire difficile.
Les innovations techniques transforment la mobilité et le combat: revolvers Colt diffusés dès les années 1840, carabines à chargement par la culasse comme les Sharps, puis armes à répétition à l’aube des années 1860. Les diligences du Butterfield Overland Mail (1858–1861) et les bateaux à vapeur sur le Rio Grande accélèrent les trajets; le télégraphe progresse sur les axes américains. Pourtant, l’immensité des distances, la rareté de l’eau et les reliefs maintiennent une forte incertitude. Le roman traduit ce décalage entre modernisation et contraintes physiques, valorisant l’endurance, la prudence et le savoir d’orientation qui fondent l’autorité pratique de l’éclaireur.
En France, le succès des feuilletons, des récits de voyage et des panoramas ethnographiques nourrit une curiosité soutenue pour l’Amérique. Sous le Second Empire, le débat sur la mission colonisatrice accompagne l’intervention française au Mexique (1861–1867), abondamment commentée par la presse. Les éditeurs parisiens publient des fictions situées au Texas, au Nouveau-Mexique et dans le nord mexicain, où s’éprouvent héroïsme et brutalité. L’éclaireur participe de cette médiation: il propose un imaginaire de l’Ouest qui flatte l’appétit d’exotisme du public, tout en laissant entrevoir, par ses périls et ambiguïtés, les coûts humains et politiques de la conquête et de la domination.
Sur le plan littéraire, Aimard s’inscrit dans l’héritage de Cooper et des récits de voyageurs, en anticipant la popularité des dime novels américains dès les années 1860. Codes récurrents de l’« Ouest » — hospitalité codifiée, duels, serments, trahisons, serments d’amitié — structurent la narration. L’éclaireur utilise la sérialisation et le suspens pour dramatiser la frontière comme théâtre d’épreuves. À travers la figure du pisteur, l’œuvre célèbre l’ingéniosité et la liberté de mouvement, mais met aussi en relief les fractures créées par les expansions nationales, la militarisation et les malentendus culturels, ce qui en fait un miroir critique de son époque.
L'éclaireur
Quatrième Édition
PARIS
AMYOT, ÉDITEUR, 8, RUE DE LA PAIX
MDCCCLX
I.
La surprise.
C'était vers la fin de mai 1855, dans un des sites les plus ignorés des immenses prairies du Far-West, à peu de distance du Río Colorado del Norte[1], que les tribus indiennes de ces parages nomment, dans leur langage imagé, le fleuve sans fin aux lames d'or.
Il faisait une nuit profonde. La lune aux deux tiers de sa course montrait, à travers les hautes branches des arbres, sa face blafarde, dont ne s'échappaient qu'avec peine de minces rayons d'une lumière tremblotante qui ne laissait distinguer que vaguement les accidents d'un paysage abrupte et sévère. Il n'y avait pas un souffle dans l'air, pas une étoile au ciel. Un silence de mort planait sur le désert[1q]. Silence interrompu seulement à de longs intervalles par les glapissements saccadés des coyotes en quête d'une proie, ou les miaulements ironiques de la panthère et du jaguar à l'abreuvoir.
Pendant les ténèbres, les grandes savanes américaines, où nul bruit humain ne trouble la majesté de la nuit, prennent, sous l'œil de Dieu, une imposante splendeur qui remue à son insu le cœur de l'homme le plus fort et le pénètre malgré lui d'un religieux respect.
Tout à coup les branches serrées d'un buisson de floripondios s'écartèrent avec précaution, et dans l'espace laissé vide apparut la tête anxieuse d'un homme dont les yeux brillants comme ceux d'une bête fauve lançaient dans toutes les directions des regards inquiets. Après quelques secondes d'une immobilité complète, l'homme dont nous parlons quitta le buisson au milieu duquel il était caché et s'élança d'un bond au dehors.
Bien que son teint hâlé eut atteint presque la couleur de la brique, cependant à son costume de chasse et surtout la nuance blonde de ses longs cheveux et à ses traits hardis, francs et accentués, il était facile de reconnaître en cet homme un de ces audacieux coureurs des bois canadiens dont la forte race s'éteint tous les jours et tend à disparaître avant peu.
Il fit quelques pas, le canon de son rifle en avant, le doigt sur la détente, inspectant minutieusement les taillis et les fourrés sans nombre qui l'entouraient; puis, rassuré probablement par le silence et la solitude qui continuaient à régner aux environs, il s'arrêta, posa à terre la crosse de son rifle, pencha le haut du corps en avant, et imita à s'y méprendre le chant du centzontle[2], le rossignol américain.
A peine la dernière modulation de ce chant, doux comme un soupir d'amour, vibrait-elle dans l'air, que du même buisson qui déjà avait livré passage au chasseur, s'élança un second personnage.
Celui-ci était un Indien; il vint se placer auprès du Canadien, et après quelques secondes de silence:
—Eh bien? lui demanda-t-il en affectant une tranquillité peut-être loin de son cœur.
—Tout est calme, répondit le chasseur, la Cihuatl peut venir.
L'Indien secoua la tête.
—Depuis le lever de la lune, Mahchsi-Karehde est séparé de l'Églantine, il ignore où elle se trouve en ce moment.
Un bienveillant sourire plissa les lèvres du chasseur.
—L'Églantine aime mon frère, dit-il doucement, le petit oiseau qui chante au fond de son cœur l'aura guidé sur les traces du chef; Mahchsi-Karehde a-t-il oublié le chant avec lequel il l'appelait à ses rendez-vous d'amour dans la tribu?
—Le chef n'a rien oublié.
—Qu'il appelle donc alors.
L'Indien ne se fit pas répéter cette invitation; le cri du Walkon s'éleva dans le silence.
Au même instant on entendit un froissement de branches, et une jeune femme, bondissant comme une biche effrayée, vint tomber haletante dans les bras du guerrier indien qui s'étaient ouverts pour la recevoir. Cette étreinte n'eut que la durée d'un éclair; le chef, honteux sans doute devant un blanc, bien que ce blanc fût son ami, du mouvement de tendresse auquel il s'était laissé entraîner, repoussa froidement la jeune femme en lui disant d'une voix dans laquelle ne perçait aucune trace d'émotion:
—Ma sœur est sans doute fatiguée, nul danger ne la menace en ce moment; elle peut dormir, des guerriers veilleront sur elle.
—L'Églantine est une fille comanche, répondit-elle d'une voix timide, son cœur est fort, elle obéira à Mahchsi-Karehde (l'Aigle-Volant); sous la protection d'un chef aussi redoutable elle sait qu'elle est en sûreté.
L'Indien lui lança un regard empreint d'une indicible tendresse; mais reprenant presque aussitôt cette apparente impassibilité dont les peaux-rouges ne se départent jamais:
—Les guerriers veulent tenir conseil, que ma sœur dorme, dit-il.
La jeune femme ne répliqua point, elle s'inclina respectueusement devant les deux hommes, et, s'éloignant de quelques pas, elle se blottit dans l'herbe, ferma les yeux et s'endormit ou parut s'endormir.
Le Canadien s'était contenté de sourire en voyant le résultat obtenu par le conseil qu'il avait donné au guerrier; il avait écouté, en hochant approbativement la tête, les quelques mots échangés entre les deux peaux-rouges. Le chef, abîmé dans ses pensées, resta quelques instants les yeux fixés avec une expression indéfinissable sur la jeune femme endormie; enfin il passa à plusieurs reprises la main sur son front comme pour dissiper les nuages qui assombrissaient son esprit, et se tournant vers le chasseur.
—Mon frère, le visage pâle a besoin de repos, un chef veillera, dit-il.
—Les coyotes ont cessé de glapir, la lune a disparu, une bande blanchâtre s'élève à l'horizon, répondit le Canadien; le jour ne tardera pas à paraître, le sommeil a fui mes paupières, les hommes doivent tenir conseil.
L'Indien s'inclina sans répondre, posant son fusil à terre il ramassa plusieurs brassées de bois sec qu'il porta auprès de la dormeuse.
Le Canadien battit le briquet; bientôt le feu jaillit, le bois s'embrasa, la flamme colora les arbres de ses reflets sanglants; alors les deux hommes s'accroupirent auprès l'un de l'autre, bourrèrent leurs calumets[4] de manachée[3] le tabac sacré, et commencèrent à fumer silencieusement avec cette imposante gravité que les Indiens, en toutes circonstances, apportent à cette symbolique opération.'
Nous profiterons du moment de répit que nous offre le hasard pour faire le portrait de ces trois personnages appelés à jouer un rôle important dans le cours de ce récit.
Le Canadien était un homme de quarante-cinq ans environ, haut de six pieds anglais, long, maigre et sec; nature nerveuse composée de muscles et de nerfs, parfaitement adaptée au rude métier de coureur des bois, qui exige une vigueur et une audace au delà de toute expression. Comme tous ses compatriotes, le Canadien présentait dans ses traits le type normand dans toute sa pureté; son front large, ses yeux gris pleins de finesse, son nez un peu recourbé, sa bouche grande et garnie de dents magnifiques, les épais cheveux blonds mêlés de quelques fils d'argent qui s'échappaient de son bonnet de peau de loutre et tombaient en énormes boucles sur les épaules, tous ces détails donnaient à cet homme une physionomie ouverte, franche et loyale qui appelait la sympathie et plaisait de prime abord. Ce digne géant nommé Bonnaire, mais connu seulement dans les prairies par le sobriquet de Bon-Affût, sobriquet qu'il justifiait amplement par la justesse de son coup d'œil et son adresse à découvrir les repaires des bêtes fauves, était né aux environs de Montréal; mais emmené tout jeune dans les grands bois du haut Canada, la vie du désert avait eu tant de charmes pour lui, qu'il avait renoncé à la vie civilisée et depuis près de trente ans parcourait les vastes solitudes de l'Amérique du Nord, ne consentant à entrer dans les villes et les villages que pour vendre les peaux des animaux qu'il avait tués ou renouveler sa provision de poudre et de balles.
Le compagnon de Bon-Affût, l'Aigle-Volant, était un des chefs les plus renommés de la tribu des Bisons-Blancs, une des plus puissantes de la batailleuse nation des Comanches, cette indomptable et féroce nation qui, dans son incommensurable orgueil, s'intitule superbement la Reine des prairies, titre que nulle autre qu'elle n'ose revendiquer.
L'Aigle-Volant, bien que fort jeune encore puisqu'il avait à peine vingt-cinq ans, s'était distingué déjà dans maintes circonstances par des traits d'une audace et d'une témérité tellement inouïes, que son nom seul inspirait une invincible terreur aux innombrables hordes indiennes que parcourent sans cesse le désert dans tous les sens.
Sa taille était haute, bien prise, parfaitement proportionnée; ses traits étaient fins, ses yeux noir comme la nuit acquéraient, sous l'influence d'une émotion forte, cette fixité étrange qui commande le respect; ses gestes étaient nobles et sa démarche gracieuse, empreinte de cette majesté innée chez les Indiens.
Le chef était revêtu de son costume de guerre.
Ce costume est assez singulier pour mériter une description détaillée.
La tête de l'Aigle-Volant était coiffée du mahch-akoub-hachka, bonnet que, seuls, les guerriers distingués qui ont tués beaucoup d'ennemis ont le droit de porter; il est fait de bandes blanches d'hermine ayant par derrière une large pièce de drap rouge tombant jusqu'au mollet, sur laquelle est attachée une crête droite de plumes d'aigle blanches et noires qui commence à la tête et se prolonge en rang serré jusqu'au bout. Au-dessus de l'oreille droite il avait passé dans sa chevelure un couteau de bois peint en rouge et long comme la main: ce couteau était l'emblème de celui avec lequel il avait tué un chef Dacotah; il portait, en outre, huit petites brochettes en bois, peintes en bleu et garnies à l'extrémité supérieure d'un clou doré pour indiquer le nombre de coups de feu dont il avait été blessé; au-dessus de l'oreille gauche il portait une grosse touffe de plumes de hibou jaunes et peintes en rouge à leur extrémité, comme signe de ralliement des Menin-ochaté, c'est-à-dire la bande des Chiens; son visage était peint moitié en rouge et son corps en rouge-brun avec des raies dont la couleur avait été enlevée avec un doigt mouillé. Ses bras, à compter de l'épaule, étaient ornés de vingt-sept raies jaunes indiquant le nombre de ses hauts faits, et sur sa poitrine il avait dessiné avec de la couleur bleue une main, ce qui annonçait qu'il avait souvent fait des prisonniers. Il portait à son cou un magnifique mato-unknappinindè, collier de griffes d'ours gris, longues de trois pouces et blanchâtres à la pointe. Ses épaules étaient couvertes de la grande mih-ihé ou robe de bison, tombant jusqu'à terre et peinte de diverses couleurs. Il avait serré étroitement à la ceinture le woupanpihunchi ou culottes consistant en deux parties séparées, une pour chaque jambe, descendant jusqu'à la cheville et brodée à la partie extérieure de piquants de porc-épic de couleur variée se terminant par une longue touffe traînant par terre; son nokké, larges bandes de drap rayées de blanc et de noir, s'enroulait autour de ses hanches et retombait devant et derrière en longs plis; ses humpés ou souliers en peau de bison étaient peu ornés, mais il avait attaché au-dessus de la cheville des queues de loups qui traînaient à terre derrière lui et dont le nombre égalait les ennemis qu'il avait vaincus; à son ichparakehn ou ceinture pendaient, d'un côté une poire à poudre, un sac à balles et un couteau à scalper, de l'autre un carquois en peau de panthère garni de flèches longues et acérées, et son tomawhauks; son eruhpa,—fusil,—était posé à terre à portée de sa main.
Ce guerrier, revêtu de cet étrange costume, avait quelque chose d'imposant et de sinistre qui inspirait la terreur.
Quant à présent, nous nous bornerons à dire que Églantine avait quinze ans au plus, qu'elle était fort belle pour une Indienne, et qu'elle portait dans toute son élégante simplicité le sévère costume adopté par les femmes de sa nation.
Terminant ici cette description peut-être trop détaillée, mais qui était nécessaire pour connaître les hommes que nous avons mis en scène, nous reprendrons le cours de notre récit.
Depuis longtemps nos deux personnages fumaient auprès l'un de l'autre sans échanger une parole; enfin le Canadien secoua le fourneau de sa pipe sur le pouce de sa main gauche, et s'adressant à son compagnon:
—Mon frère est-il satisfait? demanda-t-il.
—Ooah! répondit l'Indien en baissant affirmativement la tête, mon frère a un ami.
—Bon, reprit le chasseur, et que fera maintenant le chef?
—L'Aigle-Volant rejoindra sa tribu avec Églantine, puis il reviendra chercher la piste des Apaches.
—A quoi bon?
—L'Aigle-Volant veut se venger.
—A votre aise, chef, ce n'est certes pas moi qui vous engagerai à renoncer à vos projets contre des ennemis qui sont aussi les miens; seulement je crois que vous n'envisagez pas la question à son véritable point de vue.
—Que veut dire mon frère le guerrier pâle?
—Je veux dire que nous sommes loin des huttes des Comanches, et qu'avant de les atteindre nous aurons sans doute plus d'une fois encore maille à partir avec les ennemis, dont le chef se croit peut-être un peu prématurément débarrassé.
L'Indien haussa les épaules avec dédain.
—Les Apaches sont de vieilles femmes, bavardes et poltronnes, dit-il, l'Aigle-Volant les méprise.
—Possible! reprit le chasseur en hochant la tête; cependant, à mon avis, nous aurions mieux fait de continuer notre route jusqu'au lever du soleil, afin de mettre une plus grande distance entre eux et nous, au lieu de nous arrêter aussi imprudemment ici; nous sommes bien près encore du camp de nos ennemis.
—L'eau de feu a bouché les oreilles et fermé les yeux des chiens apaches; ils dorment étendus sur la terre.
—Hum! Ce n'est pas mon opinion, je suis au contraire, persuadé qu'il veillent et qu'ils nous cherchent.
Au même instant, comme si le hasard avait voulu justifier la crainte du prudent chasseur, une dizaine de coups de feu éclatèrent avec fracas; un horrible cri de guerre auquel le Canadien et le Comanche répondirent par un cri de défi sortit du sein de la forêt et une trentaine d'Indiens apaches se ruèrent en hurlant vers le brasier auprès duquel se tenaient nos trois personnages; mais ceux-ci avaient subitement disparu comme par enchantement.
Les Apaches s'arrêtèrent avec un frémissement de rage, ne sachant plus quelle direction prendre pour retrouver leurs rusés ennemis. Soudain trois coup de feu furent tirés de l'intérieur de la forêt; trois Apaches roulèrent sur le sol, la poitrine traversée.
Les Indiens poussèrent un hurlement de fureur et se précipitèrent dans la direction des coups de feu.
Au moment où ils arrivaient à lisière de la forêt, un homme en sortit en agitant de la main droite une robe de bison en signe de paix.
Cet homme était Bon-Affût le Canadien.
Les Apaches s'arrêtèrent avec une hésitation de mauvais augure; le Canadien, sans paraître remarquer ce mouvement, s'avança résolument vers eux du pas lent et tranquille qui lui était habituel; en le reconnaissant, les Indiens brandirent leurs armes avec colère et voulurent courir sur lui, car ils avaient bien des motifs de haine contre le chasseur; leur chef les arrêta d'un geste péremptoire.
—Que mes fils soient patients, dit-il avec un sourire sinistre, il ne perdront rien pour attendre.
II.
L'hôte.
Le jour même où commence notre récit, à trois kilomètres environ de l'endroit où se passaient les évènements que nous avons rapportés dans notre précédent chapitre, dans une vaste clairière située sur la lisière d'une immense forêt vierge dont les derniers contreforts venaient mourir sur les rives même du Río Colorado, une assez nombreuse caravane avait fait halte au coucher du soleil.
Cette caravane venait du sud-est, c'est-à-dire du Mexique; elle paraissait être en marche depuis longtemps déjà, autant qu'il était possible d'en juger par l'état de délabrement dans lequel se trouvaient les vêtements des individus qui en faisaient partie ainsi que les harnais de leurs chevaux et de leurs mules. Du reste, les pauvres bêtes étaient réduites à un état de maigreur et de faiblesse qui témoignait hautement des rudes fatigues qu'elles avaient dû éprouver. Cette caravane se composait de trente à trente-cinq individus environ, tous revêtu du pittoresque et caractéristique costume de ces chasseurs et gambusinos demi-sang, qui seuls ou par petites bandes de trois ou quatre au plus parcourent sans cesse le Far-West, qu'ils explorent dans ses plus mystérieuses profondeurs pour chasser, trapper ou découvrir les innombrables gisements aurifères qu'il recèle dans son sein.
Les aventuriers firent halte, mirent pied à terre, attachèrent leurs chevaux à des piquets et s'occupèrent immédiatement, avec cette adresse et cette vivacité que donne seule une longue habitude, à installer leur campement de nuit. L'herbe fut arrachée sur un assez grand espace; les charges des mules empilées en cercle formèrent un rempart derrière lequel on pouvait résister à un coup de main des rôdeurs de la prairie, puis des feux furent allumés en croix de saint André dans l'intérieur du camp.
Dès que ce dernier soin fut pris, quelques-uns des aventuriers dressèrent une large tente au-dessus d'un palanquin hermétiquement fermé et attelé de deux mules, une devant, l'autre derrière. La tente dressée, le palanquin fut dételé, et les rideaux en retombant le couvrirent si bien, qu'il se trouva entièrement caché.
Ce palanquin était une énigme pour les aventuriers; nul ne savait ce qu'il renfermait, bien que la curiosité générale fût singulièrement éveillée au sujet de ce mystère incompréhensible surtout dans ces parages sauvages; chacun gardait avec soin ses appréciations et ses pensées au fond de son cœur, surtout depuis le jour que dans un passage difficile, profitant de l'éloignement accidentel du chef de la cuadrilla qui ordinairement ne quittait jamais le palanquin sur lequel il veillait comme un avare sur son trésor, un chasseur s'était penché de côté et avait légèrement entr'ouvert un des rideaux; mais à peine cet homme avait-il eu le temps de jeter un coup d'œil furtif à travers l'ouverture ménagée par lui, que le chef, arrivant à l'improviste, lui avait fendu le crâne d'un coup de machette et l'avait renversé mort à ses pieds.
Puis il s'était tourné vers les assistants terrifiés, et les dominant par un regard fascinateur:
—Y a-t-il un autre de vous, avait-il dit, qui veuille découvrir ce que je prétends cacher à tous?
Ces paroles avaient été prononcées avec un tel accent d'implacable raillerie et de féroce méchanceté, que ces hommes de sac et de corde, pour la plupart sans foi ni loi, et accoutumés à braver en riant les plus grands périls, s'étaient sentis frissonner intérieurement et leur sang se figer dans leurs veines. Cette leçon avait suffi. Nul n'avait cherché depuis à découvrir le secret du capitaine.
A peine les dernières dispositions étaient-elles prises pour le campement, qu'un bruit de chevaux se fit entendre et deux cavaliers arrivèrent au galop.
—Voici le capitaine! se dirent les aventuriers l'un à l'autre.
Les nouveaux venus jetèrent la bride de leurs chevaux aux hommes accourus pour les recevoir, et se dirigèrent à grands pas vers la tente. Arrives là, le premier s'arrêta, et s'adressant à son compagnon:
—Caballero, lui dit-il, soyez le bienvenu au milieu de nous; quoique fort pauvres nous-mêmes, nous partagerons avec joie le peu que nous possédons avec vous.
—Merci, répondit le second en s'inclinant, je n'abuserai pas de votre gracieuse hospitalité; demain, au point du jour, je serai, je crois, assez reposé pour continuer ma route.
—Vous agirez comme bon vous semblera: installez-vous auprès de ce foyer préparé pour moi, tandis que j'entrerai quelques instants sous cette tente; bientôt je vous rejoindrai et j'aurai l'honneur de vous tenir compagnie.
L'étranger s'inclina et prit place devant le feu allumé à peu de distance de la tente, pendant que le capitaine laissait retomber derrière lui le rideau qu'il avait soulevé et disparaissait aux yeux de son hôte.
Celui-ci était un homme aux traits accentués, dont les membres trapus dénotaient une force peu commune; les quelques rides qui sillonnaient son visage énergique semblaient indiquer qu'il avait dépassé déjà le milieu de la vie, bien que nulle trace de décrépitude ne se laissât voir sur son corps solidement charpenté, et que pas un cheveu blanc n'argentât sa longue et épaisse chevelure noire comme l'aile du corbeau. Cet homme portait le costume des riches hacenderos mexicains, c'est-à-dire la manga, le zarapé aux couleurs bariolées, les calzoneras de velours ouvertes au genou, et les botas vaqueras; son chapeau, en poil de vigogne galonné d'or, avait la forme serrée par une riche toquilla attachée par un diamant de prix; un machette sans fourreau pendait à sa hanche droite, passé simplement dans un anneau de fer; les canons de deux revolvers à six coups brillaient à sa ceinture, et il avait jeté sur l'herbe auprès de lui un rifle américain magnifiquement damasquiné en argent.
Après que le capitaine l'eut laissé seul, cet homme, tout en s'installant devant le feu de la façon la plus confortable, c'est-à-dire en disposant son zarapé et ses armes d'eau pour lui servir de lit au besoin, jeta autour de lui un regard furtif dont l'expression aurait sans doute donné beaucoup à penser aux aventuriers, si ceux-ci avaient pu le surprendre; mais tous s'occupaient aux soins de l'installation du camp et des préparatifs de leur souper; s'en reposant surtout sur la loyauté de l'hospitalité des prairies, ils ne songeaient en aucune façon à surveiller ce que faisait l'étranger assis à leur foyer.
L'inconnu, après quelques minutes de réflexion, se leva et s'approcha d'un groupe de trappeurs, dont la conversation semblait fort animée et qui gesticulaient avec ce feu naturel aux races du Midi.
—Eh! fit un d'eux en apercevant l'étranger, ce seigneur va, d'un mot, nous mettre d'accord.
Celui-ci, directement interpellé, se tourna vers son interlocuteur.
—Que se passe-t-il donc, caballero? demanda-t-il.
—Oh! Mon Dieu, une chose bien simple, répondit l'aventurier; votre cheval, une belle et noble bête, je dois en convenir, señor, ne veut pas frayer avec les nôtres, il fait rage des pieds et des dents contre les compagnons que nous lui avons donnés.
—Eh! Cela est simple, en effet, observa un second aventurier en ricanant; ce cheval est un costeño, il est trop fier pour frayer avec de pauvres tierras interiores comme nos chevaux.
A cette singulière raison, tous éclatèrent d'un rire homérique.
L'inconnu sourit d'un air narquois.
—Peut-être est-ce la raison que vous avancez, peut-être y en a-t-il une autre, dit-il doucement; dans tous les cas, il y a un moyen bien facile de terminer le différend, moyen que je vais employer.
—Ah! fit le second aventurier, et quel est-il?
—Le voici, reprit l'inconnu, du même air placide.
S'avançant alors vers le cheval que deux hommes avaient peine à contenir:
—Lâchez-le! dit-il.
—Mais si nous le lâchons, nul ne sait ce qui arrivera.
—Lâchez-le, je réponds de tout; puis s'adressant au cheval: Lélio! dit-il.
A ce nom, le cheval releva sa noble tête, et fixant son œil intelligent sur celui qui l'appelait, d'un mouvement brusque et irrésistible il se débarrassa des deux hommes qui cherchaient à l'arrêter, les envoya rouler sur l'herbe, aux éclats de rire de leurs compagnons, et vint frotter sa tête contre la poitrine de son maître, en poussant un hennissement de plaisir.
—Vous voyez, reprit l'inconnu en flattant le noble animal, que ce n'est pas difficile!
—Hum! répondit d'un ton de mauvaise humeur en se frottant l'épaule le premier aventurier qui se relevait; c'est un démonio auquel je ne confierai pas ma peau, toute vieille et toute racornie qu'elle soit à présent.
—Ne vous en occupez pas davantage, je me charge de lui.
—Foi de Domingo, j'en ai assez pour ma part; c'est une noble bête, mais elle a le diable au corps!
L'inconnu haussa les épaules sans répondre et retourna auprès du foyer suivi par son cheval qui marchait pas à pas derrière lui, sans témoigner la moindre velléité de se livrer de nouveau à ces excentricités qui avaient si fort étonné les aventuriers, tous hommes cependant passés maîtres dans l'art de l'hippiatrique. Ce cheval était un barbe pur sang arabe, qui avait probablement coûté une somme énorme à son propriétaire actuel, et dont les allures devaient sembler étranges à des gens habitués aux chevaux américains. Son maître lui donna la provende, l'installa auprès de lui, puis il se rassit devant le feu.
Au même instant le capitaine apparut à l'entrée de la tente.
—Je vous demande pardon, dit-il avec cette charmante courtoisie innée chez les Hispano-américains, je vous demande pardon, señor caballero, de vous avoir si longtemps négligé, mais un devoir impérieux réclamait ma présence; maintenant me voici tout à vous.
L'inconnu s'inclina.
—C'est moi, répondit-il, qui vous prie, au contraire, d'agréer mes excuses pour le sans-façon avec lequel j'use de votre hospitalité.
—Pas un mot de plus sur ce sujet, si vous ne voulez me désobliger.
Le capitaine s'assit auprès de son hôte.
—Nous allons dîner, dit-il; je ne puis vous offrir qu'une maigre pitance; mais à la guerre comme à la guerre, j'en suis réduit à la portion congrue, c'est-à-dire au tasajo et aux haricots rouges au piment.
—C'est délicieux, et certes, j'y ferais honneur si je me sentais le moindre appétit; mais, en ce moment, il me serait impossible de porter la plus légère bouchée de quoi que ce soit à ma bouche.
—Ah! fit le capitaine en lançant à l'inconnu un regard défiant.
Mais il rencontra une physionomie si naïvement placide, un sourire si franc, qu'il eut honte de ses soupçons, et son visage, qui s'était rembruni, reprit instantanément toute sa sérénité.
—J'en suis fâché; je vous demanderai alors la permission de dîner seul; car, au contraire de vous, caballero, je vous confesse que je me meurs littéralement de faim.
—Je serais désespéré de vous occasionner le moindre retard.
—Domingo! cria le capitaine, mon dîner!
L'aventurier que le cheval de l'inconnu avait si rudement secoué ne tarda pas à arriver en traînant la jambe, et portant, dans une écuelle en bois, le souper de son chef; quelques tortillas de maïs, qu'il tenait à la main, complétaient ce repas d'une sobriété presque claustrale.
Domingo était un métis indien, à l'air rechigné, aux traits anguleux et à la physionomie sournoise; il paraissait avoir à peu près cinquante ans, autant qu'il est possible de juger de l'âge d'un Indien par l'apparence; depuis sa mésaventure avec le cheval, Domingo gardait rancune à l'inconnu.
—Con su permiso, dit le capitaine en rompant une tortilla.
—Je fumerai une cigarette, ce qui sera encore vous tenir compagnie, répondit l'étranger avec son éternel sourire.
L'autre s'inclina poliment et attaqua son maigre repas avec cette vivacité qui dénote une longue abstinence.
Nous saisirons cette occasion pour faire au lecteur le portrait du chef de la caravane.
Don Miguel Ortega, noms sous lesquels il était connu de ses compagnons, était un élégant et beau jeune homme de vingt-six ans au plus, au teint bronzé, aux traits fins, à l'œil fier et brillant, dont la taille élevée, les membres bien attachés, la poitrine large et bombée dénotaient une rare vigueur. Certes, dans toute l'étendue des anciennes colonies espagnoles, il aurait été difficile, sinon impossible, de rencontrer un plus séduisant cavalier, portant mieux le pittoresque costume mexicain, plus hombre de a caballo et réunissant au même degré que lui ces avantages extérieurs qui charment les femmes et entraînent le vulgaire. Cependant, pour un observateur, don Miguel avait une trop grande profondeur dans l'œil, un froncement trop rude du sourcil et un sourire trop faux et trop perfide pour que, sous ces dehors séduisants, cet homme ne cachât pas une âme atrophiée et des instincts mauvais.
Un repas de chasseur assaisonné par l'appétit n'est jamais long; celui-ci fut promptement expédié.
—Là, fit le capitaine en s'essuyant les doigts avec une touffe d'herbe; maintenant une cigarette afin de faciliter la digestion, puis j'aurai l'honneur de vous souhaiter le bonsoir; vous n'avez pas, sans doute, l'intention de nous quitter avant le point du jour.
—Je ne saurais vous le dire, cela dépendra un peu du temps qu'il fera cette nuit; je suis assez pressé, et vous le savez, caballero, ainsi que le disent si justement les Gringos, nos voisins, le temps est de l'argent.
—Mieux que moi, caballero, vous savez ce que vous avez à faire; agissez à votre guise, seulement, avant que je me retire, veuillez agréer mes souhaits de bonne nuit et de bonne réussite dans vos projets.
—Je vous remercie, caballero.
—Un dernier mot, ou plutôt une dernière question avant de nous séparer.
—Faites.
—Il est bien entendu que, si cette question vous paraît indiscrète, vous êtes parfaitement libre de ne pas y répondre.
—Cela m'étonnerait de la part d'un cabellero aussi accompli, veuillez donc vous expliquer.
—Je me nomme don Miguel Ortega.
—Et moi don Stefano Cohecho.
Le capitaine s'inclina.
—Me permettez-vous à mon tour, reprit l'étranger, de vous adresser une question?
—Je vous en prie.
—Pourquoi cet échange de nom?
—Parce que, dans la Prairie, il est bon de pouvoir distinguer ses ennemis de ses amis.
—C'est juste; maintenant?
—Maintenant je suis certain de ne pas vous compter parmi les premiers.
—¿Quién sabe? repartit en riant don Stefano; il y a de si étranges hasards!
Les deux hommes, après avoir encore échangé quelques mots de la façon la plus amicale, se serrèrent cordialement la main; don Miguel rentra sous la tente, et don Stefano, après s'être étendu les pieds au feu, s'endormit ou du moins ferma les yeux.
Une heure après, le silence le plus complet régnait dans le camp. Les feux ne jetaient plus qu'une lueur douteuse, et les sentinelles, appuyées sur leurs rifles, se laissaient elles-mêmes aller à cette espèce de vague somnolence qui n'est pas encore le sommeil, mais qui déjà n'est plus la veille.
Soudain un hibou, caché probablement dans un arbre voisin, poussa à deux reprises son hou houlement mélancolique.
Don Stefano ouvrit subitement les yeux; sans changer de position, il s'assura par un regard investigateur que tout était tranquille autour de lui; puis, après s'être convaincu que son machette et ses revolvers ne l'avaient pas quitté, il saisit son rifle et imita à son tour le cri du hibou; un cri pareil lui répondit.
L'étranger, après avoir accommodé son zarapé de façon à imiter un corps humain, dit, en le flattant à voix basse, quelques mots à son cheval, afin de le tranquilliser et de lui faire prendre patience, et s'allongeant sur le sol, il se dirigea, en rampant doucement, vers une des issues du camp, s'arrêtant par intervalle, afin de jeter un regard autour de lui.
Tout continuait à être calme. Arrivé au pied du retranchement formé par les charges des mules, il se redressa, franchit l'obstacle d'un bond de tigre et disparut dans la prairie.
Au même instant, un homme se releva, sauta par-dessus le retranchement et s'élança à sa poursuite.
Cet homme était Domingo.
III.
Colloque dans la nuit.
Don Stefano Cohecho semblait parfaitement connaître le désert. Dès qu'il fut dans la prairie et ainsi qu'il le croyait, à l'abri de toute investigation fâcheuse, il releva fièrement la tête; sa démarche se fit plus assurée, son œil brilla d'un feu sombre, et il s'avança à grands pas vers un bouquet de palmiers dont les maigres parasols offraient pendant le jour un abri précaire contre les rayons ardents du soleil.
Cependant il ne négligeait aucune précaution, parfois il s'arrêtait brusquement pour prêter l'oreille au moindre bruit suspect ou pour interroger d'un regard investigateur les sombres profondeurs du désert, puis, après quelques secondes, rassuré par le calme qui régnait autour de lui, il reprenait sa marche de ce pas délibéré qu'il avait adopté en quittant le camp.
Domingo, pour nous servir de l'expression indienne, marchait littéralement dans ses pas, épiant et surveillant chacun de ses mouvements avec cette sagacité particulière aux métis, tout en ayant bien soin d'être toujours à l'abri d'une surprise de la part de l'homme qu'il espionnait. Domingo était une de ces natures comme il ne s'en rencontre que trop sur les frontières; douées de grandes qualités et de grands vices, aussi bonnes pour le bien que pour le mal, capables d'accomplir des choses extraordinaires dans un sens comme dans l'autre, mais qui, la plupart du temps, ne se laissent guider que par leurs mauvais instincts.
Il suivait en ce moment l'étranger sans se rendre positivement compte du motif qui le faisait agir, ne sachant pas encore lui-même s'il serait pour ou contre lui, attendant pour se décider que la position se dessinât nettement, et qu'il eût pesé l'avantage qu'il retirerait d'une trahison ou de l'accomplissement de ses devoirs; aussi évitait-il avec soin de laisser soupçonner sa présence, il devinait que le mystère qu'il voulait découvrir lui offrirait, s'il parvenait à le découvrir, de grands avantages, surtout s'il savait l'exploiter; et, dans le doute, il ne s'abstenait pas mais agissait de façon à ne pas compromettre la découverte de ce précieux secret.
Les deux hommes marchèrent ainsi près d'une heure à la suite l'un de l'autre, sans que don Stefano soupçonnât une seconde qu'il était aussi finement épié, et que l'un des plus adroits coquins des prairies était sur ses talons.
Après des tours et des détours sans nombre dans les hautes herbes, don Stefano arriva sur la rive même du Río Colorado, qui en cet endroit coulait large et calme comme un lac sur un lit de sable bordé par d'épais bouquets de cotonniers et par de hauts peupliers dont les racines plongeaient dans l'eau; arrivé là, l'inconnu s'arrêta, prêta l'oreille un instant, et portant ses doigts à sa bouche il imita le glapissement du coyote; presque immédiatement le même cri s'éleva du milieu des palétuviers, et une légère pirogue faite d'écorce de bouleau, conduite par deux hommes, apparut sur la rive.
—Eh! fit don Stefano d'une voix contenue, je désespérais de vous rencontrer!
—N'avez-vous donc pas entendu notre signal? répondit un des individus de la pirogue.
—Serais-je venu sans cela! Seulement il me semble que vous auriez pu vous avancer un peu au-devant de moi.
—Ce n'était pas possible.
La pirogue s'engrava alors dans le sable; les deux hommes sautèrent légèrement à terre, et en un instant ils eurent rejoint don Stefano. Tous deux portaient le costume et les armes des chasseurs de la Prairie.
—Hum! reprit don Stefano, la route est longue du camp pour venir jusqu'ici, je crains que l'on s'aperçoive de mon absence.
—C'est un risque qu'il vous faut courir, répondit celui qui déjà avait parlé, homme de haute taille, à la figure ouverte, à la physionomie grave et sévère, et dont les cheveux blancs comme la neige tombaient en longues boucles sur les épaules.
—Enfin, puisque vous voilà, expliquons-nous et surtout soyons brefs, le temps est précieux. Qu'avez-vous fait depuis notre séparation?
—Pas grand-chose: nous vous avons suivi de loin, voilà tout, prêts à vous venir en aide si besoin était.
—Merci; pas de nouvelles?
—Aucunes: qui aurait pu nous en donner?
—C'est juste; et votre ami Bon-Affût, l'avez-vous découvert?
—Non.
—Cuerpo de Cristo! Ceci est contrariant, car si mes pressentiments ne me trompent pas, bientôt il nous faudra jouer des couteaux.
—On en jouera.
—Je le sais, Balle-Franche[1], je connais de longue date votre courage; mais vous, Ruperto, votre camarade et moi nous ne sommes que trois hommes, en résumé de compte.
—Qu'importe?
—Comment, qu'importe? Lorsqu'il s'agit de combattre contre trente ou quarante chasseurs aguerris, en vérité, Balle-Franche, vous me rendrez fou avec vos idées. Vous ne doutez de rien: songez-donc que cette fois nous n'avons pas à lutter contre des Indiens mal armés, mais contre des blancs, des bandits de sac et de corde, qui se feront tuer sans reculer d'un pouce, et que nous succomberons inévitablement.
—C'est vrai, je n'y avais pas réfléchi, ils sont beaucoup.
—Nous morts que deviendrait-elle?
—Bon, bon, reprit le chasseur en secouant la tête, je vous répète que je n'y songeais pas.
—Vous voyez donc bien qu'il est indispensable que nous nous entendions avec Bon-Affût et les hommes dont il peut disposer.
—Oui, mais allez donc trouver à point nommé dans le désert la piste d'un homme comme Bon-Affût? Qui sait; où il se trouve en ce moment? il peut n'être qu'à une portée de fusil de nous comme en être éloigné de cinq cents milles.
—C'est à en devenir fou.
—Le fait est que la position est grave. Êtes-vous au moins sûr cette fois de ne pas vous être trompe et de tenir la bonne piste?
—Je ne puis rien assurer encore, bien que tout me fasse supposer que je ne me trompe pas, mais rapportez-vous-en à moi, je saurai bientôt à quoi m'en tenir.
—Du reste, ce sont les mêmes traces que celles que nous suivons depuis Monterey; il y a des chances que ce soient eux.
—Que résolvons-nous?
—Dame, je ne sais que vous dire.
—Vous êtes désespérant, sur ma parole; comment, vous ne pouvez me suggérer aucun moyen?
—Il me faudrait d'abord une certitude, et puis, vous l'avez dit vous-même: à nous trois, ce serait folie de tenter ce coup de main!
—Vous avez raison, je retourne au camp; la nuit prochaine, nous nous reverrons, je serai bien malheureux si, cette fois, je n'ai pas découvert ce qui nous importe tant de savoir; vous, pendant ce temps-là, cherchez, furetez, fouillez la Prairie dans tous les sens, et, si cela est possible, ayez-moi des nouvelles de Bon-Affût.
—Cette recommandation est inutile, je ne demeurerai pas inactif.
Don Stefano saisit la main du vieux chasseur, et la pressant fortement entre les siennes:
—Balle-Franche, lui dit-il d'une voix émue, je ne vous parlerai pas de notre vieille amitié, ni des services que plusieurs fois j'ai été assez heureux pour vous rendre, je vous répéterai seulement, et je sais qu'avec vous cela suffira, c'est que du succès de notre expédition dépend le bonheur de ma vie.
—Bon, bon, ayez confiance en moi, don José; je suis trop vieux pour changer d'amitié, je ne sais qui a tort ou raison dans cette affaire, je souhaite que la justice soit de votre côté; mais cela ne m'occupe pas, quoi qu'il arrive, je vous serai fidèle et bon compagnon.
—Merci, mon vieil ami, à la nuit prochaine.
Après avoir dit ces quelques mots, don Stefano, ou du moins celui qui se faisait appeler ainsi, fit un mouvement pour s'éloigner, mais d'un geste brusque Balle-Franche l'arrêta.
—Qu'y a-t-il? demanda l'étranger. Le chasseur posa l'index de sa main droite sur sa bouche pour lui recommander le silence, et se tournant vers Ruperto, qui avait assisté, impassible et silencieux, à l'entretien:
—Au Coyote! lui dit-il d'une voix basse et inarticulée.
Sans répondre, Ruperto bondit comme un jaguar et disparut dans un buisson de cotonniers qui se trouvait à peu de distance.
Au bout de quelques instants, les deux hommes qui étaient demeurés le corps penché en avant, dans l'attitude de gens qui écoutent, mais sans prononcer une parole, entendirent un froissement de feuilles, un bruit de branches brisées suivi de la chute d'un corps lourd sur le sol, puis plus rien.
Presque aussitôt, le cri de la chouette s'éleva dans la nuit.
—Ruperto, nous appelle, dit alors Balle-Franche, tout est fini.
—Que s'est-il donc passé? demanda don Stefano avec inquiétude.
—Moins que rien, répliqua le chasseur, en lui faisant signe de le suivre. Vous aviez un espion à vos trousses, voilà tout.
—Un espion?
—Pardieu! Vous allez le voir.
—Oh! Oh! Ceci est grave.
—Moins que vous le supposez, puisque nous le tenons.
—Oui, mais alors il nous faudra donc tuer cet homme?
—Qui sait? Cela dépendra probablement de l'explication que nous aurons avec lui; dans tous les cas, ce n'est pas un grand mal d'écraser de semblables vermines.
Tout en parlant ainsi, Balle-Franche et son compagnon avaient pénétré dans le buisson.
Domingo, renversé et garrotté étroitement au moyen de la reata de Ruperto, se débattait vainement pour rompre les liens qui lui entraient dans les chairs. Ruperto, les deux mains réunies sur le canon de son rifle dont la crosse reposait à terre, écoutait en ricanant mais sans lui répondre le flot d'injures et de récriminations que la rage arrachait au métis.
—¡Dios me ampare! disait celui-ci en se tordant comme une vipère. ¡Verdugo del demonio! Est-ce ainsi que l'on agit entre gente de razón? Suis-je donc un peau-rouge pour me ficeler comme une carotte de tabac et me serrer les membres comme à un veau que l'on mène à l'abattoir? Si jamais tu tombes entre mes mains, chien maudit, tu me payeras le tour que tu m'as joué!
—Au lieu de menacer, mon brave homme, dit Balle-Franche en intervenant, il me semble que vous feriez mieux de convenir loyalement que vous êtes entre nos mains et d'agir en conséquence.
Le bandit tourna brusquement la tête, la seule partie du corps qu'il avait de libre vers le chasseur.
—Vous avez bon air à m'appeler brave homme et à me donner des conseils, vieux trappeur de rats musqués, lui dit-il brutalement; êtes-vous des blancs ou des Indiens, pour traiter ainsi un chasseur.
—Si au lieu de chercher à entendre ce qui ne vous regardait pas, digne señor Domingo, c'est ainsi qu'on vous nomme je crois, dit don Stefano d'un air narquois, si vous étiez resté tranquillement à dormir dans votre camp, le petit désagrément dont vous vous plaignez ne vous serait pas arrivé.
—Je dois reconnaître la justesse de votre raisonnement, reprit le bandit avec ironie, mais dame, que voulez-vous? J'ai toujours eu la manie de chercher à apprendre ce qu'on voulait me cacher.
L'étranger lui lança un regard soupçonneux.
—Et avez-vous depuis longtemps cette manie, mon bon ami? dit-il.
—Depuis ma plus tendre jeunesse, répliqua-t-il effrontément.
—Voyez-vous cela, vous avez dût apprendre bien des choses alors?
—Énormément, mon bon seigneur.
Don Stefano se tourna vers Balle-Franche.
—Mon ami, lui dit-il, desserrez donc un peu les liens de cet homme, il y a tout à gagner en sa compagnie: je désire jouir quelques instants de sa conversation.
Le chasseur exécuta silencieusement l'ordre qui lui était donné.
Le bandit poussa un soupir de satisfaction en se sentant moins gêné et se releva sur son séant.
—¡Cuerpo de Cristo! s'écria-t-il avec un accent railleur, au moins maintenant la position est tenable, on peut causer.
—N'est-ce pas?
—Ma foi, oui, je suis bien à votre service pour tout ce que vous voudrez, seigneurie.
—Alors je profiterai de votre complaisance.
—Profitez, seigneurie, profitez; je ne puis que gagner à causer avec vous.
—Croyez-vous?
—J'en suis convaincu.
—Au fait, vous pourriez avoir raison; dites-moi, à part cette noble curiosité dont vous m'avez si franchement fait l'aveu, n'auriez-vous pas par hasard d'autres petits défauts?
Le bandit eut l'air de chercher consciencieusement pendant deux ou trois minutes dans sa tête, puis il répondit en faisant l'agréable.
—Ma foi non, seigneurie, je ne vois pas.
—En êtes-vous sûr?
—Hum! Il se pourrait, mais pourtant je ne crois pas.
—Là, vous le voyez, vous n'en êtes pas sûr?
—Au fait, c'est vrai! s'écria le bandit avec une feinte franchise; vous le savez, seigneurie, la nature humaine est si incomplète.
Don Stefano fit un geste d'assentiment.
—Si je vous aidais, dit-il, peut-être que...
—Nous trouverions, n'est-ce pas, seigneurie, interrompit vivement Domingo. Eh bien! Aidez, aidez, je ne demande pas mieux, moi.
—Ainsi, par exemple, remarquez bien que je n'affirme rien, je suppose, voilà tout.
—¡Caray! Je le sais bien, allez, seigneurie, ne vous gênez pas.
—Ainsi dis-je! N'auriez-vous pas un certain faible pour l'argent?
—Pour l'or surtout.
—C'est ce que je voulais dire.
—C'est qu'aussi l'or est bien tentant, seigneurie.
—Je ne vous en fais pas un crime, mon ami, je me borne à constater; du reste, cette passion est si naturelle!
—N'est-ce pas?
—Que vous devez en être atteint.
—Eh bien! Je vous avoue, seigneurie, que vous avez deviné.
—Voyez-vous, j'en étais sûr.
—Oh! L'or gagné honnêtement.
—Cela va sans dire; ainsi, par exemple, supposons que quelqu'un vous offrit mille piastres pour découvrir le secret du palanquin de don Miguel Ortega.
—Dame! fit le bandit en fixant un clair regard sur l'étranger qui, de son côté, l'examinait attentivement.
—Et si ce quelqu'un, continua don Stefano, vous donnait en sus, comme arrhes du marché, une bague comme celle-ci.
En disant ces paroles, il faisait chatoyer un magnifique diamant aux yeux du bandit.
—J'accepterais, cuerpo de Cristo! s'écria celui-ci avec un accent de convoitise, dussé-je, pour découvrir ce secret, compromettre à jamais la part que j'espère en Paradis!
Don Stefano se tourna vers Balle-Franche.
—Déliez cet homme, dit-il froidement, nous nous entendons.
En se sentant libre, le métis fit un bond de joie.
—La bague! dit-il.
—La voilà, fit don Stefano en la lui remettant, c'est convenu?
Domingo croisa le pouce de sa main droite sur celui de sa main gauche, et redressant fièrement la tête:
—Sur la sainte croix du Rédempteur, dit-il d'une voix ferme et accentuée, je jure de faire tous mes efforts pour découvrir le secret que don Miguel cache si jalousement; je jure de ne jamais trahir le caballero avec lequel je traite en ce moment; ce serment, je le fais devant les trois caballeros ici présents, m'engageant, si je le faussais, à subir sans me plaindre telle peine, fût-ce la mort, qu'il plaira à ces trois caballeros de m'infliger.
Le serment fait par Domingo est le plus redoutable que puisse prononcer un Hispano-américain; il n'y a pas d'exemple qu'il ait été jamais faussé. Don Stefano s'inclina convaincu de la loyauté du bandit.
Soudain plusieurs coups de feu, suivis de cris horribles, éclatèrent à peu de distance.
Balle-Franche tressaillit.
—Don José, dit-il à l'étranger en lui posant la main sur l'épaule, Dieu nous favorise; retournez au camp: la nuit prochaine, je vous apprendrai probablement du nouveau.
—Mais ces coups de feu?
—Ne vous en inquiétez pas, retournez au camp, vous dis-je, et laissez-moi agir.
—Allons, puisque vous le voulez, je me retire.
—A demain?
—A demain.
—Et moi? fit Domingo, caramba, compagnons, si vous allez jouer du couteau, ne pourriez-vous pas me prendre avec vous?
Le vieux chasseur le regarda attentivement.
—Eh! fit-il au bout d'un instant, votre idée n'est pas mauvaise, venez donc puisque vous le désirez.
—A la bonne heure donc, voilà un prétexte tout trouvé pour justifier mon absence.
Don Stefano sourit; après avoir une dernière fois rappelé à Balle-Franche leur rendez-vous pour la nuit suivante, il quitta le buisson et se dirigea vers le camp.
Les deux chasseurs et le métis demeurèrent seuls.