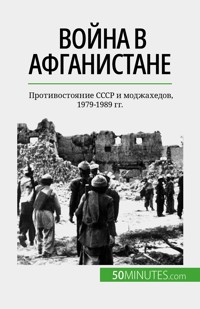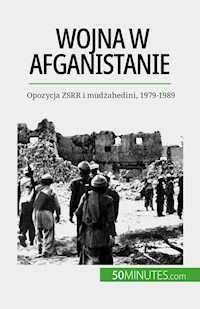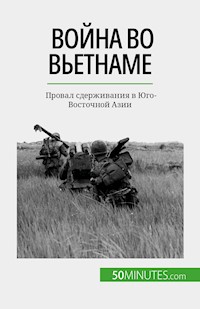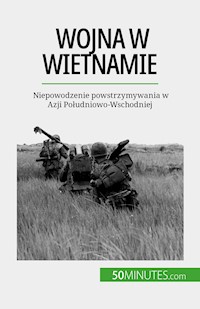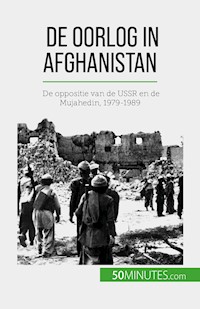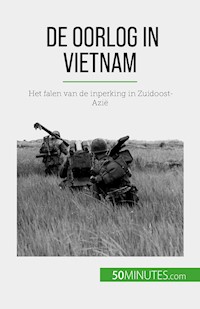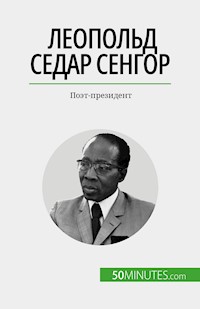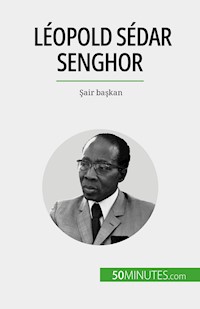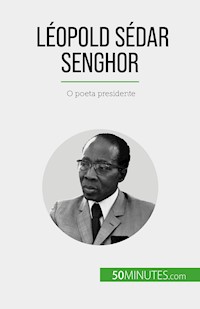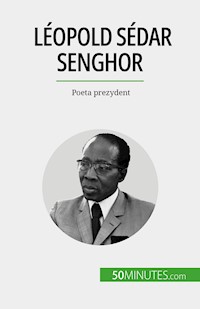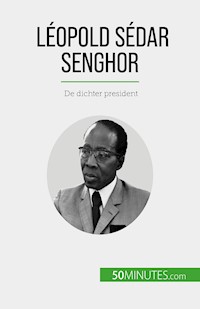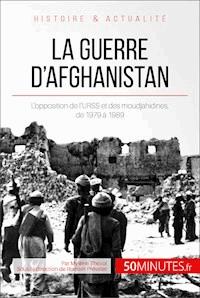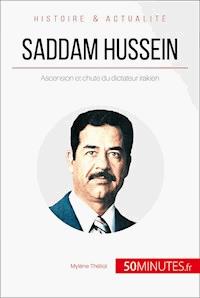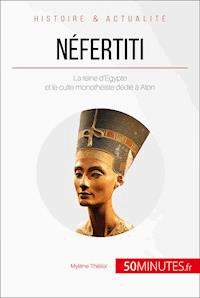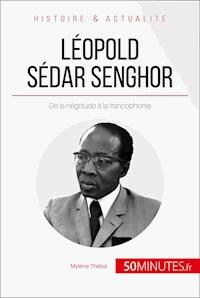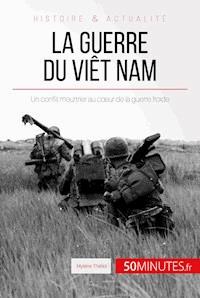L’émergence d’un marché de l’art :sociétés artistiques et galeries d’art au Maroc (1832-1956) E-Book
Mylène Théliol
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le Maroc, sous l’influence puis la domination européenne entre 1832 et 1956, met en place un marché de l’art. Les principaux acteurs sont les peintres et sculpteurs, les sociétés artistiques et les galeries d’art. Grâce à cette interaction commerciale, ce secteur se développe dans le pays et les tendances se modifient en fonction des volontés de chacun des protagonistes.
Ainsi, cet ouvrage est l’aboutissement de recherches scientifiques sur l’étude de l’art pictural et sculptural marocain entre 1832 et 1956.
À PROPOSD DE L'AUTEURE
Mylène Théliol est docteure en histoire de l’art, spécialiste de l’orientalisme français ainsi que du patrimoine et de l’art au Maroc aux XIX et XX siècles. Elle publie des articles et des ouvrages sur ces thèmes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mylène Théliol
L’émergence d’un marché de l’art : sociétés artistiques et galeries d’art au Maroc (1832-1956)
Essai
© Lys Bleu Éditions – Mylène Théliol
ISBN : 979-10-377-7867-3
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Introduction
L’histoire de l’art contemporain au Maroc s’inscrit actuellement dans la culture du pays grâce à la création, en 2014, du Musée des arts modernes à Rabat dont la présentation d’inauguration, intitulée 1914-2014 : cent ans de création,montrait plus de cinq cents œuvres de cent cinquante artistes marocains. Grâce à un parcours laborieusement agencé, le visiteur pouvait traverser les différentes évolutions de la création plastique permettant ainsi une approche chronologique des mouvements artistiques et une présentation des peintres. Cette exposition se divisait en quatre temps : l’émergence des peintres marocains dans la première moitié du XXe siècle ; la période des années 1960-1970 où la génération d’artistes modernes invente un art basé sur le retour à l’identité culturelle nationale et universelle ; les années 1980-1990 avec l’individualisme artistique et la diversification esthétique qui se développent pour s’achever aux nouvelles tendances plastiques du XXIe siècle influencées par la mondialisation, les nouvelles technologies et internet. Cette exposition d’inauguration ne fait référence qu’aux artistes marocains et non pas à l’ensemble des plasticiens, aussi bien originaires du Maroc que d’Europe, ayant exercé durant cette période. La manifestation est, en outre, l’aboutissement des études menées par de nombreux historiens de l’art. Dès les années 1960, Toni Maraini et Mohamed Chabâa (1930-2013) ont commencé à analyser les processus de création et leur filiation avec les courants européens orientalistes et avant-gardistes tout en mettant en avant les propres spécificités de l’art moderne marocain alors en plein essor. À la fin des années 1980, Mohamed Sijelmassi et Khalil M’Rabet approfondissent ces premières études. Ce nouveau regard met en exergue les aspects esthétiques et techniques de chaque plasticien, leur place dans l’art contemporain international et les relations qu’ils ont entre eux. Dans les années 1980-1990, plusieurs expositions consacrent alors la notoriété de certains artistes du Maroc. Entre 2001 et 2021, des biographies, éditées notamment par la maison d’édition Marsam à Rabat, sont dédiées à plusieurs peintres modernes marocains. Parallèlement à ces publications, de nombreux universitaires réalisent des investigations à la fois sur les périodes coloniale et post-coloniale afin de s’intéresser à l’aspect historique, esthétique et sociologique des œuvres d’art marocaines au XXe siècle. Le sujet présenté ici reprend l’ensemble de ses études tout en les inscrivant dans un contexte historique tout en se focalisant principalement sur les institutions artistiques privées et étatiques qui permettent aux plasticiens de s’organiser et vendre leurs créations au Maroc.
Ainsi, en m’appuyant sur des travaux scientifiques, des ouvrages de nombreux historiens d’art ainsi que sur la presse française au Maroc de la période coloniale (La Vigie marocaine, Le Petit Marocain, Le Courrier du Maroc, L’Echo du Maroc, Maroc-Matin, La Voix de Meknès, Le Sud marocain) et sur des revues françaises d’Algérie et de métropole de la même époque, j’ai cherché à mettre en exergue comment le Maroc – Tanger et le Protectorat français – a-t-il pu devenir un territoire artistiquement fécond entre 1832 et 1956. Quels sont les moyens mis à la disposition des plasticiens pour qu’ils puissent vivre de leur art ? J’ai limité mon étude aux cent vingt-quatre années où l’histoire du Maroc est fortement imbriquée avec celle de l’Europe. Si mon point d’ancrage de cette analyse commence en l’année 1832, c’est que cette date marque le début de la course à l’appropriation du Maroc par les puissances européennes et c’est aussi la première fois que le Royaume chérifien devient un sujet de peinture dans l’art occidental. Durant tout le XIXe siècle, les grands États européens tentent d’avoir la main mise sur ce territoire diplomatiquement et économiquement, tandis que de nombreux plasticiens occidentaux y affluent. L’étau se resserrant de plus en plus, le Royaume chérifien finit par basculer sous la tutelle de l’Espagne et de la France avec les signatures des deux Protectorats en 1912. Le pays retrouve enfin son indépendance et sa souveraineté en 1956. Cette date clé ouvre aussi de nouveaux questionnements plastiques et une remise en question des organismes artistiques mis en place par la présence française. Ainsi, entre 1832 et 1956, apparaissent de nombreuses associations regroupant des artistes européens domiciliés au Maroc (Tanger et Protectorat français) qui ont pour objectif majeur d’encourager les arts plastiques et de concourir à leur développement, de valoriser et faire subsister ses adhérents grâce à la vente de leurs tableaux ou sculptures lors de leurs diverses expositions collectives. Les peintres et les sculpteurs sont aussi aidés par les galeries d’art qui déterminent la valeur marchande de leurs œuvres tout en tenant compte de sa valeur esthétique. Plasticiens, sociétés artistiques et galeries d’art sont donc les rouages d’un marché de l’art qui s’organise progressivement au Maroc. Cependant, les données chiffrées des achats et ventes de tableaux et de sculptures sont quasiment inconnues pour la période coloniale tout comme l’identité des acquéreurs privés et leur rôle qu’ils ont auprès des artistes. L’étude de ce commerce se borne donc à comprendre comment se mettent en place les sociétés artistiques et les galeries d’art dans les différentes villes du Protectorat français. Qui sont les artistes valorisés par ces organismes, d’où viennent-ils, quelles sont leurs formations ? Quels types d’œuvres sont les plus appréciés par les amateurs d’art ? L’appréhension de cette étude passe par un recours à l’histoire. Il n’est pas concevable de séparer l’entrée des artistes occidentaux au Maroc au XIXe siècle sans connaître les raisons politiques ou économiques qui permettent leur insertion sur ce territoire si convoité par les grands États européens. Les complexes relations entre les deux rives de la Méditerranée procurent un prétexte aux peintres et sculpteurs européens, cherchant à représenter l’Orient, pour entrer à Tanger, principal port du Royaume chérifien et lieu de transit entre l’Espagne et l’Afrique du Nord. L’enracinement des plasticiens en terre marocaine est inéluctable avec la mise en place des deux Protectorats (1912-1956) qui établissent une certaine stabilité politique et économique au Maroc. Celle-ci engendre alors une institutionnalisation artistique qui s’organise par la création de sociétés privées dont les activités sont majeures dans l’expansion des arts plastiques dans le pays. Les galeries d’art, implantées dans les principales villes marocaines après la Première Guerre mondiale, sont les intermédiaires du marché de l’art qui simultanément définissent la tendance artistique du moment et accordent leur soutien à des artistes choisis parmi la multitude qui afflue de la métropole et des autres pays méditerranéens. Pour se conformer aux critères esthétiques demandés par les galeries et les sociétés artistiques, initialement instaurés par les premières générations d’artistes, les plasticiens du Maroc doivent suivre une formation dans des Écoles des Beaux-arts. Dans ces lieux et sous l’influence de peintres européens moins traditionalistes jaillissent de jeunes créateurs marocains dont l’expression plastique se dégage des carcans imposés.
Chapitre 1
L’orientalisme au Maroc et la création du premier Salon à Tanger
La peinture du Maroc a ses origines au XVIe siècle grâce à des dessinateurs et peintres de chevalet marocains pratiquant leur art en Europe1. Au XIXe siècle, Eugène Delacroix (1798-1863) remet au goût du jour la peinture ayant pour thème le Maroc grâce à une mission diplomatique de six mois qu’il entreprend avec le Comte Charles de Mornay (1803-1878), en 1832, auprès du Sultan chérifien Moulay Abd el Rahman (1822-1859). Débarqués à Tanger, l’artiste et le diplomate rejoignent Meknès, la ville impériale. Eugène Delacroix, en arpentant la cité, croque sur le vif, sous forme de dessins souvent rehaussés d’aquarelles, les scènes de rues et les intérieurs de maison qu’il est autorisé à visiter. Il répertorie dans ses carnets de voyage le quotidien ainsi que les mœurs et coutumes des habitants de Tanger puis de Meknès. Grâce à ce séjour marocain, le peintre réalise de nombreux tableaux en s’inspirant de ses notes, dessins et souvenirs. Ces œuvres font de lui le père du courant orientaliste en France. Cependant, même si pour Eugène Delacroix, le voyage au Maroc est un ravissement, la mission diplomatique du Comte Charles de Mornay n’est en revanche pas aisée. Il doit inciter le monarque marocain à retirer ses troupes de la ville algérienne de Tlemcen qui est alors sous tutelle française depuis 1830. Tlemcen est liée historiquement au Maroc puisqu’elle a été conquise au XIIIe siècle par la dynastie mérinide. Ce passé encore vivace dans l’esprit de ses habitants les incite à demander son rattachement au Royaume chérifien. Le Sultan, consentant à ce désir, envoie des contingents pour sécuriser la ville, car la présence française en Algérie est aussi une menace pour le Maroc. La France riposte alors par l’envoi d’escadrons militaires. En 1844, les deux principaux ports marocains, Tanger et Mogador, sont bombardés par la flotte française. Mogador est prise d’assaut et la bataille d’Isly est un cuisant échec pour le monarque marocain. Les scènes de ces combats sont retranscrites en peinture par les principaux artistes accompagnant la marine française : Horace Vernet (1789-1863) avec La Bataille d’Isly (1845)etHenri Durand-Brager (1814-1879) qui peint Le Combat naval devant la côte marocaine (1845)2. Cette défaite montre au souverain marocain qu’il n’a pas les moyens techniques et militaires de s’opposer aux puissances occidentales. Il doit alors moderniser son pays et par conséquent l’ouvrir aux influences marchandes européennes. Il signe donc le 9 décembre 1856 le traité de Tanger avec l’Angleterre favorisant le commerce et la navigation entre les deux pays. Le Sultan fait de même avec l’Espagne en 1860, juste après la débâcle de son armée lors de la guerre de Tétouan (1859-1860). Ce conflit est immortalisé par le tableau Bataille de Tétouan, datant de 1864, réalisé par le peintre catalan Marià Josep Bernat Fortuny i Marsal (1838-1874) alors chroniqueur de l’expédition militaire. Durant cette expédition, l’artiste travaille sans relâche en dessinant au pastel et en peignant à l’aquarelle et à l’huile des paysages, des cavaliers maures, des scènes de genre. Fait prisonnier par les troupes maures à la bataille d’Oued-er-Ras, il se fait passer pour un Anglais afin de se voir libérer rapidement. À son retour en Espagne en avril 1860, le peintre expose à Barcelone ses études réalisées durant la campagne militaire. Son exposition obtient un tel succès que la Diputació de Barcelone lui commande un tableau pour commémorer cette expédition : La Bataille de Tétouan. Un voyage à Paris est donc offert à l’artiste pour qu’il s’inspire de Prise de la smalah d’Abd-el-Kader par le duc d’Aumale d’Horace Vernet, peinte vers 1843. Marià Josep Bernat Fortuny i Marsal retourne au Maroc en 1862, accompagné par un de ses confrères, Francisco Lameyer y Berenguer (1825-1877). Les deux peintres, vêtus de costumes traditionnels marocains, visitent Tétouan. Marià Josep Bernat Fortuny i Marsal commence alors à apprendre l’arabe et à effectuer des dessins pour son grand tableau historique. Il compose ensuite l’oeuvre dans son atelier à Rome qui est accueillie en Catalogne juste après le décès du peintre, en 1874. Cette toile met en évidence la puissance militaire espagnole sur celle du Maroc, marquant l’ascension de l’expansion de l’Espagne outre-Méditerranée. En effet, les traités signés avec l’Angleterre et l’Espagne ouvrent une brèche à ces deux pays pour s’introduire dans la politique intérieure du pays. Ainsi la pénétration européenne devient donc inéluctable dans le Royaume chérifien. Des transformations économiques et sociales sont alors engagées : les ports de Tanger, Mogador et Mazagan sont développés ainsi que Casablanca, la toute nouvelle plaque tournante du commerce. Ces quatre villes, drainant l’essentiel du trafic maritime entre l’Europe et le Maroc, voient affluer non seulement des marchandises, mais aussi des Européens (Anglais, Espagnols, Français, Italiens et Portugais) cherchant fortune dans le Royaume chérifien3. La population française et britannique, principalement installée à Casablanca et Tanger, favorise la puissance de leur consulat dans ces deux ports. Cette présence occidentale s’accentue au Maroc avec l’installation de missions religieuses ouvrant des écoles et des hôpitaux, l’apparition de journaux, l’implantation de banques et d’entreprises ainsi que l’essor des télécommunications4. Cette pénétration européenne est aussi artistique, puisque des plasticiens français, anglais et espagnols suivent les voies commerciales et diplomatiques pour découvrir le pays5. Entre 1842 et 1850, l’aquarelliste Élisabeth Murray (1815-1882) réside à Tanger avec son mari, Henry Johnson Murray, attaché au consulat général britannique. Durant ce long séjour, l’artiste anglaise peint des paysages, des scènes de marché et des vues de la médina. Grâce à ses liens avec la communauté féminine marocaine et juive, elle a accès aux lieux de résidence des femmes et peut ainsi les représenter en peinture. En 1850, le peintre français Alfred Dehodencq (1822-1882) séjourne à Tanger. Parti d’Espagne où il a visité l’Andalousie, il arrive dans la cité portuaire méditerranéenne en 1853. Il n’y fait qu’un bref séjour avant d’y revenir tous les ans afin de s’aventurer plus loin sur le territoire marocain en faisant des escapades dans les villes de Tétouan, Larache, Mogador, Salé et Rabat, les autres principaux ports du Maroc. Alfred Dehodencq suit les pas d’Eugène Delacroix sans pour autant peindre les mêmes motifs. L’artiste est le chantre des rassemblements populaires (fêtes, célébrations). La violence ponctue ses œuvres avec la représentation de prisonniers ou de suppliciés, mais il exécute beaucoup plus de scènes de la communauté juive6. Dès la fin des années 1860, les peintres européens s’aventurent davantage dans le territoire marocain. Ils visitent le nord du pays entre Larache et Melilla et les villes impériales (Rabat, Fès, Meknès et Marrakech), lieux de séjour du Sultan. Ces escapades se font sous couvert de missions diplomatiques. Ainsi, au printemps 1875, les artistes italiens Cesare Biseo (1843-1909), Stefano Ussi (1822-1901) et l’écrivain Edmondo de Amicis (1846-1908) accompagnent, à sa demande, le consul général Stefano Scovasso (1816-1887) qui doit présenter des lettres de créance au Sultan Moulay Al Hassan 1er (1836-1894) à Fès7. La même mission est effectuée, en 1889, par le nouveau ministre plénipotentiaire français, Jules Patenôtre (1845-1925), qui en se rendant à Fès, est suivi par le romancier Pierre Loti (1850-1923) et le peintre Aimé Morot (1850-1913)8. Les excursions des artistes européens au sein des principales villes du Maroc sont jonchées d’obstacles. Ils ne peuvent pas circuler librement dans les villes sans être escortés par des gardes qui n’entravent guère une foule prête à fondre sur des étrangers dont la pratique de peindre en public est contraire à la tradition islamique. Ils n’ont pas le temps de prendre des notes ou des croquis en détail afin de réaliser, ensuite en atelier, de méticuleuses compositions de ces cités historiques9. Le seul moyen d’avoir une idée précise de ces monuments séculaires est de se transporter en Andalousie où l’architecture arabo-musulmane est semblable à celle du Maroc.
La découverte de Grenade et de son passé maure, en août 1869, est une exaltation pour les artistes français Henri Regnault (1843-1871) et Georges Clairin (1843-1919). « Je prends encore un bain de lumière dorée et rosée dans l’Alhambra : ces marbres, ces murs de dentelles se mirant dans les bassins immobiles, ces plafonds de stalactites qui semblent vous aspirer, vous enlever à eux, en montant et s’élevant de plus en plus à mesure que vous les regardez, ces forêts de colonnettes, ces faïences, ces montagnes lointaines baignées dans la lumière et qu’on découvre à travers chaque fenêtre, quelleféerie délicieuse et dont on ne peut se détacher !10 », écrit Henri Regnault à sa fidèle amie Adèle Affry, duchesse Colonna (1836-1879), lors de son séjour à l’Alhambra. Tout enivré de cette atmosphère féerique, le voyage au Maroc paraît donc une suite logique pour comprendre l’essence même de la civilisation maure. C’est ainsi que nos deux peintres débarquent en décembre 1869 à Tanger où ils s’installent dans une maison qu’ils décorent à la manière marocaine. Pour parvenir à créer des œuvres historiques, ils mixent des éléments andalous et tangérois comme dans Exécution sans jugement sous les rois maures de Grenade (1869) de Regnault ou encore avec Le Massacre des Abencérages (1874) de Georges Clairin. La mort prématurée d’Henri Regnault durant la guerre franco-prussienne (1870-1871) n’empêche pas son ami de regagner le Maroc en 1871. L’artiste y séjourne dix-huit mois. Il visite différentes villes dont Fès et Tétouan en compagnie de trois grands peintres espagnols rencontrés à Paris en 1870 : Josep Tapiró i Baró (1836-1913), Marià Josep Bernat Fortuny i Marsal et Bernardo Ferrándiz y Bádenes (1835-1885). Les œuvres exécutées par Georges Clairin sont dans la même veine que celles qu’ils produisaient avec son défunt ami. Quelques décennies plus tard, grâce à ses voyages en Algérie et en Égypte, ses thèmes s’éloignent de l’histoire des Maures, mais ses tableaux restent quand même indubitablement attachés aux sujets historiques des contrées visitées. Georges Clairin recrée l’histoire en peinture tout comme le fait son homologue orientaliste, Jean-Léon Gérôme (1824-1904). Ce dernier débarque avec ses élèves à Tanger en 1889 et suit le cérémonial donné en l’honneur du Sultan Moulay Hassan 1er (1857-1894) alors en visite officielle dans la ville méditerranéenne. La venue de peintres français au Maroc, à partir des années 1880, est liée à la présence de plus en plus oppressante de diplomates au Maroc, depuis l’annexion de la Tunisie en 1881. Tanger est le point de jonction où les artistes se rencontrent et s’installent pour peindre ou partir explorer d’autres villes en suivant les pistes tracées à cet effet. Ainsi, en 1888, Pascal Dagnan-Bouveret (1852-1929), Louis-Auguste Girardot (1856-1933) et Jules Alexis Muenier (1863-1942) s’installent dans la cité portuaire. Tous les trois ont bénéficié de bourses de voyage pour visiter des pays méditerranéens. Ces bourses sont octroyées par les sociétés artistiques qui se développent depuis la fin du XIXe siècle en métropole. Les plus importantes sont la Société des artistes français et la Société nationale des beaux-arts, fondées respectivement en 1881 et 1889. Elles regroupent des peintres et des sculpteurs ayant des styles divers. En 1893, une nouvelle association est créée, il s’agit de la Société des peintres orientalistes qui veut regrouper en son sein tous les artistes français voyageant et peignant les beautés de l’Orient. La notion d’orient est alors vaste à cette époque comme le précise le journaliste Ary Renan (1857-1900) :
« Nous entendons, dans la conversation, sous le terme général d’Orient, les contrées les plus diverses, une grande partie de l’Asie et toute la côte septentrionale de l’Afrique, que les écrivains arabes appelaient justement à l’inverse, le Maghreb. Nous qualifions d’Oriental tout paysage des pays du soleil, auquel nous prépare la Providence, telle l’Italie. Nous appelons Oriental tout objet manufacturé sur les terres que l’Islam a converties. L’Inde elle-même et le Caucase rentrent par extension dans l’orient des peintres. Le terme “orientalisme” se définit ainsi assez nettement aux frontières des anciennes conquêtes musulmanes11. »
Les peintres visitant les contrées ainsi définies sont donc qualifiés d’orientalistes. Pour les artistes français, l’Algérie et la Tunisie à la fin du XIXe siècle sont des territoires faciles d’accès, car ils sont sous la tutelle de la France. Ces pays recèlent des paysages, des coutumes et traditions locales qui, à cause d’une forte pression occidentale, tendent à s’éteindre. C’est ce que dénonce le peintre Étienne Dinet (1861-1929) dans son ouvrage Khadra, danseuse Ouled Naïl (1909), en montrant que les mœurs des peuples sahariens de Bou Saâda, notamment les danses d’amour des femmes Ouled Naïl, ont disparu. Il ne reste plus de cette pratique que ses propres peintures réalisées entre 1904 et 1909. Les danseuses se sont transformées en prostituées au contact de l’armée coloniale. Contrairement à l’Algérie, le Maroc possède encore de nombreux atouts pour les artistes occidentaux. Le premier est son climat méditerranéen et sa géographie aux multiples visages qui permettent aux plasticiens de réaliser des paysages uniques en travaillant à la fois sur la lumière et les couleurs. Depuis la révolution impressionniste, la tendance à peindre en plein air et à s’intéresser aux effets lumineux et chromatiques est devenue à la mode pour beaucoup de peintres. Le second attrait du Maroc est sa double culture arabo-musulmane et berbère ainsi qu’un art raffiné semblable à celui de l’Andalousie que les artistes connaissent et apprécient depuis les années 1840. Cependant, malgré des missions diplomatiques, le Maroc reste un mystère pour beaucoup de plasticiens, car les différents Sultans ont su le tenir hors d’atteinte de l’influence européenne. Mais l’accession du jeune alaouite Moulay Adbelaziz (1881-1943) au trône, entre 1899 et 1908, fait basculer le Royaume chérifien vers une domination européenne. Cinq pays – l’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et la France – sont en liste pour accroître leur présence au sein du maghzen. Malgré les ambitions de chacun d’entre eux, la France réussit à grands recours de négociations à mettre en avant ses prérogatives qui sont reconnues par l’Italie en 1900 contre une liberté d’action en Tripolitaine et par le Royaume-Uni en 1904 contre sa prédominance sur l’Égypte. En octobre 1904, un accord franco-espagnol complète le processus. En 1905, la France fait un pas de plus en proposant au Sultan un plan de réforme qui n’est rien d’autre qu’une mise sous tutelle sans nom. Le monarque marocain recourt alors à l’Allemagne pour se défendre de la France. La stratégie est judicieuse, car le kaiser, Guillaume II, reconnaît le Maroc comme étant un État indépendant et qu’aucune autre nation ne peut y établir sa suprématie. Ce soufflet diplomatique entraîne des frictions franco-allemandes qui aboutissent à la conférence d’Algésiras. Celle-ci réaffirme la souveraineté du pays chérifien et exprime les modalités d’un contrôle international de ce pays sous le commandement de la France12. Elle donne la prédominance d’influence à l’Espagne sur le nord, ainsi qu’à la France pour les questions économiques et financières. Les négociations politiques n’empêchent pas le Maroc de tomber dans le chaos : des massacres d’Européens se produisent dans de nombreuses villes en 1907. La France intervient en envoyant les troupes coloniales du colonel Hubert Lyautey, stationnées à la frontière algérienne, qui réussissent à occuper en décembre les cinq ports de l’Atlantique. Cependant, l’insurrection gagne petit à petit tout le pays dû aux agissements du khalifat de Marrakech, Moulay Abdelhafid (1908-1912), qui entend soustraire le pouvoir au Sultan13. La France, hésitant à intervenir de peur des représailles allemandes, obtient finalement l’autorisation officielle du nouveau maître du Maghzen de prendre part au rétablissement de l’ordre. En mai 1911, quinze mille hommes atteignent Rabat et Fès, tandis que les Espagnols font cesser les agitations dans leur zone d’influence. La riposte maritime allemande intervient le 1er juillet 1911 à Agadir pour faire fléchir militairement la France et ainsi permettre l’ouverture de renégociations des traités de 1906. L’intervention diplomatique britannique neutralise les espoirs allemands et impose un nouvel accord de paix, signé le 4 novembre 1911. L’Allemagne abandonne donc ses positions au Maroc en contrepartie de la cession par la France de deux cent soixante-quinze mille kilomètres carrés au Cameroun. Désormais seule, la France doit faire accepter à Moulay Abdelhafid un protectorat analogue à celui instauré en Tunisie en 1881.
Durant tout le règne de Moulay Abdelaziz, Tanger reste la porte d’entrée la plus aisée aux diplomates comme aux artistes occidentaux pour accéder aux principales villes du Maroc, mais aussi pour résider sur le sol marocain. La cité méditerranéenne, ayant le statut de station balnéaire d’hiver, se couvre de nombreux hôtels de luxe favorisant l’afflux constant de plasticiens étrangers. Entre 1880 et 1950, « [la ville] est visitée par 127 peintres britanniques et seulement 76 Français et 37 Espagnols. […] 28 peintres américains sont venus y travailler pendant cette période. […] Seuls 9 Italiens et 7 Belges ont pu être identifiés. Encore moins de Russes : 5 ; d’Austro-Hongrois : 5 ; de Hollandais : 4 ; d’Australiens : 2 ; de Canadiens 2 ; de Tchécoslovaques : 2 ; de Danois : 2 ; de Polonais : 2 ; de Sud-Africains : 2. Parmi les autres nationalités : 1 Allemand, 1 Portugais, 1 Suédois et 1 Suisse14. » De nombreux peintres américains, étudiant les Beaux-arts dans les grandes villes européennes que sont Londres, Paris et Madrid, et influencés par des peintres français ou espagnols ayant travaillé à Tanger, sont conquis par l’orientalisme. Harry Humphrey Moore (1844-1926), grâce à sa rencontre avec Marià Josep Bernat Fortuny i Marsal en 1870, en Espagne, tente le voyage au Maroc. Quant à James Wells Champney (1843-1903), s’il débarque dans le port marocain en 1880, c’est pour suivre les traces d’Henri Regnault et Marià Josep Bernat Fortuny i Marsal. Pour les peintres étasuniens, venir à Tanger représente – par rapport aux Balkans, à la Turquie, à l’Égypte ou à la Palestine – un voyage plus court et moins coûteux. Ceux qui s’y rendent se connaissent tous parce qu’ils ont côtoyé les mêmes ateliers. Samuel Colman (1832-1920), qui visite la ville en 1860, influence ses deux amis, Louis Comfort Tiffany (1848-1933) et Robert Swain Gifford (1840-1905), à séjourner au Royaume chérifien, ce qu’ils font en novembre 1870 après leur voyage en Europe. Débarquant à Tanger, ils peignent et dessinent les marchés, les scènes de rue et les paysages environnants. Par la suite, les deux jeunes artistes explorent le centre et le sud du pays, traversant l’Atlas et campant dans le Sahara. L’impressionniste John Singer Sargent (1856-1925) et Edwen Lord Weeks (1849-1903), élèves de Léon Bonnat (1833-1922) et Carolus-Duran (1837-1917) à l’École des Beaux-arts de Paris, partent à Tanger en 1880. Souhaitant voir d’autres villes du Maroc, Edwen Lord Weeks s’aventure seul sur les chemins qui le mènent à Salé et Rabat, où il peint Traversée du Fleuve et Porte du Chellah, avant de gagner Marrakech15.
Pour tous les plasticiens étrangers, la ville offre un climat doux et le coût de la vie est extrêmement abordable. Ils s’y établissent donc pour un séjour plus ou moins long et posent leur chevalet pour avoir à portée de main cet Orient, plus ou moins rêvé, qu’ils traduisent sur la toile avec leur style et leur vision d’Occidentaux. Tous ces peintres ont une formation classique et connaissent Les Mille et une Nuits. Cette œuvre littéraire persane, datant entre le IXe et XIe siècle et traduite pour la première fois en français par Antoine Galland entre 1704 et 1717, est leur référence pour se faire une idée du monde arabo-musulman16. Ils y entremêlent aussi des connaissances sur l’Antiquité. Cet amalgame entache la vision des plasticiens même si ces derniers sont en contact réel avec la culture des pays d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. À Tanger comme dans les villes impériales (Rabat, Fès, Meknès et Marrakech), les artistes sont confrontés à des difficultés jusqu’à l’instauration des Protectorats. Ils ne peuvent pas peindre en public au sein de la médina sans être pris en chasse par les citadins. Dans LeMonde illustré du 31 mars 1888, il est décrit les désagréments que rencontrent le peintre Maurice Romberg de Vaucorbeil (1862-1943) lors de son séjour à Marrakech. « S’il s’installe quelque part, soit debout, soit assis, tout de suite un rassemblement d’une centaine de personnes se forme autour de lui ; le soldat préposé à sa garde les chasse à coups de bâtons, les groupes se reforment à dix pas, restent devant l’artiste, fût-ce même une journée entière, jusqu’à ce qu’il s’en aille17. » Pour parer à ces problèmes, les artistes se font accompagner de domestiques ou de gardes armés de bâtons. L’autre obstacle rencontré est la difficulté qu’ont les peintres à trouver des modèles professionnelles dans la communauté arabo-musulmane. Certains artistes doivent finalement se contenter de modèles juives, voire de prostituées. Malgré ces complications, les artistes réussissent à retranscrire à leur manière ce qu’ils voient : les populations locales, les principaux monuments de Tanger comme la kasbah datant du XIIIe siècle, la grande mosquée, les rues et scènes de rue de la médina ou encore des vues de la ville et de ses alentours. Mais, la cité portuaire n’offre pas d’endroit fixe pour leur permettre de présenter leurs œuvres. Finalement, les expatriés s’approprient les halls des hôtels pour remédier à ce problème. Le quotidien tangérois, Al-Moghreb Al-Aksa, faitétat le 11 février 1893 d’une exposition individuelle picturale de l’artiste Manuel Alvarez. L’année suivante, en mai, le journal annonce celle des peintres américain et espagnol Harry Humphrey Moore (1844-1926) et José Tapiró i Baró18. Ce peintre orientaliste catalan est installé à Tanger depuis 1876. Il a transformé un ancien théâtre du quartier juif de la Fuente Nueva en atelier-musée de style mauresque dans lequel il rassemble ses œuvres et une collection d’objets orientaux et antiques. Il trouve l’inspiration, pour ses compositions, dans la vivacité des rues de la médina où se côtoient différentes cultures et populations. Il excelle notamment dans les portraits comme dans son aquarelle Retrat del santó Darcagüey de 1890. Le peintre exécute le portrait d’un marabout de Tanger en faisant poser un de ses modèles qu’il habille de vêtements et pare de bijoux appartenant à sa collection personnelle19. Le tour de force de l’artiste est de rendre crédible cette supercherie grâce à sa minutie du rendu du costume, des parures, ainsi que des traits physiques. Bien que ses toiles soient de pures inventions, elles sont attrayantes pour l’ensemble des amateurs d’art de Tanger. Le peintre trouve d’ailleurs dans cette ville cosmopolite une clientèle assidue, aussi bien européenne que juive, qui achète avec passion ses principaux tableaux.
Avec l’avènement de Moulay Abdelhafid et le retour au calme sur le territoire marocain, l’afflux constant d’artistes venant à Tanger pousse ses habitants occidentaux à ouvrir un Salon de peinture au printemps 1909. L’idée est lancée par le Stade Marocain, association sportive locale, qui, lors de la première édition de ce salon, regroupe dans leur local des toiles d’artistes résidant dans la ville ainsi que des œuvres prêtées par les Tangérois eux-mêmes. Cette manifestation étant un succès, d’autres se succèdent20. En automne 1909, l’exposition rassemble entre autres des peintres européens venant d’Algérie comme Maxime Noiré (1861-1927) et Francisque Noilly (1855-1942)21. Entre 1910 et 1913, le Salon réunit des artistes locaux, ceux de la métropole et des étrangers, dont le peintre finlandais Hugo Elias Backmansson (1860-1953), John Lavery (1856-1941) et Maurice Romberg de Vaucorbeil22. Cet artiste belge, naturalisé français, débarquant en 1887 à Tanger, accompagne pendant quatre mois l’archéologue Henri de la Martinière (1859-1922) à travers tout le Maroc en passant par les principales villes comme Tétouan, Rabat, Fès, Mekhnès et Marrakech. Ces dessins et tableaux qu’il rapporte de ses expéditions sont ensuite exposés à Tanger. Il poursuit la découverte du Maroc en se fondant dans la population pour mieux retranscrire sur la toile les beautés architecturales du pays même si certaines sont interdites aux Européens23. Un autre Français fait sensation au Salon de 1911, il s’agit du peintre Maurice Tranchant de Lunel (1869-1932). Il y présente des aquarelles illustrant les principaux monuments de la capitale culturelle et cultuelle du Maroc. Cet architecte-peintre est un grand voyageur qui a visité le continent asiatique dont notamment les contrées indochinoises et le Moyen-Orient. Il s’est installé à Fès dans le mellah (quartier juif) de la médina qui est quasiment détruit lors de l’insurrection fassie en avril 1912, juste après la signature du traité du 30 mars 1912 instaurant le Protectorat français au Maroc.
Le Protectorat français est une forme de régime mettant en relation un État protecteur et un État protégé. Le premier, représentant l’État sous sa protection, conclut les accords internationaux à sa place. Le pouvoir interne est partagé entre les deux États bien que le pouvoir autochtone soit à l’origine de la législation. Le traité de Fès impose au Royaume chérifien de se moderniser administrativement, judiciairement, économiquement, financièrement, scolairement et militairement. En contrepartie, les mœurs et coutumes, la religion et le statut du Sultan sont sauvegardés. La constitution du maghzen est renforcée par l’adjonction de fonctionnaires français à tous les niveaux du pouvoir. Les anciens vizirats des finances, de la justice et de la guerre sont remplacés ou réformés. Le Commissaire Résident Général, représentant de la République française au Maroc, prend la place de l’ancien vizir de la mer. Il a les fonctions de ministre des Affaires étrangères, de celui de la Défense et de l’Intérieur, et assure la direction de tous les services publics locaux. Le nouveau vizirat de la justice est chargé de tout ce qui se rapporte à l’administration de la justice « indigène », au culte, au haut enseignement musulman et à la propriété immobilière. Le vizirat des Habous a la charge de la gestion des fondations pieuses. Le Sultan garde ses prérogatives sur le plan religieux et sur la communauté marocaine. Il est aidé par son grand vizir dont toutes mesures ou décisions doivent être en accord avec les vues du Résident Général ou un de ses collaborateurs. La mise en place du Protectorat participe à la sédentarisation du Sultan dans une des villes impériales. Sont considérées comme telles, les cités de Fès, Meknès, Marrakech et Rabat, car elles possèdent un palais royal au sein de leur périmètre.
La signature du Protectorat éveille un élan de protestation et de violence au sein du Maroc. Fès s’insurge le 17 avril 1912. Les officiers français présents sont massacrés, tandis que la ville est assiégée par les tribus berbères récalcitrantes à la tutelle française. Moulay Adbelhafid ne fait rien pour apaiser les revendications. Il laisse les Français rétablir l’ordre petit à petit. La désorganisation soudaine du Royaume chérifien déconcerte le pouvoir français d’autant plus que le nouveau Résident Général n’a pas encore été nommé. Le ministère des Affaires étrangères français dépêche d’urgence le général Hubert Lyautey (1854-1934), alors en garnison à Rennes, afin de trouver des solutions à cet imbroglio. Fort de son expérience aux frontières algéro-marocaines en 1906-1907, il est alors la meilleure personne à envoyer sur le territoire marocain pour représenter la République française. Lyautey, investi de sa charge depuis le 28 avril, débarque à Casablanca le 13 mai pour rejoindre Fès le 24. Le Résident Général organise dès lors la défense de la ville avec la collaboration du général Henri Gouraud (1867-1946). Dès la mi-juin, il prend la direction de Marrakech et du Souss afin de pacifier les régions occupées par les insurgés en prenant appui sur l’aide militaire des grands caïds du Sud. Les relations entre Moulay Abdelhafid et Hubert Lyautey sont assez mauvaises. Le Sultan, ne voulant pas être le jouet de la politique française, refuse de signer des dahirs (lois) instituant les nouveaux services administratifs ou modifiant les anciens. Il répond aux remontrances du Résident Général par la menace de son abdication qui a finalement lieu le 12 août 1912. Le 13, le Maghzen, réuni au palais impérial de Rabat, institue le demi-frère de Moulay Abdelhafid, Moulay Youssef Ben Hassan (1881-1927), comme nouveau Sultan. Cette investiture favorise la pacification du pays, du moins à l’Est, au nord de Fès et dans la région de Marrakech.
La création du Protectorat français est un des facteurs qui incite la venue des artistes au Maroc. Les territoires du pays sont plus facilement accessibles grâce à la présence militaire qui sécurise les principales voies de communication. Les villes impériales s’offrent enfin à la contemplation des plasticiens même si la Résidence générale interdit l’accès des lieux de culte et d’apprentissage de l’Islam aux non-musulmans. Les artistes peuvent donc à loisir croquer sur le vif et en public les édifices et les populations de ces cités et déployer tout leur talent pour les transposer sur leurs toiles ou en sculptures. L’organisation administrative du Protectorat nécessite une multitude de fonctionnaires dont la présence dans les villes impériales demande l’édification de nouvelles agglomérations en annexe, explicitement adaptées aux commodités européennes, mais qui gardent le cachet originel des médinas adjacentes. Le Maroc est donc un pays en construction qui sollicite une main-d’œuvre artistique non seulement pour l’architecture, mais aussi pour le décor des intérieurs, tâche à laquelle les peintres peuvent s’atteler aisément. Les plasticiens sont aussi des relais pour la propagande coloniale. Leurs œuvres servent à véhiculer les beautés du Maroc via les expositions artistiques organisées par les différentes sociétés artistiques existantes en métropole, mais aussi au Maroc, grâce notamment au Salon de Tanger.
Le traité de Fès partage donc le Maroc en trois zones : une zone espagnole dont la capitale est Tétouan ; la petite zone de Tanger enclavée dans la zone espagnole ; la zone française, dans le reste du pays, dont le siège est à Rabat24. Ces trois espaces restent sous la souveraineté théorique du Sultan, mais Tanger, en raison de la présence ancienne des consuls et d’une population cosmopolite, jouit d’un régime de neutralité internationale. Un statut définitif est l’objet de longues négociations, en particulier entre l’Espagne, la France et la Grande-Bretagne, jusqu’à la convention du 18 décembre 1923. Ce nouvel accord instaure alors un gouvernement collectif, représentant les grandes puissances, qui s’exerce par l’intermédiaire d’une assemblée législative, d’un comité de contrôle chargé de vérifier l’application des traités et d’une administration internationale, tandis que le Sultan est représenté par un délégué. Malgré quelques amendements, le statut international est maintenu jusqu’à l’indépendance du Maroc.
Le nouveau statut de Tanger n’empêche aucunement l’évolution du Salon artistique de la ville, bien au contraire, puisqu’en 1913, la manifestation est installée dans les salles du Syndicat international du Tourisme. Les membres-organisateurs souhaitant faire venir des peintres et sculpteurs européens d’Algérie s’adressent alors à la Société des artistes algériens orientalistes pour les aider dans le recrutement. En échange, les membres de cette association, désirant venir au Salon, ont leurs frais d’emballage et d’expédition de leurs œuvres pris en charge par le comité responsable de la manifestation tangéroise qui prélève, en revanche, vingt pour cent sur les ventes des toiles et sculptures envoyées25. Interrompu durant la Première Guerre mondiale, le Salon de Tanger reprend de plus belle à partir de 1923 sous l’égide du Cercle privé d’Escrime. Lors de cette manifestation, les nombreux exposants sont de nationalités française, italienne, anglaise et américaine : Louis Pastour (1876-1948), Marie Campardon, M.P. Mesple, Hélène Rivière (1895-1977), M. Soudon, Édouard Herzig (1860-1926), Nicolo Brentono, Henrietta Moodie Vickers (1870-1939), Gertrude Gwendolyne Scott (1878-1961), Dirk Jansen (1878-1952), Françoise Molle, Dario Villares Barbosa (1880-1952), Jacques Majorelle (1886-1962), Maurice Bouviolle (1893-1971), Gordon Coutts (1869-1937), François de Marliave (1874-1953), le Dr David Donald, Helen Wilson (1873-1924), M. Paryse, James Povedano et Mme Wild. L’ensemble de ces artistes présentent quatre cents œuvres dont une partie de leur vente rapporte quinze mille francs.
En 1924, le Salon prend de plus en plus d’importance avec la participation d’artistes venus d’Alger, de Marrakech, de Paris et de Toulouse, car un jury attribue enfin des prix. Le quotidien Al-Moghreb Al-Aksa, du 5 avril 1924, liste l’ensemble des bénéficiaires des récompenses lors de ce Salon : Gordon Coutts a obtenu le Rappel de Prix d’honneur et José Cruz Herrera (1890-1972), le Prix d’honneur. Paston, Édouard Herzig et Dirk Jansen ont obtenu les médailles d’or, tandis que Mattéo Brondy (1866-1944), Françoise Molle, René Bénézech (?-1945), David Donald, Helen Wilson, Ruth Benthall (1898-1949) et Gordon Coutts ont reçu les médailles d’argent26. Le succès de cette dernière manifestation encourage les organisateurs à la réitérer chaque année à la même période. Le Salon tangérois devient donc annuel. Il permet ainsi d’accroître l’affluence d’artistes de tout style comme les fauves Henri Matisse (1869-1954) et Albert Marquet (1875-1947) dont les séjours s’échelonnent entre 1911 et 1913. Pour ces peintres, le Maroc est une source de renouvellement et de maturation dans la recherche de la lumière et des couleurs. Ils exposent leurs œuvres au sein des sociétés artistiques françaises les plus importantes.
La Société des peintres orientalistes (1893) avec la Société coloniale des artistes français (1906) accueillent lors de leur salon annuel respectif l’essentiel des artistes peignant au Maroc. Ces premières sociétés artistiques dévolues aux peintres et sculpteurs voyageant dans les colonies font des émules en Afrique du Nord. Des associations de ce genre y éclosent afin de faire valoir les œuvres des artistes résidant au Maghreb. En Tunisie, l’Institut de Carthage, créé en 1890, devient la principale organisation culturelle au service de la communauté française, en inaugurant, en 1894, un Salon tunisien. En Algérie, dès 1897, la Société des peintres orientalistes algériens est fondée dans le même esprit. L’affluence des artistes européens est encore plus grande grâce à la création en 1907 de la villa Abd-el-Tif à Alger. Cette institution accueille des peintres, après l’obtention d’une bourse annuelle à la Société des peintres orientalistes, pour une période d’un an afin qu’ils puissent retranscrire les beautés du pays. Ce concept est aussi envisagé pour le Maroc. Dès les premiers mois de l’année 1914, le Duc de Trévise (Édouard Mortier), De Vilmin, Léon Bonnat (1833-1922), Alfred Micié, Georges Clairin et Léonce Bénédite (1859-1925) envisagent la création de la Fondation Henri Regnault à Tanger. Mais, la déclaration du conflit européen, en août 1914, balaie tout espoir de réalisation de ce projet qui n’est pas repris en 191827. Toutefois, le rapprochement de la Société des peintres orientalistes avec la Résidence générale permet l’ouverture, en 1917, au pavillon de Marsan au Louvre, d’une exposition consacrée à l’art marocain. Cette manifestation est divisée en deux sections : l’une est réservée à l’artisanat local et l’autre à la peinture du Maroc. Les auteurs de ces toiles sont pour la plupart des orientalistes mobilisés au Maroc ou des peintres définitivement installés là-bas. Joseph de la Nézière (1873-1944), peintre travaillant pour le Service des antiquités, Beaux-arts et monuments historiques au Maroc, présente trois œuvres : Retour de fantasia, Rabat, le Matin et Le marché aux poteries28. Ses tableaux résument bien l’exposition. Rabat, capitale du pays, est aussi une cité impériale tout comme Fès, Meknès et Marrakech. Le marché aux poteries fait référence à l’artisanat présent dans l’exposition. La fantasia rappelle les coutumes ancestrales du pays. Ces courses équestres ont été très souvent peintes. L’artiste orientaliste Alfred Dehodencq en a exécuté de nombreuses. Le thème est aussi repris par Charles Duvent (1867-1940) et Suzanne Crépin (1880-1956). Quant à Jules Galand (1882-1924), il se distingue des autres artistes par la présentation d’œuvres sur bois où les vues de villes sont gravées au canif telle que Kasbah des Oudaïas à Rabat.