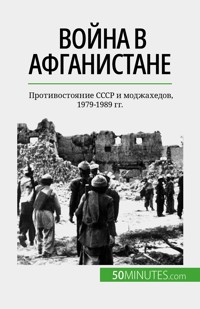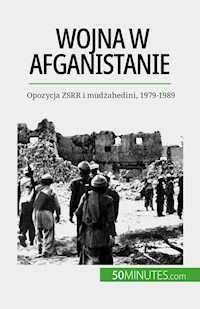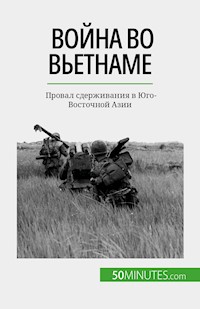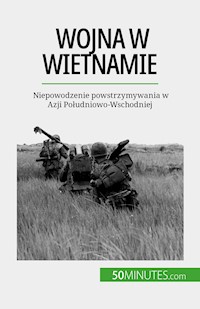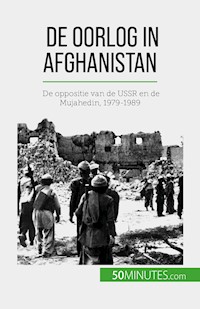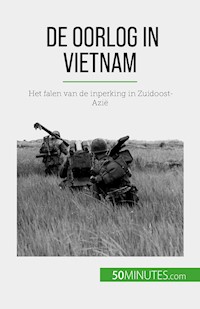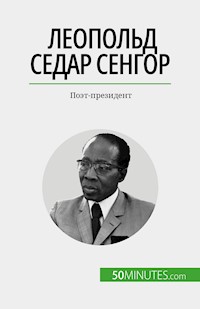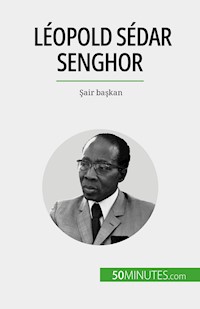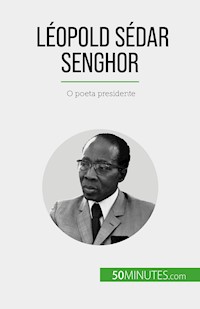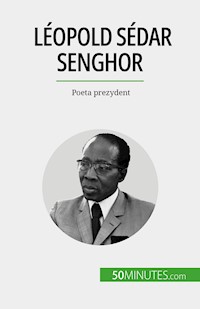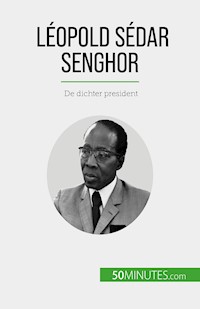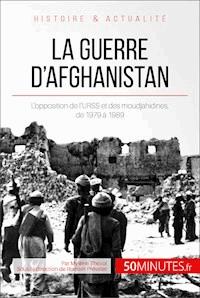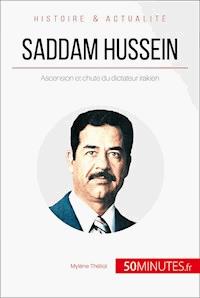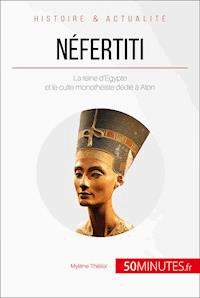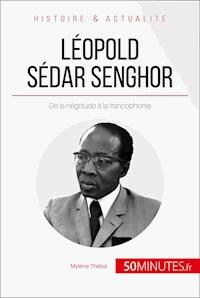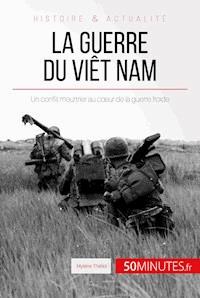Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
La préservation des villes impériales marocaines durant le Protectorat met en exergue l’importance de l’architecture, des monuments historiques et de l’urbanisme dans la sauvegarde des cités impériales marocaines pendant la période du Protectorat. Les efforts importants mis en œuvre témoignent de l’attachement du Maroc à son inestimable patrimoine culturel, avec les bâtiments symboliques et les médinas scrupuleusement conservés pour les générations à venir.
À PROPOS DE L’AUTRICE
En tant que docteure en histoire de l’art contemporain, experte en orientalisme, en patrimoine et en art marocain du XXe siècle, Mylène Théliol fait ressortir sa maîtrise du sujet dans cet ouvrage de référence. Elle manifeste ainsi son dévouement pour la préservation du riche patrimoine culturel marocain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mylène Théliol
La préservation des villes impériales marocaines durant
le Protectorat
Essai
© Lys Bleu Éditions – Mylène Théliol
ISBN : 979-10-422-0242-2
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Introduction
La notion occidentale de protection du patrimoine, telle qu’elle est définie au XIXe siècle 1en France, n’a pas été introduite au Maroc avant l’instauration du Protectorat français2. Pendant la période ante-coloniale, les édifices prestigieux liés au culte de l’Islam ou au pouvoir royal sont régulièrement entretenus grâce à l’initiative des différents Sultans Alaouites. Ces derniers ont gardé, jusqu’au milieu du XIXe siècle, les portes de leur royaume closes aux Européens. Le changement s’opère sous le règne du Sultan Moulay Abd el Rahman (1822-1859). Inquiet de la mise sous tutelle de l’Algérie par la France en 1830, le roi du Maroc prend position en faveur des résistants à la colonisation française. Cette attitude belliqueuse est vite neutralisée par la France qui, en 1844, envoie sa marine bombardée les deux grands ports marocains, Tanger et Mogador. Ces derniers sont pris d’assaut et une confrontation militaire franco-marocaine a lieu à Isly, près de la frontière algéro-marocaine. L’issue de ce combat est désastreuse pour le Sultan. Il prend conscience que son pays n’a pas les moyens techniques et militaires de s’opposer à une armée occidentale. Pour remédier à cette faiblesse, il doit donc moderniser son pays et par conséquent l’ouvrir aux influences commerciales et marchandes européennes. Ainsi, il signe, le 9 décembre 1956, le traité de Tanger avec l’Angleterre concernant le commerce et la navigation entre les deux pays. Le Sultan fait de même avec l’Espagne en 1860. La pénétration européenne en terre chérifienne devient donc inéluctable. Des transformations économiques et sociales du pays sont alors engagées. Les ports de Tanger et Mogador sont développés ainsi que Mazagan et la toute nouvelle plaque tournante du commerce maritime, Casablanca. Ces quatre villes drainent alors l’essentiel du trafic maritime entre l’Europe et le Maroc. Ces cités portuaires voient affluer non seulement des marchandises, mais aussi des Européens (Anglais, Espagnols, Français, Italiens et Portugais) cherchant à faire fortune dans le pays chérifien3. Cette présence européenne s’accentue au Maroc avec l’installation de missions religieuses ouvrant des écoles et des hôpitaux, l’apparition de publication de journaux occidentaux, l’implantation de banques et entreprises européennes, ainsi que l’essor des télécommunications4. Cette pénétration européenne au Maroc est aussi l’apanage des artistes français, britanniques et espagnols qui suivent les voies commerciales et diplomatiques pour découvrir le pays. Sous le règne de Moulay Abdelaziz (1878-1943) entre 1894 et 1908, le Maroc passe sous influence occidentale, notamment espagnole et française, à partir de la conférence d’Algésiras en 19065. Des artistes et des photographes européens, notamment français, sont alors invités à la cour du Sultan, tandis que des voyageurs explorent les régions encore inconnues. Leurs récits révèlent une image du Maroc différente de celle des deux autres pays du Maghreb tes que l’Algérie et la Tunisie où les Français se sont installés. La colonisation militaire de ces territoires a été accompagnée par un transfert des pratiques politiques et culturelles métropolitaines et notamment du processus de sauvegarde des monuments historiques6. Dans un premier temps, les classements d’édifices se sont focalisés sur l’architecture et les objets d’art romains. La protection des antiques est cependant suivie, au début du XXe siècle, par la reconnaissance de l’architecture arabo-musulmane.
L’instauration du programme de préservation des monuments marocains est avant tout un acte politique délibérément pensé par le premier Commissaire Résident général du Protectorat, Hubert Lyautey (1854-1934). Cet homme a su mettre à profit les expériences françaises, algériennes et tunisiennes et les adapter au Maroc, tout en s’entourant d’hommes capables de réaliser ses projets. Cette politique patrimoniale a une longévité exceptionnelle, cependant elle évolue au gré des perturbations idéologiques, économiques et sociales du régime colonial. Le Maroc, dépendant de la France dans sa politique extérieure, est aussi sensible aux innovations conceptuelles européennes en matière de préservation des monuments historiques. Le dialogue entre les deux demeure constant durant les quarante-quatre années de tutelle française. Si l’étude historique de la patrimonialisation des villes impériales est donc envisagée, il est aussi intéressant de s’interroger sur les procédés de conservation ainsi que sur les méthodes, les techniques et les matériaux employés. Sont-ils les mêmes qu’en France, qu’en Algérie ou qu’en Tunisie ? Ou bien sont-ils inédits ? Les conditions de mise en valeur des monuments historiques et de l’urbanisme marocain sont également des notions à prendre en considération. Sont-ils simplement mis en scène dans un but esthétique ou bien dans un but touristique ? Y a-t-il eu une interaction entre la patrimonialisation du Maroc et la mise en tourisme du pays ? Des études récentes, concernant la création des villes françaises jouxtant les cités arabo-musulmanes, ont bien montré le lien architectural qui existe entre les deux agglomérations. Les villes marocaines déterminent leurs voisines qui, à leur tour, offrent une image bien caractéristique de leurs consœurs7.
Afin d’étudier le processus complexe de patrimonialisation au Maroc, il nous a semblé plus approprié de réaliser une approche chronologique. La sauvegarde des villes impériales et des monuments historiques a été décidée dès 1912 et toutes les mesures les concernant sont mises en place avant la fin du mandat de Lyautey (1912-1925). Elles servent de références jusqu’à la fin du Protectorat, mais aussi après l’indépendance du pays. Il a été impossible de traiter l’historique du programme patrimonial indépendamment de l’étude des méthodes de préservation puisqu’ils sont intimement liés. Des dates clés de l’histoire du Maroc servent à la division du discours en cinq parties. Les deux premières analysent les causes et les conséquences de la création du programme patrimonial au Maroc de 1912 à 1945. Elles sont marquées par la pensée de Lyautey et la politique menée par ce dernier dans les treize premières années du Protectorat. La troisième partie est exclusivement réservée à l’étude de la préservation du tissu urbain des cités médiévales (médinas) et des rapports architecturaux et esthétiques que ces villes entretiennent avec les nouvelles agglomérations françaises. La fin de la Seconde Guerre mondiale apporte son lot de changements, notamment dans le traitement de l’urbanisme marocain. Comment alors sauvegarder et maintenir en place le patrimoine des villes marocaines face aux développements intenses des zones d’habitat modernes issues d’un système architectural et urbanistique fonctionnel ? Ces points sont abordés dans la quatrième et la cinquième partie de l’ouvrage.
Outre une étude historique du processus de patrimonialisation, ce découpage fait aussi apparaître les différentes étapes de dépossession des Marocains du droit à décider du devenir de leurs monuments et villes, au profit de l’administration coloniale. Cette dernière a su créer une politique patrimoniale atypique qui remodèle l’identité marocaine à l’occidentale tout en lui imposant un visage traditionnel, voire folklorique. Cette transformation a encore des répercussions visibles à notre époque, singularisant le Maroc de l’Algérie et de la Tunisie.
Chapitre I
La mise en place de la politique de patrimonialisation au Maroc
La nomination d’Hubert Lyautey, le 27 avril 1912, au poste de premier Commissaire Résident général du Protectorat français, engendre de nombreux changements au Maroc. Ce dernier envisage une réorganisation militaire, économique et administrative du pays dans laquelle la sauvegarde du patrimoine architectural et urbain prend une place prépondérante. Lyautey considère cette mise sous tutelle comme bénéfique et devant être de courte durée. Elle doit permettre de faire retrouver au pays chérifien sa puissance d’antan.
Les préceptes de gouvernement de Lyautey puisent dans les théories de Jean-Louis de Lanessan (1843-1919), l’ancien gouverneur général de l’Union de l’Indochine (1891-1894), qu’il a côtoyé de novembre 1894 à janvier 1895 durant son séjour militaire au Tonkin (1894-1898). Auprès de cet homme, il a appris les principes de la politique de Protectorat qui a été mise en forme dans l’ouvrage La colonisation française de l’Indo-Chine, paru en 1895. Trois grandes règles fondamentales de gouvernement sont développées.
La première règle à suivre dans le gouvernement des colonies est le respect absolu des croyances et des pratiques religieuses des indigènes. […] La seconde règle qui s’impose à la colonisation moderne découle de la première ; elle consiste à respecter les institutions sociales des peuples colonisés. […] La troisième règle de la colonisation moderne […] consiste à utiliser autant que possible l’organisation administrative et politique locale dans le double but de diminuer les dépenses et de gagner les sympathies des autorités et du pays8.
Il s’initia à cette théorie aux côtés du colonel Joseph Gallieni (1849-1916) lors de la guerre coloniale aux frontières de la Chine et du Tonkin. Lors de son séjour à Madagascar (1897-1902) et à Oran (1908-1912), il eut à appliquer ses méthodes basées sur les principes de pacification, d’administration indirecte et de politique de mise en valeur9. Ce sont ces mêmes préceptes qu’il emploie alors au Maroc dès 1912.
En plus d’être un administrateur, Hubert Lyautey est un orientaliste : il côtoie les cercles artistiques de ce mouvement. Ses voyages ont aguerri sa sensibilité aux arts asiatiques, africains et arabo-musulmans. Il est aussi un collectionneur d’objets d’apparat ayant un caractère religieux, politique et militaire. Du Maroc, il a ramené, dans son château à Thorey-Lyautey, hormis des fusils et des selles de cheval pour la fantasia, des textiles, des céramiques, et du mobilier de très bonne facture qui forment son salon marocain. Certaines de ces créations artisanales sont uniques et d’autres ont été copiées d’après des modèles anciens. Cette collection résume à elle seule les objectifs qu’il a entrepris pour l’art marocain : le protéger et le rénover.
En 1912, le pays chérifien préserve encore tous ses trésors. Les architectures et les villes gardent leurs caractéristiques artistiques des siècles antérieurs malgré quelques altérations européennes dues à une présence de plus en plus accrue depuis 190710. La volonté de protéger les édifices, les cités et la religion islamique incite le Résident à créer, dès la première année du Protectorat, un dispositif administratif et législatif relatif à la conservation des monuments historiques. C’est à travers cette constitution et son application que se met en place une reconnaissance d’une certaine identité culturelle marocaine. Cependant, celle-ci reste conditionnée à une pensée française, voire européenne, du monument historique.
La colonisation n’est pas uniquement politique, elle entraîne un déplacement et une implantation de populations étrangères. Dès la nomination de Lyautey, les Français ne sont pas autorisés à s’installer dans les villes marocaines. De nouvelles agglomérations sont créées uniquement pour eux. Cependant, le désir du Résident de ne pas dénaturer les villes existantes impose toute une procédure de mesures et de règlements urbains contraignants pour les nouvelles agglomérations. La théorie de conservation et de modernisation du Maroc prend alors tout son sens dans cette politique patrimoniale.
1. Les mesures patrimoniales algériennes, tunisiennes et européennes comme source d’inspiration pour le Maroc
La première loi concernant les monuments historiques est homologuée par le dahir du 26 novembre 1912. Inaugurant la construction patrimoniale du Maroc, elle porte sur la protection des vestiges du passé qui touche à l’histoire de l’empire marocain ainsi que les choses artistiques qui contribuent à son embellissement11. Cette loi est divisée en quatre parties. La première concerne les monuments antérieurs à l’Islam et ceux des six dynasties musulmanes. La seconde partie traite des inscriptions historiques, la troisième, des objets d’art et d’antiquité et la dernière, des fouilles archéologiques. Ce premier dahir, définissant déjà les types d’objets à conserver et à classer, est complété par celui du 13 février 1914. Il s’inspire de la loi italienne dite « Édit Pacca » et de la loi tunisienne qui ont toutes les deux de si heureux effets pour la conservation du patrimoine artistique en Italie et au sein de la Régence. Les dispositions du décret beylical concernant le classement des immeubles appartenant à des particuliers ou des personnes morales ont été adoptées de préférence à celles de la loi française du 30 mars 1887. D’après celle-ci, le classement d’un immeuble appartenant à un particulier ne peut résulter que d’un contrat passé entre l’État et ce dernier.
Cette disposition qui donne lieu en France à de nombreuses difficultés eût été très difficilement applicable au Maroc où la propriété est si mal définie. Le classement d’office de la législation tunisienne a donc été adopté, mais les garanties données aux propriétaires ont été augmentées par l’organisation d’une publicité beaucoup plus largement inspirée de celle édictée par la réorganisation du régime foncier. Les dispositions de la loi tunisienne concernant les fouilles et la conservation des objets mobiliers, qui ne fait pas l’objet d’un classement impossible à l’heure actuelle, mais dont l’exportation hors des limites de l’Empire est interdite, ont été conservées. Enfin, le dahir organise, ce qui n’était pas prévu par la loi tunisienne, le classement des sites et monuments naturels et de zones de protections soumises à des servitudes particulières autour des monuments historiques12.
Dans son rapport du 31 juillet 1914, le général Hubert Lyautey résume les lignes directrices du dahir du 13 février 1914 ainsi que les diverses lois dont il s’inspire. Il fait peu mention de la législation française, mais il accorde une place importante à celle de la Tunisie. En démontrant volontairement les origines de la loi marocaine, le Résident accentue encore l’idée de parallélisme avec le premier Protectorat français au Maghreb. Cette filiation est déjà visible dans le traité de Fès. Les principes fondamentaux de la législation marocaine sont liés aussi bien aux lois françaises et tunisiennes qu’à l’engouement orientaliste pour les monuments arabo-musulmans.
1.1. La loi française de 1887 et ses conséquences en Algérie
La création en France, dès 1837, du Service des monuments historiques a permis la prise en charge par l’État d’une reconnaissance d’édifices ayant un caractère historique et artistique permettant la sauvegarde d’une expression de la civilisation nationale et universelle. L’examen du projet de la loi Bardoux de 1878 recommande que l’État n’intervienne en faveur que d’un nombre restreint de monuments ou d’objets importants pour que leur conservation soit d’intérêt national13. On ne conserve bien que les monuments et objets qui présentent une utilité actuelle, c’est-à-dire qui servent à satisfaire les goûts et les besoins de la génération présente14. La notion maîtresse qui se détache de cette norme est celle d’exemplarité. Seuls certains spécimens permettent de se faire une idée de l’ensemble de l’espèce disparue. La loi sur la conservation des monuments historiques, promulguée le 30 mars 1887, relève de cette notion de typologie d’édifices. Composée de quatre chapitres divisés en dix-sept articles, elle est entérinée par le décret présidentiel du 3 janvier 1889. Cette loi distingue les immeubles et les objets mobiliers appartenant à l’État, à un département, à une commune, à la fabrique ou à tout autre établissement. La question du classement et de la conservation des objets mobiliers est déterminée par le ministère de l’Instruction publique. En ce qui concerne les fouilles, la législation assure la conservation des objets découverts sur des terrains appartenant à l’État, à un département, une commune ou à tout autre établissement public. Elle prévoit l’expropriation pour cause d’utilité publique, après l’avis de la Commission des monuments historiques, concernant des terrains appartenant aux particuliers où ont lieu des découvertes intéressantes. La loi est aussi applicable en Algérie et dans tous les pays sous Protectorat français qui n’ont pas de législation spéciale15. Cette clause a été particulièrement défendue par Agénor Bardoux (1829-1897), rapporteur de la loi devant le Sénat, qui signalait la destruction massive d’œuvres d’art au Maghreb16.
En Algérie, l’application de la loi a permis de classer des architectures arabo-musulmanes ayant un caractère historique et artistique prononcé. Cette législation concorde avec la création, en 1880, d’une Commission des monuments historiques, dont le rôle essentiel consiste à coordonner l’organisation et la direction des travaux de fouilles et de restaurations. Ces activités touchent particulièrement les édifices romains et les monuments arabo-musulmans majeurs qui ont marqué l’Algérie. Ainsi, en 1898, les établissements inventoriés sont au nombre de quarante. Huit se situent à Alger, un à Oran, un à Bougie et un autre à Biskra. Les trente-deux autres appartiennent à la cité de Tlemcen qui a été la première des villes à retenir l’intérêt de la Commission des monuments historiques français17. Le 14 mai 1872, l’arrêté du ministre de l’Instruction publique, des beaux-arts et des cultes envoie l’architecte, Edmond Duthoit (1837-1889), en mission en Algérie afin d’étudier et de dessiner les monuments arabes pour mieux connaître leur état de conservation et leur possibilité de restauration18. Cet inventaire des édifices arabo-musulmans est accompli en trois mois dans les régions d’Alger et d’Oran, mais la ville de Tlemcen et ses environs retiennent particulièrement son attention19.
Cette cité se compose de deux parties distinctes : Tlemcen de la dynastie des Abd el Wadites et Mansourah, fondée par les sultans mérinides du Maroc. Ces derniers, lorgnant toujours vers la capitale des Beni Zeïyan20, ont dirigé périodiquement des attaques contre elle. Les premières offensives commencèrent dès l’année 1299. À partir de cette date, se construisit petit à petit le camp de Mansourah qui s’érigea vite en ville due à une occupation permanente des armées marocaines. Enfin, le 1er mai 1337, le Sultan Abou al Hassan prit d’assaut Tlemcen après un siège de deux ans. La cité passa sous le contrôle de la dynastie Zenatienne, alliée des Marocains pendant vingt-cinq ans. Durant cette période, sont érigées autour de Tlemcen trois annexes architecturales : Mansourah, Sidi Bou Medine et Sidi el Halwi. En 1559, la ville retrouva le gouvernement des sultans Abd el Wadites, mais la présence marocaine avait déjà modelé la ville21. Les édifices répertoriés y sont identiques à ceux de Fès, la capitale des Mérinides. Cette constatation architecturale est faite lors de la mission d’étude à Tlemcen entre mai et juillet 1902 par l’orientaliste arabisant William Marçais (1872-1956). Un livre, publié l’année suivante, argumente les analyses réalisées sur le terrain22.
Quand Edmond Duthoit se retrouve face aux monuments, il ne connaît pas leur histoire, il remarque seulement que les plans et les décorations sont différents et très raffinés par rapport aux autres villes algériennes. Il en effectue l’étude précise et leur restauration. Il sélectionne les plus beaux bâtiments, afin de les faire figurer dans les archives de la Commission des monuments historiques, tels que la mosquée Sidi Boumediene et ses dépendances, la mosquée Sidi El Halouy, le mihrab et la maqsurah de la grande mosquée, la porte de la médersa Tachfinya et la mosquée, ainsi que le minaret de Mansourah23. L’architecte conceptualise, à partir de tous ses relevés, une catégorisation par style.
Cette typologie permettant de résumer une évolution d’un courant artistique est présente dans la première loi marocaine du 26 novembre 1912. Lyautey reprend les mêmes objectifs que Duthoit en faisant classer les édifices religieux (mosquées, zaouïat et médersas) les plus représentatifs de l’art des différentes dynasties marocaines. Pour les remparts et les portes des villes, il renforce le firman de Moulay Youssef du 1er novembre 1912, assurant la protection des murailles des vieilles villes et les sites avoisinants en les grevant de servitude militaire24. L’article premier du dahir du 26 novembre 1912 prévoit aussi le classement des vestiges antiques et les enceintes et dépendances des palais des anciens Sultans comme dans la législation tunisienne.
1.2. L’influence des législations tunisiennes et européennes sur la législation marocaine
Les résolutions concernant la protection des édifices maghrébins, projetées dans le quatrième chapitre de la loi de 1887, sont devancées par le Bey de Tunis. Celui-ci prend ses propres dispositions législatives relatives à la propriété et à la conservation des antiquités, des monuments et des objets d’art en promulguant le décret du 7 mars 1886. Ce dernier insiste surtout sur la notion de propriété. Les objets archéologiques trouvés sur le sol tunisien appartiennent à l’État. Il faut son accord pour les détruire ou les exporter.
Les décrets du 8 mars 1885, du 25 mars 1885 et du 12 janvier 1886 organisent le Service des antiquités et des arts qui est chargé d’appliquer la loi beylicale et de former au Bardo un musée afin de recueillir les œuvres antiques découvertes dans les fouilles des sites romains25. Si l’archéologie monopolise davantage les investigations tunisiennes, l’art arabo-musulman commence à intéresser. L’inauguration du Musée Alaoui, le 7 mai 1888, dans l’ancien harem du Bey Mohamed au Bardo, permet l’étude de son architecture et de sa décoration ainsi que de sa protection. En effet, des ateliers sont installés au sein même des locaux afin de reproduire des œuvres d’art comparables à celles des périodes antérieures.
Le premier édifice classé, en 1891, est un pavillon mauresque composé de cinq coupoles à arcades soutenues par des colonnes en marbre blanc et dont l’ornementation intérieure est formée de stucs ouvragés et de carreaux de faïences. Ce monument est représentatif de la décoration tunisienne du XVIIIe siècle. Il est transplanté dans le jardin du Belvédère à Tunis en 1901. Cette même année, la direction des Antiquités procède à la restauration du mausolée de Kara-Mustapha Dey à Tunis ; le petit édifice à coupole, datant de 1131 de l’hégire (1753), est richement orné de stucs ajourés et de faïence. Il constitue un spécimen typique de l’architecture funéraire du début du XVIIIe siècle26.
Le décret du 13 mars 1912, classant les immeubles à titre de monuments historiques, offre une liste assez généreuse d’édifices arabo-musulmans. Ils sont éparpillés dans trois grandes villes tunisienne : Tunis, Sfax et Kairouan. Les bâtiments énumérés sont des mosquées, des médersas27, des zaouïat (sanctuaires), des portes d’enceintes28, et les tourbets29 (mausolées). L’article 2 du décret éclaire sur cette catégorisation des édifices historiques et artistiques en insistant sur leur caractère habous. Cette notion encore vivace au Maroc impose une législation des monuments historiques adaptée.
1.3. Les Habous
Les Habous sont des donations d’usufruit faites à perpétuité au profit des pauvres, des établissements pieux, mosquées, médersas, hôpitaux, zaouïat ou des dons d’utilité générale. Les fonds versés par le donateur restent en sa propriété, mais ceux-ci sont inaliénables et demeurent séquestrés pour assurer leur attribution aux bénéficiaires. En Tunisie, la réforme de l’institution est réalisée avant le Protectorat, sur la proposition du général Kheireddine Pacha, le Premier ministre du Bey. Le décret du 19 mars 1874 crée la Djemaï’a des Habous. Placée sous l’autorité du Premier ministre, elle se compose d’un président, de deux membres et de deux secrétaires-notaires. Sa mission est d’exercer un contrôle absolu sur tous les gestionnaires des Habous publics, les oukils, qui sont élus dans chaque caïdat, par le caïd (gouverneur) et les notables du lieu. La Djemaï’a doit aussi surveiller la gestion des Habous des zaouïat. Contrairement à l’Algérie, le Protectorat tunisien maintient cette organisation30. Il la complète par la création, le 17 juillet 1908, d’un conseil supérieur des Habous, chargé de la haute tutelle, afin d’administrer plus efficacement les fondations pieuses31 dont la plupart sont classés comme monument historique.
L’article 3 du dahir marocain du 26 novembre 1912 précise que : Tous ceux des immeubles classés appartenant au Makhzen, telles que les ruines de villes anciennes, les forteresses et remparts, les palais de nos prédécesseurs et leurs dépendances, etc., ainsi que toutes les mosquées, koubba, médersas, etc., ayant un caractère habous public, seront inaliénables et imprescriptibles tant qu’ils n’auront pas fait l’objet d’un décret de classement32. La préservation de ce type d’édifices est aussi indiquée dans le traité de Fès, notamment dans l’article premier. Ce régime sauvegardera la situation religieuse, le respect et le prestige traditionnel du Sultan, l’exercice de la religion musulmane et des institutions religieuses, notamment celle des Habous33.
Au Maroc, les Habous sont une fondation pieuse créée au XIe siècle dont le but est d’aider les nécessiteux et de gérer le bien public de la communauté musulmane, notamment les édifices publics d’intérêt général comme les lieux de culte (mosquées, zaouïat, médersas), les msids (écoles primaires), les hammams, les fontaines, les égouts, les places publiques, les remparts des médinas, les cimetières et les latrines publiques. Afin d’entretenir ces différents bâtiments, les Habous reçoivent des dons, soit de particuliers, soit du Maghzen lui-même34. Cependant, les Habous ont aussi le droit d’acquérir des terrains agricoles et des immeubles de rapport tels que des commerces, des fondouks et des habitations dans les médinas. L’ensemble de ces biens est loué à des particuliers. Ainsi, les Habous perçoivent des dons en espèce et des loyers de leurs différentes propriétés. Le patrimoine habous est très étendu dans l’ensemble du Royaume chérifien. Dans les quatre médinas les plus importantes du pays que sont Rabat, Fès, Meknès et Marrakech, plus de la moitié des immeubles de rapport et des terrains agricoles leur appartiennent. Les biens habous sont inaliénables et imprescriptibles. Afin d’administrer les édifices publics, les Habous, depuis le XVIIIe siècle, nomment un nadir par ville. Cet administrateur, qui est placé sous l’autorité du cadi et du Sultan lui-même, a la gestion de tous les édifices cultuels comme les mosquées, les zaouïat et les médersas35. En ce qui concerne les mosquées, les nadirs doivent veiller pour que les bâtiments ne se détériorent pas, que les salles de prière soient pourvues d’assez de nattes pour les croyants, que les latrines attenantes aux bâtiments et les fontaines d’ablutions fonctionnent bien et soient propres. Si ces édifices sont en mauvais état, le nadir est chargé de trouver et d’employer des maçons et des charpentiers pour la réparation des murs et des toits. En ce qui concerne les décors architecturaux intérieurs, il fait appel aux divers artisans fassis spécialisés dans l’art du plâtre ouvragé, des zelliges et de la sculpture sur bois. Ces dispositions sont les mêmes pour les réfections ornementales des cours intérieures des zaouïat36 et médersas. Le principal entretien consiste à réparer les toitures, les décors de plâtre, le bois des linteaux et à remplacer les zelliges des piliers.
Outre la gestion des édifices du culte, le nadir est aussi chargé de recruter du personnel pour entretenir les remparts et les portes d’entrée des médinas, les fontaines et les abreuvoirs. En ce qui concerne le nettoyage des égouts, ce sont les moqqadems de quartier qui doivent faire exécuter les travaux37. Le curage est payé par les habitants des immeubles desservis par ces égouts. Le nadir veille aussi à ce que l’alimentation en eau potable des villes se fasse dans les meilleures conditions possibles puisque l’ensemble des sources qui fournissent l’eau appartiennent aux Habous.
Les nadirs jouent donc un rôle primordial puisqu’ils doivent assurer le bon fonctionnement des biens publics. Cependant, leur rôle est de plus en plus décrié au début du XXe siècle et notamment juste après l’instauration du Protectorat français entraînant alors de profondes modifications dans leur organisation. Deux pétitions adressées au Grand Vizir (Premier ministre du Sultan), l’une par les habitants de Rabat, et l’autre, en septembre 1918, par les notables de Marrakech38, déplorent que les mosquées des deux médinas sont mal entretenues. La lettre adressée par trente-trois notables de Rabat au Grand Vizir le 14 janvier 1914 est particulièrement éclairante : Les mosquées sont, depuis quelque temps, en état de délabrement, des réparations y sont nécessaires et notamment aux toits de la grande mosquée que certains nadirs avaient projeté de faire réparer sans jamais donner suite à ce projet39. Ils dénoncent le mauvais fonctionnement des services et la mauvaise répartition des revenus habous. Les revenus des Habous se sont encore accrus avec la location de maisons, la suppression de postes de professeur dans les mosquées et la faible dotation aux nécessiteux […]. Nous avons vu des mosquées dénuées de nattes, d’autres en renferment quelques-unes. La propreté y fait extrêmement défaut et les fonctionnaires sont devenus négligents. La cause est due à l’imprudence des nadirs peu avisés qui se bornent à amasser sans rien donner comme si les revenus des Habous étaient des impôts. Or, les Habous n’en sont pas. C’est une œuvre de bienfaisance et d’assistance publique40. Ces virulentes critiques poussent les autorités, toujours à l’écoute de la bourgeoisie marocaine, à réorganiser les Habous qui vont être codirigés par les Français et certaines de leurs attributions seront données à deux organismes nouvellement créés, la municipalité et le Service des antiquités, beaux-arts et monument historiques.
Ainsi, les Habous sont administrativement réorganisés tout en étant maintenus dans leur cadre traditionnel. Un personnel exclusivement marocain est toujours employé, mais il passe sous le contrôle discret de quelques Français et notamment de Joseph Luccioni (1897-1984) entre 1919 et 1956. Ces modifications répondent à des objectifs précis : elles mettent un terme définitif à la dilapidation du patrimoine habous, observation qui avait été faite lors de l’inventaire des biens habous ordonné par la Résidence et effectué entre 1912 et 191541. Lors de ce recensement, il a été constaté que de nombreux terrains et immeubles appartenant à la communauté musulmane n’existaient plus sur les registres des nadirs. De plus, beaucoup de biens immobiliers (commerces, bains, fondouks, moulins, habitations) et des terrains agricoles et urbains ne rapportaient pas assez d’argent malgré leur valeur. Les nadirs, par négligence ou par consentement, avaient donc permis le développement de nombreuses malversations. Détournement, dissimulation de recettes, exagération des dépenses, destruction de titres et d’archives, tous les moyens leur étaient bons. Certains même, agissant de connivence avec les locataires, les cadis et les représentants locaux du maghzen, se sont approprié une partie des biens confiés à leur garde ; ils en ont vendu d’autres ou ont consenti des baux à long terme incompatibles avec la loi coranique ou même la vente de clé42.
En effet, les locataires ne payaient plus la guelsa ou la gza ou s’insurgeaient contre le prix de ce bail43. D’autres avaient sous-loué leurs commerces ou habitations afin de percevoir plus d’argent. Enfin, le Maghzen, sous les règnes de Moulay Abdelaziz et de Moulay Hafid (1908-1912), avait aussi spolié des terres et immeubles habous pour leur propre compte44. Ainsi, depuis plus de vingt ans, les revenus des Habous, n’étant pas assez importants, ne permettaient plus l’entretien des bâtiments cultuels. Afin de renflouer les caisses de la communauté, la Résidence a effectué de grandes transformations administratives. La première mesure est la création, au sein du Maghzen, de la Direction générale des Habous par le dahir du 30 octobre 1912 qui est ensuite érigée en vizirat par promulgation du décret chérifien du 4 août 1915. Cet organisme a pour but de surveiller et de contrôler la gestion et la comptabilité des biens habous privés, publics ainsi que ceux des édifices du culte45. Le dahir du 27 février 1914, quant à lui, réglemente le système de location des biens habous46. Les commerces, les fondouks, les hammams ainsi que les habitations sont loués aux enchères publiques pour une période de deux ans. Les terrains agricoles et urbains non bâtis, servant uniquement à des travaux de culture, sont affermés aux enchères publiques pour un an seulement47. Avec l’instauration du vizirat des Habous, les nadirs doivent donc s’accorder avec la municipalité et le Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques pour pouvoir effectuer des travaux dans les édifices du culte, sur les remparts et leurs portes monumentales, mais aussi les latrines, égouts et fontaines publiques. Cet état est encore plus accentué lorsque les dahirs de protections artistiques concernant les médinas de Salé, Meknès, Fès et Marrakech sont promulgués entre 1922 et 192348. Outre le changement au sein des Habous, la loi patrimoniale marocaine apporte aussi des transformations en ce qui concerne la gestion des villes marocaines dont certains aspects se retrouvent dans les législations européennes.
1.4. La modernité de la loi marocaine
La loi du 13 février 1914 relative à la conservation des monuments historiques, d’inscriptions et des objets d’art et d’antiquité du Royaume chérifien et à la protection des lieux entourant des monuments, des sites et monuments naturels, complète le dahir du 26 novembre 1912. Elle s’inspire directement de la législation française et italienne. Cependant, la loi française du 30 mars 1887 comporte une lacune. La procédure de classement ne s’applique pas aux propriétés privées. Elle ne concerne que les édifices publics hormis les établissements religieux qui dépendent du ministère de l’Instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Il faut attendre la loi de la séparation de l’Église et de l’État du 9 décembre 1905 pour que ces monuments soient rattachés à la Commission des monuments historiques.
Dans son rapport du 31 juillet 1914, Lyautey insiste sur la nouveauté de la loi marocaine concernant le classement d’édifices privés. Cette disposition est déjà prévue dans la législation italienne de 1909 sur les monuments historiques avec la suppression de la notion de monuments nationaux. Elle englobe sous sa protection tous les biens immobiliers ayant un intérêt au point de vue archéologique, historique ou artistique. Cela comprend des immeubles, des parties d’édifices, un ensemble de bâtiments (place ou quartier urbain) ou encore un jardin, une fontaine, un rocher ou un élément d’infrastructure. Ces biens sont divisés en deux grandes catégories : l’une contient les biens appartenant à l’administration publique, à des personnes morales, civiles ou ecclésiastiques ; l’autre, les biens possédés par des associations privées ou des particuliers49. Cette clause inspire littéralement la loi marocaine de 1914 pour la conservation non seulement des édifices, des quartiers mais aussi de la ville entière.
Le classement de l’immobilier privé est inscrit dans l’article 5 de la loi française du 31 décembre 1913. L’immeuble appartenant à toute personne, autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 [L’État, un département, une commune, ou bien un établissement public], est classé par arrêté du ministre des Beaux-arts, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement. S’il y a contestation sur l’interprétation ou l’exécution de cet acte, il est statué par le ministre des Beaux-arts50.
Cette notion de propriété est édictée plus souplement dans le dahir du 13 février 1914, à l’article 3. Si l’immeuble n’appartient pas à l’État, ce classement peut en être demandé à notre grand Vizir soit, d’une part, par le chef du Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques, soit, d’autre part, par le propriétaire de l’immeuble, s’il appartient à un particulier, ou par le Directeur général des Habous, si l’immeuble est un bien habous, enfin par le service public intéressé51.
L’autre point abordé par le dahir marocain, aux articles 15 à 18, concerne les sites et monuments naturels. En France, cette disposition législative date du 21 juin 1906. La loi autorise la protection des sites et monuments naturels à caractère artistique. Divisée en six articles, elle prévoit la création d’une commission composée du préfet, des ingénieurs des ponts et chaussées, du directeur des Services des eaux et forêts ainsi que cinq membres choisis par le Conseil général parmi les notabilités des arts, des sciences et de la littérature. Ces derniers dressent une liste des différentes propriétés foncières dont la conservation a, au point de vue artistique ou pittoresque, un intérêt général. L’article six applique cette loi à l’Algérie52. La notion de conservation de site naturel est aussi présente dans la loi italienne de 1909. Elle est englobée dans le terme de biens immobiliers. Le texte législatif marocain incorpore aux monuments et sites naturels, les lieux entourant certains monuments historiques dont il est nécessaire de ne pas modifier leur aspect afin de conserver leurs caractères spécifiques. Cette clause résume la volonté personnelle de Lyautey de ne pas toucher à l’apparence générale du Maroc.
Le dahir du 11 février 1916 modifie et complète celui du 13 février 1914 sur la protection et le classement des lieux entourant les monuments, les sites et les espaces naturels. Il est une innovation dans la conception du monument historique. Cette législation est concevable au Maroc, car la plupart des édifices en vue de classement sont encore en service comme les mosquées, les médersas fassies, les zaouïat, les fontaines ou les écoles primaires (msids). Ces bâtiments sont inscrits dans un schéma urbain complexe où il participe à l’animer. Sans vraiment le désigner clairement, le dahir instaure la préservation et le classement du patrimoine urbain mineur, c’est-à-dire des habitations et des édifices de commerce. La législation marocaine n’insinue aucune prédominance de l’art arabo-musulman sur l’art antique. Mais, contrairement à ce qui se passe en Algérie ou en Tunisie, Lyautey donne la prépondérance à l’art islamique. Les antiquités et les édifices portugais restent minoritaires dans l’inventaire des monuments historiques.
2. Le Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques (1912-1945)
La première loi marocaine est accompagnée par la fondation d’un service appliquant les dispositions édictées. L’arrêté de la résidence générale, datant du 26 novembre 1912, fonde au siège du gouvernement du Protectorat marocain, un Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques qui doit exécuter les résolutions du dahir relatif à la protection des monuments historiques et des objets d’art et d’antiquité. Le troisième article de l’arrêté résidentiel précise la pluridisciplinarité que peut avoir à remplir le directeur de ce service. Le chef du Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques pourra être appelé à remplir les fonctions d’architecte conseiller de la résidence générale. En cette qualité, des missions spéciales touchant l’étude des projets de constructions et d’aménagement de bâtiments civils et le classement de nos cités pourront lui être confiés par le gouvernement53.
Par arrêté du 28 novembre 1912, Maurice Tranchant de Lunel (1869-1932) est nommé à la direction du Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques. Cet homme n’est pas choisi au hasard. Architecte et peintre aquarelliste, cet artiste voyageur connaît très bien le Maroc. Son premier séjour date de 1902. Cinq ans après, il y revient pour visiter les villes de Tanger, de Fès et la région de la Chaouïa. Cette même année, il est invité par le Sultan Moulay Abdelaziz à Rabat. En 1911, il est de nouveau à Fès. Le 21 mai 1912, il rencontre le général Lyautey sur la route qui le mène à la capitale culturelle du Maroc. Lyautey, tout juste investi de sa charge de Commissaire Résident général, confie, lors de cette entrevue, la tâche de préserver les monuments marocains54.
Le lendemain, je partais pour Fez, ayant en tête beaucoup d’autres préoccupations que ces casernes, quand, le surlendemain, le hasard me fit rencontrer à mon bivouac un groupe de touristes qui rentraient en France. Je les invitai à partager mon déjeuner sommaire. Or, l’un d’eux était M. Tranchant de Lunel, ancien élève de l’École des beaux-arts, qui avait voyagé en Égypte, en Orient et en Extrême-Orient. Il me parla des beautés de ces pays, que je connaissais presque tous, avec autant de compétence que de goût, puis m’apprit combien le Maroc renfermait encore de trésors d’art et me dit ses appréhensions pour leur sauvegarde. Partageant ses craintes, je le mis au courant de ce que je venais de voir à Rabat. […] Je le priais de ne pas rentrer en France, que je le prenais dès maintenant comme directeur provisoire des Beaux-arts et qu’il allait se mettre à l’œuvre à Rabat dès le lendemain. Il fut pour moi, dans toute cette période du début, pour la sauvegarde des beautés artistiques du Maroc, pour l’adaptation au style du pays des bâtiments administratifs qu’il fallait bien édifier, un auxiliaire inappréciable55.
Entre 1912 et 1914, Maurice Tranchant de Lunel doit s’entourer du personnel du génie militaire afin de mettre en place les premières mesures de recensement des monuments historiques et d’aménagement des médinas, notamment celles de Rabat, devenue capitale administrative en 1913, et Fès, la ville la plus importante du Royaume du Maroc. Cependant, avec la Première Guerre mondiale, le personnel du Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques augmente considérablement et change. Lyautey doit se rabattre sur les territoriaux démobilisés ou demander les blessés du front, car le ministère de la Guerre lui demande un important contingent militaire afin de rejoindre l’armée métropolitaine. Mais, si ses conditions sont réalisées, le Maroc pacifié par Lyautey risque de s’écrouler comme un château de cartes. Aussi la décision du Résident général est tranchée, il garde le pays tout entier avec ses garnisons. Lyautey envoie trente-huit bataillons composés de chasseurs zouaves, de tirailleurs sénégalais, algériens et tunisiens en 1914. Sur les quatre années de guerre, le Résident a réussi à sauvegarder sa main mise sur le pays, seuls six mille militaires ont été envoyés sur les quatre-vingt-huit mille demandés. Les soldats réquisitionnés sont quasiment tous remplacés par des territoriaux venant des provinces françaises56.
Le conflit européen permet ainsi à Lyautey une liberté d’action au Maroc. Débarrassé du contrôle du ministère des Affaires étrangères, il peut enfin réaliser sa propre politique. Son objectif est triple : donner l’impression que la France sera victorieuse, accroître la prospérité de la population marocaine et l’occuper par de grands travaux. Dans cette optique, le Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques est le premier acteur par son rôle de conservateur et de restaurateur des édifices et des médinas marocains. La législation du 13 février 1914 lui sert de talisman pour tout placer sous sa tutelle de protection. Cependant, il lui faut un personnel compétent. Lyautey demande alors principalement des artistes, des architectes, des historiens démobilisés ou blessés qui ont déjà eu une expérience dans les colonies ou dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Après la fin du conflit, des changements internes surviennent au sein du service. Le personnel est de plus en plus sélectionné parmi les agents administratifs et les universitaires.
2.1. Une composition d’artistes (1912-1924)
Aux côtés des architectes Maurice Tranchant de Lunel et Maurice Mantout (1886-1953)57, viennent prendre place au sein de l’équipe du Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques, des peintres, des architectes et des photographes mobilisés. Le premier d’entre eux est Joseph de la Nézière (1873-1944). Ce peintre orientaliste est un voyageur chevronné, il a visité tous les pays de la Méditerranée, ceux de l’Afrique occidentale et les régions de l’Asie du Sud-est. Il a séjourné à Tanger pour la première fois en 1908. En 1914, il est mobilisé au Maroc et est nommé adjoint du directeur du Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques. D’autres artistes sont employés dans ce même service. Presque tous sont des amis de Joseph de la Nézière comme le peintre Henri Avelot58 (1873-1935), l’ingénieur et photographe Jean Rhoné (1871-1933) et l’éditeur Lucien Vogel (1886-1954)59. Trois architectes mobilisés, Georges Beaumet (1887-1980), Léon Dumas (?-1951) et Marcel Rougemont (1890-1965) coopèrent avec Maurice Mantout. En 1916, Maurice Pillet (1881-1964) rejoint cette équipe. Blessé durant les campagnes de Belgique en 1914-1915, il est réformé en 1916. Lyautey le réclame au Maroc pour ses qualités d’architecte et d’archéologue. En effet, il avait été envoyé en mission en Haute-Égypte, entre 1911 et 1912, afin de faire des relevés des tombes de Kasr-es-Sayed, de Deir Rifeh et de Deir Droukeh. Après des voyages au Proche-Orient et en Grèce durant l’année 1912, il a été rattaché à la délégation scientifique en Perse. Il a exécuté le relevé du plan et les restaurations du palais de Darius Ier à Suse60. Nommé inspecteur des beaux-arts de Marrakech de 1916 à 1917, il est le principal collaborateur de Maurice Tranchant de Lunel pour les restaurations des palais impériaux et de la médersa Ben Youssef.
En été 1920, une réorganisation complète du Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques est effectuée. Ce dernier passe sous la tutelle de l’Instruction publique dont le directeur est Georges Hardy (1860-1939), ancien élève de l’École normale supérieure61. Maurice Tranchant de Lunel garde ses prérogatives au point de vue technique en étant nommé inspecteur des antiquités, beaux-arts, monuments historiques et architecte du Protectorat. Il a alors la surveillance de tous les types d’architectures. Les Services du génie militaire, des travaux publics et de l’enseignement lui soumettent leurs projets et leurs travaux dès que la question artistique est en jeu, et reçoivent ses instructions.
Le Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques est divisé en trois grandes sections. Les monuments historiques, palais impériaux, entretien des résidences, construction et aménagement des musées sont tous dirigés par un architecte diplômé résidant à Rabat, Edmond Pauty (1887-1980)62. Dans chacune des villes où se trouvent des édifices classés ou des palais impériaux, il peut employer comme agents d’exécution les architectes du Service des plans de villes après un accord établi avec son directeur, Henri Prost (1874-1959). Prosper Ricard (1874-1952) et Joseph de la Nézière assurent ensemble le fonctionnement des ateliers d’art indigène, la conservation et l’entretien des musées. Le Service des antiquités est géré par Louis Chatelain (1883-1950)63. Le dahir du 1er mars 1921 crée une Direction générale de l’Instruction publique, des beaux-arts et des antiquités. Georges Hardy en devient le directeur jusqu’en 1933. Les spécificités concernant les différentes sections des Beaux-arts restructurées en 1920 ne changent pas.
Le premier avril 1923, les postes de Joseph de la Nézière et de Maurice Tranchant de Lunel sont supprimés. Les deux peintres sont remerciés pour leur action. Ils ont créé les bases d’un service dont l’activité n’a pas cessé de croître entre 1914 et 1923. L’apogée étant l’année 1922. Les rapports entre les deux hommes ont toujours été tendus même s’ils étaient, l’un et l’autre, proches d’Hubert Lyautey. Maurice Tranchant de Lunel a joui d’un soutien intime de la part du Résident général, voire peut-être trop. Ce dernier a bénéficié de larges pouvoirs sur l’ensemble des divers services liés à l’architecture. Il est plausible qu’il y ait eu des envieux parmi ses collaborateurs. La prise en charge des services artistiques par la direction générale de l’Instruction publique aboutit à une élimination de plus en plus nette des artistes au profit des professionnels de l’enseignement. Les peintres mobilisés sont remplacés par des agents agréés.
En parallèle du Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques se mettent en place des associations d’habitants dans les villes impériales dont le but est de renforcer le maintien de la protection des cités en aidant le service par la surveillance des édifices. Ainsi en 1922, est créé les Amis de Marrakech dont l’objectif est de signaler à l’administration coloniale toute infraction aux textes en vigueur pour la conservation des sites classés, proposer de nouveaux lieux et monuments à classer ou bien à protéger et enfin faire connaître au public que la conservation de Marrakech est d’intérêt général pour tous64. Cet élan de soutien au Service des beaux-arts et monuments historiques est dû, pour Marrakech, aux oppositions aux nouvelles constructions réalisées dans la médina : Déjà presque tout le côté ouest de la ville arabe, la fameuse place Djemaa El Fna, les deux Riad Zitoun sont devenus un hideux mélange de magasins, de cafés, de garages ; la réclame y étale ses affiches criardes, ses inscriptions énormes ; du haut des terrasses on domine des hangars couverts en tôle ondulée, des constructions nouvelles qui détonnent autant parleur style que par leur couleur. Et la lèpre menace de s’étendre…65
Les Amis de Fès est une autre association qui reprend les mêmes principes que celles de sa consœur du sud. Créée en 1932, elle regroupe des amateurs d’archéologie, d’histoire, de littérature et d’art. Son président est Marcel Vicaire (1893-1976). Cette association facilite les travaux relatifs à l’histoire de Fès et de ses monuments historiques tout en défendant les beautés de la ville66. Elle a aussi pour but de faire découvrir et valoriser l’artisanat marocain : Chaque mois, une conférence promenade conduit les membres de l’Association dans les tanneries, les souks des babouches, les fabriques de poteries. Les amateurs d’archéologie, de littérature, d’histoire, d’art, de vie sociale indigène, urbaine et rurale, se réunissent également et encouragent les travaux de ceux qui s’intéressent à l’histoire de Fez, de ses monuments, des divers éléments de sa population. Ils s’efforcent de recueillir des dons et de favoriser les acquisitions d’objets d’art pour les Musées de la ville, de livres pour les bibliothèques67.
Cette association se développe rapidement, elle compte, en 1938, déjà 350 adhérents. Elle perdure jusqu’à la fin du Protectorat en 1956.
2.2. Le nouveau Service des beaux-arts et monuments historiques (1924-1935)
Le dahir du 1er avril 1924 réaménage le Service des monuments historiques, palais impériaux et résidences. Il lui confère la nouvelle appellation de Service des beaux-arts et monuments historiques. Le 5 mars 1924, un nouvel inspecteur général est nommé. Il s’agit de Jules Borély (1874-1947)68.
Le Service des beaux-arts et monuments historiques assure désormais l’examen des plans, des bâtiments publics ou à l’usage du public, et la préparation, en accord avec le Service des contrôles civils et des municipalités, des projets d’aménagement des voies et des places publiques comportant une ordonnance architecturale. Il est chargé de l’inspection des médinas, des monuments historiques et de leur conservation. Pour accomplir ces missions, le nouveau service se divise en trois sections : un organe central de direction est situé à Rabat, tandis que des directions régionales sont réparties dans trois zones distinctes. Celle du Sud intègre Mazagan, Safi, Mogador et Marrakech. La région de Rabat insère Kenitra, Rabat et Casablanca. Les architectes, Marcel Jourdan et Gaston Goupil sont respectivement agents d’exécution du service pour la région de Fès comprenant Taza, Meknès et Fès elle-même69. L’architecte Joachim Richard (1869-1960) est nommé pour la région de Rabat. Il est remplacé en 1926-27 par Jean Léonetti (1899-1972). L’architecte Louis Poisson (1875-1969) est affecté à Marrakech et Jean Gallotti (1881-1972) aux villes de Mogador, de Safi et de Mazagan70. Tous ces agents sont spécialement chargés d’effectuer et de surveiller les travaux de restauration. Ils étudient les demandes d’autorisation de construire à l’intérieur des médinas et celles des bâtiments publics ou à l’usage du public. Les demandes concernant les immeubles à édifier le long des voies et places où l’unité architecturale devant être maintenue sont aussi examinées. Tous les projets sont ensuite transmis et reconsidérés à la direction centrale du service, à Rabat.
En 1924, Marcel Vicaire est inspecteur régional du Nord, il réside à Fès. Jean Gallotti, installé à Marrakech, est inspecteur régional du Sud. Ils sont respectivement remplacés, en 1927, par Boris Maslow (1893-1962) et Alphonse Métérié (1887-1967)71. Le premier est nommé inspecteur régional à Fès tandis que le second a la charge de Marrakech et des régions du sud de l’Atlas et du Souss. Ces agents régionaux sont placés sous l’autorité immédiate du directeur du Service des beaux-arts et monuments historiques. Ils doivent veiller à ce que les initiatives prises par les particuliers, par les services publics ou bien par les agents d’exécution du service, satisfassent les objectifs esthétiques initialisés par ce dernier. Ces agents sont en étroite liaison avec les autorités régionales et les municipalités. Dans les médinas ayant fait l’objet de règlement de protection esthétique, tous projets de transformation et d’amélioration de lotissement sont soumis à leur examen. Il en est de même pour les travaux à effectuer à l’intérieur des zones de protection entourant entièrement les médinas72.
En 1934, le Service des beaux-arts et monuments historiques est composé de Jules Borély comme directeur. Les inspecteurs sont Boris Maslow pour la région de Fès, Étienne Marchisio (1900-1990) et Pierre Souchon pour la région de Rabat et Alphonse Métérié pour celle de Marrakech. Les commis principaux sont au nombre de deux : Henri Bonnefoy et Jean Leonetti. Cinq dessinateurs sont affectés dans les deux principales villes impériales : Jean Aymond, Gérard Pinset et Georges Soipteur à Rabat ; Clément Nutte à Marrakech73.
L’arrêté du 1er septembre 1925 du directeur général de l’Instruction publique, des beaux-arts et des antiquités fonde un comité pour la restauration des monuments historiques, à Rabat, au siège de l’Institut des hautes études marocaines. Cette institution, créée par l’arrêté résidentiel du 11 février 1920, est l’œuvre de Georges Hardy. L’arrêté viziriel du 18 septembre 1921 en définit les objectifs. Elle doit provoquer et encourager les recherches scientifiques relatives au Maroc, favoriser l’enseignement des langues berbères et arabes, de la géographie, de l’histoire, de l’ethnologie et de la civilisation marocaine. Pour cela, l’Institut des hautes études marocaines a créé une revue scientifique, Hespéris. Depuis 1921, les pages de ce périodique sont consacrées à la publication de travaux universitaires et aux résultats des différentes études menées lors des travaux de restauration comme celles réalisées par Émile Lévi Provençal74 (1894-1956) et Henri Basset (1892-1926), respectivement professeurs d’histoire de la civilisation musulmane et d’ethnographie marocaine75. Leurs investigations concernant les monuments almohades sont révélatrices de l’évolution des théories sur l’art marocain. Leur étude est conçue toujours de la même manière. Ils établissent le contexte historique de l’édifice, en décrivent minutieusement le plan et le mode de construction avec un large éventail de détails sur les types de matériaux usités. Le décor extérieur est ensuite passé en revue. Les relevés graphiques, notamment dessins et aquarelles, servent de support à leurs propos. Les monuments sont toujours comparés avec d’autres édifices datant des mêmes périodes. L’intérieur des bâtiments est ensuite dépeint en détail. Il en est de même pour les décorations. Cette méthode d’analyse est adoptée pour la description des mosquées, des bastions ou bien d’autres objets.
Émile Lévi Provençal s’est spécialisé dans l’histoire et l’art d’Al Andalous. Entre 1923 et 1924, il obtient une mission, à Madrid, du ministère de l’Instruction publique française pour étudier les catalogues et les manuscrits arabes de théologie, de géographie et d’histoire conservés à l’Escurial. Il emmène avec lui le jeune doctorant en histoire islamique, Henri Terrasse (1895-1971). Le 7 avril 1925, cet universitaire obtient de la Résidence générale une somme de cinq mille francs afin d’effectuer un voyage d’études en Andalousie pour examiner l’architecture maure76. De ces deux missions en terre espagnole, Henri Terrasse rédige l’ouvrage L’art hispano-mauresque des origines au XIIIe siècle qui synthétise toutes les recherches sur les liens entre l’art islamique d’Espagne et celui du Maroc.
Ces nouvelles connaissances scientifiques sur les monuments marocains expliquent la création d’un comité de restauration composé principalement d’universitaires. Le président est Georges Hardy, le vice-président, Henri Basset, le directeur de l’Institut des hautes études marocaines, et le rapporteur, Jules Borély. Les autres membres sont Émile Lévi Provençal en qualité de directeur des études classiques, Henri Terrasse, directeur des études d’archéologie musulmane et Prosper Ricard, directeur du Service des arts indigènes. Tous sont appelés, en février et sur convocation du président, à élaborer le programme des restaurations à effectuer dans l’année. Ils délibèrent sur le rapport qui leur est présenté par le directeur du Service des beaux-arts et monuments historiques en vue de ces travaux. Il est alors dressé un procès-verbal de leurs observations et des décisions prises77. Si ce programme de restauration est mis en place, le résultat des travaux ne satisfait pas tout le monde.
2.3. La réorganisation du Service des beaux-arts et monuments historiques (1935-1945)
La réorganisation du Service des beaux-arts et monuments historiques est la conséquence des remontrances faites par l’Académie des beaux-arts de Paris à l’encontre de certaines restaurations à Chellah et au minaret de la mosquée de la Koutoubia à Marrakech. Ces critiques remettent en cause les actions de ce service. De plus, il est aussi émis l’idée de regrouper dans un seul organisme les services des beaux-arts et monuments historiques, de l’urbanisme, des antiquités et des arts indigènes. Le Résident général du Maroc, Lucien Saint (1867-1938), n’adhère pas à cette idée, car il est assez difficile de le réaliser par manque de personnel78.
Finalement, ces jugements acerbes ont quand même gain de cause puisque le 1er juin 1935, le Service des beaux-arts et monuments historiques devient une Inspection des monuments historiques, des médinas et des sites classés79. Henri Terrasse en devient le directeur. Il est secondé par Jean Leonetti et Jean Meunier80. Cette inspection est composée de deux sections. La première s’occupe du classement et de la restauration des monuments historiques arabo-musulmans en collaborant avec les municipalités et les Habous. Elle a la charge de remettre en état les remparts classés et les édifices du culte. La seconde section assure la protection urbanistique et architecturale des médinas et des sites en coopérant étroitement avec la direction des Affaires politiques et les municipalités. Elle examine ou fait examiner par ses correspondants régionaux toutes les demandes d’autorisation de bâtir dans les médinas protégées soient deux à trois mille dossiers par année. Les plans et les dessins sont visés et parfois rectifiés. Le contrôle des constructions est effectué en liaison avec les municipalités qui sanctionnent les infractions. Le service central étudie directement les projets d’aménagements relatifs aux médinas, ceux des bâtiments publics ou à l’usage du public81.
En 1935, l’ancien personnel du Service des beaux-arts et monuments historiques, en dehors de celui du bureau, est transféré à la direction des Affaires politiques. Les inspecteurs conservent leur statut, mais ils changent d’appellation, ils prennent le titre d’inspecteur de l’urbanisme. Au nombre de cinq, ils sont les correspondants régionaux de l’Inspection des monuments historiques82. Alphonse Métérié est nommé pour la région du Sud et Boris Maslow est toujours attaché à celle du centre, incluant Fès et Meknès. Il est remplacé par Jean Nutte en 194083. L’architecte Pierre Souchon a la responsabilité de la région du Nord84. Le Comité pour la restauration des monuments historiques, institué le 13 août 1925, est supprimé, il est remplacé par un Comité des médinas et des sites classés85. Les divers changements de 1935 renforcent les pouvoirs municipaux par rapport à ceux de l’Inspection des monuments historiques.
2.4. Le Service des arts indigènes
Le renouveau de l’artisanat local comme source industrielle du pays est un des objectifs de la politique économique de Lyautey. La plupart des métiers artisanaux sont en déclin dû à l’affluence de l’importation de produits manufacturés européens et asiatiques. Ainsi, dès 1913, la priorité est de répertorier les différents types d’artisans. Lyautey nomme un agent du Secrétariat général pour effectuer une mission d’étude à Rabat-Salé, Meknès et Fès, en vue d’établir la situation générale des corporations au Maroc et de proposer des mesures propres à leur relève86. Les premiers métiers à être rénovés sont ceux des décorateurs d’architecture tels que les menuisiers, les créateurs de zelliges, les stucateurs et les peintres sur bois. Les pratiques artisanales traditionnelles sont maintenues en activité grâce à la création d’ateliers d’enseignement professionnel identiques à ceux élaborés en Algérie. Pour mettre en place ces mesures, Lyautey a fait appel en 1912 à Prosper Ricard, inspecteur de l’enseignement artistique et industriel dans les écoles indigènes algériennes entre 1909 et 1912. Il débarque à Casablanca au début du printemps 1913. Intégré au Service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques, il est nommé le 24 novembre 1915, inspecteur des arts industriels des régions de Fès et de Meknès. Des artistes mobilisés, comme le peintre Gabriel Rousseau (1876-1951), le secondent87. Jean Gallotti devient aussi inspecteur des arts industriels à Rabat et à Salé par l’arrêté de la résidence générale du 30 novembre 1915. Les écoles d’arts indigènes sont placées sous la tutelle de Joseph de la Nézière.
Le Service des arts indigènes a pour but de collecter les objets ancestraux pour les proposer comme modèles d’inspiration aux artisans les plus habiles du pays. Toutes les pièces de collection récoltées sont inventoriées. Pour pouvoir les exposer, il faut créer des musées. Les deux villes, Rabat et Fès, où l’activité de conservation et de restauration est la plus importante, sont privilégiées. Dans la capitale, en 1915, la « médersa » des Oudaïas est désignée pour cette nouvelle reconversion. Son conservateur est Jean Gallotti. À Fès, un premier musée a été installé au Bou Jeloud, au rez-de-chaussée du Dar Adiyel, depuis 1913. La mosquée édifiée sous le règne de Moulay Hafid est aussi consacrée à cet usage. Des rénovations et des transformations ont été réalisées en urgence pour modifier son aspect intérieur. Une salle annexe à la mosquée a été prévue pour agrandir le bâtiment cultuel. La bénika (pièce annexe) est destinée à de nombreux objets précieux ou de petites tailles. En 1915, un second musée est créé au Dar Batha, l’ancien palais du Sultan Moulay Hassan (1836-1894). Dans la partie réservée à la résidence, les deux pièces latérales réunies à la pièce centrale sont consacrées aux collections d’armes88. Deux inspections des arts indigènes se créent à Rabat et à Fès en même temps que les musées. Il faut attendre 1926 pour qu’un musée des arts indigènes s’ouvre à Meknès au Dar Jamaï et 1928 pour qu’un autre fasse son apparition à Marrakech au Dar Si Saïd.