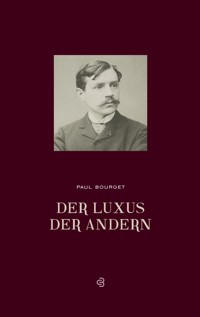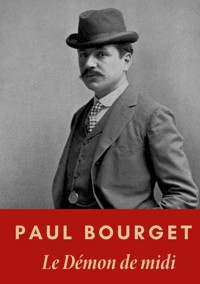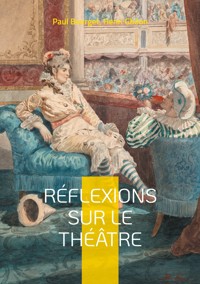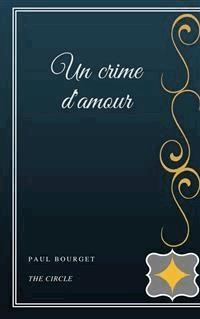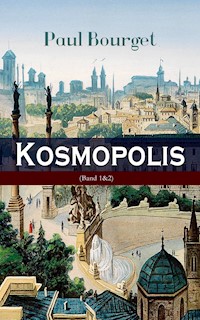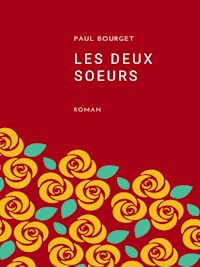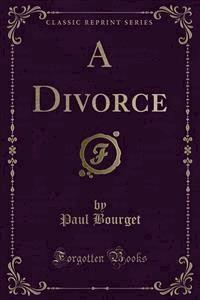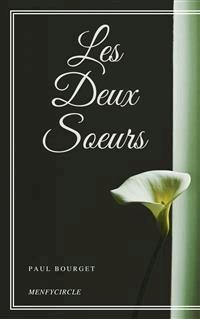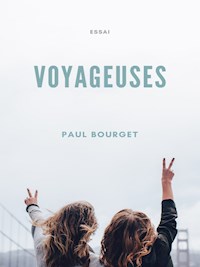
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
C'est là réellement une suite de portraits de passantes, esquissés dans le rapide éclair de la plus fugitive impression. Une seule fois nos chemins se sont croisés pour ne plus se toucher ici-bas. De presque toutes, j'ignore où elles vivent, et si elles vivent. Elles ne me réapparaissent, quand j'y songe, que dans le cadre momentané où je les ai connues : un pont de bateau [...], la nef d'une vieille basilique italienne, la terrasse d'un palais étranger, une rue d'une ville où ni elles ni moi ne sommes revenus... [...] Voyageuses, connues juste assez pour les plaindre de leur mélancolie, pour être heureux de leur bonheur, et pas assez pour souffrir de les avoir vues disparaître à jamais...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Voyageuses
Voyageuses-VOYAGEUSESLA PIAIIICHARITÉ DE FEMMEI. 2II. 2III. 2IV. 2ANTIGONEI. 3II. 3III. 3IV. 3DEUX MÉNAGESI. 4II. 4III. 4IV. 4ODILEI. 5II. 5III. 5IV. 5V. 5NEPTUNEVALEI. 6II. 6III. 6IV. 6V. 6Page de copyrightVoyageuses
Paul Bourget
À MADAME LA COMTESSE DE BRIGODE, Respectueux Hommage
-VOYAGEUSES
J’ai là, sur ma table, à portée de ma main, quinze ou vingt cahiers d’épaisseur diverse, et à la première page desquels je peux lire ces mots : Provence, Italie, Espagne, Angleterre, Grèce, Syrie, Palestine, Maroc, Allemagne, Amérique… une vraie table des matières d’un manuel de géographie. Ce journal d’une jeunesse qui fut passionnément errante m’amuse à feuilleter, comme, tout enfant, l’herbier où je conservais, avec des dates et des noms, les plantes cueillies dans mes promenades d’écolier. D’innombrables silhouettes humaines s’animent pour moi, à travers ces pages. Celles que j’évoque plus complaisamment sont des physionomies de femmes rencontrées une semaine, un jour, une heure, et dont j’ai deviné, imaginé peut-être, le roman intime par le rapide hasard de quelque accident de route. De ces rencontres, les unes sont toutes récentes, d’autres lointaines. Une ou deux restent associées à des souvenirs tragiques. Je viens d’en transcrire plusieurs qui m’ont semblé former un tout par elles-mêmes. Je les ai réunies sous ce titre commun de Voyageuses parce que c’est là réellement une suite de portraits de passantes, esquissés dans le rapide éclair de la plus fugitive impression. Une seule fois nos chemins se sont croisés pour ne plus se toucher ici-bas. De presque toutes, j’ignore où elles vivent, et si elles vivent. Elles ne me réapparaissent, quand j’y songe, que dans le cadre momentané où je les ai connues : un pont de bateau sur la Méditerranée ou sur l’Océan, la nef d’une vieille basilique italienne, la terrasse d’un palais étranger, une rue d’une ville où ni elles ni moi ne sommes revenus, l’angle d’un wagon qui filait… Mais cette brièveté de leur passage ne demeure-t-elle pas la poésie unique, le charme inégalé de ces voyageuses, connues juste assez pour les plaindre de leur mélancolie, pour être heureux de leur bonheur, et pas assez pour souffrir de les avoir vues disparaître à jamais ?…
LA PIA
I
Qui a pu voyager en Italie et ne pas connaître quelqu’une de ces journées de parfaite beauté, où il semble que toutes les circonstances se réunissent pour porter l’âme à son plus haut degré d’émotion heureuse : la saison qu’il est, le temps qu’il fait, la lumière du ciel, le coloris du paysage, la rencontre d’un chef-d’œuvre inconnu, la grâce pittoresque des gens ? Ailleurs, en Égypte, en Algérie, en Andalousie, vous trouverez un air aussi tiède, aussi transparent, d’aussi lumineuses après-midi ; – en Syrie, au Maroc, des horizons plus grandioses ; – en Espagne, en Grèce, des tableaux, des sculptures, des architectures d’une égale splendeur ; – en Provence, en Irlande, des hommes du peuple aussi humoristiquement familiers. En Italie seulement vous goûterez l’accord total de ces impressions, et cela donne à certaines heures, dans cette contrée, un inoubliable, un incomparable enchantement. Que j’en ai savouré de ces heures, durant mes vingt séjours au delà des Alpes, loin, bien loin de Paris et de ses pauvretés intellectuelles, loin du monde littéraire et de ses cruautés gratuites, loin, bien loin de tout et près de l’Idéal, près des morts qui nous ont légué dans leur art le meilleur d’eux-mêmes, près de l’âme de notre race, puisque c’est ici le point d’origine de l’esprit latin, du commun génie que nous renions en vain dans des rivalités fratricides ! – En Toscane, autour de Pise, de Florence, de Sienne, il est des coins dont le seul nom, gravé sur une carte, fait battre mon cœur. De Sienne surtout. Beyle a ordonné que l’on mît sur son tombeau : Milanese. Je suis parfois tenté de demander que l’on écrive sur celui où je reposerai : Senese… Et ce ne serait pas trahir mon vrai pays. Tant d’histoire française, et de la plus héroïque, demeure mêlée aux pierres de cette ville où commanda Montluc et qui, seule, nous resta fidèle, durant ce terrible seizième siècle, si indulgent aux trahisons : « Étranger, » est-il écrit sur une de ses portes, « Sienne t’ouvre son cœur… » je n’ai jamais lu cette inscription sans m’attendrir.
C’est le détail des souvenirs rattachés à deux de mes séjours dans cette chère ville que je voudrais fixer aujourd’hui. Le premier remonte au printemps de 1885, et je le retrouve en moi, quand j’y songe, comme un de ces rayonnements de beauté dont je parlais tout à l’heure. Ce matin-là, un des derniers du mois de mars, j’étais parti sur la foi d’un livre anglais, pour visiter un couvent de Franciscains, perdu dans la montagne au-dessus de Volterra. Je devais y voir toute une série de scènes de la Passion, représentées en terre cuite coloriée, l’œuvre la plus considérable de ce mystérieux sculpteur aveugle, Giovanni Gonnelli, dit : il Cieco di Gambassi. L’excursion, assez longue et compliquée, m’avait été fortement déconseillée par mon guide habituel à travers la province, un vieil artiste dont j’avais fait la connaissance au petit musée municipal de Sienne. Il y était attaché, je ne sais trop en quelle qualité, et il passait ses journées depuis vingt ans dans une des salles du premier étage, à mastiquer de cire les éraillures des panneaux peints a tempera par tous les Bartolo di Maestro Fredi, les Taddeo di Bartolo, les Domenico di Bartolo, les Matteo di Giovanni di Bartolo, les Benvenuto di Giovanni, les Girolamo di Benvenuto. Je me perds aujourd’hui parmi les noms de ces vieux maîtres. Le cavalier Amilcare Martini m’avait pourtant appris à les distinguer, lui dont la vie entière s’était employée à réparer leurs Madones avec des délicatesses de dentiste qui aurifie les deux dents de devant d’une princesse royale. C’était un homme de mine chétive, qui portait de longs cheveux soyeux et grisonnants, une barbiche blanche ; et ses yeux, d’un brun pâle, luisaient dans un maigre visage tout passé, tout effacé. À force de vivre devant les fresques éteintes et les triptyques dégradés du quatorzième siècle, sa personne physique semblait s’être harmonisée à ces décolorations. Il les aimait si passionnément, ces peintres de son pays ! Il veillait sur leur œuvre survivante avec une si religieuse patience ! Et tout ce qui n’était pas eux lui paraissait si barbare !
— « Qu’irez-vous faire à San Sebastiano ? » m’avait-il dit. – C’était le nom du couvent. – « Il n’y avait là qu’une bonne chose, un supplice du saint, par Giovanni di Paolo. Les moines l’ont vendu à un Anglais, à l’époque de la suppression… »
— « Et le Ghirlandajo qui reste ? Et les terres cuites ? »
— « Ghirlandajo ! » m’avait-il répondu avec mépris, en laissant errer son regard sur les fonds en or des tableaux de son musée. « Peuh ! C’est un brave artiste, mais déjà de bien basse époque. Quant aux terres cuites, elles sont du dix-septième siècle… Et puis », avait-il ajouté, « vous n’arriverez jamais à San Sebastiano en un jour… »
— « En allant avec le train jusqu’à Castel Fiorentino cependant ?… Je suis là vers les dix heures. Comptez : trois heures de voiture pour aller, autant pour revenir, deux heures dans l’intervalle pour laisser reposer les chevaux, déjeuner, voir le couvent, et je suis à temps pour le dernier train qui me ramène à Sienne vers neuf heures. »
— « Il faudrait pour cela que le chemin de fer partît et arrivât à l’heure », avait répondu philosophiquement l’adorateur des Primitifs, en hochant sa vieille tête, « et vous savez bien qu’ici il y a toujours du retard. Le retard en tout, hélas ! c’est le destin italien, aujourd’hui… »
Je l’entends encore, après tant d’années, prononcer avec un soupir et un sourire cette formule, où il y avait de l’ironie et de la conviction, de l’orgueil et du désenchantement : Il Destino Italiano ! Je devais en avoir un commentaire trop indiscutable dès le lendemain matin ; car, m’étant obstiné, malgré l’absence du panneau de Giovanni di Paolo, à entreprendre mon voyage, un embarras de la petite ligne locale me fit arriver à Castel avec deux heures de retard, et le premier cocher que je consultai, aussitôt descendu de wagon, répondit à ma demande :
— « Pour aller à San Sebastiano de Montajone ?… Il faut trois heures et demie en marchant bien, autant pour revenir, et une heure de repos là-bas. Cela fait neuf heures. Encore faudra-t-il que j’attelle le Moro, car la jument est bonne mais elle est vieille et il faut la ménager : chi non ha amore alle bestie, non l’ha neanche ai cristiani… »
L’aimable Toscan avait dit cet aimable proverbe en caressant du fouet la pauvre rosse blanche attelée à sa voiture, une de ces carrioles à deux roues que les gens du pays dénomment des baroccini. Les brancards attachés très haut pointent à la hauteur des oreilles de la bête. Les deux personnes que peut tenir l’unique banquette sont rejetées en arrière à chaque coup de collier. Elles doivent, pour maintenir leur équilibre, assurer leurs pieds sur le treillis en grosse corde qui sert de fond à la voiture et de filet pour les paquets. C’est tout de même un admirable outil à rouler vite que cette dure charrette, si légère, si gaie. Elle brave fondrière et cailloutis, montées et pentes. Et puis, lorsqu’un cocher est plaisant comme celui-là et qu’il parle le joli italien, mâle et musical, de cette province, quelle fête d’aller ainsi, parmi les oliviers, les mûriers, les vignes et les chênes verts ! Le geste de l’homme flattant sa jument avait été si avenant ; dans son costume de drap jaune à carreaux noirs, il avait une si alerte tournure ; son brun visage exprimait tant d’intelligence, qu’obligé de renoncer à mon expédition, je fis à mauvais jeu bonne mine. – Les Toscans ont encore un proverbe pour cette sagesse-là. D’ailleurs pour quelle circonstance n’en ont-ils point ? « Chi non puo ber nell’oro, beva nel vetro… – Que celui qui ne peut boire dans l’or boive dans le verre… »
— « Neuf heures… Eh bien ! je n’irai donc pas à San Sebastiano », lui dis-je ; « je ne serais pas à temps pour le train. Mais n’y a-t-il pas quelque promenade à faire plus près ?… »
— « Des promenades ? » s’écria-t-il. « Si vous voulez monter dans la voiture, avec la blanche, je vous porte à San Gimignano en une heure et demie, et quelles églises il y a là, et quelles fresques, – tutta roba del quattrocento !… »
— « Je les connais », répondis-je, amusé par l’accent avec lequel il avait prononcé un des deux mots que les plus humbles habitants de cette artistique campagne ont toujours à la bouche. Quattrocento, c’est l’éloge. Seicento, c’est l’autre mot, et c’est le mépris. Ils les distribuent, ces formules, au petit bonheur, et avec une assurance, une sincérité ! Celui-ci réfléchit une minute :
— « Est-ce que vous connaissez San Spirito in Val d’Elsa ?… » me demanda-t-il, et sur ma réponse négative : « Non ? Mais c’est la plus belle église de la Toscane. Je vous y porterai », dit-il en ramassant les rênes. « Accommodez-vous… » Et sur ma réponse que je n’avais pas déjeuné : « Heureusement, il y a ici la meilleure auberge de la province… » s’écria-t-il, « une cuisine de famille, vous savez, mais de premier choix, et du chianti, du vrai cru !… Veramente, non c’è male… Je profiterai de ce temps pour atteler le Moro. »
La facilité avec laquelle ce subtil personnage faisait alterner des éloges enthousiastes et ce prudent non c’è male, me mit bien un peu en défiance à l’égard du monument inconnu qu’il entendait me révéler. Mais quoi ! à défaut d’un chef-d’œuvre d’architecture, j’aurais le paysage toscan. J’aurais la conversation d’Antonio Bonciani, – ainsi s’appelait mon tentateur. – Et aussitôt le déjeuner fini, lequel se composait d’une omelette à l’huile, d’un peu de viande grillée qu’il fallut tremper de citron, et d’un verre de chianti, piquant à en paraître poivré, je me hissai sur la banquette du baroccino… Nous voilà donc roulant lestement au trot du Moro : un bidet plus maigre que la jument, avec des flancs étiques, un cou décharné, mais des jambes solides et qui vont le vent aux descentes. Bonciani, pour le soulager, marche aux montées. Il a allumé un long cigare, préalablement vidé de sa paille, et nous causons. C’est autour de nous le plus idyllique des horizons : ici, une vallée où les mottes, brunes et retournées, attendent le maïs et les fèves ; plus loin, le blé et l’avoine commencent à lever, verts sur la terre sombre. Presque tous les champs sont plantés d’arbres aux troncs desquels s’enlacent des vignes. Des hommes taillent le bois de ces vignes encore dénudées et les attachent à l’ormeau, avec des baguettes jaunes en osier souple. De noueux oliviers, de place en place, remuent au soleil leur feuillée d’argent gris. Du haut des coteaux, on aperçoit la forêt là-bas, d’où arrivent les charbonniers qui passent, menant des chars traînés de bœufs blancs aux cornes énormes. Ils portent, qui à Castel Fiorentino, qui à Empoli, qui à Florence, des sacs remplis d’un charbon de bois, destiné à rôtir, dans la saison de la chasse, les grives nourries de baies de genièvre. De grosses bourgades dentellent de tours les hauteurs lointaines, et, de place en place, derrière un rideau de cyprès, une villa peinte profile sa masse claire auprès d’une ferme qui sert à l’exploitation. Sans cesse, à la fin d’une descente, au faîte d’une colline, au détour d’une vallée, nous retrouvons le mince ruban de l’Elsa. Elle tord son eau, d’un vert très pâle, entre deux rives argileuses. Un soleil léger et vibrant, un jeune soleil d’une griserie heureuse, enveloppe d’une féerie de lumière ces travaux des champs, ces jeunes pousses, ces attelages, ces arbres, cette forêt, cette rivière, et j’écoute Bonciani me célébrer les louanges de sa Toscane, – de notre Toscane.
— « Ah ! » racontait-il, « l’Italie est le jardin du monde, et la Toscane est le jardin de l’Italie… C’est dommage qu’il y ait un peu trop d’impôts, maintenant. Autrefois, tout était à si bon marché. Pour prendre une merenda, qui se composait d’un pigeon, de macaroni, de pain, de salade, le tout arrosé d’un demi-fiasco de chianti, mon père payait un paolo… Cinquante-six centimes d’à présent… Aujourd’hui, il faut gagner un peu plus… Mais bah ! Nous n’avons pas l’épaule ronde, dans la maison Bonciani. Nous sommes cinq frères. L’aîné fait le vendeur de chapeaux. Moi, le second, je suis voiturier. Le troisième est en Amérique, au Brésil. On lui payait mal le chianti et l’huile qu’il expédiait là-bas. Alors il est allé faire ses affaires lui-même. Le quatrième frère a pris la ferme et envoie le chianti et l’huile à l’autre… Ils réussissent… » Il disait : « Fanno del bene. » Comment traduire ces mots, accompagnés d’un geste des doigts et d’un clignement des yeux ? Comment traduire aussi cette gracieuse image sur l’épaule ronde, qui symbolise le nonchaloir, parce qu’elle laisse glisser les fardeaux ; et la merenda, ce goûter-souper ; et tout le vocable italien, ponctué de « c » durs prononcés en « h » aspirés ? Il continuait : « Le cinquième est à Rome, employé du gouvernement. Toute la famille s’est étalée ainsi, – Tutta la famiglia s’è ramata cosi !… » Et du doigt montrant un gros hameau sur une crête au loin : « Notre père est venu de là, de Montajone. Ils étaient, eux, quatre frères. Per Bacco ! ils sont allés souvent à la messe de la Pentecôte, tout petits, à San Spirito in Val d’Elsa. »
— « L’église dépend donc de ce village ? » lui demandai-je.
— « Che ! Che !… Si vous disiez cela à l’archiprêtre, le brave homme crierait de colère. Il est vif comme le feu, vous savez, malgré ses soixante-dix ans. Mais ce ne sont pas les vifs qui sont à craindre. C’est la colère de ceux qui ne se fâchent jamais dont il faut avoir peur. Nous disons en Toscane : « Garde-toi du vinaigre de vin doux. » Vous comprenez ?… San Spirito in Val d’Elsa ne dépend que du Saint-Père. L’archiprêtre vous l’expliquera… Il vous expliquera tout. Il est si fier de son église… »
— « Et il y a longtemps qu’il l’administre ?… »
— « Au moins quarante », fit Bonciani. « J’en ai trente-huit et j’ai toujours connu Dom Casalta… J’étais haut comme la moitié de mon fouet que je le voyais aller et venir, quêtant de l’argent pour son église… Il en a mangé des mille et des mille lires à la reconstruire. Quand il l’a prise, c’était une ruine, et vous jugerez !… On la croirait neuve !… C’est qu’il l’aime, et c’est qu’elle est belle, le plus pur quattrocento !… »
Jamais la prodigieuse souplesse de ce vocable admiratif ne devait être illustrée pour moi d’un plus étonnant exemple qu’à cette occasion. À travers les pittoresques bavardages de ce brave garçon, et depuis une heure que nous marchions, je m’étais fait une idée assez pauvre de l’édifice et du prêtre vers lesquels il me menait. J’imaginais un monument d’un style quelconque, violemment badigeonné, flambant neuf, et, pour y présider, quelque ecclésiastique à demi paysan, grand buveur de chianti, grand mangeur de gorgonzola, grand quémandeur d’aumônes, et fort mal élevé. Aussi fut-ce une première surprise, et délicieuse, lorsque, à un tournant du chemin, Bonciani me montra du bout de son fouet une façade soudain dressée à deux cents mètres de nous, et que j’aperçus le plus rare bijou de vieille basilique mi-romane, mi-gothique. Je devais plus tard retrouver, dans la collégiale de San Quirico, commencée elle aussi au huitième siècle et finie au treizième, cette légèreté paradoxale d’un style adorablement ambigu, avec les arches du porche arrondies en plein cintre et les fenêtres du clocher aiguisées en ogive. Cette façade de pierre rousse, comme brûlée, comme mangée de soleil, était revêtue de plusieurs rangs de colonnes étagées, d’une sveltesse singulière. Je constatai, en m’approchant, combien cette impression de légèreté était savamment obtenue : chacune de ces colonnes ramassait en un faisceau quatre plus petites colonnettes, ajourées, toutes grêles, et enjolivées d’un serpent qui en faisait de véritables torsades. Des animaux jumelés formaient les chapiteaux et d’autres bêtes se voyaient partout. Au fronton, deux crocodiles se dévoraient au-dessus d’une Madone ; au portail, des lions et des léopards accroupis soutenaient les piliers de la base. Contre l’église s’accotait une maison construite en pierres de cette même couleur rousse. Elle devait servir de presbytère, car, à l’approche de notre voiture, je vis sur le seuil une silhouette surgir qui fit s’écrier mon cocher :
— « Voilà Dom Casalta lui-même. Ah ! l’on ne peut pas dire de lui que ses cheveux gris sont les fleurs de l’arbre de la mort. Est-il vif ! Et à chaque nouveau printemps il a l’air plus jeune… »
Le fait est que l’extraordinaire personnage qui nous accueillait maintenant d’un salut, ainsi debout à côté de l’admirable église, n’offrait dans son premier aspect aucun signe du grand âge mentionné par l’indiscret Bonciani. L’archiprêtre était un homme de six pieds, demeuré souple et mince. Un sourire de sympathie éclairait son beau visage bien rasé, où brillaient deux yeux du bleu le plus limpide, et ce sourire découvrait une rangée de très blanches dents que l’on devinait intactes. Il avait la tête nue. La brise qui avait rafraîchi toute notre excursion de cette idéale après-midi secouait doucement les boucles argentées de ses cheveux qui retombaient sur le collet droit de sa redingote taillée à l’ancienne mode. Une culotte courte, des bas de soie où se dessinaient des mollets d’athlète, des souliers à boucles dorées où se moulait un pied un peu déformé par la goutte, achevaient ce costume que le bonhomme portait avec une élégance personnelle d’un caractère très saisissant. Le vieillard avait dû être, à trente ans, un des plus beaux exemplaires d’une race féconde en beaux exemplaires humains. Il était encore magnifique de robustesse et d’allures. Avec cela il émanait de lui une dignité native, cette grâce aimable, pour laquelle ses compatriotes ont créé le mot de sympathique.
— « Bonjour, Tonino », dit-il à Bonciani, d’une voix profonde, comme en ont souvent les personnes de son âge qui conservent la pleine vigueur de la vie. « Il y avait longtemps que tu n’étais venu faire tes dévotions à San Spirito. Où étais-tu à la Pentecôte dernière ? Mais il te sera beaucoup pardonné, puisque tu nous amènes des visiteurs. Et vous, monsieur, soyez le bienvenu. Vous arrivez à une heure admirable… C’est le meilleur moment de la journée pour voir la façade, à cause de l’éclairage… Tenez, à deux pas en arrière de la voiture. Deux pas, juste. C’est le point… »
Sans chapeau, quoique le soleil de cette fin de mars fût déjà brûlant, l’enthousiaste s’était précipité vers la carriole. Il m’avait aidé à descendre, et, me prenant par le bras, il m’avait placé à l’endroit voulu. Qui étais-je ? D’où et pourquoi venais-je ? Mes connaissances ou mes ignorances en architecture ?… Que lui importait ? J’étais le témoin de sa chimère. Me voyait-il ? Non. Il ne voyait que l’église, son église. Toute sa noble physionomie s’animait, s’éclairait d’une joie exaltée et naïve. C’était l’extase du numismate qui manie une médaille à fleur de coin, de l’archéologue qui contemple une stèle antique, du fleuriste qui s’hypnotise devant un œillet triplé. Quelque chose ennoblissait dans cet aimable Dom Casalta cette fièvre maniaque du collectionneur. Il était prêtre, et le sanctuaire où il disait sa messe chaque jour depuis quarante ans ne lui représentait pas seulement un bel édifice. Son être entier, à cette minute, faisait un commentaire vivant à la phrase du psalmiste : « Seigneur, j’ai aimé la maison où vous demeurez, et le lieu où réside votre gloire… » Je compris dès cette seconde, qu’avec toute sa finesse de rustaud, Bonciani n’avait su ni démêler la vraie nature de cet homme, ni me la faire deviner. J’avais devant moi un cas très extraordinaire de passion, celle d’un desservant génial pour sa chapelle, passion très étrange, très particulière, comme il a dû s’en produire par centaines au moyen âge. Ainsi s’expliquent la fondation et l’achèvement de tant d’édifices magnifiques à travers de tels obstacles. Sur la fin du dix-neuvième siècle, ces ferveurs-là sont plus rares. Aussi écoutais-je avec un intérêt de curiosité vivement excité ce vigoureux et radieux vieillard m’ouvrir ingénument son cœur, comme il faisait sans doute à tout passant venu dans sa solitude :
— « Regardez bien la statue de la Madone sur le tympan du porche », disait-il, après m’avoir détaillé les crocodiles et les léopards, un par un, « celle qui tient l’enfant à distance, et qui hanche, en se rejetant, comme ceci… C’est un chef-d’œuvre de l’école pisane, et, pour moi, une statue de Nicolas de Pise lui-même, quand il travaillait à la chaire de Sienne… Vous voyez les grands traits sévères de la Vierge, et comme elle est triste de ce qu’elle pressent, comme elle respecte aussi le Sauveur dans l’enfant ?… On l’avait enlevée d’ici, monsieur, le croiriez-vous ? et vendue !… Elle avait fini par échouer au musée du Bargello, à Florence. Heureusement, celui qui l’avait volée était, malgré ce vol, un bon chrétien. À son lit de mort, vingt ans après la disparition de la statue, il a chargé son fils de venir me dire son crime et à qui il avait cédé la Madone. C’était avant moi, vous savez, ce larcin. Mon pauvre prédécesseur – Dieu ait son âme – ne se souciait pas beaucoup des objets d’art… Enfin !… Je débarque chez le brocanteur de Lucques qui avait acheté la Madone au paysan… Il commence par nier. Il ne se rappelait plus, après tant d’années. Il finit par faire l’insolent… Nous étions seuls dans la boutique. Je le prends par le bras et je le soulève de terre en lui montrant la fenêtre : Si tu ne me dis pas la vérité, tu es mort… Ah ! j’étais robuste, alors », – et il riait gaiement de ses trente-deux dents, conservées malgré l’âge. « Je ne lui aurais rien fait, bien sûr, et c’était une menace pour l’épouvanter. C’est permis, un mensonge comme celui-là, pour le service de Dieu, n’est-il pas vrai ?… Le brigand a peur et il avoue… La Madone était au Bargello… Au Bargello ! Comment la ravoir jamais ?… Je prends le train pour Florence, où je savais trouver la princesse Marguerite, qui est notre reine à présent. On m’avait dit qu’elle aimait les arts. Je vais droit à son palais. Je demande à lui parler. On me renvoie. Après toutes sortes de difficultés, je finis par être introduit. Je lui raconte mon histoire, comme je viens de vous la raconter. Elle rit, et, huit jours plus tard, la Madone était revenue. Cette fois, elle tient aux pierres, et les voleurs ne me la descelleront pas, je vous jure. C’est moi qui ai mis le ciment, de mes mains… »
Il les montrait avec orgueil, ces mains d’ouvrier sacré, de fortes mains aux doigts longs et d’une spiritualité singulière, malgré les petits nœuds rhumatismaux des jointures. Comme il se taisait, en contemplant la Vierge pisane, pareille dans sa rudesse triste aux sarcleuses ou aux bergères de notre Millet, une autre personne parut sur le seuil du presbytère, une toute jeune fille, de vingt ans peut-être, frêle et jolie, avec un teint d’une pâleur fiévreuse et une envolée de fins cheveux, couleur de cendre, sous un chapeau rond, de paille très souple, à fond minuscule et à larges ailes flottantes. Elle tenait à la main un autre chapeau, celui de l’archiprêtre, et elle l’interpellait sur un ton de reproche soumis et affectueux :
— « Dom Casalta, c’est la signorina Bice qui m’envoie vous dire que ce n’est pas prudent d’être au soleil la tête nue… Prenez votre chapeau, vite, vite. »
— « Et c’est pour cela qu’elle te fait quitter ta dentelle, ma pauvre Pia ? Ce n’était pas la peine. Nous allons entrer dans l’église… N’est-ce pas, monsieur ? » ajouta-t-il en se tournant vers moi. « Et puisque tu es là », – cette fois il parlait à la jolie jeune fille, – « apporte-nous la clef de la chapelle du fond… » Et de nouveau m’interpellant : « C’est ma petite élève », fit-il, « une enfant d’ici… Vous pouvez voir la ferme où loge son père, là-bas, tenez, à cent mètres, cette maison entre ces cyprès par delà une petite chapelle, un des reposoirs des moines quand il y avait un couvent ici. Tout a disparu, excepté cet édicule… Pia ! Elle est bien nommée, allez. Elle aime son San Spirito autant que moi, et intelligente !… C’est avec son aide que j’ai refait l’autel que vous allez voir… Ah ! Elle a du mérite, beaucoup de mérite. Il lui est arrivé une de ces disgrâces qui sont aussi de bien grands dangers. Une dame riche, une comtesse qui a un château près de Gambassi, de l’autre côté de ces collines, l’avait remarquée, voilà cinq ans, et emmenée à Rome. La Pia est si fine, si délicate. La comtesse, qui n’avait pas d’enfants, voulait l’adopter. Pendant trois années, la petite a vécu da contessina », – comment traduire derechef cet italianisme ? – « Et puis la comtesse est morte subitement. A morte improvisâ, libera nos, Domine… » Il se signa. « Elle n’a pas fait de testament. Les héritiers, qui jalousaient la pauvre Pia, l’ont renvoyée dans sa famille sans un sou. Monsieur, vous pouvez penser combien elle a souffert. Ses parents sont de très braves gens, mais elle était devenue une vraie dame… Enfin, le bon Dieu a eu pitié d’elle, parce qu’il a vu comme elle aimait San Spirito. On la laisse passer toutes les journées chez moi pour soigner l’église, et elle est mieux que résignée, elle est heureuse. C’est ici sa vraie maison, et elle aussi peut dire en parlant d’elle-même : Ecce ancilla Domini… »
Nous étions entrés, comme il tenait ce discours, dans l’intérieur de la petite église. C’était une construction à trois nefs, dont les murailles avaient dû autrefois être peintes à fresque d’une extrémité à l’autre : un pan, à côté de la porte, montrait encore de vagues formes coloriées. Une incurie de plusieurs siècles avait laissé cette décoration se dégrader. Maintenant, ces longues murailles se développaient vides et toutes blanches. Les vitraux des fenêtres avaient été remplacés par des carreaux dépolis qui filtraient un jour neutre et gris, – mais cette clarté sobre convenait bien à ce pauvre temple dénudé, dont la dernière splendeur consistait en une suite de colonnes de marbre, évidemment arrachées à quelque temple païen, et presque toutes différentes de grandeur, de style, de matière. L’architecte du huitième siècle les avait utilisées, telles quelles, en exhaussant ou abaissant leurs bases. La plupart étaient de porphyre, quelques-unes de granit, d’autres de marbre blanc ou de bresche verte. Aucun des chapiteaux ne ressemblait exactement à un autre, quoique presque tous trahissent leur origine romaine. Des volutes, des oves, et des perles ioniques s’y mélangeaient aux feuilles d’acanthe corinthiennes. L’autel, isolé au milieu de l’abside semi-circulaire, se dressait en arrière des deux ambons. La mosaïque des colonnettes de son baldaquin, exécutée dans le goût des Cosmates, attestait, elle aussi, l’ancienne magnificence de San Spirito in Val d’Elsa. Ainsi dépouillée de la parure de tableaux, de statues, de bas-reliefs, de métaux ciselés et d’étoffes qui en Italie fait un musée de chaque église, celle-ci apparaissait vêtue de la seule beauté de ses lignes. Le plan sévère de la basilique primitive s’y révélait, dégagé de toute surcharge. Il avait fallu, pour la ramener à cette sorte de schéma idéal, le plus patient et le plus intelligent travail. L’archiprêtre y avait dépensé quarante années. Et, jouissant de mon admiration pour ce qui avait été l’œuvre de son existence, sa poésie, son amour, il continuait son monologue :
— « Quand je suis venu ici pour la première fois, il y a bien longtemps, en 1845, nommé par hasard, j’ai pleuré de chagrin, oui, monsieur, j’ai pleuré, et de vraies larmes, devant la ruine qu’était cette belle chose… Ce mur à gauche avait une lézarde qui descendait jusqu’au pavé. Il a fallu le reprendre depuis le bas. Maintenant un tremblement de terre ne le secouerait seulement plus… Toutes les solives ont été changées là-haut, toutes… Et les ambons… Voyez la délicatesse de cette figure de paon qui marche parmi ces feuillages et ces raisins. Savez-vous où j’ai retrouvé cette pierre, que des barbares avaient arrachée ? Pourquoi ? – Je vous le demande. – Elle faisait la margelle d’un puits, dans notre campagne. Tenez, on reconnaît la trace des deux cordes qui servaient à tirer les seaux… Et ces mosaïques dans les parties évidées de ces jolies colonnettes torses ? C’est la Pia et moi qui les avons restaurées, petit carré par petit carré… Mais voici la Pia elle-même, monsieur, avec les clefs ; venez jusque dans l’abside. Vous verrez la merveille des merveilles, une voûte que vous couvririez tout entière de pièces d’or, sans la payer ce qu’elle vaut… »
La jeune fille, dont l’archiprêtre m’avait esquissé la touchante histoire, arrivait, en effet, mais la tête nue, à présent, – une adorable tête un peu longue et dont la forme grecque se devinait sous ses cheveux blonds, simplement séparés au milieu par une raie et sans une frisure. Elle apportait une clef dont la tige était deux fois plus grosse que ses doigts, rendus plus fins encore par des mitaines en fil de nuance bise. Cette petite coquetterie de parure, l’extrême propreté de la simple robe en laine verte, sur laquelle tranchaient une collerette et des poignets de dentelle certainement faits par elle-même, les galons noirs cousus au bas de la jupe, tout révélait, dans cette enfant de pauvres fermiers qui avait traversé une vie si différente de sa vie actuelle, un souci de ne pas trop déchoir. La modestie de son virginal visage, le regard réservé de ses yeux d’un gris doux, la grâce un peu farouche de chacun de ses gestes, faisaient aussitôt comprendre que ce naïf effort d’élégance était pour elle seule. Aucune coquetterie ne l’avait guidée dans ces soins. On devinait, rien qu’à la voir marcher sans bruit, de son pas léger et souple, une créature d’une distinction innée. La grossièreté de son milieu natal aurait trop justifié chez elle la révolte contre l’injuste sort. Mais non. Une sérénité pieuse et gaie émanait au contraire de tout son être. C’était vraiment la petite Servante du Seigneur, comme l’avait saluée Dom Casalta, Marthe et Marie à la fois : celle qui s’évertue, préparant chaque chose dans la maison, et celle aussi qui écoute la parole du Maître. Dès cette première rencontre, le secret de cette destinée se fit perceptible pour moi jusqu’à l’évidence. Par un de ces prestiges qu’exercent les sentiments très sincères, l’archiprêtre avait insufflé à cette Pia, la bien nommée, – comme il avait dit encore, – l’amour passionné voué par lui à son église. Pour le grand artiste inédit qu’était ce Toscan de pure race, la conservation de San Spirito, de ce joyau d’architecture, avait représenté un roman vécu, un poème réel, une longue extase imaginative, entretenue quarante ans durant, et ce roman se continuait dans l’élève du vieillard, ce poème était devenu celui de la fine paysanne, rejetée, après les périlleuses gâteries de sa mère adoptive, dans les médiocrités de la chaumière paternelle. Cette extase d’un culte, poussé jusqu’à la ferveur, pour une belle chose d’art dont on a la garde, illuminait également les prunelles de l’initiée et de l’initiateur. Je crois les revoir, ces deux visages, celui de l’archiprêtre et celui de son acolyte, se levant, une fois la grille de l’abside ouverte, avec la même idolâtrie, vers la merveille annoncée, « qu’il aurait fallu couvrir de pièces d’or, avant de la payer ». C’était une voûte entièrement composée de caissons en terre cuite, chacun exécuté sur un moule différent, et d’une originalité de décoration que les mots ne peuvent pas rendre : des corolles de fleurs fantastiques s’y entrelaçaient à des fruits irréels, des feuillages de songe s’y mariaient les uns aux autres en reliefs adoucis par des teintes adorablement nuancées. Et Dom Casalta reprenait :
— « Voilà le chef-d’œuvre du Cieco. Connaissez-vous les vers qu’il a mis au bas du buste de son Élisa ? – Jean, l’aveugle et qui aimait Élisabeth, – l’a sculptée ainsi d’après l’idée que lui en donnait l’amour[1]. Et ces fleurs aussi, ces feuillages, c’est le grand amour qu’il avait des choses créées par Dieu qui les lui a fait voir et sculpter ainsi… Ah ! Ces malons de terre cuite ! Ils nous ont donné plus de peine encore que les colonnettes cosmates de l’autel… Nous avons dû, la Pia et moi, les repasser, moulure par moulure… Nous y avons employé seize mois… À la fin, les yeux me manquant, c’est elle qui a tout fait. Il fallait la voir, debout, sur l’échelle là-haut, à dix mètres… Elle avait le vertige d’abord. Elle l’a dompté, – n’est-il pas vrai, Pia ?… »
— « C’était la besogne du bon Dieu. Je n’avais pas peur », répondit la jeune fille, qui rougissait d’être interpellée ainsi devant un étranger. Il y avait dans ces mots une profondeur de foi d’autant plus touchante, que l’accent étouffé dont ils étaient prononcés dénonçait une si craintive timidité. Avait-elle dû frissonner de cette peur, dont elle se défendait, la frêle enfant, tandis qu’elle exécutait, pendant des heures et des heures, cette besogne périlleuse, loin du sol et avec le vide autour d’elle, au-dessous, partout ! Je la regardais regarder la voûte dont je mesurais mentalement l’effrayante hauteur. Ses délicates paupières battaient un peu, son souffle se faisait plus court, comme il arrive au souvenir d’un danger passé qui nous saisit d’une émotion rétrospective, et elle avait un sourire d’une douceur fière à l’idée de son propre héroïsme, tandis que Dom Casalta, avec ce pouvoir de penser par images, inné dans cette race où la spiritualité même s’anime et se sensualise, commentait le mot de son élève :
— « C’est vrai : nous sommes tous d’argile et Dieu est le grand potier. Il ne casse ses vases qu’à sa volonté… Mais », insista-t-il, « je vous offre, monsieur, une bien pauvre hospitalité. Vous reverrez l’église tout à votre aise, car je vois que vous êtes connaisseur. Auparavant, il faut vous restaurer… Vous allez boire du vin de mon jardin. » Son rire s’était fait naïvement, enfantinement orgueilleux, pour dire ces mots de propriétaire : il mio orto… « Mon jardin », répéta-t-il, « c’est une treille contre le presbytère, dont nous coupons les raisins, la Pia et moi, à l’automne, et c’est elle qui me fait ce vin… Oh ! pas beaucoup ! Nous avons beau être de Toscane ; nous ne sommes pas de ceux qui disent : bois du vin et laisse aller l’eau au moulin… Mais un verre du vin de San Spirito, c’est de la jeunesse pour toute la journée, et l’église est si fraîche qu’il faut vous réchauffer. Vous n’y êtes pas habitué… Nous, en été, la Pia et moi, nous avons ici des heures délicieuses. L’air n’y est jamais plus chaud que maintenant, et, en hiver, jamais plus froid… Allons… Mais, auparavant, regardez cet effet des deux colonnes de porphyre près des fonts. Quelle pureté de lignes ! C’est le pur chapiteau ionique. Un professeur allemand est venu ici, qui croit que San Spirito était d’abord un temple d’Apollon… Dans ce cas, monsieur, notre basilique serait la plus vieille de la province… »
Le digne homme aimait si partialement son église qu’il racontait cette origine païenne avec la même exaltation qu’il avait mise, tout à l’heure, à me célébrer le génie du Cieco ! Cependant nous étions arrivés devant une petite porte qui communiquait directement avec le presbytère. Le temps de gravir quelques marches creusées par l’usure, de tourner dans un corridor, nous débouchâmes dans une pièce très haute et très claire, qui servait de salle d’étude à l’archiprêtre. Tout, dans cette chambre, racontait cette dévotion à San Spirito in Val d’Elsa, qui avait soutenu et enchanté cette existence, si humble dans son décor, si romanesque dans son ardeur intime. La bibliothèque était remplie de hauts volumes dont le format seul dénonçait des ouvrages relatifs aux beaux-arts. Une table d’architecte, dressée sur des tréteaux, montrait des lavis et des épures, avec un arsenal d’équerres, de règles, de compas, de bâtons d’encre de Chine, de godets et de pinceaux. Aux murs étaient suspendues des photographies et des gravures représentant le plan, la silhouette ou les détails des basiliques contemporaines de celle-ci : le San Giorgio de Valpolicella, la Santa Teutaria de Vérone, le San Salvatore de Brescia, la Santa Maria de Pavie, qui fut longtemps « Sainte Marie hors de la Porte » et qui est devenue « Sainte Marie des Chasses », et, de Rome, la Santa Maria in Cosmedin, San Saba, San Clemente, Santa Prassede… Que sais-je ? – On pense bien que ma pauvre instruction d’homme de lettres ne va pas jusqu’à reconnaître, ni jusqu’à connaître, les divers spécimens du vieil art roman épars sur la terre italienne. Mais j’entends encore Dom Casalta me nommant, les uns après les autres, ces vénérables sanctuaires, et il concluait :
— « Tous, je les ai tous vus de mes yeux. Vous pouvez m’en croire. Je suis bien désintéressé. Il y en a de plus riches que San Spirito, de plus ornés, de mieux conservés. Il n’y en a pas un qui donne une impression d’une beauté plus pure… Et il n’y en a pas un qui ait autour de lui ce paysage. » Par la fenêtre grillée, il me montrait la douce vallée de l’Elsa, où les ombres commençaient de grandir. Une lumière transparente et divinement pure descendait sur la terre brune, sur les oliviers d’argent, sur l’eau verte de la rivière et sur les hauts cyprès noirs, près de la chapelle, qui cachaient la ferme du père de la Pia. Cela émanait du ciel bleu comme une caresse, comme une bénédiction. Je me retournai vers le vieillard. Sa noble figure était en harmonie avec ce calme horizon devant lequel il avait passé tant d’heures. La jeune fille entrait, tenant aux mains un plateau avec deux verres et des tranches de ce gâteau noir qu’on appelle à Sienne du panforte. Une vieille femme la suivait, que je reconnus, à la ressemblance, pour la sœur de mon hôte, cette demoiselle Bice dont le nom avait été prononcé tout à l’heure. Elle avait le flacon du précieux vin. Qu’elle était âgée et cassée ! Mais elle aussi souriait à l’étranger d’un sourire ami.
— « C’est ma sœur », me dit l’archiprêtre. « Elle a quatre-vingts ans depuis la Saint-Sylvestre. C’est un grand âge… Malheureusement elle est sourde. Elle qui aimait tant causer !… Que voulez-vous ? Dans ce monde il faut s’adapter, s’enrager ou se désespérer… Elle s’adapte. C’est un ange de Dieu pour la patience… Sans elle, et si elle n’avait pas tenu ma maison comme elle l’a fait, je n’aurais pas pu mettre à San Spirito tout l’argent que j’y ai mis… Et elle a eu du mérite, car je dois reconnaître qu’elle n’a jamais compris la beauté de cette église. Elle ne s’y entend pas aux choses d’art, excepté pour la musique. Elle chantait. Ah ! Si vous l’aviez entendue entonner à la Pentecôte le Veni sancte… Bon ! prenez le verre qu’elle vient de vous remplir. Sans cela elle me grondera, parce qu’en bavardant je vous empêche de boire. »
Donna Bice avait débouché la bouteille de sa main toute tremblante et commencé d’en verser le contenu. La Pia me tendait le plateau ; je pris le verre où tremblait une liqueur de topaze, un de ces vins comme j’en buvais, petit garçon, en Auvergne, dans une vieille et douce maison de Combronde, et qui, fait avec des raisins conservés au grenier, s’appelait là-bas vin de paille. Quelle association d’idées éveillait en moi ce chaud et un peu âpre breuvage, retrouvé à une telle distance du pays où j’ai grandi ! Je n’eus pas le temps de m’y livrer, car à la minute où je portais le verre à mes lèvres, j’aperçus, sur le bureau où écrivait d’habitude l’archiprêtre, un objet qui me fit m’écrier aussitôt. Ce n’était qu’un petit panneau de bois peint, qui représentait évidemment une scène empruntée au Livre de Tobie. Quatre personnages la composaient : un ange allait vêtu en chevalier tenant d’une main une épée, de l’autre une boule ; un second ange suivait en robe longue, sa droite portait un coffre de médecine, tandis que sa gauche soutenait un jeune homme en costume de voyageur et chargé d’un poisson ; un troisième ange fermait la marche avec un lys dans ses doigts. Un chien jappait parmi eux, celui dont parle la Bible, et qui courut le premier avertir le père aveugle. Un paysage de terres ravinées, comme on en voit dans cette partie de la Toscane, faisait à ces personnages, merveilleusement enluminés, un fond fauve sur lequel s’enlevaient en pleine vigueur le bleu intense, le rouge profond, l’orange pâle et le vert très doux des vêtements, l’or des auréoles et celui des armures. Si je ne suis pas assez bon archéologue pour distinguer au premier regard une basilique du huitième ou du neuvième siècle, j’avais, dès lors, étudié assez longtemps les maîtres de Sienne, à la Pinacothèque, sous la direction du seigneur Amilcare, pour reconnaître à l’examen, dans cette adorable peinture, le faire d’un artiste de cette école. Un détail me permit même de discerner presque aussitôt que l’auteur était Francesco di Giorgio ou Neroccio : l’ornementation des genouillères et des brassards où se voyaient de minuscules têtes de chérubins ciselés en or sur l’acier du métal. C’est une décoration habituelle à ces deux peintres pour tous leurs anges en armure. Une autre particularité acheva de me renseigner sur l’origine de ce panneau : les quatre blasons peints dans la partie d’en bas, avec la date 1471.
— « Mais », fis-je involontairement et sans réfléchir à ce que ces mots techniques et d’une érudition si spéciale avaient d’inintelligible pour mon hôte : « c’est une couverture d’un livre de biccherna… » Et, voyant son étonnement : « Oui, ce petit panneau a dû servir de reliure à un compte de douanes ou de gabelles. On appelait à Sienne ces sortes d’impôts de ce nom de biccherna, et ceux qui examinaient les comptes de ces impôts, s’appelaient les camerlingues de biccherna. C’étaient toujours de grands seigneurs, très riches, et ils avaient l’habitude de faire chaque année relier le cahier qui contenait ces comptes entre deux panneaux de cette dimension. La décoration de cette reliure était confiée aux meilleurs artistes. C’est une des particularités de l’histoire de Sienne, cette coutume. Quand vous irez aux archives de cette ville, vous verrez des livres de biccherna, au nombre de cent ou cent cinquante, ceux que l’on a pu ramasser, décorés ainsi sur leur reliure, par Sano di Pietro, par Matteo, par Lorenzetti, par Duccio… Ce panneau-ci est d’un maître excellent… » Je nommai les deux peintres auxquels je songeais. « Au-dessous, voilà les blasons des camerlingues de cette année-là… J’ai vu beaucoup de ces petits tableaux. J’en ai rarement rencontré un plus fin de ton, plus ingénieux de composition, mieux conservé… »
— « Vous êtes bien sûr de ce que vous me dites là, monsieur ? » fit l’archiprêtre après un silence durant lequel il étudiait la mystérieuse peinture. Son expressif visage avait traduit, en m’écoutant, un intérêt passionné.
— « Parfaitement sûr », répondis-je, « et bien par hasard, car ma science est toute récente. Avant-hier, mon ami M. Martini, le conservateur du Musée, me montrait cette collection des tablettes de biccherna