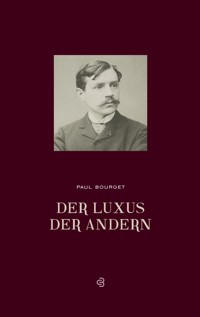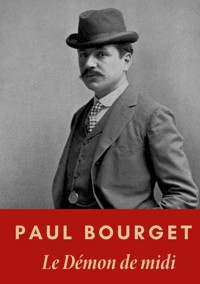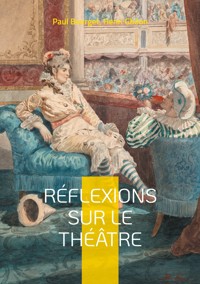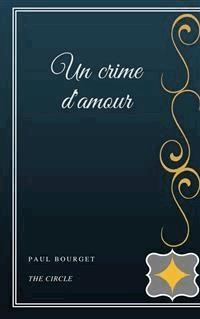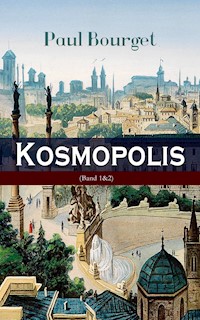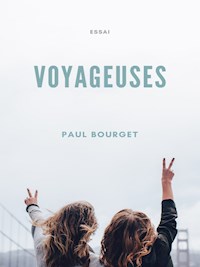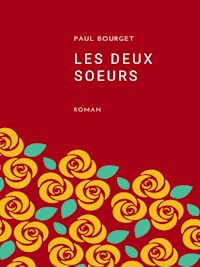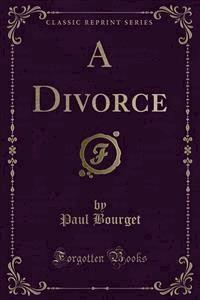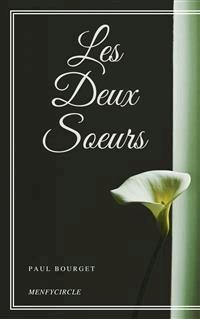3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Renée, tombe amoureuse de Neyrial, maître de danse dans un hôtel de la Riviera, qui est également très attiré par la jeune femme... Mais ce dernier a un passé suspect. Autrefois il était employé chez un avocat,lequel était aussi un bibliophile passionné, et il a volé quelques volumes en éditions rarissimes. Le vol étant découvert, Neyrial (de son vrai nom, Pierre-Stéphane Beurtin) a du partir...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Le Danseur Mondain
Le Danseur MondainIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPage de copyrightLe Danseur Mondain
Paul Bourget
À MONSIEUR GUSTAVE MAÇON
Amical souvenir de son voisin
du Pavillon d’Enghien à Chantilly.
P. B.
I
– « Voulez-vous nous rejouer ce Fox-blues, mademoiselle Morange ? » dit le maître de danse à la jeune femme assise au piano dans le petit salon d’hôtel qui servait à cette leçon. « Et vous, mademoiselle Favy, » – il s’adressait à son élève, – « nous reprenons ?… Plus vivement, cette fois. Rappelez-vous : Ne pas briser l’élan. La marche moins raide que dans le One Step. Des pas de côté, un en avant, légèrement fléchis, un peu élancés. Donner l’impression d’un oiseau qui va s’envoler. Ça, c’est bien, très bien. Ne pliez pas le genou… »
Et les deux jeunes gens glissaient, étroitement enlacés, au rythme de la musique, – cette musique précipitée et monotone, mélancolique et saccadée, qui caractérise les danses d’aujourd’hui. Depuis la guerre de 1914 et sa longue tragédie, il y a de la frénésie et de la tristesse, à la fois, dans les moindres gestes d’une société trop profondément ébranlée. Même ceux qui ne devraient, comme une sauterie dans un bal, n’être qu’un plaisir et qu’une détente, sont touchés de névropathie. Un ruban, noué à la boutonnière du veston ajusté du maître de danse, attestait que, peu d’années auparavant, – on était en 1925, – il prenait part en effet à cette terrible guerre et s’y distinguait. Ce martial épisode semblait bien absent de son visage, très viril certes dans sa joliesse, mais comment concilier de sanglants et sinistres souvenirs avec l’espèce de frivole ferveur qu’il mettait à conduire les pas de son élève : une jeune fille de vingt ans, souple, mince, et dont les traits délicats étaient comme éclairés par des prunelles bleues d’une intensité singulière ? Ce couple élégant, agile, uni dans un accord balancé de tous les mouvements, allait et venait ainsi, dans le décor banal et faussement stylisé de ce salon d’un hôtel de la Riviera, ouvert largement sur un lumineux et grandiose paysage.
La baie d’Hyères se développait, encadrée d’un côté par le sombre massif des Maures, de l’autre par les montagnes de Toulon, et fermée par les îles que les Grecs appelaient jadis les Stoechades, les « rangées en lignes ». À la pointe de l’une, celle de Porquerolles, surgissent les récifs des Mèdes, Mediae Rupes, – les Roches du Milieu. Ce nom justifiait celui de l’hôtel, britanniquement et barbarement baptisé Médes-Palace. Il était situé sur une hauteur, à mi-chemin entre la ville d’Hyères et la rivière du Gapeau.
Par ce clair et tiède matin du mois de mars, cet immense horizon était admirable de splendeur et de grâce. Le sombre azur de la mer, doucement marié au bleu plus léger du ciel, s’apercevait par delà le floconnement argenté des vastes champs d’oliviers qui dévalaient jusqu’au rivage, et, tout près, c’était le jardin de l’hôtel, fraîche oasis de palmiers et d’eucalyptus entre lesquels foisonnaient des roses et des mimosas en pleine floraison. Comme ce salon servait aux leçons du danseur professionnel de l’établissement, le milieu en était vide. L’anglomanie qui avait présidé à l’appellation du Palace se reconnaissait à la forme des fauteuils et des chaises, évidemment commandés outre-Manche et qui plaquaient leur massif acajou contre les murs, décorés eux-mêmes de gravures anglaises. Il semblait paradoxal qu’il y eût à cette minute, dans ce coin londonien, quatre personnes de nationalité française : Mlle Morange la pianiste, le maître de danse et son élève, une femme plus âgée enfin, qui était la mère de la jeune fille. Leur seul aspect le disait assez et cette ressemblance des physiologies qui décèle une analogie profonde des natures. Chez l’une et chez l’autre, une extrême sensibilité nerveuse se reconnaissait à vingt petits signes identiques : à la finesse des linéaments du visage, à celle des pieds et des mains, à la mobilité tour à tour et à la fixité de la bouche et du regard, à la gracilité fragile de tout l’être. Mais la flamme de la vie était intacte chez la jeune fille. Autrement, se serait-elle prêtée avec cette ardeur gaie à l’enfantin plaisir de cette leçon de danse ? Mme Favy, elle, donnait, au contraire, l’idée d’un organisme usé, avec la pâleur de son visage amaigri taché de rouge aux pommettes. Son souffle, par moments si court, et la légère saillie de ses yeux trop brillants, comme il arrive dans certaines névroses du cœur, dénonçaient une maladie chronique, et aussi le léger tremblement de ses doigts, aux ongles cyanosés, qui s’occupaient en ce moment à tricoter une casaque de laine, destinée sans doute à quelque vente de charité. Étendue parmi des coussins, sur une chaise longue en paille, apportée pour elle du jardin, elle relevait sans cesse la tête et abaissait son ouvrage, pour se caresser avec tendresse à la gracieuse vision de sa charmante enfant, naïvement amusée de ces tournoiements et de ces pas rythmés sous la main conductrice du maître. La musicienne, elle aussi, regardait, dans la haute glace placée au-dessus du piano, l’image mouvante du jeune couple, avec une tout autre expression d’amertume et de déplaisir. Elle était jolie également, mais son masque sans jeunesse, quoiqu’elle eût à peine vingt-sept ans, disait la mélancolie d’une destinée sans horizon, emprisonnée dans des conditions trop dures. Elle tenait, au Mèdes-Palace l’emploi de danseuse professionnelle. Sachant l’un et l’autre un peu de musique, elle et son camarade se rendaient le service de s’accompagner dans leurs leçons, quand ils pouvaient, afin d’épargner à leurs élèves et de s’épargner l’assourdissement du gramophone.
– « Cette fois, » dit le maître de danse, le piano à peine arrêté, « ça y est. Vous n’avez pas fait une faute, mademoiselle Favy. »
– « Savez-vous que nous avons joliment travaillé ce matin, monsieur Neyrial ? » répondit la jeune fille, en riant, « Scottish espagnole, Paso doble, Java, et, pour finir, Fox-blues, c’est quatre danses que j’ai bien dans les jambes maintenant. Je continue à préférer le Tango. Ces airs espagnols sont si prenants ! On les sent passer dans ses gestes. Ce n’est pas comme la Samba. »
– « Moi non plus, » fit le jeune homme, « je ne l’aime pas beaucoup. Tournée, pourtant, elle a son charme. Sautée, elle devient trop vite excentrique. »
– « À la bonne heure, » dit Mme Favy, qui se relevait de sa chaise longue, aidée par sa fille. « Voilà ce que j’apprécie en vous, monsieur Neyrial. Vous gardez du goût dans ces danses modernes. Elles en manquent si facilement ! »
– « C’est que je considère la danse comme un art… » répondit vivement Neyrial. « La danse, c’est le rythme, c’est la mesure, c’est la beauté du mouvement, ce que mademoiselle vient de dire si justement, de la musique gesticulée. »
– « Quel dommage ! » repartit Mme Favy, « que tous vos confrères ne pensent pas de même ! Je vous avoue, quand Renée m’a demandé à prendre des leçons avec vous, j’ai eu un peu peur. Pensez donc. De mon temps, nous ne connaissions que le quadrille, la polka, la valse… »
– « Je vous l’ai dit aussitôt, maman, » interjeta la jeune fille, « qu’avec M. Neyrial, ces danses d’aujourd’hui, qui vous déplaisent tant, s’ennoblissaient, s’idéalisaient… »
– « J’aime mon art, mademoiselle, » fit Neyrial en reconduisant Mme Favy et son élève jusqu’à la porte, « et, ce que l’on aime vraiment, on le respecte. »
Les deux femmes étaient à peine sorties de la pièce que la pianiste, à demi tournée sur son tabouret, disait, avec une ironie singulière, au jeune homme en train d’allumer une cigarette :
– « Vous n’avez pas honte de lui servir de ces boniments, à cette pauvre petite ? »
– « Quels boniments ? » répondit-il.
– « J’aime mon art… Tout ce qu’on aime, on le respecte… »
Son accent se faisait de plus en plus railleur pour répéter les paroles de son camarade en contrefaisant son accent, et elle insistait :
– « Voyons. Nous nous sommes mis danseurs mondains, vous et moi, dans les hôtels, parce que nous savions bien danser et que nous n’avions pas le sou. Vous en profitez pour avoir des histoires de femmes. Tant qu’il s’agit de personnes qui ont de la défense, rien à dire ; mais bourrer le crâne à une jeune fille, quand on ne peut pas l’épouser, ce n’est pas propre, et vous ne pouvez pas l’épouser. Jamais le colonel Favy, professeur à l’École de guerre et qui sera demain général, ne donnera sa fille à un danseur d’hôtel. Il n’est venu ici que peur vingt-quatre heures. De le voir passer m’a suffi pour le juger. À vous aussi. Rappelez-vous. Il y avait un thé-dansant ce soir-là. La petite et sa mère n’en manquent pas un. Ont-elles paru ? Non. À cause du père évidemment… »
– « Vous voilà encore jalouse », dit Neyrial. « Vous n’en avez pourtant pas le droit. Répondez ai-je été loyal avec vous ? »
– « Très loyal, » fit-elle sur un ton de dépit qui ne s’accordait que trop avec la subite contraction de son visage aigu.
– « Quand vous m’avez rapporté, » continua Neyrial, « cette conversation, entendue par hasard, qui calomniait nos rapports, vous ai-je offert, oui ou non, de rompre mon engagement ici, et d’aller, à Tamaris, à l’Eden où j’avais, où j’ai encore une offre ? Vous m’avez prié de rester, en me disant que votre sympathie pour moi vous rendrait cette séparation pénible. Vous m’avez, à ce propos, fait cette déclaration très nette, je vous en ai estimée, qu’une fille, dans votre profession, ne devait pas se laisser courtiser. J’entends encore vos mots : le mariage ou rien. Nous avons convenu alors qu’il n’y aurait jamais entre nous qu’une bonne et franche amitié. Il exclut la jalousie, ce pacte, et c’est si propre, pour employer votre mot de tout à l’heure, une relation comme la nôtre, ce compagnonnage de deux artistes qui aiment profondément leur art… Vous allez encore parler de boniments… »
– « Dans ce moment-ci, non, » répondit-elle. « Ça n’empêche pas que j’avais raison tout à l’heure, et vous le savez bien… Mais voilà miss Oliver qui vient pour sa leçon. »
– « Vous n’allez pas de nouveau être jalouse ? Sinon… »
Il avait jeté cette phrase de taquinerie, en riant, cette fois, du rire d’un homme qui ne veut pas prendre au sérieux les sentimentalismes d’une femme qu’il n’aime pas. Ce fut de nouveau d’un accent très sérieux que Mlle Morange lui répondit :
– « Elle est bien belle, mais elle ne vous regarde pas comme l’autre, ni vous non plus… »
Une jeune fille entrait maintenant, qui offrait un type accompli de la beauté anglaise grande, énergique, assouplie par le sport, son teint de rousse fouetté par la brise de la mer. Ses cheveux coupés « à la Jeanne d’Arc » ou « à la typhoïde », comme disent indifféremment les coiffeurs d’aujourd’hui, lui donnaient un air garçonnier que son verbe haut et trop direct accusait encore. Sa jupe courte découvrait des mollets vigoureux comme ceux d’un coureur, et son corsage, presque sans manches, des bras tannés par le soleil, dont un boxeur eût envié la musculature. Quel contraste avec la frêle et mince Française qui s’essayait, dix minutes auparavant, à ce Fox-blues qu’elle dansait si finement, et, tout de suite, l’arrivante dit avec un accent, qui rendait plus excentriques les termes d’argot qu’elle croyait devoir employer pour « être à la page », – parlons comme elle :
– « Pas de Tango, n’est-ce pas, monsieur Neyrial. C’est moche, le Tango, vous ne trouvez pas ?… Un Two-steps d’abord, puis une Samba, mais sautée, pour gigolos tortillards. Que ce mot exprime bien la chose, pas ?… »
Et s’adressant à Mlle Morange qui attaquait le morceau demandé :
– « Parfait, mademoiselle. Rien que cet air me donne des fourmis dans les pieds… »
Les doigts de la pianiste continuaient de courir sur les touches, et plus allègrement, en effet, plus brutalement, comme gagnés par la vitalité de la jeune Anglaise. Celle-ci virevoltait aux bras de Neyrial, qui, lui aussi, avait changé. Son allure, à présent, se faisait aussi alerte, aussi trépidante qu’elle était réservée et mesurée tout à l’heure. Si la danse est un art, comme il disait, elle est également un sport. Il y a de l’athlétisme dans le métier de gymnaste que le jeune homme exerçait au bénéfice de cet hôtel, et c’était le sportsman qui dansait maintenant. Un témoin de deux leçons successives en fût demeuré saisi. À la façon dont il enserrait le corps de cette créature animalement robuste, à la pression de sa main appuyée sur cette taille presque carrée, il était visible qu’il se plaisait à partager sa fougue, comme tout à l’heure le nervosisme un peu mièvre de Renée Favy, et pas plus maintenant qu’alors, il ne cessait de garder au fond des yeux un je ne sais quoi de distant, de lointain, comme s’il assistait aux divers épisodes de son étrange vie, sans se donner tout à fait à chacun. Mais qu’il s’y prêtait complaisamment ! Comme il semblait ne faire qu’un avec sa véhémente partenaire, tandis qu’ils attaquaient tour à tour la Samba demandée après le Two-steps, un Shimmy après une Huppa-huppa, toujours plus fébrilement, sans que l’Anglaise prononçât d’autres paroles que des So nice et des Fascinating, jusqu’à un moment où l’apparition, sur le seuil de la porte, d’un jeune homme en vêtements de tennis, une raquette à la main, la fit arrêter son danseur !
– « Eh bien ! monsieur Favy », demanda-t-elle, « quel est le score ? »
– « Six deux, six quatre, » répondit l’arrivant.
– « All right ! » fit-elle gaiement, – et serrant les mains alentour avec une énergie presque masculine : – « Merci, mademoiselle Morange. Merci, monsieur Neyrial. Je vous retrouve au Golf cet après-midi, monsieur Favy ?… Je me sauve. Nous avons des personnes un peu formal au lunch. Il faut que je monte m’habiller plus vieux jeu. »
Et, riant de toutes ses belles dents, elle sortit de la pièce, suivie de Mlle Morange, à qui la seule présence du frère de Renée avait rendu son expression mécontente d’auparavant.
– « À deux heures, monsieur Neyrial, n’est-ce pas ? » avait-elle dit, en repliant sa musique et fermant le piano, « pour notre numéro. »
Pas un mot, pas un geste de tête à l’égard du nouveau venu, qui demanda, une fois les deux jeunes gens seuls :
– « Qu’est-ce que peut avoir contre moi Mlle Morange ? Je suis toujours correct avec elle, et quand il nous arrive de danser ensemble, je sens son antipathie. Vous me l’avez dit un jour, je me rappelle, et c’est si juste ça ne trompe pas, la danse. Rien ne révèle davantage le caractère des gens et ce qu’ils pensent les uns des autres. »
– « Elle est un peu sauvage, » répondit Neyrial. « Elle n’est pas contente de sa vie. Ça se comprend. Son père tenait un gros commerce. Il s’est ruiné. On l’avait élevée pour devenir une dame. Elle a besoin de gagner son pain, comme moi. Elle a pris le métier qu’elle a trouvé. Il y a deux différences entre nous. Elle a sa mère, à qui elle peut donner du bien-être, au lieu que moi, je n’ai plus de famille. Et puis, j’aime mon métier et elle subit le sien. Il est vrai que, pour une femme, ce métier est moins amusant. Nous, les hommes, nous ne sommes guère intéressants à étudier, tandis que chaque danseuse, c’est un petit monde. »
– « Et quelquefois mieux… » répondit Gilbert Favy, – et sur une protestation de l’autre : – « Mais oui, mais oui…, » insista-t-il, « joli garçon, comme vous êtes, distingué, vous devez en avoir eu des aventures !… Surtout qu’une femme dans un hôtel, c’est libre. Le mari est loin. On ne se retrouvera pas. Donc, pas de chaîne. Le caprice, dans toute sa fantaisie et sa sécurité. Il suffit de causer avec vous, deux ou trois fois, pour constater que vous n’êtes pas bavard. »
– « Et c’est pour cela que vous voudriez me faire parler ? Le futur diplomate s’exerce à son métier, qui consiste à surprendre les secrets des autres, en flattant leur vanité. »
– « Vous désirez bien tout de même que l’on sache que vous êtes un monsieur et que votre famille ne vous destinait pas à enseigner la valse-hésitation dans les palaces ?… Mais, pardon, » – et il eut un geste caressant, – « me voilà en train de vous froisser, et, jugez si je suis un mauvais diplomate, au moment où j’ai un service à vous demander… »
– « J’espère que ce n’est pas le même que celui de l’autre jour ? »
« – Eh bien ! si, » répondit Gilbert Favy.
Une expression d’anxiété, presque d’angoisse, contractait ses traits, tandis qu’il continuait :
– « Vous ne savez pas ce que je traverse, depuis ces trois jours !… »
– « Vous avez encore joué ? » interrogea Neyrial. « J’espérais que non, en vous voyant passer ces dernières soirées dans le hall, en compagnie de madame votre mère et de Mlle Renée… »
– « C’est dimanche que ça m’est arrivé.
J’étais allé au Casino, pour le concert, simplement. D’avoir dû vous emprunter de l’argent, une fois déjà, m’avait été si pénible ! Ça m’est si pénible, en ce moment, de vous parler comme je vous parle Un Américain tenait la banque et perdait tout ce qu’il voulait. La tentation me prend. Je me rappelle ma chance de la semaine dernière, qui m’a permis de vous rendre ce que je vous devais, aussitôt… Je risque vingt francs d’abord… »
– « Et puis vingt autres, et puis cent, et c’est vous qui perdez tout ce que vous ne voulez pas, » interrompit Neyrial, « et maintenant, vous n’avez plus qu’une idée : retourner là-bas, prendre votre revanche… »
– « Oh » fit Gilbert, « si ce n’était que cela ! »…
– « Quoi alors ? Que se passe-t-il ?… »
– « Il se passe que le délire du jeu m’a grisé. On m’avait raconté qu’un des employés, – on me l’avait nommé, – prêtait de l’argent aux décavés qui présentaient des garanties sérieuses. Je me suis adressé à lui. J’ai eu mille francs. Je les ai perdus encore. Je me suis engagé par écrit, à les lui rendre dans la semaine. C’était dimanche, je vous répète, il faut que je les aie pour dimanche prochain au plus tard. Pouvez-vous m’aider ?… »
– « Je ne veux pas vous aider, » répondit Neyrial, en insistant sur ce : je ne veux pas. « Votre dette réglée, c’est le Casino de nouveau ouvert, d’autres parties en perspective, et d’autres pertes, plus graves peut-être… »
– « Mais si je ne les rends pas, ces mille francs, à la date fixée… »
– « Vous les rendrez plus tard, semaine par semaine, sur votre pension. »
– « Et si mon prêteur s’adresse à ma mère ? Malade du cœur comme elle est, à la merci des moindres émotions… »
– « Il ne s’adressera pas à elle. Le Casino défend expressément à ses employés d’avancer de l’argent aux joueurs. Madame votre mère parlerait, et cet homme serait renvoyé. Non, il sait qui vous êtes. Il sera parfaitement sûr que le fils du colonel Favy paiera aux échéances convenues, d’autant qu’il ne manquera pas de vous demander des intérêts. Vous serez un peu gêné. Ça vous fera réfléchir, et, en attendant, vous ne jouerez plus… »
À la simple mention du nom du colonel, Gilbert avait eu un sursaut, vite réprimé, comme si cette image, évoquée à cette seconde, lui était insupportable.
– « C’est bien, » dit-il d’une voix âpre et avec un regard sombre. « Je trouverai un autre moyen. »
– « Il y en a un plus simple, en effet, s’il vous répugne trop de discuter avec votre prêteur, » reprit Neyrial, qui avait remarqué le mouvement de son interlocuteur. « Vous ne voulez pas vous adresser à madame votre mère, à cause de son état de santé ? Écrivez la vérité à votre père, tout franchement, tout simplement… »
– « Mon père !… » fit Gilbert. Cette fois, une véritable terreur décomposait son visage. « Je me couperais la main plutôt que d’écrire cette lettre-là. Mon père, vous ne le connaissez que de réputation. C’est un magnifique soldat. Il a été admirable à Charleroi, à Verdun, sur la Somme, partout. Et l’homme vaut le soldat. Depuis que j’existe, je ne lui ai pas vu commettre une seule faute, de quelque ordre que ce soit, et cela, du grand au petit. Un exemple quelque affaire qu’il ait, il ne se presse jamais en écrivant, de sorte que vous diriez que ses lettres sont imprimées, tant les caractères sont bien formés. Ses élèves à l’École de guerre sont unanimes à reconnaître que son cours est une perfection. Son régiment, quand il commandait à Poitiers, faisait l’admiration de tous. Mais cette impeccabilité qui est la sienne, il exige qu’elle soit celle de tous autour de lui, et cela fait chez nous une atmosphère dans laquelle on étouffe. Cette discipline de chaque heure, de chaque minute, avec ce témoin toujours impassible, qui ne se permet, qui ne vous permet pas une négligence, une spontanéité, c’est accablant. Un autre exemple. Il est venu ici. Renée n’a pas osé danser pendant son séjour. Il adore maman, et si elle a perdu sa santé, j’en suis sûr, c’est qu’elle est trop sensible et qu’il ne s’en est jamais douté. Il l’a écrasée, et ne s’en rendra jamais compte, comme il nous a écrasés, ma sœur et moi. Seulement, nous sommes jeunes, nous, et quand un être jeune est trop comprimé, il explose. Nous en sommes venus à nous réjouir que les médecins aient envoyé maman dans le Midi. Au moins, ici, nous respirons librement. Cette joie de Renée de courir à bicyclette, de jouer au tennis, de danser, c’est sa libération à elle. La mienne, à moi, c’est le casino et le jeu. Pour que mon père comprît comment je me suis laissé entraîner, et me le pardonnât, il faudrait lui expliquer tout cela, est-ce que je peux ?… »
– « Vous appelez le jeu une libération, vous ? » dit Neyrial. « Mais c’est l’esclavage des esclavages, la passion à laquelle on fait le plus difficilement sa part ! »
– « Je n’ai pas joué par passion, » répondit Gilbert. « Je me suis assis à la table de baccara, je viens de vous le dire, par amusement et surtout avec l’idée d’avoir un peu d’argent, quand je reviendrai reprendre ma préparation aux Affaires étrangères. Avec les cent francs par mois que mon père m’alloue, pour toute pension, qu’est-ce qu’un garçon de mon âge peut devenir à Paris ? Pas de théâtre. Pas de restaurant. Rien que le travail tout le jour, et le soir, la maison, le silence entre papa qui ne prononce pas dix mots par heure, quelquefois, et maman, occupée avec Renée à une tapisserie… Je me suis dit : Si je rentrais avec trois ou quatre billets de mille francs, tout de même ?… Et sans cette guigne… »
– « Oui, on commence ainsi, » interrompit Neyrial. « Et puis… C’est un Anglais, Sheridan, qui prétendait qu’au jeu, il y a deux bonheurs le premier de gagner, l’autre de perdre. Autant dire que l’attrait du jeu, ce n’est pas le gain seulement, c’est le risque. Oui, on commence, comme vous, par penser aux quelques billets de banque à ramasser sur le tapis vert avec une carte heureuse, et, bien vite, ce ne sont plus ces chiffons de papier bleu qui vous remuent le cœur, mais cette inexprimable et toute-puissante sensation, faite d’incertitude, d’audace, d’avantages et de désastres possibles, – le risque enfin, je le répète. Quand une fois on a goûté à ce poison-là, il vous mord à fond. Il devient un besoin, comme l’alcool, la morphine, la cocaïne, l’opium, – toutes les drogues qui portent à son paroxysme la tension de notre être intérieur. Voilà pourquoi je vous ai refusé, tout à l’heure, l’argent que vous me demandiez. Vous ne jouerez plus, du moins ici, et chaque mois, la somme à prélever sur votre pension vous causera un petit ennui bien salutaire… »
– « Pour que vous parliez du jeu sur ce ton, » répliqua Gilbert, « il faut que vous l’ayez pratiqué vous-même. Vous en êtes guéri. Ce n’est donc pas une intoxication si dangereuse. »
– « On peut faire tant de mal aux autres, sans le vouloir, avec le jeu, » continua Neyrial. – Il ne relevait pas directement cette interruption. Mais son front s’était soudain barré d’une ride. Sa bouche se serrait. Visiblement, des souvenirs, restés trop présents, l’obsédaient. « Vous parlez de votre père… Si le mien, à moi, n’avait pas été un joueur, ma mère n’aurait pas vécu ses derniers jours dans la gêne, et je ne serais pas danseur mondain dans un palace… »
Gilbert Favy ne répondit rien. Le contraste était trop grand entre le sourire habituel de Neyrial et la physionomie qu’il venait d’avoir, presque tragique, celle d’un homme qui a beaucoup souffert, et devant qui se dresse brusquement sa destinée. Le fils du colonel tenait de sa mère une sensibilité trop vive pour ne pas le deviner il toucherait à des plaies secrètes en interrogeant davantage son interlocuteur. Celui-ci s’étant arrêté soudain de sa plainte et de sa confidence, les deux jeunes gens sortirent de la chambre, sans prolonger un entretien qui leur laissait à chacun l’impression d’une énigme pressentie chez l’autre.
« Mais qui est-il ? » se demandait Gilbert Favy. « Il est tellement supérieur à son métier par sa tenue, sa conversation, ses façons de sentir. Quel était ce père qui l’a ruiné ? Pourquoi s’est-il fait danseur ? Ce nom de Neyrial est-il son nom ? Si je lui avais dit toute la vérité, toute, m’aurait-il refusé ces mille francs ? Mais lui avouer ce que j’ai osé et ma honte, ça, c’était trop dur. Comment me tirer d’affaire ? Il y a son moyen, à lui, demander ce délai à ce Gibeuf… » C’était le nom de l’usurier du Casino. « C’est bien dur aussi, et, il a beau dire, inutile sans doute. Le mieux est d’aller à Marseille. Les brocanteurs véreux n’y manquent certainement pas. Quand on a fait ce que j’ai fait, on va jusqu’au bout… On est dans l’irréparable. Mais le prétexte pour expliquer ce voyage à maman ? Il faut cependant sortir de là… Il le faut… »
« Comme il a peur de son père ! » se disait, de son côté, Neyrial. « Une dette de jeu, ce n’est pas si grave ! Qu’a-t-il d’autre dans sa vie dont il tremble que son père ne le découvre ?… Ai-je eu raison de ne pas l’aider ? Si pourtant son créancier du Casino s’adressait à sa mère ?… Non. Ces coquins-là sont des usuriers adroits qui redoutent trop le scandale. Et puis, je reparlerai à ce pauvre garçon. S’il n’a pas obtenu ce que je lui ai suggéré, ce règlement par échéances, je serai toujours à temps de lui avancer la somme, en exigeant sa parole de ne plus toucher une carte. C’est ce que j’aurais dû faire peut-être… En attendant, pensons à notre « numéro… » Il y a une figure à changer. »