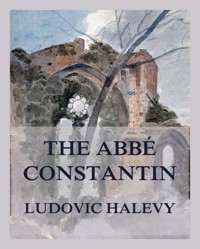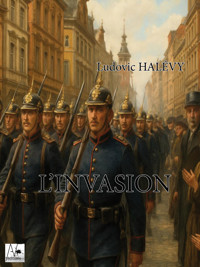
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Souvent aussi j’ai copié ; on me confiait de petits agendas couverts de notes écrites au crayon, le soir mème de la bataille, dans les bivouacs de Frœschwiller et de Gravelotte. Les phrases étaient incomplètes, les mots effacés, à peine lisibles..... Je m’efforçais de conserver la forme brusque, heurtée, incorrecte de ces notes, vivantes d’émotion et de réalité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludovic HALÉVY
L’Invasion
ÉDITO
La plupart de ces récits ont été publiés par le journal Le Temps, sous la signature XX. Je les réunis aujourd’hui en volume et j’écris mon nom en tète de ce volume ; mais je crois nécessaire d’expliquer, en peu de mots, ce que c’est au juste que ce livre. Je puis en parler librement, car il est bien peu de moi.
Trois de ces récits seulement : Tours, Étretat, Rouen contiennent des impressions personnelles. J’ai recueilli les autres récits de la bouche de témoins honnêtes, sincères, désintéressés, détachés de toute passion politique. Je leur ai demandé de me raconter ce qu’ils avaient vu, ce qu’ils avaient fait, ce qu’ils avaient souffert. Pas autre chose. Et ce qu’ils m’ont raconté, moi, avec autant de fidélité et de simplicité que possible, je l’ai écrit. J’ai fait office de sténographe, rien de plus ; et je fais aujourd’hui, en publiant ce livre, office d’éditeur bien plus que d’auteur.
Souvent aussi j’ai copié ; on me confiait de petits agendas couverts de notes écrites au crayon, le soir mème de la bataille, dans les bivouacs de Frœschwiller et de Gravelotte. Les phrases étaient incomplètes, les mots effacés, à peine lisibles..... Je m’efforçais de conserver la forme brusque, heurtée, incorrecte de ces notes, vivantes d’émotion et de réalité.
J’aurais aimé à mettre sur la première page de ce volume, au lieu de mon nom, les noms de ceux qui en sont véritablement les auteurs, mais la plupart appartiennent encore à l’armée et tous demandent à rester inconnus.
J’aurais aimé à écrire, en toutes lettres, dans le récit de Graudenz, le nom de la noble femme qui, pendant dix-huit mois, en France et en Allemagne, s’est consacrée au soin de nos blessés et à la consolation de nos prisonniers ; mais cette femme, si elle m’a pardonné d’avoir trahi le secret d’une causerie intime, ne me pardonnerait pas d’apprendre au public un nom bien digne cependant d’être honoré.
Je reste donc seul à signer ce livre et j’en accepte la responsabilité, mais, s’il paraissait digne de l’attention du public, je ne pourrais en revendiquer l’honneur, qui appartiendrait, tout entier, à mes collaborateurs anonymes.
LUDOVIC HALÉVY
Paris, 5 avril 1872.
1 - PERL
UNE PETITE CAMPAGNE EN ALLEMAGNE
Notre corps d’armée se réunissait à Thionville. Le chemin de fer nous y amène le 21 juillet 1870. Nous débarquons et nous allons camper sur les glacis de la forteresse. Les troupes arrivent de toutes parts, mais pas d’artillerie. On apprend alors que l’artillerie du corps d’armée venait par étapes de la Fère. De l’artillerie voyageant par étapes, au moment où il s’agissait de faire face au mouvement de concentration des Allemands ! Chaleur écrasante. Sept jours d’insupportable inaction.
27 Juillet. Trois heures du matin . Ordre de départ. Toujours la même chaleur. Le lever du jour est comme un coucher de soleil après une journée orageuse. Pas une goutte de rosée. L’air brûlant et lourd. Le mouvement du camp soulève des nuages de poussière.
Les tentes sont abattues, mais lentement ; les chevaux chargés, mais sans méthode ; les voitures attelées maladroitement sont écrasées de bagages entassés pèle-mêle... C’est l’inexpérience d’un premier départ, Des chevaux tout sellés s’échappent, emportant les cordes détendues et les piquets arrachés. Les hommes montent à cheval... le sol est jonché d’effets laissés à terre... Le plaisir de quitter cet odieux bivouac et d’aller de l’avant met les têtes à l’envers. Les maréchaux des logis glanent de-ci de-là un maillet, un bidon, une entrave, une longe. Les officiers tempêtent. Chacun finit par rentrer dans son bien. Les rangs se forment. L’appel est fait et rendu. Les trompettes sonnent la marche ! Enfin, on a démarré... Les hommes sont pleins d’entrain et de bonne humeur. Tous demandaient à marcher. Ils marchent. Ils sont contents.
Nous voilà sur la grande route, à rangs ouverts... On continue à entendre, à la queue de la colonne, les jurons du vaguemestre, les imprécations des hommes à pied et des conducteurs qui ne peuvent tirer des terres labourées leurs voitures surchargées.
On se dirige vers la frontière. A l’entrée de chaque village les chanteurs de la colonne entonnent quelque refrain de soldat : La mère Godichon, ou bien Quatre hommes et un caporal.
Il était une fois quatre hommes
Conduits par un caporal
Qu’éprouvaient tous les symptômes
D’un embêt’ ment général.
Les paysannes sont aux fenêtres et nous regardent passer. Les enfants avec de grands cris de joie nous font cortége. La chanson continue.
L’un disait : Comme on barbotte !
Le second dit : C’est qu’il pleut.
Le troisièm’ : Ça fait d’la crotte !
L’quatrièm’ : Qu’est-ce qu’on y peut ?
L’caporal dit : C’est comm’ ça ;
Quand il pleut, dam’ ça vous mouille,
Et la chanson allait toujours : la baronne de Folbiche se mettait à la fenètre, invitait les fantassins à monter chez elle sans façon, épousait le caporal et donnait en mariage ses quatre sœurs aux quatre hommes... J’entendais avec plaisir cette bête de chanson, qui valait mieux pour les soldats que la Marseillaise. Je ne discute pas, je constate. Les libations dans les. cabarets et dans les gares, les ovations malsaines, les chants patriotiques ont fait beaucoup de mal à l’armée. Le temps devient de plus en plus lourd... Il est huit heures du matin.:. L’orage éclate. Torrents de pluie. En une minute on est transpercé... La sonnerie pour dérouler les manteaux se fait entendre... Les hommes s’exécutent de mauvaise grâce. Ils aimeraient bien mieux continuer à être inondés que d’avoir l’ennui de dérouler leurs manteaux... Du sommet d’une côte, tout à coup nous apercevons Sierck. Paysage charmant, même à travers cette pluie battante. Un grand coude de la Moselle dessine la frontière du Luxembourg ct de la France. Au hord de la rivière s’étend une petite promenade plantée de platanes ct d’acacias en boule, déjà encombrée de voitures de l’intendance et de chariots de bagages. A l’extrémité campent deux escadrons de dragons... puis en pointe le long de la Moselle bivouaque le 20· bataillon de chasseurs à pied, qui sert avec nous d’avant-poste au corps d’armée... La pluie redouble... Apparaît, à pied, fort empaqueté, sous un grand parapluie, le général commandant la division à laquelle nous avons été détachés. Il nous fait le meilleur accueil, s’excuse de l’humidité que nous trouverons chez lui et nous installe sur les cailloux mêmes du lit de la rivière. Cela me fait penser à un de nos bivouacs de la guerre d’Italie. C’était à Sarzana, pres de Massa-Carrara. Nous étions campés dans le lit desséché d’un de ces torrents qui descendent des Alpes. La journée avait été admirable. A dix heures du soir, éclate un orage épouvantable et nous sommes littéralement enlevés par les eaux... Il y avait là deux escadrons et une batterie d’artillerie... Les hommes eurent le temps de s’échapper ; mais plusieurs chevaux furent entrainés et noyés, Tous les effets et harnachements s’en allaient à la dérive. Deux pièces d’artillerie furent emportées par le torrent.
Donc nous voilà les pieds dans l’eau et la pluie sur le dos. La bonne humeur du soldat persiste sous cc déluge. Ah ! quelle friture de goujons !.. c’est le cri général. Les chevaux sont à la corde. Les tentes sont dressées. Les amateurs de pêche courent aussitôt à la rivière. Fantassins et cavaliers, de grandes gaules à la main, s’alignent sur le bord de l’eau. Plaisanteries, éclats derire... Ça mord...Ça ne mord pas... etc...
On entend un coup de feu. C’est le premier de la campagne. Un maladroit s’est amusé à jouer avec son chassepot. Il a grièvement blessé un de ses camarades.
La pluie cesse. Le ciel se dégage... On regarde... On s’oriente... Sur le côteau voisin passent et repassent des vedettes prussiennes. On les aperçoit distinctement. Elles nous considèrent et nous comptent à loisir. Un escadron part en grand’garde, un peloton en reconnaissance.
Cependant des chasseurs à pied traversent la Moselle : ils ont appris que le tabac et les cigares coûtaient moins cher dans le Luxembourg qu’en France. Ils allaient faire leur petite provision, malgré les plus sévères défenses des officiers... Et le lendemain une note de M. de Bismarck, adressée directement à l’état-major général, dénonçait la violation par les troupes françaises de la neutralité du Luxembourg.
Le peloton en reconnaissance a signalé des vedettes qui se sont repliées à son approche et la présence d’un trompette monté sur un cheval blanc... Nous avons été toujours accompagnés par ce trompette monté sur ce cheval blanc. J’envoie mon ordonnance me chercher à Thionville une peau de mouton pour la nuit... Il me rapporte en même temps des journaux. Ces journaux nous donnent des nouvelles de la reconnaissance faite par la brigade de Bernis. On a pris deux uhlans et un journaliste anglais dans une auberge. Pourvu qu’on n’ait pas illuminé à Paris !
Le lendemain 28, à deux heures du matin, on monte à cheval sans bruit... Il faisait nuit close. On dit qu’on va marcher en avant, entrer en Allemagne... Nous traversons le village de Sierck... Des bourgeois effarés se précipitent au-devant des officiers, les implorent, les supplient :
« Epargnez nos voisins, disent-ils, » ce sont nos amis, nos frères... Mon gendre sert dans la landwehr... Ma fille est. mariée à Trèves avec un officier d’administration prussien... Ayez pitié d’eux, etc., etc. Nous sortons du village. Voici la frontière, et, en travers de la route, la barrière prussienne noire et blanche. Le sous-officier de l’avant-garde part au galop et franchit rondement la barrière. Un hussard veut le suivre, enlève son cheval, mais, en arrivant devant l’obstacle, l’animal s’arrête, refuse, se dérobe. Le douanier prussien se précipite alors... Il parlait très bien français, était fort aimable, souriant, empressé.
« Attendez, s’écrie-t-il, attendez, je vais ouvrir. », Il fait glisser Ia barrière. L’Allemagne était devant nous. Nous y entrons.
Cinq heures du matin. Perl, petit village allemand. Comme on était confiant et gai ce jour-là !.. Un calembour suffisait à notre joie ; il était bête comme tous les calembours ; les Parisiens et même certains Parisiens seulement peuvent le comprendre... On criait, au milieu de grands éclats de rire : C’est à qui qu’aura, Perl ! c’est à qui qu’aura Perl !
La population est stupéfaite. Des portes s’entr’ouvrent..; Des têtes effarées se montrent... A demi nues, des fernmes paraissent aux fenêtres... On envoie un officier s’emparer du télégraphe ; l’employé répond qu’il a expédié les appareils à Trèves... Ils sont très probablement cachés dans la cave, mais on accepte naïvement l’explication.
Des hussards, à coups de sabre, brisent les fils du télégraphe. Les habitants nous regardent faire... De l’étonnement, de la curiosité... Pas de colère... Ma conviction est que, si nous avions été victorieux, nos hussards se seraient promenés en Allemagne aussi tranquillement que les uhlans se sont promenés en France, plus tranquillement peut-être... L’Allemand au fond est bonasse, facile à vivre et docile devant la. force. La victoire l’a rendu insolent et dur. La défaite l’aurait trouvé doux et résigné.
Nous sommes en pays ennemi. Dispositions pour la marche... On envoie des éclaireurs et des flanqueurs... Coups de feu échangés... L’inévitable cheva blanc se montre et se replie devant nous... Le terrain devient difficile et boisé. Hésitation du colonel. On s’approche, on le questionne... Nous sommes très en l’air... Il y a un ravin sur la droite et peut-être du monde dans ce ravin. Le bois est-il occupé ? On se met à étudier le vol des oiseaux ; c’est l’observation la plus simple et l’indice le plus sùr, Si, en effet, il y a des mouvements de troupes dans un bois, tous les oiseaux effarés déménagent, se sauvent, volet éperdus au-dessus des arbres, en jetant de grands cris. Rien, nous ne voyons ni n’entendons rien. On peut entrer ; on entre. Le plus grand calme el le plus grand silence dans ces bois. Nous continuons notre marche régulière et méthodique. Nous arrivons en vue de Borg. On fait fouiller le village par un peloton . Des cavaliers dispersés en tirailleurs et marchant sur une ligue circulaire, à grands intervalles, s’approchent du village et l’enveloppent, puis les plus avancés se jettent au galop dans le village et le parcourent dans tous les sens. Absolunent la manœuvre tant admirée chez nos vainqueurs. Nos hussards l’auraient exécutée aussi hardiment que les uhlans, s’ils avaient précédé en Allemagne une armée françaisc victorieuse. On ne trouve rien dans le village. L’ennemi a passé la nuit à Borg, mais il s’est retiré au petit jour clans la direction de Trèves. Retour à Sierck par une route différente. Ce n’était qu’une reconnaissance. Mauvaise humeur des soldats. Pourquoi ne pas rester en Allemagne ? Ce n’était pas la peine de venir pour s’en aller si vite que ça, etc... etc... Aux abords d’un village, la colonne s’arrête ; un quart d’heure de halte. Les chevaux mangent aridement l’avoine sur pied. On les laisse faire. C’est de l’avoine ennemie. Les habitants du village avec beaucoup d’empressement accourent ct nous vendent le plus cher possibleforce canards et force poulets ; nous payons le tout en bon argent, qui est accepté avec la plus vive satisfaction. Oui, je le répète, nous aurions très bien trouvé à vivre en Allemagne... Peut-ètre seulement n’aurions-nous pas fait preuve du génie allemand dans l’application administrative du système des réquisitions. Nous aurions laissé beaucoup d’argent français en Allemagne. Nous aurions eu une certaine façon chevaleresque de comprendre et de faire la guerre chevaleresque et partant un peu sotte, en présence d’un tel ennemi, Rentrée au bivouac - temps superbe - arrivée des journaux de Paris... Ils nous annoncent une grande victoire de la flotte dans la mer Baltique. Sur cette heureuse nouvelle, on se souhaite une bonne nuit et ou rentre chez soi... Ma maison est un peu resserrée, mais assez confortable. Vingt-cinq centimètres de plus en hauteur et je pourrais m’y tenir debout. J’ai acheté à Sierck un petit pliant. Je m’assieds sur mon pliant et je me mets à écrire sur mes genoux... Mon bout de bougie est planté dans une pomme de terre trouée... Il fait une chaleur extrême... La lune se mire dans la Moselle... Sur le quai un point lumineux... C’est un cabaret très éclairé d’où sortent de bruyants éclats de rire... Un général de brigade et quelques officiers achèvent de dîner... Ce général, très jeune, très riche et de grande maison, était tué trois semaines après à Gravelotte. Quant à moi j’écris ma lettre qui commençait ainsi : « Nous avons fait aujourd’hui un petit tour en Allemagne... Nous avons été très bien reçus par les habitants.. . Nous y retournerons, etc... etc... En effet, je devais y retourner, trois mois plus tard, prisonnier, après la capitulation de Metz.
2 - FRŒSCHWILLER
RÉCIT D’UN CHASSEUR A PIED
Le temps était épouvantable. Nous avions passé à Frœschwiller la nuit du 3 au 4 août. Le général Ducrot, qui commandait notre division, était resté debout toute la nuit, sous la pluie, près d’un grand feu. A six heures nous partons et nous allons bivouaquer au-dessus de Lembach. On dresse les tentes, on place les grand’gardes.
Vers midi on apprend qu’une bataille se livre du côté de Wissembourg. Nous voyons arriver le maréchal Mac Mahon. Il donne au général Ducrot l’ordre de se porter en avant. Nous plions bagage. Nous partons. Il était trop tard. A Climbach nous trouvons les débris de la division Douay, des turcos, des soldats du 74e, Un chef de bataillon du 74e vient à nous ; il est tout couvert de boue, il boîte ; son cheval a été tué. Ce chef de bataillon parle à nos officiers : « Je commande » cequi reste du régiment, leur dit-il, et voilà tout ce qui en reste : pas grand’chose, comme vous voyez. » Tous les officiers sont tués ou disparus. La division a été surprise, abîmée, écrasée. »
Nous ne continuons pas notre marche en avant. L’ennemi arrive en force entre les montagnes ct le Rhin. Il faut garder les hauteurs. On a froid, on a faim, on grignote un peu de biscuit. Des compagnies sont détachées pour occuper les bois. Nous abattons des arbres et nous les couchons en travers sur la route ; nous creusons des fossés.
La nuit vient. Nous sommes épuisés de fatigue. Officiers ct soldats se couchent par terre, dans l’eau, sans abri, Des sentinelles sont placées à deux ou trois cents mètres en avant pour surveiller et garder les routes. Je fais ainsi deux heures de faction, seul, dans une nuit noire, tressaillant au moindre bruit, et croyant toujours voir, à travers l’obscurité, s’agiter des formes confuses. A trois heures du matin, un mouvement de retraite est ordonné ; nous allons prendre des positions en arrière. Les chemins sont difficiles, le sol est humide, boueux. Il faut marcher vite cependant. L’ennemi, a ce qu’il parait, nous serre de très près. Une grand-garde a été oubliée ; pourra-t-elle nous rejoindre ? Aurait-elle été enlevée par les Prussiens ? Non, voici nos cimarades, mais dans quel état ! Exténués, rendus, harassés..... Ils ont vu les Prussiens. Il faut nous hâter. Voici Lembach. Là étaient tous nos approvisionnements de vivres, de fourrages. On les entasse précipitamment sur les charrues des paysans. Nous devons former l’extrême arrière-garde, ramasser les égarés et les fuyards, pousser devant nous les traînards. C’est une désolation dans le village. Les habitants veulent nous retenir. Les femmes crient, pleurent : « Pourquoi partez-vous ? Ne nous abandonnez pas ! Qu’est-ce que nous allons devenir ? »
Nous suivons une route délicieuse. Quel riche, charmant, et riant pays que toute cette partie de l’Alsace ! Quelle merveille que ce vallon de Liebenfraventhal ! Et cette terre française, il faut l’abandonner à l’ennemi... A tous les braves gens qui nous interrogent, nous faisons la même réponse : « N’ayez pas peur, nous reviendrons, nous reviendrons. » Et nous ne sommes pas revenus ! Nous arrivons enfin à notre ancien bivouac de Frœschwiller. L’ennemi nous suivait de bien près ; à peine notre campement commençait-il à s’établir que le canon se faisait entendre. C’était une forte reconnaissance de cavalerie prussienne qui, appuyée par de l’artillerie, avançait. Quelques coups de canon sont jetés par les Prussiens dans Frœschwiller et y répandent la panique. Des hommes qui battent en retraite sont facilement démoralisés, Les officiers ont grand’peine à rétablir l’ordre et le calme. Nous nous formons, prêts à marcher au combat. Ce n’était qu’une alerte. La cavalerie prussienne se retire. La canonnade cesse. Nous passerons la nuit tranquillement à Frœschwiller. Nos bagages nous rejoignent. On dresse les tentes. On se couche.
Le lendemain matin, à huit heures, on entend la fusillade et le canon. Nous sommes attaqués. L’ennemi arrive par les bois et de notre côté. C’est nous qui supporterons le premier choc. Nous autres, les fantassins, nous sommes bien vite prêts, mais l’artillerie n’a pas ses chevaux. Tout à l’heure ils sont partis, en longues files, pour aller boire, et il paraît que l’eau était très loin.
Nous avons dans notre compagnie un groupe de Parisiens, des jeunes gens. Ils ont apporté un drapeau qui doit flotter dans les rues de Berlin le jour de l’entrée triomphale. Ceux-là sont résolus, gais, confiants.
Mon voisin est marié ; il pleure ; il me prend les mains en me disant : « Ma pauvre femme ! mes enfants ! Si je suis tué, vous trouverez une lettre dans mon portefeuille. »
Voici de nouvelles troupes qui arrivent. C’est une division du 7e corps ; les régiments de cette division sont encore en voie d’organisation pour passer sur le pied de guerre ; tenus en main, sans harnais ni couvertures, les chevaux destinés aux voitures régimentaires suivent les troupes. Pourquoi ne pas avoir laissé à Reischoffein ces chevaux inutiles ? La route est encombrée, obstruée. Les chevaux d’artillerie arrivent au grand galop, revenant de l’abreuvoir, tombent dans cette confusion, sont obligés de s’arrêter, d’attendre. Quel désordre ! Frœschwiller est en feu. Les obus pleuvent sur le village. Dans la campagne, autour de nous, de tous les côtés, nous voyons s’élever de lourdes colonnes de fumée noire. Ce sont des fermes qui brûlent. Les habitants affolés s’enfuient, traversent nos rangs, conduisant des charrettes, portant de grands sacs sur les épaules. Une femme passe près de nous, le visage baigné de larmes, un enfa nt sur chaque bras et trois petites filles accrochées à ses jupes. Enfin nos pièces sont attelées. Nous pouvons répondre à l’artillerie allemande. Nous nous portons en avant. Nous allons à l’ennemi. Non, pas encore. L’ordre est donné de s’arrêter, Nous assistons à un combat de tirailleurs. Les Prussiens occupent le bois et cherchent à en sortir. A chaque tentative ils sont arrêtés et repoussés par les tirailleurs du 1er zouaves. Dans les bois, par une éclaircie, nous voyons manœuvrer des masses noires. Les mitrailleuses avancent et, pour la première fois, nous entendons le bruit saisissant de leurs détonations. Les obus sifflent au-dessus de nos têtes. Nous sommes tous couchés par terre ; nous nous soulevons, appuyés sur les mains, pour essayer de voir un peu. On ne parle pas. On sent que c’est la bataille, la vraie bataille qui arrive et va nous envelopper. Les hommes sont calmes et décidés. La canonnade augmente, approche. L’artillerie tonne à notre droite avec une intensité formidable.
Un ordre arrive, Nous reprenons notre marche en avant, dans la direction de Frœschwiller. Au pas accéléré, d’abord, puis de nous-mêmes, sans commandement, nous prenons le pas de course. On est comme attiré, comme entratné. Un bois très épais se présente à notre gauche. Nous nous y engageons pèle-mêle. Nous avons marché trop vite, le désordre est dans nos rangs. Toutes les compagnies du bataillon sont confondues. Nous apercevons des hommes couchés par terre, blottis derrière des arbres. Nous les obligeons à se relever, à marcher avec nous, Nous avançons toujours à travers bois, dans un fourré inextricable.L’ennemi sans doute a vu notre mouvement, car les obus accompagnent notre marche. Nous approchons, nous serons bientôt en pleine bataille. Voici, sous sa forme la plus hideuse, la mort qui nous l’annonce. Un turco étendu par terre, sur le dos, le ventre ouvert. C’est un nègre. Sa figure est toute couverte de sang. On détourne la tête, on passe sans regarder. Nous rencontrons des blessés qui se traînent, gémissant, s’accrochant aux arbres, tombant, faisant de vains efforts pour se relever, criant, appelant, demandant secours. Nous marchons, nous marchons toujours. Un chef le bataillon vient d’être tué roide d’une balle dans le cœur. Un capitaine est à genoux près du corps étendu par terre sur une grande couverture de laine grise ; il retire des poches du commandant un portefeuille, une montre, des clefs, une poignée de menue monnaie, un étui en maroquin. Il fait voir cet étui à deux ou trois officiers qui sont là : « La photographie de sa femme et de son petit garçon », dit-il. Le capitaine remet toutes ces choses à l’ordonnance, tire un mouchoir blanc de sa poche, le déplie, l’étend sur la figure du commandant, se passe les deux mains sur le front, et dit aux officiers qui étaient là: « Allons, maintenant ! » Quant à nous, après une halte de quelques minutes, nous reprenons notre marche et nous arrivons sur la lisière du bois. Nous sommes arrêtés par une véritable oluie de mitraille. Nous trouvons là des turcos et des soldats de la ligne de divers régiments qui, mêlés, confondus, font ensemble le coup de fusil.
Nous nous blottissons quatre ou cinq dans un fossé, nous avons devant nous les tentes des turcos. On se bat dans leur camp. Beaucoup de tentes sont encore debout. D’autres battent au vent, renversées, déchirées, mises en lambeaux. La terre est jonchée de sacs et l’effets de campement. Nous voyons l’ennemi de tout près, distinctement. De l’autre côté de la petite rivière le la Sanerbach, les Prussiens massent de l’artillerie et de la cavalerie. Par-dessus nos têtes passent encore quelques boulets envoyés par notre artillerie, mais le tir devient rare, faible et nous protege mal. Nos pièces ont perdu beaucoup de servants et de chevaux. Elles seront bientôt obligées de se taire. Les Prussiens se forment devant nous et s’avancent en colonnes serrées. Il faut déposer le sac... Mon pauvre sac ! Comme il me pesait sur les épaules pendant la longue et laborieuse traversée de ce bois ! Et maintenant, au moment de le quitter, je le regarde. J’ai là des vivres, des cartouches et des lettres... surtout des lettres. Et puis encore, sous la marmite, la viande de l’escouade. Comment fera-t-on la soupe ce soir, si je ne retrouve pas mon sac ?
Nous laissons arriver les Prussiens. Le colonel Suzzini, des tirailleurs indigènes, avait pris le commandement, montrait le plus grand sang-froid, nous obligeait à régler notre feu. C’est, avec le chasse-pot, la grande difficulté. Une fois qu’on a commencé de tirer, il n’y a plus de raison pour s’arrèter ; on va, on va toujours, on se grise avec son arme et, au bout d’un quart d’heure, plus de cartouches. Nous ne commencions le feu que lorsque l’ennemi était à bonne portée ; puis, quand nous avions mis l’hésitation et le désordre dans les rangs allemands, nous nous jetions en avant. J’entends encore les cris des turcos. Les officiers avaient beaucoup de peine à les modérer. Les Prussiens se retiraienl, puis revenaient et ces efforts nous épuisaient. Les Prussiens perdaient du monde, beaucoup de monde ; seulement les généraux allemands avaient des hommes plein les mains et renouvelaient sans cesse les colonnes d’attaque. Et nous autres, peu nombreux, affaiblis, non soutenus, nous avions ainsi affaire à un ennemi toujours frais et toujours en haleine.
Nos cartouches s’épuisaient. Nos voitures de munitions avaient disparu. Aucun moyen de se ravitailler. Plusieurs fois déjà le colonel Suzzini avait fait demander des cartouches. On ne lui envoyait rien. Quel soldat et comme il s’est bien conduit ! Allant et venant sans cesse dans nos rangs, sous le feu, nous encourageant et nous disant : « du calme, du calme ! Ne tirez pas trop vite, ménagez vos cartouches. »
Un général à pied, seul, sans aide de camp, tout à coup sortant du bois, vient se jeter au milieu de nous. Plusieurs officiers aussitôt l’entourent,
- La position n’est pas tenable, mon général, dit un de ces officiers ; donnez un ordre de retraite ; on ne peut pas sacrifier des troupes inutilement.
- Non, non, répondit-il ; je ne donnerai pas d’ordre de retraite. Voyez, je n’ai plus rien ; mes deux chevaux tués, mes aides de camp disparus. Je vais rester avec vous. Il faut tenir ici, et, si on ne peut pas tenir, mourir.
Quelques instants après, un de mes camarades me dit :
- Le général qui était ici tout à l’heure...
- Eh bien ?
- Eh bien ! il est mort. Il s’est jeté en avant, dans les balles. On n’a pas pu l’empêcher. Il voulait se faire tuer.
- Sais-tu son nom ?
- Le général Raoul.
Cependant notre artillerie, qui jusqu’alors nous avait couverts de son feu, était complétement silencieuse. Les Prussiens redoublaient leurs attaques. Nous étions inondés d’un déluge de feu et de plomb.
Les arbres, autour de nous, étaient hachés par la mitraille ; les branches craquaient, se brisaient, tombaient sur nos têtes. Partout des blessés, dont les plaintes étaient horribles. Un de nos officiers s’écrie :
- En retraite ! En retraite !... Nous sommes battus. Inutile a été le courage de tous ces braves gens qui sont couchés par terre. Inutile a été leur mort. En retraite ! En retraite ! Que ce mot est dur à entendre ! Nous reculons. Nous nous glissons dans le bois. Nous marchons pliés en deux. Nous trouvons un chemin. Il est jonché de blessés et de morts. Dans ce sentier marchent devant nous deux sapeurs-tirailleurs. Ils portent un corps roulé dans la toile d’une tente-abri. Deux bras sortent et pendent de chaque côté. Sur des manches en drap bleu clair je vois cinq galons d’or. Je m’approche de l’un des sapeurs :
- C’est le colonel Suzzini ?
- Oui, c’est lui. Il vient d’être tué.
Nous suivons le chemin qui ramène à Frœschwiller. C’est la défaite ! c’est la déroute ! Un de mes malheureux camarades est là, par terre, les deux pieds coupés par un obus. Il me reconnaît, m’appelle par mon nom, m’implore d’une voix suppliante. Que faire ? Je suis seul. Je me détourne et je passe. C’est un de mes remords. On pouvait les compter par centaines, ceux qui restaient dans ce bois, mutilés et sans secours ! mais celui-là, je le vois encore, je le verrai toujours, appuyé contre un arbre, le regard fixe et tendant les bras vers moi !
Nous sortons du bois. Nous apercevons Frœschwiller. A l’entrée du village, des maisons isolées. Nous avançons cinq on six. Nous passons à côté de canons démontés, Des cadavres d’hommes et de chevaux sont étendus près des affûts brisés.
A cent cinquante ou deux cents mètres du village, nous sommes accueillis par des coups de fusil. Frœschwiller est occupé par des tirailleurs prussiens. Nous nous rejetons dans le bois. La retraite est coupée de ce côté. Il faut chercher une autre issue.
Dans le bois je me trouve seul. Mes camarades se sont dispersés. Je vais devant moi à l’aventure. Je marche pendant une heure. Je vois un cheval immobile, sans cavalier. Je m’approche. Un homme est étendu par terre, sur le ventre. Il a été tué raide par une balle. La bride du cheval est restée dans la main de l’homme et l’animal n’a pas bougé. Je retire la bride de ces doigts crispés par la mort et je monte sur le cheval.
J’arrive à la lisière du bois. Une plaine s’ouvre devant moi. Je me lance au galop. Des balles me sifflent aux oreilles. Je me couche sur l’encolure du cheval. Une de mes sangles éclate, la selle tourne. Je tombe, Je me relève. Je ne suis pas blessé. J’appelle le cheval, il vient à moi docilement. Je replace la selle. Je remonte, je repars. Tout cela au milieu des balles. J’aperçois des pantalons rouges. Ce sont les débris du 1er régiment de zouaves. Une centaine d’hommes qui se retirent lentement, fermement, groupés autour du drapeau,
L’ennemi nous suit de près, de très près. Les hauteurs se couvrent de ses tirailleurs et de son artillerie. Je me dirige du côté de Reischoffein. A l’entrée du vilIage, une tente surmontée du drapeau blanc à la croix rouge est criblée de projectiles par les Prussiens. Je traverse le vilage. Une grande maison brûle. C’est une ambulance.
A ma droite, à travers champs, s’avance au pas, sous le feu le plus violent, un groupe nombreux de cavaliers. C’est le maréchal Mac Mahon, suivi de son escorte.
Les troupes s’amassent et s’entassent dans Reischoffein. Beaucoup d’hommes s’arrêtent, demandant .un morceau de pain, un verre d’eau. Les habitants chargent en hâte leurs récoltes sur des charrettes. Sur tous les visages le désespoir et la terreur.
Je traverse le village avec beaucoup de lenteur et de peine. Le même encombrement et la même confusion sur la route, qui est obstruée par des canons brisés, des voitures renversées. Fantassins et cavaliers marchent pèle-mêle. On se laisse emporter, tête basse, silencieux, par ce grand courant de déroute.
Nous sommes arrêtés par les barrières fermées du chemin de fer. Deux trains sont en gare et nous barrent le passage. On brise les palissades de la voie. On passe derrière les trains. Devant nous la campagne est libre. Celte fois où aller ? On se consulte. Les uns disent à Bitche ; les autres à Saverne. Quant à moi, j’ai peur des grandes routes. Je ne veux pas tomber aux mains des Prussiens. Je demande le chemin de Saverne par la montagne. Un paysan m’indique un sentier dans les bois. Je m’engage dans ce chemin ; il est impraticable pour un cheval. Je suis obligé de regagner la grande route. Plusieurs escadrons de cavalerie arrivent à grande allure, bousculant tout sur leur passage, obligeant les fantassins à se jeter de côté dans les terres labourées. Je suis entraîné par le torrent. Je fais ainsi trois ou quatre kilomètres au galop. Mais je ne suis pas grand cavalier. Le train est trop rapide. Je ne peux pas suivre. Je me jette dans un chemin de campagne. Je traverse deux ou trois villages abandonnés.
La nuit arrivait. Dans un de ces villages je m’arrête, je mets pied à terre, je fais boire mon cheval à l’abreuvoir sur la place. Toutes les fenêtres sont fermées, toutes les portes closes. Je meurs de soif et de faim. J’entends une voix qui m’appelle. C’est un cabaretier, il n’a pas abandonné sa maison. Il me fait entrer chez lui, me donne quelques poignées d’avoine pour mon cheval. Je dévore un morceau de pain, je bois un verre de vin. Une femme d’une quarantaine d’années me regarde d’un air stupide, hébété. Elle tient sur ses genoux un petit enfant de six à sept ans.
- C’est donc vrai, me dit le cabaretier ; vous avez été battus ?
- Oui, complétement. C’est la déroute.
Et alors j’entends le petit garçon dire à demi-voix :
- Maman, c’est-il un Français ou un prussien ?
- C’est un Français.
- Alors pourquoi qu’il dit qu’il a été battu !
On avait raconté à cet enfant que l’armée française avait toujours été et ne pouvait pas ne pas être victorieuse. Je veux payer le cabaretier. Il refuse. Que de braves gens dans cette Alsace ! Je remonte à cheval. Je veux aller d’une traite jusqu’à Saverne. J’ai à faire sept ou huit lieues. Déjà, sur la route, des hommes à bout de forces se couchent par terre et s’endorment sur le bord du chemin. Oh ils sont tombés, ils passeront la nuit, et demain ils essayeront de gagner Saverne.Beaucoup de ces hommes seront tués ou pris par les uhlans.
Nuit noire... Voici des lumières... C’est un grand village. Il est rempli de fuyards. Les habitants sont admirables, viennent au-devant de nous, et, charitablement, nous offrent du vin, de la bière, des vivres. Des misérables abusent de cette hospitalité qui leur est offerte. Des soldats dans une maison s’enivrent, se disputent, se battent. Je passe sans m’arrêter. J’éprouve un sentiment de soulagement à me trouver seul sur la grande route. Je me suis informé : dix kilomètres seulement me séparent de Saverne.
Je rejoins quatre ou cinq zouaves. Je fais route avec eux ; nous traversons le chemin de fer et le canal. Nous approchions de Saverne, quand nous sommes arrêtés sur la route devant une haute grille dont les deux battants étaient ouverts.
- Entrez, mes enfants, nous dit un vieillard, entrez chez moi, vous avez besoin de manger et dc dormir; la maison est à vous ! Et, en parlant ainsi, il nous prenait les mains et nous les serrait à nous les briser. Nous entrons. J’attache mon cheval à un arbre dans la cour. Toutes les portes sont ouvertes, toutes les chambres éclairées. Des domestiques vont et viennent pour nous recevoir. Une jeune femme - la maîtresse de la maison - nous fait asseoir à une grande table dans une vaste salle à manger qui est illuminée comme pour une fête. La jeune femme nous sert elle-même, nous apporte de grandes assiettées d’une soupe bien chaude et nous dit à tous de bonnes paroles. Je crois encore entendre sa voix. Il y avait sur ses lèvres un sourire si doux et si triste ! En la regardant. je pensais à ces contes qui ont amusé et attendri notre enfance, à ces châteaux étincelants qui s’ouvrent, tout d’un coup, au milieu d’une forêt, devant le voyageur épuisé. Je regarde autour de moi. Nous étions là une trentaine autour de cette table. Des cuirassiers, des zouaves, des artilleurs, des dragons. De mon régiment, pas une figure. Mes camarades, que sont-ils devenus ? Où et comment les retrouver ? Quand j’ai fini de manger, je vais voir mon cheval. Du foin et de la paille sont étendus par terre devant lui, mais il n’y touche pas. Je rentre dans la maison. On a défait tous les lits. Les matelas sont étendus dans les grandes pièces du rez-de-chauss ée contre les murs. Je me jette sur un de ces matelas et je m’endors aussitôt d’un sommeil de plomb.
Quand je me réveille, il fait grand jour, et je vois devant moi la jeune femme d’hier au soir. Elle enroule une longue bande de toile blanche autour du bras d’un zouave qui, assis dans un grand fauteuil de velours rouge, regarde son infirmière d’un air étonné. Quand la bande est attachée, le zouave rabat sa manche, se lève, prend la main de la jeune femme, la serre entre ses doigts, et, sans trouver une parole, s’en va.
Je me lève, je descends. Les domestiques, en bas, dans le vestibule, nous donnent à chacun un gros morceau de pain encore chaud et qui a dû être cuit au château même pendant que nous dormions. On remplit de vin nos gourdes jusqu’au bord. Je remonte à cheval. Je pars. Et je n’ai pas même songé à demander le nom de cette famille française qui nous a fait un tel accueil, et qui celle-là, j’en réponds, ne deviendra jamais une famille allemande.
La route est encombrée de soldats de toutes armes qui se dirigent vers Saverne. Des fantassins à cheval, des cavaliers à pied, des cuirassiers sans cuirasse et sans casque, des blessés qui se traînent péniblement appuyés sur des camarades. De grands chariot de campagne passent chargés de soldats qui se tiennent debout dans les voitures, entassés et serrés les uns contre les autres. Beaucoup de ces hommes laissent tomber leur tête et dorment.
Je regarde les numéros des képis. Je cherche des camarades. Je ne vois personne. Aux abords de Saverne, on essaye de mettre un peu d’ordre dans ce grand désordre. Des camps s’organisent. Des officiers d’état-major nous indiquent sur quel point nous devons nous porter. Des colonels attendent leurs officiers et leurs soldats, les rallient au passage.
Enfin je trouve un de mes officiers. Il est à pied, mort de fatigue, épuisé. Je lui donne mon cheval. Cet officier me conduit au campement assigné à notre bataillon . C’était une prairie à l’extrémité de Saverne, sur le bord de la route. Je trouve là un bien petit nombre de mes camarades ; on n’ose pas se compter. Presque tous nos officiers et sous-offlciers manquent ; ils ont été pris ou tués.
On cherche à se débrouiller, on se procure des marmites, du pain, de la viande.Vers quatre heures, nous étions occupés à préparer la soupe quand arrive un de nos camarades ; le pauvre garçon depuis quelques jours était malade. Le chirurgien avait voulu l’envoyer à l’hôpital, mais il avait répondu: « Entrer à l’hôpital, la veille d’une bataille ; non, non, je ne veux pas. » Tant que je pourrai aller, j’irai ; quand je ne pourrai plus, il faudra bien que je m’arrête. »
Il était resté.
Avec nous, il avait fait les marches si dures de ces derniers jours ; avec nous, la veille, à Frœschwiller, il s’était battu, et depuis vingt-quatre heures, dévoré par la fièvre, il marchait, ou plutôt se traînait, s’arrêtant tous les cinquante pas, tombant sur la route, puis se relevant et faisant encore une cinquantaine de pas. Pendant qu’il nous racontait cela, nous le regardions attentivement. II avait de gros boutons rouges sur la figure. Un de nos camarades va chercher le médecin. Celui-ci arrive et tout aussitôt s’écrie :
- Vous ne pouvez pas rester ici. Allez-vous-en. Allez-vous-en tout de suite.
- M’en aller, et où voulez-vous quc je m’en aille ?
- A l’hôpital. Vous trouverez une ambulance à Saverne.
- Comme vous regardez ma figure ! Qu’est-ce que j’ai sur la figure ? Une glace. Qu’on me prête une glace. Je veux savoir ce que j’ai sur la figure.
Une glace, personne ne voulut ou ne put lui en prêter une. Tous nos sacs étaient restés dans le bois de Frœschwiller. Le pauvre garçon s’éloigna dans la direction de Saverne. A peine avait-il fait quelques pas quc le médecin nous disait :
- Il a la petite vérole et très violente.
Le soir, à six heures, ce malheureux revenait de Saverne, toujours à pied. On n’avait pas voulu le recevoir à l’hôpital. Partout il avait été repoussé comme un pestiféré, et nous, encore une fois, nous eùmes la cruauté de le renvoyer. Il partit. Nous ne l’avons pas revu et je ne sais ce qu’il est devenu. Cependant on s’était compté. Nous étions deux cents environ... deux cents au lieu de neuf cents... trois officiers seulement. Les Prussiens devaient approcher. On entendait de temps en temps des coups de fusil.
Enfin l’ordre de battre en retraite arrive, L’ordre n’était pas très clair, à ce qu’il parait, car le général, en le lisant à nos officiers, cherchait et semblait trouver avec peine sur la carle les villages indiqués comme ligne de retraite.
Nous nous préparions au départ, qui devait avoir lieu à sept heures. Déjà un régiment avait passé pres de nous, remontant la route qui mène à Phalsbourg, lorsque nous entendons, du côté de Saverne, une immense rumeur, puis des cris, des eoups de fusil. Une colonne de cavalerie, général en tète, arrive au grand galop sur la route, comme une avalanche. « Les Prussiens ! les Prussiens ! les voilà ! » Les cavaliers, en passant, nous crient cela et disparaissent.
Pourquoi cette panique ? Nous ne pouvons avoir déjà affaire au gros de l’armée prussienne. Très probablement, ce ne sont que des détachements de cavalerie jetés en avant par l’ennemi. On pourrait encore se défendre, essayer de résister. Telles sont les réflexions de nos officiers. Par bonheur, les régiments qui nous entourent font bonne contenance et ne bougent pas. Ce mauvais vent passe sans nous emporter, et, à sept heures du soir, bien peu nombreux, hélas ! mais, du moins, calmes et en bon ordre, nous nous mettons en route.
On nous dirige vers le chemin de fer, dont nous devons suivre la voie. Les habitants nous regardent effarés. Un ouvrier nous insulte : « Les soldats sont des feignants » dit-il. Nous passons, baissant la tête, sans que personne ait la pensée de répondre. Cet homme pouvait bien cependant, rien qu’à voir passer ce bataillon de deux cents hommes, calculer quelle large part les blessures et la mort avaient prélevée sur ces feignants.
Nous suivons la voie ferrée. Nous arrivons à l’entrée d’un des tunnels qui livrent passage au chemin de fer sous la chaîne des Vosges. Nous nous engageonssans lumière dans ce tunnel. La voie n’est pas ballastée ; les traverses ne sont pas couvertes : nous trébuchons à chaque instant et nous n’avançons que très lentement, comme à tâtons. Les chevaux de nos officiers ont peur, se défendent, pointent, refusent d’avancer ; On les entend souffler de frayeur. Pendant que nous marchons dans cette obscurité, deux trains nous dépassent, allant dans la direction de Paris, reculant eux aussi devant l’invasion. Les machines sifflent, sifflent pendant toute la traversée du tunnel. Il y a des blessé dans ces trains. On entend des gémissements, des plaintes.
Nous arrivons enfin à l’extrémité du tunnel, et là nous prenons la route qui côtoie le chemin de fer. Pas de lune, pas d’étoiles, nuit profonde. Des nouvelles sinistres circulent : Nous avons éprouvé un nouveau désastre, nous sommes cernés, coupés, les Prussiens vont nous barrer le passage, etc., etc. Alors on forme des projets : on se jettera dans les bois, on fera la guerre de partisans. Les têtes sont fatiguées. Ces craintes chimériques gagnent et troublent le plus résolus. On s’attend toujours à une attaque, on avance très lentement. Personne ne parle, personne ne fume. Des hommes sont envoyés en éclaireurs pour sonder la route.
Au bout d’une petite étape de deux heures, il faut déjà faire halte. L’épuisement est général. Bien peu d’hommes ont eu, la nuit dernière, quelques heures de sommeil. On s’arrete sans bruit, sans sonnerie, sans tout le tapage habituel. On ne quitte même pas le fond de la route, on tombe où l’on se trouve, on s’étend par terre, on s’endort. Le général lui-même se couche au milieu de nous, et, au moment du départ, après un repos d’une heure, c’est un de nos officiers qui, pour réveiller le général, est obligé de le secouer de toutes ses forces. Le général se lève brusquement et s’écrie :
- Quoi ? qu’est-ce qu’il y a ? que se passe-t-il ?
Nous nous remettons en route. Nous approchons d’un village; c’est Lutzelbourg, nous dit-on. Phalsbourg n’est pas loin ; voici la route qui nous y conduirait.
Nous laissons cette route sur notre gauche. Il est minuit environ, Nous traversons Lutzelbourg ; toutes les maisons sont éclairées. Par les fenêtres nous apercevons les habitants qui vident des armoires, remplissent des caisses, font des paquets, se préparent à fuir.
Nous prenons des guides dans le village, et, péniblement, nous continuons notre route. Il parait que nous allons à Sarrebourg, et,que nous devons nous y rendre par des chemins détournés.
Quels chemins ! Des sentiers étroits, escarpés, abruptes, qui montent à pic, à travers un interminable bois de sapins. Ce n’est qu’à deux heures du matin que nous touchons enfin an terme de notre ascension. Nous débouchons sur un grand plateau nu. Nous avons laissé derriere nous les bois ct les ravins que longe le chemin de fer ; devant nous, il y a maintenant de l’air et de l’espace, mais il faut attendre que la longue colonne qui nous suit ait atteint le plateau. On parle d’hommes égarés dans les détours des bois. Nous nous couchons dans un champ.
Des lumières paraissent bientôt à l’horizon. On fait des suppositions : Ce sont les Prussiens qui investissent Phalsbourg : une rencontre est peut-être imminente. Nos guides sont là, gardés à vue. Un des paysans que nous avons emmenés supplie le général de le laisser retourner à Sarrebourg. Il y a laissé sa femme et ses enfants, il veut être là quand les Prussiens arriveront, etc., etc. Ce pauvre homme se lamente, pleure. Le général est inflexible. Ordre de tirer sur ce malheureux, s’il cherche à s’échapper.
Le froid est très vif. Nous sommes à peine couverts. Nous dormons en tas, par terre, rapprochés, collés les uns contre Ies autres. La nuit se passe tranquillement. Au petit jour, ordre de départ.
Conduits par nos guides, nous cheminons à travers bois, nous traversons des villages. Les habitants viennent au-devant de nous, nous apportent du vin, du pain. Nous vivons d’aumônes et nous sommes nourris par la charité publique ; car, depuis quarante-huit heures, de l’intendance aucune trace, aucune nouvelle. Quel aspect misérable nous devons avoir ! Beaucoup de femmes pleurent en nous regardant. Les hommes nous serrent la main. Peu de paroles d’ailleurs. Nous arrivons exténués, abrutis, inertes, avec nos barbes longues, nos joues creuses, nos uniformes souillés de boue. Nous nous appuyons contre les murs. Nous nous laissons tomber comme des paquets sur le pavé de la route. Nos désastres sont racontés sans que nous ayons à dire une parole.
Voici Sarrebourg. La ville est encombrée de soldats. Le général Ducrot est arrivé et cherche à rallier les troupes du corps d’armée. Le général n’est pas venu par la route de Saverne ; il a passé par la Petite Pierre : Nous traversons toute la ville ; nous allons nous établir dans un grand champ au-dessus du chemin de fer. Beau temps. Le vin et les vivres nous sont donnés en abondance. Nous achetons des marmites en grès. La soupe .commence à marcher, mais nos maudits pots se brisent au feu et voilà tout le bouillon par terre. Nous mangeons notre viande grillée.