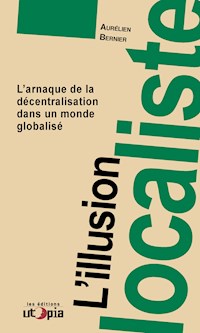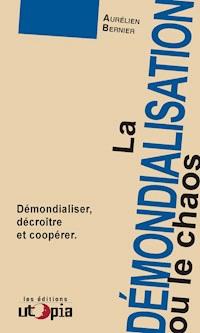Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Utopia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Malgré les promesses et les critiques, malgré les leçons de la Covid-19, le libre-échange se poursuit et la délocalisation des activités productives s’accélère. En réaction, une réponse inquiétante se profile : le nationalisme économique. Incarné par la présidence américaine de Donald Trump, ce concept monte aussi en France, à l’extrême-droite, à droite et même parfois à gauche.
Pour combattre le libre-échange tout en cessant d’offrir un boulevard aux nationalistes, les forces de transformation doivent penser la relocalisation, la décrire, la planifier. L’enjeu est économique mais aussi écologique et démocratique, car sans relocalisation, il est impossible de choisir ce qu’il faut produire et de quelle manière.
Dans cet ouvrage, l’auteur livre sa vision transformatrice, décroissante et internationaliste de la relocalisation, ainsi que les modalités concrètes dans cinq domaines stratégiques : les capitaux (et donc les investissements), la santé, l’alimentation, l’énergie et l’automobile.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Aurélien Bernier est essayiste et conférencier, il collabore régulièrement au Monde diplomatique. Dernières publications aux Éditions Utopia : La démondialisation ou le chaos (2016), Les voleurs d’énergie (2018) et L'illusion localiste (2020).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Essais
Les OGM en guerre contre la société, Mille et une nuits, 2005
Le climat, otage de la finance, Mille et une nuits, 2008
Ne soyons pas des écologistes benêts, Mille et une nuits, 2010 (avec Michel Marchand)
Désobéissons à l’Union européenne, Mille et une nuits, 2011
Comment la mondialisation a tué l’écologie, Mille et une nuits, 2012
La gauche radicale et ses tabous, Seuil, 2014
La démondialisation ou le chaos, Utopia, 2016
Les voleurs d’énergie, Utopia, 2018
L’illusion localiste, Utopia, 2020
Nouvelles
Transgénial !, Mille et une nuits, 2006 (avec Michel Gicquel)
Les mondes d’après, Golias, 2011 (collectif)
Pour contacter l’auteur :
http://abernier.vefblog.net
Collection Ruptures
Les Éditions Utopia
61, boulevard Mortier – 75020 Paris
www.editions-utopia.org
www.mouvementutopia.org
Diffusion : CED
Distribution : Daudin
© Les Éditions Utopia, novembre 2021
SOMMAIRE
Introduction
1. Les fausses évidences du commerce international
L’illusion d’un commerce entre États
La valeur des échanges : une représentation déformée
Délocalisations, sous-traitance, robotisation : même combat
Les coûts de la division internationale du travail
Le mythe du déficit extérieur français
De la « guerre commerciale »… à la « guerre commerciale »
Le néocolonialisme économique
La démondialisation n’aura pas lieu spontanément
2. La relocalisation au cœur du débat politique
Protectionnisme : du tabou à la pensée magique
Le modèle américain et le trumpisme français
La fable du « juste échange »
La relocalisation sans protectionnisme
3. Sur quelles bases penser la relocalisation
Emploi et contrôle public : une relocalisation de lutte des classes
Que faut-il relocaliser ? Utilité sociale, technologie et décroissance
Un protectionnisme qui cible les productions, pas les États
Sortir du néocolonialisme et de l’échange inégal
Le débat institutionnel : rompre avec l’Union européenne et les institutions libre-échangistes
4. Relocaliser concrètement : les capitaux
Régulation publique ou régulation privée
Ce que la libre circulation des capitaux signifie
Comment relocaliser les investissements
5. Relocaliser concrètement : la santé
La division internationale poussée à l’extrême
Un problème politique national et international
Une stratégie de relocalisation
6. Relocaliser concrètement : l’alimentation
Le retour du local, vraiment ?
Quelles souverainetés alimentaires ?
Ce qui ne se relocalise pas
7. Relocaliser concrètement : l’énergie
L’urgence de stopper les délocalisations
Que faut-il relocaliser ?
Comment s’y prendre
8. Relocaliser concrètement : l’automobile
Des délocalisations au sein même de l’Union européenne
Délires productivistes, technologiques et environnementaux
Relocaliser pour décroître et reconvertir
9. Pour finir
Bibliographie sélective
Notes
Les Éditions Utopia
Pour Eugénie et Alice, « maintenant qu’un et un font trois » Je vous aime.
Un grand merci à Morvan, Justine, et bien sûr Eugénie, pour les échanges, les conseils et les yeux acérés qui traquent les coquilles.
Ce livre est à la mémoire de Coralie Delaume (1976-2020). Pas une seule page sans penser à toi.
Introduction
En janvier 2016, le site parodique d’information Le Gorafi publiait une (fausse) dépêche : « L’usine qui produisait les étiquettes “fabriqué en France” délocalisée à l’étranger ». La brève humoristique imagine une entreprise basée à Évry qui transfère sa production en Chine pour baisser ses coûts et rester compétitive dans la concurrence internationale.
Comme souvent, Le Gorafi est drôle mais dramatiquement proche de la réalité. Une simple recherche sur le site commercial chinois Alibaba suffit à le comprendre. En tapant « étiquettes Made in France » sur la page d’accueil de cette plateforme, on trouve des centaines de références proposées par des firmes chinoises. On peut y commander des lots de marquages en tissus, en cuir ou en métal fabriqués par Douya Co. Ltd Store, par exemple, une société basée dans la ville portuaire de Jiujiang (province du Jiangxi, au Sud-Est de la République populaire de Chine) au bord du plus grand fleuve du pays, le Yangzi Jiang (ou Yang-Tsé-Kiang). Chez le fournisseur Icraft Happiness Store, implanté dans la ville côtière de Jiaxing (province du Zhejiang, à l’Est), l’une des capitales de la soie, on trouvera de magnifiques autocollants en papier kraft sur lesquels sont imprimés en français « Fait main avec amour » ou « Fait maison ». Ces imprimeurs ne proposent pas que du « Made in France » : on trouvera des marquages pour toutes les provenances, jusqu’aux étiquettes lavables pour textiles estampillées « 100 % coton made in USA ». La délocalisation d’étiquettes avec laquelle Le Gorafi nous fait sourire a déjà eu lieu, comme celle de beaucoup de produits consommés par les particuliers ou les entreprises françaises.
D’une manière générale, les délocalisations font partie du quotidien économique des pays industrialisés à forte protection sociale et dont le coût du travail est relativement élevé, ce qui est le cas de la France. De nombreux livres et de nombreux travaux universitaires en ont décrit aussi bien les causes que les conséquences. Je l’ai moi-même fait dans plusieurs ouvrages, en particulier dans La démondialisation ou le chaos1. Nous avons maintenant besoin de passer à l’étape suivante. À propos du libre-échange et du transfert d’activité dans les pays à bas coût, je me contenterai de rappeler ici les éléments indispensables pour imaginer le mouvement inverse : celui de la relocalisation. Car ce qui n’existe pas à ce jour et qui nous manque cruellement, c’est un travail qui dépasse le constat, les solutions simplistes et qui vise à penser la relocalisation de l’économie dans toute sa complexité et sa radicalité. C’est l’objet de ce livre.
Les délocalisations sont une conséquence de ce que l’on nommait dans les années 1970 la « division internationale du travail » : une réorganisation de la production qui la segmente et localise les activités en fonction des avantages de chaque pays ou de chaque région du monde. Une stratégie de firmes multinationales, donc, qui lui ont d’ailleurs trouvé un nom moins technique, plus moderne et plus positif : la mondialisation.
Si les grandes entreprises ont pu procéder à cette réorganisation, c’est grâce aux progrès technologiques, mais aussi et peut-être surtout parce que les États leur ont offert cette possibilité en adoptant un ordre international libre-échangiste. La suppression progressive des outils de régulation (le contrôle des marchandises et des capitaux notamment) a rendu la division internationale du travail rentable et légale, ce qui a totalement transformé l’économie mondiale en l’espace de quelques décennies.
Ancien économiste à l’Université de Poitiers, Olivier Bouba-Olga a proposé une description convaincante des évolutions de la figure type de la firme transnationale à travers le temps2. Dans les années 1950, l’internationalisation sert avant tout l’approvisionnement en matières premières. Dans les années 1960, les grands groupes ouvrent des succursales à l’étranger pour se rapprocher de la demande et conquérir de nouveaux marchés. Dans les années 1970 et 1980 débute la véritable division internationale du travail : pour rationaliser la production, les transnationales implantent des ateliers dans les pays à bas coût de main-d’œuvre et avec peu de contraintes environnementales ou sociales. Enfin, les années 1980 et 1990 voient émerger des « firmes globales » à la recherche d’une flexibilité maximale qui leur permet de s’adapter rapidement aux fluctuations des marchés. Cette flexibilité s’obtient par un recours accru à la sous-traitance, par une logique de filialisation et de gestion des actifs à court terme : on vend des filiales pour se désendetter et faire remonter les cours de Bourse, on en rachète pour se positionner sur des marchés émergents… tout cela à un rythme qui donne le vertige.
C’est ainsi que les affaires de fermetures d’usines en France ont défilé dans l’actualité, particulièrement depuis les années 1990, laissant des noms d’entreprises ou de villes irrémédiablement associés à des licenciements massifs et au déclin industriel : ArcelorMittal à Florange, Continental à Compiègne, ST Microelectronics à Rennes, Renault à Flins et Sandouville, Whirlpool à Amiens, Metaleurop à Noyelles-Gaudault…
La définition académique de la délocalisation ne reflète absolument pas l’ampleur du problème. Pour l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la délocalisation est une fermeture d’usine en France avec une réouverture équivalente à l’étranger. Mais le vrai phénomène massif est la désindustrialisation, qui peut s’opérer de bien d’autres manières. On peut laisser un site se délabrer et investir ailleurs par anticipation de façon à justifier a posteriori sa fermeture. On peut choisir un sous-traitant d’Europe de l’Est à la place d’un sous-traitant français et pousser ce dernier à la faillite. Fin 2019, le nombre d’emplois industriels en France était de 3,17 millions contre 5,72 en 1974. La part de l’industrie manufacturière dans le Produit intérieur brut (PIB) ne représentait plus que 10 % alors qu’elle était de plus de 22 % en 1970. Et dans cet intervalle, la consommation de biens en France n’a évidemment pas diminué, au contraire. L’agriculture, elle, pèse 2 % du PIB, soit près de quatre fois moins qu’en 1974.
Les conséquences de ce libre-échange et de cette mondialisation de la production et du commerce sont colossales. D’abord un chômage de masse, qualifié maintenant de structurel, qui touche en premier lieu les ouvriers. Pour ceux qui conservent un emploi en France, c’est la dégradation continue des conditions de travail pour s’aligner sur la concurrence internationale, prétexte rêvé qui permet au patronat de soumettre les salariés. Pour les travailleurs des pays à bas coût de main-d’œuvre, c’est la perpétuation d’une exploitation insupportable qui s’apparente dans certains cas à de l’esclavage à peine indemnisé.
La division internationale du travail a fait émerger une production à très bas coût dans de nombreux secteurs (alimentation, textile, électroménager, informatique, téléphonie, jouets…) dont les impacts sont catastrophiques à plusieurs titres. Sur le plan environnemental d’abord, elle gaspille les ressources et détruit le milieu naturel. Sur le plan social ensuite, elle permet de maintenir des salaires bas mais d’augmenter artificiellement le pouvoir d’achat en baissant le prix du « panier de la ménagère ». La contrepartie du T-shirt à cinq euros est sa durée de vie très courte, celle des dix steaks à six euros est leur qualité nutritionnelle déplorable − quand ce n’est pas leur toxicité. Mais le résultat est là : on peut perpétuer la consommation de masse, voire l’augmenter, sans rogner sur les profits du patronat.
Sur un plan stratégique, la désindustrialisation détruit les savoir-faire et place des pans cruciaux de l’économie française sous dépendance étrangère. C’est le cas par exemple avec la prise de contrôle de la division énergie de l’entreprise Alstom par General Electric en 2014 : le secteur des turbines, y compris celles qui équipent les centrales nucléaires, est passé sous contrôle américain et quatre ans plus tard, certaines activités sont déjà menacées de délocalisation. En 2020, la pandémie de Covid-19 a également montré ce que la division internationale du travail pouvait avoir de plus catastrophique en matière de santé publique. Privée de masques (un morceau de tissu et deux élastiques !), de gel hydroalcoolique (fabriqué à partir de quatre composants courants : de l’alcool, de la glycérine, de l’eau oxygénée et de l’eau) et de matériels médicaux de base, la France a découvert que la quasi-totalité de la production de molécules pharmaceutiques était importée d’Asie. Une situation largement connue dans le milieu médical, les pénuries de médicaments étant un sujet d’inquiétude récurrent.
Les délocalisations, ce sont aussi celles des capitaux, dont la circulation est libre, ce qui produit un double mouvement. D’une part, les grandes entreprises nationales peuvent diriger leurs investissements vers des marchés plus rentables à l’étranger, ce qui prive l’économie française de capitaux. Alors que la transition énergétique nécessiterait des investissements pour entretenir ou rénover les infrastructures, Électricité de France et Engie, par exemple, préfèrent placer leurs fonds en Asie, aux États-Unis ou en Amérique du Sud car les profits à court terme y sont bien plus prometteurs qu’en France. D’autre part, la libre circulation des capitaux empêche de taxer sérieusement les richesses, les grandes fortunes pouvant fuir l’impôt en ouvrant des comptes dans des pays plus complaisants, voire dans des paradis fiscaux. En se privant de ces ressources, l’État se prive des moyens de mener des politiques sociales, de développer les services publics, ce qui permet aux libéraux d’ouvrir la porte aux privatisations.
En définitive, le libre-échange et la division internationale du travail opèrent un transfert de pouvoir des autorités publiques vers les multinationales. En dérégulant, on permet aux grands groupes privés de définir ce qu’il convient de produire et les conditions de cette production. On leur permet également de remettre en cause les protections sociales au prétexte d’améliorer la compétitivité de l’économie française dans la concurrence mondiale. Avec cet alibi, les groupes de pression industriels et financiers peuvent tranquillement dicter leurs réformes aux gouvernements, comme celles, successives, qui ont remis en cause les retraites par répartition ou ajouté de la « flexibilité » dans le droit du travail. Le chantage est d’autant plus efficace, la production de normes passe d’autant plus facilement du public au privé, que la libre circulation des marchandises et des capitaux rend les risques de fermetures d’usines ou d’évasion fiscale bien réels.
Comme le démographe Emmanuel Todd l’a souligné dès 1998 dans son livre L’illusion économique, le libre-échange, les délocalisations d’usines et de capitaux sont avant tout un problème de classe3. Il est évident, en effet, que les classes populaires sont bien plus exposées que les classes moyennes et supérieures au chômage, aux dégradations des conditions de travail, au désinvestissement dans les services publics et au rabotage des politiques redistributives. Mais le libre-échange nous place aussi face à un problème démocratique qui concerne, lui, l’ensemble de la société : qui, du peuple ou des multinationales, doit commander à notre destin ?
La critique de la mondialisation n’a jamais été aussi forte. Elle transcende les frontières et les clivages politiques traditionnels mais bénéficie le plus souvent à des mouvements conservateurs et autoritaires plutôt qu’à des mouvements progressistes. Elle se nourrit de revendications économiques et identitaires, le rejet de l’immigration et celui de la division internationale du travail allant souvent ensemble, mais le premier, par facilité, prenant le pas sur le second.
L’un des événements politiques les plus représentatifs de ce rejet est l’élection à la présidence des États-Unis du Républicain Donald Trump en 2016, candidat porté par l’ultradroite mais élu grâce aux voix des habitants de régions désindustrialisées. Malgré son échec à se faire réélire en 2020, le « trumpisme » n’a pas disparu. Le souhait légitime des travailleurs américains d’en finir avec la désindustrialisation et de retrouver des emplois locaux, la crainte du déclassement générée par l’émergence d’économies à bas coût de main-d’œuvre ont changé la donne du débat politique. Un souhait et une crainte partagés par les classes populaires européennes.
En France, une grande majorité de citoyens a une mauvaise image de la mondialisation. En mars 2018, l’institut de sondage OpinionWay publiait une enquête dont les résultats sont sans appel : pour près des deux tiers des Français interrogés, la mondialisation a eu des effets négatifs sur les salaires et l’emploi et 71 % se disent pessimistes pour l’avenir. Le plus frappant est la presque disparition des partisans du libre-échange : seuls 13 % des sondés pensent qu’il faut supprimer davantage les obstacles pour faciliter les échanges commerciaux − un chiffre sans doute inversement proportionnel à la part de libre-échangistes siégeant à l’Assemblée nationale ou intervenant dans les grands médias… S’ils ne suffisent pas à l’expliquer, l’ascension électorale de Marine Le Pen et du Rassemblement national doit néanmoins beaucoup à cet effondrement du mythe de la « mondialisation heureuse » et à la présence de mesures protectionnistes dans son programme.
Dans son ensemble, la sphère politique française a bien compris que le vent avait tourné et qu’une large majorité de citoyens condamnait les délocalisations. Sur des bases politiques très différentes et avec des niveaux de radicalité très variables, six candidats à l’élection présidentielle de 2017 proposaient de réguler les échanges internationaux : Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau et Jacques Cheminade. Le cumul de leur score au premier tour dépasse 53 % des suffrages, ce qui confirme au moins que cette idée n’est plus un repoussoir.
Avec la pandémie mondiale de Covid-19, même l’exécutif en place s’est senti obligé de prendre ses distances avec le libre-échange ou d’évoquer l’idée de relocaliser certaines productions. Le 31 mars 2020, le président de la République Emmanuel Macron déclare vouloir « produire davantage en France, sur notre sol. Produire parce que cette crise nous enseigne que sur certains biens, certains produits, certains matériaux, le caractère stratégique impose d’avoir une souveraineté européenne. » Et de conclure, en forme de promesse : « Le jour d’après ne ressemblera pas aux jours d’avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne4. » Le 15 juillet 2020, dans sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex entonne le même refrain : « Notre industrie s’est affaiblie. Nous avons vu certains de nos fleurons industriels et technologiques passer sous pavillon étranger sans que nous puissions, ou souhaitions, réagir. Nous sommes aujourd’hui trop dépendants de nos partenaires extérieurs, et insuffisamment présents sur certains secteurs stratégiques. Nous consacrerons 40 milliards d’euros pour que cela change5. »
À droite, Nicolas Sarkozy a plusieurs fois défendu un protectionnisme à l’échelle de l’Union européenne au cours de son mandat de président de la République, de 2007 à 2012. En mars 2012 notamment, alors qu’il faisait campagne pour sa réélection, il réclamait une législation qui oblige à réserver une partie des commandes publiques aux petites entreprises nationales et se disait prêt à prendre des mesures unilatérales si l’Union européenne ne le permettait pas.
À gauche, Jean-Luc Mélenchon défend de longue date un « protectionnisme altruiste ». Europe écologie - Les Verts réclame que l’Union européenne instaure une taxe carbone aux frontières extérieures et que « les produits des pays qui ne respectent pas la liberté syndicale soient fortement taxés ou interdits de territoire européen ». Au Parti socialiste, la même idée est présentée sous le doux nom d’« écluses tarifaires ». Quant à l’ancien ministre du Redressement productif de François Hollande, Arnaud Montebourg, il a quitté le Parti socialiste pour se consacrer à la défense du « Made in France » et ne cache pas ses ambitions pour l’élection présidentielle de 2022.
La relocalisation est devenue en quelques années un thème central du débat politique. Propulsée par la crise de 2007-2008, maintenue sur le devant de la scène par une désindustrialisation qui n’en finit pas, elle est à présent érigée en priorité nationale sous l’effet de la crise sanitaire et de son pendant économique.
Il serait néanmoins imprudent de trop s’en réjouir. D’une part, beaucoup n’envisagent les mesures de régulation qui permettraient (selon eux) de relocaliser qu’au seul niveau européen, alors même que l’Union européenne s’est fondée sur le libre-échange et que son ordre juridique le sanctuarise. Dans ces conditions, le passage à l’acte reste totalement improbable. D’autre part, bon nombre de ceux qui défendent la relocalisation (sincèrement ou par opportunisme) partagent deux objectifs : la baisse du chômage et la reconquête de la souveraineté économique, étant entendu que cette souveraineté n’est pas nécessairement populaire mais toujours nationale.
Nous avons donc deux types de comportements : un européisme maladif qui fait espérer et attendre la validation de Bruxelles pour agir, et un « trumpisme » à la française qui ne remet jamais en cause l’ordre international mais veut juste tordre les règles de la concurrence à son profit. Le premier est plutôt en vogue à gauche, le second à droite, mais les deux visions ne sont pas exclusives : on peut être à la fois pour le « trumpisme » économique (couramment qualifié de patriotisme) et pour sa mise en œuvre à l’échelle européenne uniquement.
Il est tout à fait possible qu’à court terme, un certain patriotisme économique soit en mesure de réduire le chômage et de nous faire gagner en souveraineté nationale. Mais à quel prix ? Puisque les productions à bas coût sont déjà délocalisées, le patriotisme économique que l’on nous propose table sur le progrès technique et le productivisme. Pour améliorer la compétitivité des entreprises nationales, il réclame l’implication de tous : celle du patronat, qu’il appelle à prendre en compte l’intérêt de la nation mais sans lui appliquer de contrainte inutile, et celle des salariés, qui doivent se conformer à l’ordre social en place, voire même accepter quelques concessions sur les salaires ou les conditions de travail. Les rapports Nord-Sud n’ont pas à être changés, l’essentiel étant que les entreprises françaises continuent à accéder à des matières premières à bas prix, à une main-d’œuvre sous-payée et à des marchés extérieurs profitables. En matière de propriété des moyens de production, ce patriotisme-là conforte les grandes entreprises privées et veut mettre davantage de moyens publics à leur disposition : des financements, la recherche, le renseignement, la diplomatie…
J’ai la conviction que la relocalisation est absolument nécessaire, mais je suis tout aussi convaincu qu’elle ne doit rien avoir de commun avec cette vision étroite du patriotisme économique. L’objectif n’est pas de faire « comme les États-Unis » qui, certes, sont moins dogmatiquement libre-échangistes que l’Union européenne mais qui sont tout aussi capitalistes, productivistes et impérialistes, si ce n’est davantage. Il n’est pas de faire « comme la Chine » qui sait très bien protéger ses activités stratégiques mais dont le capitalisme d’État détruit les écosystèmes et asservit son propre peuple ainsi que nombre de pays du Sud. L’enjeu est de transformer radicalement la production, son empreinte écologique, les conditions de travail des salariés et, en définitive, l’ordre international. Relocaliser est un impératif car on ne contrôlera jamais de façon démocratique une production délocalisée. Mais l’objectif ne se limite pas à produire en France. Nous devons stopper certaines productions nuisibles, nous devons imposer des normes sociales et environnementales exigeantes et les faire respecter, nous devons rendre les biens et services de première nécessité accessibles au plus grand nombre et nous devons inverser la répartition de la valeur ajoutée entre capital et travail. Si la sortie du libre-échange et la relocalisation sont incontournables, c’est parce qu’elles sont un point de passage obligé pour reprendre le contrôle politique de l’économie et soumettre les grandes puissances privées. C’est bien le but ultime.
Les fausses évidences du commerce international
Pour les économistes libéraux, la division internationale du travail, la spécialisation des États en fonction de leurs avantages comparatifs et l’intensification du commerce international étaient censées maximiser la richesse produite, tirer vers le haut les salaires et les normes environnementales pour, au bout du compte, bénéficier à tous. Ce mythe s’est lentement érodé avant de s’effondrer réellement avec la crise de 2007-2008, période à laquelle nous sommes passés, dans les discours officiels, du mythe de la « mondialisation heureuse » à la mondialisation-fatalité.
Si nous avons à présent une vision plus lucide de ce qu’est réellement la mondialisation, il reste néanmoins de nombreuses fausses évidences dans la description qui est donnée de l’ordre commercial, fausses évidences véhiculées par les médias, les politiques et, encore plus grave, par de nombreux travaux universitaires. Si nous voulons remettre en cause cet ordre productiviste et libre-échangiste, nous devons commencer par nous désintoxiquer de ces représentations faussées.
L’illusion d’un commerce entre États
« Avec une part de marché inférieure à 2 %, la France reste très loin derrière les deux principaux fournisseurs du Japon que sont la Chine et les États-Unis. Douzième client mais aussi douzième fournisseur de la France, le Japon n’en reste pas moins notre deuxième partenaire commercial asiatique après la Chine. »
Ce court texte est extrait du rapport du commerce extérieur de la France 2021 édité par la direction générale du Trésor, un document on ne peut plus officiel qui détaille les échanges entre l’économie française et le reste du monde. Comme toutes les publications de ce type, on y évoque les parts de marché d’un pays dans une région du monde, les échanges entre deux pays, les excédents ou les déficits d’une nation, globalement ou par secteur d’activité. Dans l’esprit du lecteur, il se dégage une représentation : « la France » commerce avec « le Japon », elle importe depuis « la Chine » ou se trouve en concurrence avec « les États-Unis ». Les échanges commerciaux sont présentés comme des relations inter-étatiques.
On comprend bien l’intérêt de la simplification de langage utilisée par les pouvoirs publics, les médias et les universitaires pour décrire les échanges commerciaux à l’international, qui correspond d’ailleurs à la présentation comptable en vigueur, celle de la balance des paiements et de la balance commerciale. Mais elle n’est pas neutre pour autant.
Les États ne commercent pas directement entre eux mais par l’intermédiaire d’entreprises, la plupart du temps privées. Ce sont bien des entreprises qui achètent à d’autres entreprises étrangères – qui peuvent être leurs propres filiales – des matières premières et des produits semi-transformés pour fabriquer des produits finis. C’est bien la grande distribution qui choisit de remplir ses rayons avec des produits fabriqués par des entreprises installées dans des pays à bas coût de main-d’œuvre. S’il peut arriver que les intérêts d’une entreprise dont une partie au moins du capital est public et de l’État qui la dirige se confondent, ce cas de figure est plutôt rare. On peut penser aux grandes compagnies pétrolières publiques dans les pays producteurs ou à la part (importante) de l’économie chinoise directement contrôlée par Pékin. Mais le seul cas de figure où il serait possible de considérer que des États commercent directement entre eux serait celui de deux entreprises publiques réalisant des transactions directes, et encore, à condition qu’elles ne disposent pas d’une autonomie de gestion. Autant dire qu’il s’agit de l’exception qui confirme la règle des échanges marchands entre entités privées.
De plus, les échanges internationaux sont contrôlés par un très petit nombre de firmes. L’économie française compte 3,7 millions d’entreprises dont la plupart sont des microentreprises. Les firmes exportatrices sont un peu moins de 129 000. Dans ce cercle assez restreint, la concentration est particulièrement forte : les 1 000 premières d’entre elles (moins de 1 %) réalisent 73 % du total des exportations et les 100 premières réalisent 40 % des exportations françaises. Les importations, quant à elles, sont contrôlées par les grossistes, dont les plus puissants sont les centrales d’achats de la grande distribution, les grands groupes de l’agro-alimentaire, de la pharmacie, de la métallurgie, de l’électronique…
Si l’on voulait rendre compte de la réalité, le rapport du commerce extérieur s’écrirait de la façon suivante : « Avec une part de marché inférieure à 2 %, les multinationales françaises restent très loin derrière les deux principaux fournisseurs des entreprises japonaises que sont les multinationales chinoises et les multinationales américaines. » On y perdrait en facilité de lecture mais on y gagnerait du sens : ce sont les grandes entreprises privées qui dirigent les échanges internationaux de biens, de services et de capitaux.
La distinction est importante. Tout d’abord, elle permet de ne pas assimiler les intérêts d’une petite fraction de l’économie nationale (les exportateurs) à l’intérêt de la nation. Ensuite, elle évite de donner l’impression que les États interviennent dans ces échanges alors que, justement, les politiques de dérégulation visent à limiter le plus possible cette intervention publique, sauf bien sûr quand il s’agit d’envoyer des présidents de la République ou des ministres en voyage négocier des contrats comme de vulgaires commerciaux de grands groupes.
La valeur des échanges : une représentation déformée
La comptabilité des échanges internationaux se fait grâce à la balance des paiements, qui récapitule les transactions effectuées avec l’étranger par les ressortissants des États. Elle agrège les achats et les ventes de biens et de services (la balance commerciale), les investissements et les rapatriements de capitaux, les prêts, l’aide au développement… Pour établir un solde dans une même unité, les transactions de biens et de services sont inscrites en valeur marchande.
Le problème de cette norme comptable est qu’elle cache un déséquilibre structurel dans les échanges. Les importations en provenance du Sud et des nouveaux pays industrialisés comme la Chine sont en grande partie des matières premières et des productions à bas coût. Les exportations des pays occidentaux contiennent, en moyenne, une valeur ajoutée bien supérieure. Un échange équilibré en unité monétaire sera donc souvent très déséquilibré en volume et en poids.
Prenons un exemple concret : la firme française Citroën exporte un véhicule en Chine tandis qu’une enseigne de bricolage française importe des vis à bois. La voiture est un modèle « C5 Aircross » fabriqué en France, à l’usine de Rennes. Son poids est de 1 404 kilogrammes et elle coûte 28 650 euros, soit 34 518 -dollars1. Les vis chinoises, elles, sont vendues 1,20 dollar le kilogramme2. Pour équilibrer la transaction en prix (34 518 dollars), il faut 28 tonnes et 765 kilogrammes de vis contre une tonne et 404 kilogrammes de voiture.
Avec ce cas simple, on comprend mieux pourquoi nous croulons littéralement, dans certains secteurs d’activité, sous les produits fabriqués dans des pays à bas coût de main-d’œuvre, ce que le déficit commercial, certes important mais pas abyssal, ne reflète pas.
Le même type de question peut en effet se poser dans beaucoup de secteurs. Combien de T-shirts chinois à bas prix faut-il pour équilibrer en valeur les exportations françaises de vêtements de luxe ? Combien de tonnes d’aspirine fabriquées en Asie faut-il importer pour équilibrer en valeur l’export d’un médicament français récent, breveté et chèrement vendu ?
Ce différentiel énorme en terme de valeur ajoutée explique que le déficit commercial pour le commerce des biens avec la Chine ne soit « que » de 32,9 milliards en 2019 alors que les Leroy Merlin, les Décathlon, les rayons non-alimentaires des différentes enseignes de supermarchés sont largement remplis de produits fabriqués en Chine.
Or, l’impact écologique et social des productions délocalisées dans les pays à bas coût de main-d’œuvre se perçoit beaucoup mieux en volume ou en poids qu’en dollars ou en euros. Les 53,8 milliards d’euros importés par les entreprises françaises depuis la Chine ne disent pas grand-chose de ces impacts. Par contre, le transit de conteneurs ou les tonnages déchargés dans les ports de commerce international sont beaucoup plus parlants.
Les cinq premiers ports de commerce européens (Rotterdam et Amsterdam aux Pays-Bas, Anvers en Belgique, Hambourg en Allemagne et Algésiras en Espagne) ont vu transiter plus de 800 millions de tonnes de marchandises en 2005 et plus d’un milliard de tonnes en 2015, soit une augmentation de 26 % en dix ans. Les cinq premiers ports pour le trafic de conteneurs (Rotterdam, Anvers, Hambourg, Valence en Espagne et Athènes en Grèce) ont traité 27,9 millions d’équivalents vingt pieds3 en 2005. Dix ans plus tard, le volume avait augmenté de 39 %, à 38,7 millions de conteneurs. En France, le trafic au port du Havre a augmenté de 21 % sur la même période, passant de 2,1 millions à près de 2,6 millions de conteneurs.
Toutes ces marchandises ne viennent pas de pays à bas coût de main-d’œuvre et ces données englobent des échanges maritimes intra-européens ou des flux avec les États-Unis ou le Canada. Pourtant, une grande partie des produits qui arrivent dans les ports sont des productions délocalisées dans des régions où les entreprises bénéficient d’une main-d’œuvre bon marché et corvéable et où les réglementations environnementales sont peu contraignantes. En valeur (puisque nous n’avons que ces statistiques à disposition), 17,5 % des importations de biens en 2019 venaient d’Asie, 6,8 % des pays d’Europe de l’Est et 1,6 % de Turquie ; trois régions de délocalisation qui totalisent 26 % de la valeur des importations en France et bien plus encore en volume et en poids.
Délocalisations, sous-traitance, robotisation : même combat
Les délocalisations ne sont pas un objectif en soi mais un moyen d’augmenter les profits des grands groupes. Elles ne sont d’ailleurs pas le seul et il en existe d’autres, très puissants, qui concourent aussi à détruire les emplois dans les pays occidentaux. Pour réduire drastiquement les coûts, trois possibilités s’offrent aux multinationales : situer leur production dans des pays à bas salaires, la sous-traiter dans ces mêmes pays et automatiser la production. Le débat sur les rôles respectifs de la désindustrialisation et de la robotisation dans la montée du chômage est d’ailleurs un vaste sujet de polémiques dans les médias et les milieux universitaires.
Pour aller au fond des choses, il faut repartir des objectifs fondamentaux des grandes puissances économiques privées. Le principal, l’ultime, est d’accumuler un maximum de profits. Pour y parvenir, elles ont déjà fait beaucoup : construire un marché mondial des matières premières à bas prix basé sur l’exploitation des pays du Sud, étendre le secteur marchand en libéralisant les services publics, bâtir des oligopoles privés de taille mondiale en multipliant les fusions-acquisitions, réduire les prélèvements obligatoires par le lobbying et la mise en concurrence fiscale des États, confisquer la propriété intellectuelle par le brevet ou le Copyright… Dans ces conditions, le dernier obstacle à l’accumulation capitaliste (avant, peut-être, d’atteindre les limites physiques de la planète) est le salarié disposant de droits sociaux. Il représente à la fois un coût déterminant et un contre-pouvoir au pouvoir patronal.
Soumettre ou supprimer le salarié disposant de droits sociaux est un objectif secondaire primordial pour atteindre l’objectif ultime du profit maximal. Le soumettre, c’est remettre en cause ses droits à la protection sociale, à la grève, au libre exercice des activités syndicales, à un salaire décent… La concurrence internationale est le moyen rêvé d’y parvenir et plus les délocalisations sont facilitées, plus la menace est efficace. Quand cela ne suffit pas, la logique purement comptable exige de le supprimer ce qui, concrètement, veut dire le remplacer soit par des salariés surexploités soit par des machines.
La machine a son utilité pour limiter le travail humain dangereux ou pénible. Mais pour les actionnaires et les dirigeants des grands groupes mondiaux, il ne s’agit pas de cela. Les délocalisations et la robotisation relèvent de la même logique. Un robot ne fait pas grève et ne revendique pas, un salarié de l’industrie textile du Bangladesh non plus (et cela se comprend compte tenu de la violence de la répression qui lui est opposée). Quant à la sous-traitance, elle est un moyen incroyablement efficace d’exploiter les salariés occidentaux en les mettant directement en concurrence avec les autres : à l’heure d’Internet et du libre-échange, rien de plus facile que de passer commande d’un achat de fourniture ou de prestation à l’étranger ; si le prestataire local veut rester compétitif, il doit trouver les moyens de s’aligner.
Les manuels de stratégie pour les entreprises sont fastidieux à lire, mais ils ont au moins le mérite de la transparence. Une méthode préconisée dans cette littérature est de définir chaque activité d’une grande entreprise comme un service qui peut soit être rendu en interne soit externalisé. Selon une approche coûts/bénéfices qui ne se limite pas aux aspects comptables mais comprend également des critères stratégiques, l’entreprise décidera soit de conserver cette activité en son sein, soit de la délocaliser, soit de la sous-traiter. Avec une telle logique, la grande entreprise occidentale a souvent intérêt à conserver des ressources humaines pour les activités à forte valeur ajoutée ou à caractère stratégique que sont la conception, la recherche, la méthode, le marketing, la vente… mais à comprimer ou supprimer les ressources humaines liées à la production.
Un modèle de réussite en la matière est le géant américain de l’électronique, SCI Systems, Inc., l’un des plus grands sous-traitants au monde… qui a lui-même sous-traité toute sa production pour ne conserver en interne que la conception, la logistique, le contrôle qualité. En matière de robotisation, Morning Star, une autre firme américaine qui produit du concentré de tomates, a poussé la logique à l’extrême. Grâce à ses usines de très haute technologie, elle concurrence depuis les États-Unis le concentré de tomates chinois qui bénéficie pourtant d’un coût du travail et de l’énergie très bas. Dans sa remarquable enquête sur cette filière, le journaliste Jean-Baptiste Malet décrit une usine Morning Star implantée dans la ville de Williams (Californie) qui transforme 1 350 tonnes de tomates par heure sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre grâce à une ligne entièrement robotisée qui ne nécessite quasiment aucune présence humaine4.