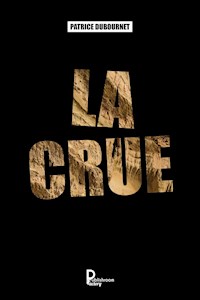
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Suivez un groupe de spéléologues dans leurs périples et de leurs découvertes !
Au début des années 1970 un groupe de spéléologues passionnés investit le dernier grand massif karstique européen encore vierge de toute exploration. Au fil des années, les découvertes et les profondeurs atteintes le transformèrent en un Himalaya inversé, terrain de jeu des derniers explorateurs du XXe siècle. Spéléos, héritiers de nos prédécesseurs, marins ou montagnards, nous étions en quête perpétuelle de découvertes de territoires encore vierges pour assouvir l’infatigable curiosité qui nous dévorait. Mais il fallut aussi gérer des imprévus : une formidable crue et l’effondrement du passage, chemin supposé, qui nous aurait conduit à l’un des collecteurs du massif, objectif de nos expéditions.
Au delà des chiffres et des records attendus, ce document est le récit d’une aventure humaine partagée.
Assouvissez votre soif d'aventures, avec ce roman autobiographique aux multiples rebondissements qui vous invite à suivre un groupe de curieux que rien n'arrête !
EXTRAIT
Si nous avions vécu dans les temps anciens, quand les équipages et leurs navires partaient à la conquête des océans chercher des terres inconnues et leurs richesses, nous aurions été de toutes ces aventures. Officier, géographe, militaire, charpentier, botaniste, novice, déserteur, médecin ou simple matelot toutes ces fonctions répondaient en écho aux nôtres. Sur le continent Antarctique, à la quête du pôle Sud, Ernest Shackleton nous aurait entraînés dans ses épopées, et le passage du nord-ouest n’aurait été qu’une formalité. Mais voilà, d’autres avant nous en avaient réalisé les exploits, quant à la Lune, elle venait d’être conquise et l’exploration de la planète Mars n’était pas encore d’actualité…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrice Dubournet
La crue
Roman autobiographique
A mes parents qui vécurent dans l’ignorance de mes périples A mes enfants explorateurs du web Aux spéléos de l’A.S.C
En ce mois d’août 1983, sous les montagnes espagnoles des Picos d’Europa, l’exploration d’un nouveau gouffre occupait, une fois de plus, les vacances d’été d’un groupe de spéléologues charentais que j’avais rejoint en 1973.
Depuis 1971, ils avaient abandonné toute perspective de farniente estivale où les seules contraintes d’apéritif et de sieste auraient réglé leurs journées.
Après un voyage de nuit, d’Angoulême, en Charente, vers Fuente Dé, en Espagne, la matinée était consacrée à compléter le ravitaillement dans le petit village d’Espinama ou plus exactement à débarrasser les étagères de l’épicerie locale de boîtes de conserve aux contenus divers. Si l’indispensable provenait de France, le pondéreux et l’exotique étaient achetés sur place. Deux stars revenaient immanquablement. La première, Natacha, au prénom évocateur de voyages, n’était que de la margarine bien éloignée de nos beurres de Charente que magnifiaient les tables des grands chefs. La seconde, les calamares, se déclinaient à toutes les sauces et principalement, pour la plus appréciée, en su tinta. La couleur noire de leur encre nous était désormais familière car, à la première ouverture, devant ces formes étranges baignant dans une sauce noirâtre, nous faillîmes alerter les autorités sanitaires locales. Une fois extraits de leur cercueil métallique nous les tartinions généreusement sur des tranches de pain à la fraîcheur légèrement passée.
Sous peine de révolte, nous devions apporter les calories nécessaires au métabolisme d’une quinzaine de ventres et les tenir en mode survie pour une durée de quinze à vingt jours. Malgré les années, l’intendance n’était pas encore totalement maîtrisée car, immanquablement, au cinquième jour, des ingrédients venaient à manquer, obligeant quelques volontaires à redescendre dans la vallée, encouragés par la perspective d’une douche et d’une virée dans les bars des villages.
Un chauffeur local, soucieux de la durabilité de sa grande Land Rover voyait avec effroi s’entasser dans son habitacle, puis sur le toit, un chargement inhabituel constitué de nos achats du matin et de tout notre précieux matériel d’exploration. La première fois que nous fîmes appel à ses services, il renégocia le prix à la hausse arguant l’omission que nous aurions commise de l’importance du poids et du volume à transporter. Nous doutâmes de notre niveau d’espagnol à moins qu’une certaine mauvaise foi de notre part ne tentât de préserver notre modeste budget. Une ancienne piste minière défoncée guidait le conducteur au col de la Vueltona, son terminus. Après avoir déchargé le véhicule par de nombreux allers-retours, nous assurâmes le portage de son contenu jusqu’à notre futur camp d’altitude. En l’espace de quelques heures, la montagne ressemblait à une de ces foires de village aux marchandises hétéroclites où l’indispensable côtoyait l’invraisemblable.
La Land Rover poussiéreuse et son chauffeur regagnaient la vallée avec comme souvenir des pois chiches et des grains de riz échappés de notre ravitaillement. Disséminés dans les recoins inaccessibles, ils réapparaîtraient au gré des chaos secouant, tel un shaker, le véhicule et ses passagers.
En fin de soirée, les hommes, les rares femmes et l’ensemble de l’équipement nécessaire au fonctionnement du camp d’été étaient rassemblés à 2 100 mètres dans un cadre majestueux effaçant la fatigue et les difficultés des heures précédentes. La mer de nuages qui venait de s’établir accentuait un sentiment d’isolement entre nous et le reste du monde. Nous voilà passagers clandestins montés à bord d’un vaisseau mystérieux voguant vers des émotions nouvelles.
L’imposante montagne de la Torre de Altaiz dominerait pendant quelques semaines le théâtre des opérations.
Imperturbable face au spectacle, le soleil poursuivait sa course et disparaissait derrière les sommets. Il laissait progressivement place au scintillement des premières étoiles. Les plus impatients d’entre nous, après un court repos, commençaient l’équipement de la cavité. Ils en redécouvriraient la lumière et l’intensité après un long cheminement souterrain. À peine vingt-quatre heures nous séparaient du départ de nos lieux de vie qui, désormais, ne nous appartenaient plus. Nous endossâmes nos habits d’explorateurs, laissés là onze mois plus tôt. À quelques centaines de mètres du camp, la lumière jaune et bleue des lampes frontales s’évanouissait dans les anfractuosités du relief. Après ce tumulte passager, la montagne reprit ses droits et le silence de la nuit s’installa.
Nos insolites vacances d’été allaient commencer.
Depuis quelques jours, les équipes se succédaient dans la cavité et s’enfonçaient au cœur de cet immense massif calcaire encore vierge de toute exploration.
Au début des années soixante-dix, quelques groupes spéléos venus de France ou d’Angleterre s’étaient confrontés aux cavités des massifs occidental, oriental ou central. L’accès plus difficile de ce dernier avait retardé l’arrivée de ces premiers aventuriers.
Précédés par un groupe venu de la lointaine terre anglaise, les Charentais en avaient investi les lieux. Chez nos voisins, se perpétrait une puissante aspiration à franchir les limites de leur île et à explorer des territoires inconnus. Après avoir sillonné et assuré la maîtrise des océans puis de leur commerce, une nouvelle génération d’aventuriers se substitua aux précédentes. Celle-ci, composée de montagnards, comme on les dénommait, s’était illustrée dans les Alpes, ouvrant là de nouvelles perspectives aux Français. On imagine un amour-propre un peu écorné par un Wymper conquérant d’inédites verticalités. Oubliée cette vieille rivalité du boulet de canon vecteur d’un dialogue et d’une entente pas vraiment cordiale, nul commerce ni richesse à attendre de ces nouvelles explorations. Les reines, rois et autres commanditaires ne les soutiendraient plus. Le pacifisme animait désormais nos amis anglais, avides, comme nous, de nouvelles aventures. Après les mers, les territoires glacés, les montagnes, ils s’intéressèrent à d’autres horizons. Nous allions partager des conquêtes qui se dérouleraient désormais en sous-sol.
Nos aspirations étaient communes et ce ne fut qu’une demi-surprise de les retrouver ici, dans ces montagnes, à parcourir les derniers terrains vierges de notre terre.
Le massif des Cantabriques prolonge vers l’ouest la chaîne des Pyrénées. En leur centre, les Picos d’Europa les dominent. Ils portent le nom donné par les marins espagnols et peut-être basques, formidables navigateurs qui conquirent l’Atlantique à bord de leurs navires à la poursuite des grands cétacés. Les premières montagnes de l’ancien continent émergeant de l’horizon brumeux furent nommées les Pics d’Europe. Remarquables amers culminant jusqu’à 2 600 mètres d’altitude, ils ont vraisemblablement permis à de nombreux capitaines et leurs équipages d’éviter une fin tragique lorsqu’ils atterrissaient sur la côte nord. Les longues semaines de navigation passées sur l’Atlantique, sans instrument précis, entraînaient des erreurs d’estime parfois considérables. La vision lointaine de ces montagnes devait être vécue comme une renaissance. Ces marins des anciens temps y retrouvaient des familles, un port dont ils repartiraient vers la haute mer et ses dangers.
La roche blanche massive constituant ces montagnes est du calcaire : accumulation sur plusieurs centaines de mètres d’organismes marins déposés dans des temps lointains bien avant que l’homme ne parte à la conquête des continents. Progressivement, au fil des millions d’années, ils se sont transformés en cette roche dure que nos marteaux peinent à ébrécher. Les mouvements successifs des plaques continentales les ont soulevés, déformés et fracturés sur une période couvrant plusieurs dizaines de millions d’années. Abandonnés par les temps géologiques et échoués à quelques encablures de l’Atlantique, les millénaires se sont chargés de les modeler pour leur donner les formes tourmentées et majestueuses que nous leur connaissons. Durant ces deux derniers millions d’années, les glaciers y creusèrent des vallées et leurs eaux de fonte s’enfouirent profondément dans les fissures de la roche, dérobant au regard des touristes de passage des paysages insolites que seuls les spéléologues viendront contempler. Les eaux nivales et pluviales poursuivent inlassablement leur œuvre qui, fatalement, entraînera un jour la disparition de ces montagnes. Sans l’écoulement de l’eau dans les fissures de la roche, nous ne serions pas là. Elle est notre alliée, l’instrument qui façonne les grottes et les gouffres. Nous avons appris à nous en méfier, pas à la dompter.
Les conditions climatiques très humides de la région des Cantabriques, avec les orages estivaux violents, sont venues se rappeler à nous en de nombreuses fois, transformant d’inoffensifs ruisseaux en torrents puissants et dangereux.
De profondes vallées, d’où surgissent les eaux drainées des montagnes, partagent le massif des Picos en trois blocs. Ils font face à l’Atlantique, défiant l’océan et ses tempêtes. Les hommes, par commodité, les ont baptisés en fonction de la course du soleil. Le plus à l’ouest s’est appelé massif occidental, celui de l’est, oriental et le dernier, cerné par les deux autres, en toute logique, a été nommé massif central. Du fait de ses dimensions, il est incontestablement le plus imposant. C’est ici que culmine le Torre Ceredo et ses 2 600 mètres de calcaire. Non loin de lui, le Najanjo de Bulnés, monolithe de pierre compact dont les cinq cents mètres de verticale, qui, au-delà d’illustrer les cartes postales, offre aux grimpeurs un terrain de jeu difficile. C’est là, dans ce massif, que nous avons jeté tous nos espoirs.
Pour atteindre le pied des montagnes et les larges zones à prospecter par les spéléologues, il faut généralement s’élever de plus de mille mètres en empruntant d’étroits chemins serpentant au milieu de la rocaille ou en dessiner de nouveaux, matérialisés par des cairns de pierres.
Les étendues de roches laissées à nu par les glaciers du Quaternaire, recouvertes une grande partie de l’année par la neige et battues par les dépressions de l’Atlantique ne sont pas propices au développement de la végétation. Aptes à se maintenir en milieu difficile, seuls les rebeccos, proches cousins des chamois, survivent l’été sur de maigres herbages qu’ils partagent avec les chèvres et les moutons.
Les premiers hommes à parcourir ces paysages minéraux, nommés « lapiaz » par les géographes, furent sans doute des chercheurs de métaux ou des géologues, suivis par des mineurs venus exploiter de nombreux filons de plomb et de zinc. Ces mines disséminées sans logique apparente percent de loin en loin le lapiaz et les flancs des montagnes. Elles sont facilement repérables par leurs orifices noirs qui ponctuent le calcaire blanc alentour. Le volume des déchets de pierres, issus de l’exploitation et laissés à proximité, donne une indication sur l’importance des creusements. Pour y accéder, les mineurs taillèrent dans le roc des chemins et, pour les gisements les plus importants nécessitant l’acheminement d’hommes et de matériels, ils construisirent de petites routes. Des bergers suivis de leurs troupeaux à la recherche de pâturages les avaient peut-être précédés.
Depuis bien longtemps, les grottes et gouffres accessibles de Charente avaient été explorés, et seules les interminables désobstructions des week-ends berçaient l’espoir de découvertes. Lorsque l’été venait, les clubs spéléos, comme le nôtre, quittaient leurs terrains de jeux dominicaux pour affronter de nouveaux territoires. La migration estivale poussait les membres de notre club vers le sud, dans les Pyrénées : magnifique réserve de gouffres. Mais les meilleurs morceaux étaient déjà préemptés. Les spéléos de cette époque ne possédaient pas encore la culture du partage mais uniquement celle de la conquête. Nous ne partagions pas nos territoires avec les autres clubs mais au contraire nous les défendions, les protégeant jalousement de tout intrus. Nous avions cette paranoïa d’imaginer que d’autres étaient susceptibles de venir poursuivre nos découvertes abandonnées temporairement pour de longs mois. Nous avions la naïveté d’imaginer que des pirates viendraient mettre un terme à nos efforts, plantant un drapeau, symbole d’une victoire qui nous aurait été volée. La piraterie perdurait sous des formes inattendues comme chez celles et ceux qui, avec leurs bateaux, guettaient les galions chargés d’or et d’argent.
Ce sont les grimpeurs, dont Paul et son frère, partageant une double passion, partis escalader et réaliser des premières dans ces belles parois de calcaire, qui croisèrent lors des marches d’approche des bouches noires dans lesquelles quelques pierres lancées dévoilèrent de nouveaux territoires.
En 1971, un camp de repérage, établi à proximité du refuge de Veronica à 2 300 mètres d’altitude, confirma aux premiers Charentais la présence d’immenses zones percées de centaines de gouffres, vierges de toute exploration. La montagne nous offrait toute sa générosité. C’était en quelque sorte l’Eldorado où le vieil adage pouvait de nouveau être entendu :
–Ça continue ?
–Non, il faut se baisser…
Mais il fallut de la pugnacité pour les atteindre, une combativité sans faille pour s’y maintenir, et de la passion pour y revenir. Nous comprîmes rapidement qu’elles se mériteraient et qu’un lien indéfectible allait se nouer entre ces montagnes et nous.
L’accès depuis la France était assez malcommode. Le parcours des 700 kilomètres nous séparant des Picos nécessitait une à deux journées. Le magnifique contraste mer et montagne, peu avant la bifurcation qui nous conduisait au pied des Picos, effaçait le calvaire des 600 premiers kilomètres où nos voitures surchargées tentaient de se frayer un chemin au milieu des camions, les Pegaso, circulant sur des nationales encombrées et dangereuses qui desservaient les grandes agglomérations industrielles du nord de l’Espagne. Le risque de mourir sur ces routes était plus grand que celui que nous allions affronter dans l’exploration de nouvelles cavités.
L’arrivée, en fin d’après-midi ou au petit matin, dans le cirque de Fuente Dé, au sud du massif central, était à chaque fois une renaissance, objectif de toute une année d’attente.
Immense pâturage à l’aube du xxe siècle, le cirque de Fuente Dé était devenu un site touristique où s’étaient implantés, dans les années vingt, un hôtel de luxe de la chaîne des Parador, puis un téléphérique dans les années soixante. Il attirait, les jours de beau temps, les touristes de passage. Il n’était pas rare non plus, les jours de brouillard, d’en trouver perdus en petites chaussures sur le lapiaz, et qui, attirés par notre campement, immanquablement, nous demandaient :
–¿Adónde esta el camino por Veronica?1
La cabana Veronica était le nom d’un refuge à la taille très modeste, posé au milieu des gouffres et établi à proximité de belles courses. Sa capacité était limitée à quelques couchages et son style architectural la distinguait difficilement de la tourelle d’une canonnière d’un navire de guerre ou de celle d’un observatoire astronomique. Sa position sur son belvédère aurait assuré les deux fonctions.
Visible dès la plateforme supérieure du téléphérique, Veronica attirait les touristes les plus courageux qui disposaient d’un objectif pour cette journée de vacances. Les zones touristiques se doivent de posséder des symboles. Paris a sa tour Eiffel, le Louvre sa Joconde où s’agglutinent les touristes et les Picos, Veronica. Car, une fois arrivés sur la plateforme du téléphérique, après en avoir contemplé les alentours, désœuvrés devant l’immensité de roches dont ils ne comprenaient pas le sens, ils partaient dans sa direction. Les nuages accrochés aux sommets masquant temporairement l’objectif et la présence colorée de notre camp entraînaient de la confusion dans l’orientation des inexpérimentés randonneurs. La large piste minière qui conduisait à notre camp les détournait du chemin pierreux et pentu, passage obligé vers Veronica. Après un temps d’hésitation à la bifurcation, et en l’absence de toute signalétique, ils choisissaient la facilité.
La question nous soulevait à chaque fois le même soupir de lassitude. Pour tenter de les remettre dans la bonne direction, nous tendions un index salvateur vers ce qui nous semblait être l’objet de leur demande. Ils repartaient heureux de cette rencontre providentielle, et nous de nous être débarrassés de ces intrus. Avec les années, nous considérions notre terrain de jeu comme notre territoire sans aucune volonté de partition. Seuls ceux qui en éprouveraient le parcours initiatique auraient ce droit de partage. Lors du franchissement de la frontière, le regard du douanier posé sur nos tentes et gamelles dépassant de notre chargement nous classait dans la rubrique « touristes » au même titre que ceux que nous retrouvions égarés sur nos terres. Que savait le touriste de l’appréhension qu’il fallait surmonter lors d’une première descente dans un de ces vastes puits, de ces longs mois d’attente, faits d’impatience, lorsque nous laissions une cavité inexplorée faute de temps, de la description de nos aventures estivales transformant peu à peu nos explorations en épopées ? Savait-il que notre présence ici était l’aboutissement de rêves d’enfant, de cette quête étrange qui pousse les hommes à se surpasser ? La nôtre, c’était ces montagnes parsemées d’entrées mystérieuses. Que savait-il des relations humaines immatérielles tissées au fil des ans ? Nos vies avaient des trajectoires différentes avec ce point de rencontre que l’on partageait quelques jours, quelques semaines quelques années sur ce flanc de montagne. Pour certains d’entre nous, l’intensité de ces liens nous unirait pour de longues années même si les aléas de la vie nous séparaient. Les sensations que nous nous révélions ne pouvaient qu’échapper à ces touristes à la tenue grotesque, perdus lamentablement sur des chemins balisés. Et eux, qu’avaient-ils pensé de cette rencontre fortuite avec ces Français un peu hautains et de leur drôle d’équipement ? Ils venaient d’ouvrir une porte sur un monde énigmatique qu’ils s’étaient empressés de refermer. Notre regard ironique et la barrière de la langue n’incitaient pas au dialogue avec ces drôles de personnages croisés sur ce flanc de montagne. De cette rencontre, émergeait une part de mystère et d’inconnu que traduisait peut-être une pointe d’inquiétude. Eux, comme nous, reflétaient dans un même miroir des images respectives floues et inaccessibles pour ceux qui n’en avaient pas la lecture. Leur départ d’un pas assuré et ferme vers l’objectif de leur journée, sans un regard vers l’arrière, nous réjouissait. Nous retournions alors vers notre royaume imaginaire et nos occupations matérielles du jour.
Le téléphérique nous élevait de mille mètres pour atteindre le bord d’un plateau d’où apparaissaient les grands sommets du massif. La vue est grandiose : d’un côté les paysages de moyenne montagne que nous venions de quitter et de l’autre celui de la haute montagne où, selon les années, des névés plus ou moins imposants occupaient les pentes nord à l’ensoleillement éphémère.
La présence de ce téléphérique était une bénédiction des dieux. Sans lui, l’accès était quasi impossible ou devenait très coûteux en moyens humains. L’hélicoptère n’avait pas encore cet usage de faciliter la vie des hommes et de soulager les animaux de bât par le transport des marchandises, et quand là même, les moyens financiers de notre club n’auraient pas permis son utilisation.
L’exploration de nos gouffres nécessitait d’imposants et pondéreux matériels : cordes, échelles, marteaux, mousquetons, carbure de calcium pour l’éclairage, auxquels il fallait ajouter tout l’équipement individuel à la fois de spéléologie et de montagne, sans oublier tentes, civière de secours, matériel de cuisine, gaz et nourriture… Tout cela représentait plusieurs centaines de kilogrammes de matériel à acheminer à dos d’Homme au camp d’altitude.
À peine les 1000 mètres avalés en quelques minutes pour le prix de quelques pesetas, les choses sérieuses commençaient : 500 à 600 mètres de dénivelé restaient à parcourir en partie sur une ancienne piste minière puis sur un assez mauvais chemin. Ce n’était pas le chemin ou le dénivelé qui posait un problème, car les touristes en basket l’empruntaient sans difficultés, mais les charges, complètement démentes qui pesaient sur les épaules. Avec des sacs à dos de 30 à 50 kilogrammes, la courte distance nous séparant des camps d’altitude devenait très relative. Pour les touristes, nous étions les montagneros charriant des charges incroyables et dont l’utilité leur échappait. Les plus curieux tentèrent de soulever les sacs les plus imposants. Ils regardaient leurs porteurs et les interpellaient. De ce monologue improvisé ressortait le mot burro plusieurs fois répété. Sa traduction par le mot « âne » laissait libre cours à différentes interprétations. Si l’intelligence de l’animal ne peut plus être contestée, les touristes nous faisaient-ils remarquer qu’un compagnon de bât eut été plus approprié ou bien nous identifiaient-ils à l’image populaire que renvoyait l’animal à quatre pattes ? Plus tard, de sourdes douleurs vertébrales se rappelaient à nous et le diagnostic ne laissait aucun doute sur quelques démesures de jeunesse. La justesse des propos de ces touristes, croisés sur ces chemins pierreux, prenait un sens qui nous échappait alors.





























