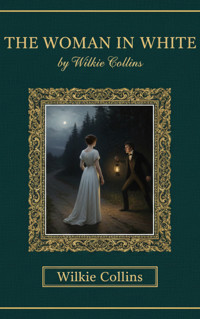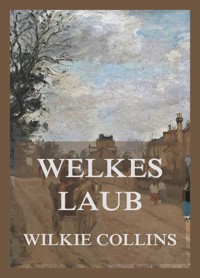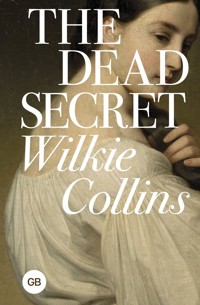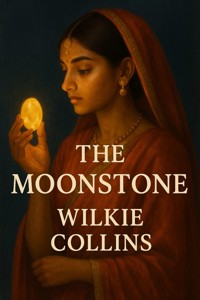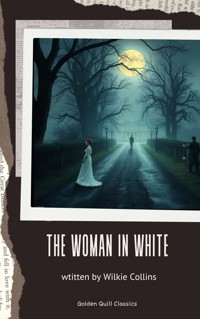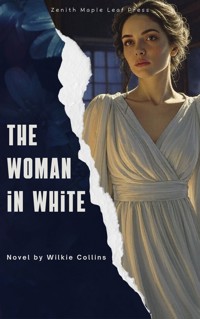Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Walter Hartright, professeur de dessin est engagé par Mr Fairlie, tuteur de demi-soeurs, Marian et la jolie Lucy. Avant de quitter Londres, Walter rencontre une mystérieuse femme vêtue de blanc et qui se comporte de façon très étrange. Installé à son nouveau poste, il va vite comprendre que cette dame en blanc est liée à la famille Fairlie, et qu'il y a un mystère autour de Sir Percival, auquel Lucy est fiancée par une promesse à son père sur son lit de mort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Dame en blanc
La Dame en blancPREMIÈRE PARTIERÉCIT DE WALTER HARTRIGHT, DE CLEMENT’S INN, PROFESSEUR DE DESSINLE RÉCIT SE POURSUIT, REPRIS PAR VINCENT GILMORE, DE CHANCERY LANE, AVOCAT-CONSEILEXTRAITS DU JOURNAL DE MARIAN HALCOMBEDEUXIÈME PARTIESUITE DU JOURNAL DE MARIAN HALCOMBEL'HISTOIRE CONTINUE, RACONTÉE PAR FREDERICK FAIRLIE, ESQUIRE, DE LIMMERIDGE HOUSEL’HISTOIRE CONTINUE, RACONTÉE PAR ÉLIZA MICHELSON, GOUVERNANTE À BLACKWATER PARKRÉCITS DE DIVERSES PERSONNESTROISIÈME PARTIEL’HISTOIRE CONTINUE, RACONTÉE PAR WALTER HARTRIGHTL’HISTOIRE REPRISE PAR WALTER HARTRIGHTL’HISTOIRE SE TERMINE, RACONTÉE PAR WALTER HARTRIGHTPage de copyrightLa Dame en blanc
Wilkie Collins
PREMIÈRE PARTIE
RÉCIT DE WALTER HARTRIGHT, DE CLEMENT’S INN, PROFESSEUR DE DESSIN
1
Cette histoire montre avec quel courage une femme peut supporter les épreuves de la vie et ce dont un homme est capable pour arriver à ses fins.
Évoqués devant un tribunal, les faits dont nous allons faire le récit, auraient dû l’être en cour d’assises.
Puisque aussi bien la loi dépend encore souvent de la puissance de l’argent, allons-nous présenter au lecteur la suite des événements telle que nous l’eussions exposée au tribunal.
Aucun fait important, du début à la fin de cette révélation, ne sera relaté par simple ouï-dire. Quand l’auteur de cette introduction, Walter Hartright, sera intimement mêlé aux incidents, il les décrira lui-même ; mais lorsqu’il ne s’agira plus de sa propre expérience, il passera la plume à d’autres qui raconteront à leur tour ce qu’ils savent, clairement et objectivement eux aussi.
Cette histoire sera donc écrite par des personnes différentes, comme l’exposé d’une offense contre la loi est présenté au tribunal par plusieurs témoins dans un seul et même but : montrer clairement et sans détour où est la vérité ; chaque expérience personnelle, relatée ainsi successivement, et fidèlement, permet aux juges de relier un fait à un autre fait et d’arriver enfin à établir toute l’affaire telle qu’elle s’est réellement passée.
Mais entendez donc Walter Hartright, professeur de dessin, âgé de vingt-huit ans.
2
Les derniers jours de juillet s’effeuillaient. L’été touchait à sa fin. Pèlerins fatigués du pavé de Londres, nous commencions à rêver avec envie aux nuages jetant de larges ombres sur les champs de blés et aux brises d’automne rafraîchissant les rivages.
Pour ma part, l’été mourant me laissait sans souffle, sans énergie, et, s’il me faut tout dire, sans argent. Durant l’année écoulée, je n’avais pas géré mes revenus avec autant de soin que d’habitude, et, à cause de ces imprudences assez folles, il ne me restait qu’une seule perspective à envisager : passer tout simplement l’automne en partie chez ma mère, dans sa petite maison de Hampstead, en partie chez moi, dans mon appartement en ville.
La soirée, je m’en souviens, était calme, le ciel nuageux, l’air de Londres suffocant. Lointains, les bruits de la ville s’atténuaient peu à peu ; l’infime pulsation de vie en moi et l’immense cœur de la cité tout autour de moi semblaient s’éteindre à mesure que le soleil déclinait. Je quittai mon appartement pour aller respirer un peu l’air frais des faubourgs. C’était l’une des deux soirées par semaine que je passais d’habitude avec ma mère et ma sœur ; je me dirigeai donc vers Hampstead.
Les événements que je vais conter m’obligent à noter que mon père était mort depuis quelques années déjà, et que ma sœur Sarah et moi-même étions les seuls survivants d’une famille de cinq enfants. Mon père, qui avait été, lui aussi, professeur de dessin, avait un très grand talent. Son désir incessant de pourvoir à l’avenir de ceux qui dépendaient de lui l’avait poussé à économiser, sa vie durant, une grande partie de ses revenus, chose assez rare, convenez-en. Grâce à cette admirable prévoyance, ma mère et ma sœur, après sa mort, purent rester aussi indépendantes qu’elles l’avaient été de son vivant. Pour moi, je choisis la profession qu’il avait choisie, et j’avais toutes les raisons du monde d’éprouver une véritable gratitude envers la vie qui s’ouvrait à moi.
Doucement, le crépuscule enveloppait la lande. La vue de Londres, à mes pieds, se noyait dans la pénombre de la nuit nuageuse lorsque j’atteignis le cottage de ma mère. J’avais à peine touché la sonnette que la porte s’ouvrit violemment ; au lieu de la servante, ce fut mon excellent ami italien, le professeur Pesca, qui m’accueillit joyeusement, dans un anglais coloré d’un accent étranger tout à fait charmant.
Le professeur mérite, tant pour lui que pour moi-même, l’honneur que je le présente ici.
C’est un accident banal qui le place à l’origine de l’étrange histoire de famille que l’on va lire.
J’avais fait sa connaissance dans certain milieu élégant où il enseignait sa langue maternelle, tandis que j’y enseignais le dessin. Tout ce que je savais de lui, c’est que, après avoir occupé une brillante situation à l’université de Padoue, il avait dû quitter l’Italie pour des raisons politiques dont il ne parlait jamais à personne, et que, depuis de nombreuses années, il était connu à Londres comme un respectable professeur de langues.
Sans être un nain, car il était parfaitement proportionné, Pesca était, je pense, le plus petit être humain que j’aie jamais rencontré. Étrange par son apparence, il l’était encore plus par l’excentricité inoffensive de son caractère. L’idée maîtresse de sa vie, semblait-il, était de faire l’impossible pour devenir un véritable Anglais, afin de prouver sa gratitude au pays qui lui avait procuré un asile et des moyens de vivre. Non content d’avoir toujours un parapluie à la main et de porter des guêtres et un chapeau blanc, le professeur aspirait à devenir un parfait Anglais dans ses manières comme dans ses plaisirs. Trouvant que nous formions une nation remarquable par notre amour des exercices athlétiques, ce petit homme, dans l’innocence de son cœur, se lança tête baissée dans la pratique de tous les sports, fermement persuadé qu’il pourrait s’y adapter, par un seul effort de la volonté, comme il s’était adapté à la guêtre et au chapeau blanc national. Je l’ai vu se risquer de se casser le cou à une chasse au renard et sur un terrain de cricket, comme je l’ai vu, bientôt après, risquer sa vie à Brighton.
Nous nous y étions rencontrés par hasard, et nous nous baignions ensemble. S’il se fût agi d’un genre d’exercice particulier à mon pays, j’aurais évidemment surveillé Pesca avec soin, mais comme les étrangers sont en général aussi bons nageurs que nous, l’idée ne me vint pas un instant que la natation se trouvait sur la liste des sports que le professeur croyait devoir apprendre sans tarder. Peu après que nous eûmes quitté le rivage, je me retournai, étonné de ne pas voir mon ami à mes côtés. À ma grande horreur, je ne vis que deux petits bras blancs se débattant à la surface de l’eau, puis disparaître aussitôt. Lorsque je plongeai à sa recherche, le pauvre petit bonhomme se trouvait au fond, dans un creux, parmi les galets, et il paraissait plus petit que jamais. Pendant que je le ramenais à la surface, puis jusqu’à sa cabine de bain, il reprit peu à peu ses sens et m’expliqua tant bien que mal sa désillusion étonnée au sujet de la natation. Lorsqu’il eut enfin cessé de claquer des dents, il sourit d’un air absent et il déclara qu’il avait sans doute eu une crampe.
Tout à fait remis, il me rejoignit sur la plage ; son sang méridional reprit ses droits au mépris de toute la retenue anglaise. Il me témoigna l’affection la plus débordante, protestant à l’italienne, avec passion, que désormais sa vie était à ma disposition, et qu’il serait heureux le jour où il m’aurait prouvé sa reconnaissance en me rendant un service dont à mon tour je me souviendrais jusqu’à ma mort.
J’essayai d’arrêter ce torrent de pleurs et de protestations d’amitié en faisant mille plaisanteries au sujet de cette aventure ; j’imaginai y avoir réussi enfin, car je croyais avoir convaincu Pesca qu’il exagérait beaucoup le rôle que je venais de jouer. Je me doutais bien peu alors que l’occasion tant désirée par mon ami allait se présenter bientôt et changer le cours de mon existence – au point que je ne devais pour ainsi dire plus me reconnaître.
Si je n’avais pas plongé pour repêcher le professeur Pesca, je n’aurais sans doute jamais été mêlé à l’histoire qui va suivre, et je n’aurais peut-être jamais entendu le nom de la femme qui occupa toutes mes pensées, qui capta pour elle seule tout mon courage et toutes mes forces, et qui influença mon existence tout entière.
3
Ce soir, la façon d’être de Pesca, et son visage illuminé, suffirent à me faire comprendre, dès que je me trouvai devant lui, qu’une chose extraordinaire était arrivée. Il était tout à fait inutile, cependant, d’attendre qu’il s’expliquât au moment même. Il m’emmena en me tirant par les deux mains, nous entrâmes en trombe dans le salon où ma mère, assise près de la fenêtre, riait en s’éventant. Pesca était un de ses favoris, et ses pires excentricités trouvaient grâce à ses yeux. Pauvre chère maman ! Dès qu’elle eut découvert que le petit professeur était profondément attaché à son fils, elle lui ouvrit son cœur sans réserve et prit au sérieux toutes ses bizarreries, sans même essayer de les comprendre.
Ma sœur Sarah, malgré sa jeunesse, était moins indulgente. Tout en rendant justice aux grandes qualités de Pesca, elle ne pouvait l’approuver implicitement. Son idée des convenances se scandalisait continuellement de la désinvolture du petit Italien et elle s’étonnait toujours plus ou moins ouvertement de la familiarité de notre mère avec l’excentrique étranger. J’ai observé, non seulement chez ma sœur mais aussi chez d’autres jeunes gens, que notre génération est beaucoup moins expansive que celle de nos parents. Je vois continuellement des personnes âgées, joyeuses et agitées devant la perspective de quelque plaisir qui ne trouble même pas la tranquillité de leurs petits-enfants. Les garçons et les filles, de nos jours, seraient-ils moins sincères que leurs aînés ? Est-ce là un progrès trop rapide de l’éducation ? Et sommes-nous, nous, ceux de la jeune génération, un tant soit peu trop bien élevés ?
Sans essayer de répondre à cette question, je puis en tout cas assurer que je n’ai jamais vu ma mère et ma sœur en compagnie de Pesca sans trouver que ma mère était de beaucoup la plus jeune des deux.
En cette occasion, par exemple, tandis que la vieille dame riait de bon cœur de la façon de collégien avec laquelle nous étions entrés dans le salon, Sarah, d’un air réservé, ramassait les débris d’une soucoupe que le professeur avait heurtée en passant.
– Je ne sais ce qui serait arrivé, Walter, si vous aviez encore tardé à rentrer, dit ma mère. Pesca n’était plus à tenir et j’étais moi-même à demi folle de curiosité. Le professeur apporte une nouvelle extraordinaire qui vous concerne et a cruellement refusé de nous en donner la moindre idée avant que son ami Walter ne fût là.
– C’est agaçant ! murmura Sarah, et cela dépareille le beau service !
Pendant ce temps, Pesca, inconscient de sa maladresse, traînait à l’autre bout du salon un grand fauteuil à haut dossier. Tourné vers nous, à genoux sur le siège, il commença un discours emphatique, comme un orateur s’adressant à un vaste auditoire.
– Maintenant, mes chers amis, fit-il, écoutez-moi ! Le moment est venu de vous annoncer enfin ma grande nouvelle.
– On vous écoute, on vous écoute ! s’exclama ma mère avec impatience.
– La prochaine chose qu’il cassera, marmotta Sarah, sera le dossier du meilleur fauteuil !
– Je fais un pas en arrière dans le passé et je m’adresse à l’être le plus noble qui existe, continua Pesca s’adressant à moi par-dessus son rempart, à celui qui, me trouvant mort au fond de la mer, me ramena à la surface. Et que lui ai-je dit lorsque je me retrouvai en possession de la vie et de mes vêtements ?
– Beaucoup plus qu’il n’en fallait ! répondis-je afin d’empêcher l’émotion qui allait immanquablement provoquer un flot de larmes chez le professeur.
– J’ai dit, répéta Pesca, que ma vie lui appartenait, et que je ne pourrais être heureux que le jour où j’aurais l’occasion de lui prouver ma gratitude. Aujourd’hui, la joie éclate dans mon cœur et sort par tous les pores de ma peau, car ce jour est enfin arrivé !
» Parmi les élégantes demeures de Londres où j’enseigne ma langue maternelle, poursuivit le professeur sans s’arrêter, il en existe une merveilleuse qui est située à Portland. Vous savez tous où cela se trouve naturellement ? Oui, évidemment ! cette superbe habitation abrite une superbe famille : une jolie maman, trois belles jeunes filles, deux garçons beaux et potelés, et un père, financier important, autrefois bel homme, qu’un crâne chauve et un double menton ont un peu abîmé. Mais rendez-vous compte ! J’étais en train d’enseigner le sublime Dante (non sans peine d’ailleurs) aux trois jeunes filles et nous étions précisément tous les quatre en Enfer, moi m’efforçant, avec un enthousiasme bien inutile, de leur faire comprendre la grandeur du sujet, lorsqu’un bruit de bottes se fit entendre. Le père apparut bientôt sur le seuil de la porte. Ah ! mes chers bons amis ! Soyez patients, j’approche de la grande nouvelle… Il tenait une lettre à la main et, après s’être excusé de nous avoir tirés de nos Régions Infernales pour nous ramener à des affaires terrestres, il s’adressa à ses filles et commença, comme vous autres Anglais commencez toutes vos phrases, par un “Oh !”. “Oh ! mes chères filles, j’ai ici une lettre d’un ami, me demandant de lui indiquer un maître de dessin qui pourrait aller chez lui à la campagne”… Que Dieu me bénisse ! à ces paroles, je l’aurais serré sur mon cœur ! Mais je me bornai à sauter de mon siège tant j’avais l’impression d’être assis sur des épines, et je brûlais de parler. Je n’en fis rien pourtant ; j’attendis qu’il eût terminé.
» – Peut-être, mes chéries, connaissez-vous un bon professeur de dessin que je pourrais lui recommander ? continua l’excellent homme en agitant la lettre dans ses mains couvertes de bagues étincelantes.
» Les jeunes filles se regardèrent et répondirent ensemble.
» – Oh ! Mon Dieu ! Non, papa ! mais peut-être Mr Pesca…
» À ces mots, mon sang ne fit qu’un tour et je m’écriai avec feu :
» – Cher monsieur ! J’ai votre homme ! Le premier et le meilleur professeur de dessin du monde ! Recommandez-le par le courrier de ce soir et envoyez-le avec armes et bagages par le premier train du matin !
» – Arrêtez ! Arrêtez ! s’écria le père. Est-ce un étranger ou un Anglais ?
» – Anglais jusqu’à la moelle des os ! répondis-je.
» – Respectable ?
» – Monsieur ! m’écriai-je à cette question qui m’offensait personnellement, et je poursuivis dignement : La flamme immortelle du génie brûle dans le cœur de cet homme et son père l’avait déjà avant lui !
» – Peu importe son génie, déclara-t-il d’un ton rude, dans notre pays, nous ne voulons pas d’un génie sans respectabilité, mais si les deux se trouvent réunis, tant mieux ! tant mieux ! Votre ami peut-il fournir des certificats ou des références ?
» – Des lettres de références ! m’écriai-je en agitant la main, mais des douzaines, des volumes si vous le désirez !
» – Une ou deux suffiront, répondit cet homme de sang-froid et d’argent. Qu’il me les fasse parvenir avec son nom et son adresse et… attendez ! Attendez, Mr Pesca, avant de courir chez votre ami, il vaudrait mieux que je vous remette un billet pour lui.
» – Un billet de banque ! m’écriai-je indigné, s’il vous plaît, monsieur, pas avant que mon estimé ami l’ait gagné…
» – Billet de banque ? reprit le papa, qui vous parle de billet de banque ? Je veux dire un mot expliquant les conditions, un résumé de ce qu’on attend de lui. Continuez votre leçon, Mr Pesca, je vous remettrai cette note dans un instant.
» Cela dit, il alla s’installer à une table de travail, prit une plume et du papier tandis que je redescendais dans l’Enfer de Dante avec mes trois jeunes filles.
» Dix minutes après, la note était rédigée et les bottes du père s’éloignaient dans le corridor.
» L’idée que j’avais enfin la merveilleuse occasion de prouver ma gratitude à mon très cher ami Walter me rendait ivre de bonheur.
» Comment je sortis avec mes trois jeunes filles des Régions Infernales, comment je terminai mes cours, comment mon dîner passa dans mon gosier, je ne pourrais vous le dire ! Le principal est que j’ai ce message et que je me sens fou de joie et plus heureux qu’un roi !
Ici, le professeur termina son discours en brandissant la lettre au-dessus de sa tête et en exécutant une parodie italienne du vivat anglais.
Ma mère se leva, les joues en feu, les yeux brillants, saisit chaleureusement les mains du petit homme.
– Mon cher excellent Pesca, s’écria-t-elle, je n’ai jamais douté de votre affection pour Walter, mais maintenant, j’en ai la certitude.
– Nous sommes vraiment très obligées de ce que le professeur Pesca fait pour Walter, ajouta Sarah, se levant à demi du siège qu’elle occupait, comme si elle avait l’intention de s’approcher, elle aussi, du fauteuil. Mais lorsqu’elle vit Pesca couvrir de baisers les mains de sa mère, elle se rembrunit et se rassit. Elle s’était certainement demandé, si le singulier petit homme traitait sa mère de cette façon, comment il la traiterait, elle. Très reconnaissant à mon ami de sa bonté, je n’étais pourtant pas enthousiasmé de cette offre.
Lorsque le professeur eut enfin abandonné les mains de ma mère, je le remerciai chaleureusement de son intervention et le priai de me passer la note, afin d’apprendre ce qu’on attendait de moi.
Pesca me tendit le papier d’un air triomphant. La note était claire, précise et complète. Elle m’informait de ce que :
Premièrement. Frédérick Fairlie Esq. de Limmeridge House, en Cumberland, désirait engager un maître de dessin très compétent pour une période certaine de quatre mois.
Deuxièmement. La tâche que le maître aurait à remplir serait double : parfaire, dans l’art de l’aquarelle, l’instruction de deux jeunes filles et consacrer ses loisirs à la restauration d’une collection d’estampes de valeur négligée jusqu’alors.
Troisièmement. Les conditions pour ce travail étaient de quatre guinées par semaine, que la personne devrait vivre à Limmeridge House et serait traitée comme un gentleman.
Quatrièmement. Il était inutile de se présenter sans références exceptionnelles, celles-ci devant être envoyées à l’ami de Mr Fairlie chargé de conclure l’engagement. Suivait l’adresse à Portland.
La perspective était tentante, la situation facile et agréable ; elle m’était proposée à l’entrée de l’automne, morte saison pour moi ; les conditions étaient extraordinairement avantageuses. J’aurais dû me considérer comme très heureux d’une telle aubaine, cependant j’hésitais. Une inexplicable répugnance à accepter m’envahissait.
– Oh ! Walter, votre père n’a jamais eu une telle chance ! s’exclama ma mère, après avoir lu, à son tour, les conditions que l’on me proposait.
– Connaître des personnes si distinguées et dans de telles conditions ! remarqua Sarah en se redressant.
– Oui, les conditions sont certes très tentantes, répondis-je avec impatience, mais avant d’accepter, il faut que j’examine…
– Examiner ! s’écria ma mère. Mais, Walter, que se passe-t-il ?
– Examiner ! reprit Sarah, quel drôle de mot dans une telle circonstance !
– Examiner ! répéta le professeur comme un écho. Qu’y a-t-il à examiner, mon Dieu ? Ne vous êtes-vous pas plaint de votre santé, ces derniers temps, et n’avez-vous pas dit que vous aspiriez à un peu d’air frais ? Eh bien ! vous tenez en main le papier qui vous offre ce que vous appelez « un coup de fouet » et l’air frais de la campagne à volonté pendant quatre mois, n’est-il pas vrai ? Vous avez besoin d’argent, et quatre guinées par semaine ne sont pas à dédaigner, je crois ! Quatre guinées par semaine, deux jeunes filles, un gîte, une nourriture soignée et abondante ! Vraiment, Walter, mon cher et bon ami, pour la première fois de ma vie, je ne vous comprends pas !
Ni l’étonnement de ma mère ni la fiévreuse énumération des avantages qui m’étaient offerts n’arrivaient à dissiper l’aversion que j’éprouvais à aller à Limmeridge House. Après avoir épuisé toutes les objections possibles, et après avoir entendu ce que tous trois avaient à me répondre pour me prouver combien j’avais tort, je trouvai une nouvelle et dernière raison qui s’opposait à mon départ : que deviendraient donc mes élèves de Londres pendant que j’enseignerais aux jeunes filles de Mr Fairlie l’art de dessiner et de peindre d’après nature ? La réponse, une nouvelle fois, m’apparut claire. La plupart de mes élèves voyageaient pendant ces mois d’automne ; ceux qui restaient à Londres, je n’avais qu’à les confier à l’un de mes collègues dont j’avais déjà pris les élèves en charge en de semblables circonstances. Ma sœur ne manqua d’ailleurs pas de me rappeler que ce confrère s’était spontanément offert à me remplacer, cet été ou cet automne, au cas où je désirerais partir pendant quelque temps, ma mère me fit sérieusement entendre qu’il ne fallait pas laisser un caprice nuire à mes intérêts et à ma santé ; et Pesca me supplia, de la façon la plus attendrissante, de ne pas le blesser jusqu’au cœur en repoussant le premier service qu’il pouvait enfin rendre à l’ami qui lui avait sauvé la vie.
L’affection sincère qui dictait chacune de ces remontrances eût touché tout homme quelque peu sensible. Encore qu’il me fût impossible de faire taire mon inexplicable obstination, j’étais moi-même assez sincère pour en ressentir de la honte ; aussi mis-je fin à la discussion en donnant raison à mes adversaires et en promettant de faire tout ce que l’on attendait de moi.
Le reste de la soirée se passa en conjectures plaisantes sur ma future existence en compagnie des deux jeunes filles du Cumberland. Pesca, inspiré par notre grog national, auquel il faisait grand honneur, affirma une fois encore ses droits à être considéré comme un Anglais accompli en nous faisant des discours volubiles et sans fin, en buvant à la santé de ma mère, de ma sœur et de la mienne, sans oublier les habitants de Limmeridge House et, enfin, se félicitant lui-même d’avoir rendu à tout le monde un inestimable service.
– Confidentiellement, Walter, me dit-il tandis que nous retournions ensemble vers la ville, je suis émerveillé de mon éloquence ! Mon âme éclate de fierté. Un de ces jours, j’entrerai au Parlement, votre grand Parlement ! Être l’Honorable Pesca, M. P.[1], voilà le rêve de ma vie !
Le matin suivant, j’envoyai mes certificats et références au patron de Pesca à Portland.
Trois jours s’étant écoulés sans réponse, je commençais à espérer que mes papiers n’aient pas donné satisfaction, mais le quatrième jour, je reçus une lettre m’informant que Mr Fairlie acceptait mes services et me priait de me mettre en route. Toutes les instructions quant à mon voyage étaient clairement données en post-scriptum.
Je pris, bien à contrecœur, mes dispositions pour quitter Londres le lendemain matin à l’aube.
Pesca, devant se rendre à un dîner, vint me faire ses adieux.
– La merveilleuse pensée que c’est moi qui ai donné le premier élan à votre essor m’aidera à sécher mes larmes en votre absence, me dit-il. Allez, mon ami, et, puisque la chance vous sourit, profitez-en. Épousez l’une des deux jeunes filles et devenez l’Hon. Hartright M. P. Puis, quand vous serez au sommet de l’échelle, souvenez-vous que c’est grâce au tout petit Pesca.
J’essayai de rire, mais le cœur me manquait et une angoisse affreuse m’oppressait.
Il ne me restait plus qu’à aller faire mes adieux à Hampstead.
4
La chaleur avait été suffocante tout le jour et la nuit s’annonçait étouffante. Ma mère et ma sœur m’avaient tant de fois prié de rester encore cinq minutes auprès d’elles et avaient eu tant de derniers petits mots à me dire qu’il était près de minuit quand je sortis de chez elles. Après avoir fait quelques pas en direction de Londres, je m’arrêtai hésitant. La lune était pleine et claire dans un ciel sans étoiles, et le sol couvert de bruyère prenait, sous cette mystérieuse lumière, un aspect sauvage, comme si des centaines de lieues le séparaient de la grande ville qui gisait à ses pieds. La pensée de retourner dans l’atmosphère oppressante de Londres, la perspective d’aller dormir dans un appartement surchauffé ne me tentaient guère. Je décidai de rentrer par le chemin le plus long en faisant un détour par les faubourgs aérés de Finchley Road et par le côté ouest de Regent’s Park.
Tout en me frayant lentement un chemin à travers la bruyère, je jouissais du calme divin du paysage, admirant les jeux de lumière et d’ombre autour de moi.
Pendant cette première partie – la plus jolie – de ma promenade, mon esprit paresseux ne s’ouvrait qu’aux impressions qu’il recevait du paysage, et mes pensées s’attardaient peu sur quelque sujet que ce fût. De fait, je ne pensais à rien du tout.
Après avoir quitté la bruyère, sur la route, beaucoup moins pittoresque, mes pensées revinrent naturellement au changement d’existence que j’allais connaître et aux personnes avec lesquelles j’allais vivre à Limmeridge House.
Je fus bientôt à l’endroit où les quatre grand-routes se croisent – celle de Hampstead, par laquelle j’étais revenu, celle de Finchley, celle qui conduisait au quartier du West Land, et celle qui me ramènerait à Londres.
Je venais, tout machinalement, de prendre cette dernière, et je me plaisais à imaginer à quoi ressembleraient mes deux nouvelles élèves quand, soudain, mon sang se glaça dans mes veines : une main s’appuyait légèrement sur mon épaule.
Je me retournai vivement, les doigts crispés sur le pommeau de ma canne.
Là, derrière moi, au milieu de la route déserte et qui se détachait plus claire dans la nuit, se tenait une femme, sortie de terre comme par miracle ou bien tombée du ciel. Elle était tout de blanc vêtue et, le visage tendu vers moi d’un air interrogateur et anxieux, elle me montrait de la main la direction de Londres. J’étais bien trop surpris de cette soudaine et étrange apparition pour songer à lui demander ce qu’elle désirait. Ce fut elle qui-parla la première.
– Est-ce le chemin de Londres ?
Je la regardai avec attention, étonné de sa singulière question. Il était alors près d’une heure. Je distinguai au clair de lune un visage jeune, pâle, maigre, fatigué, de grands yeux au regard grave, des lèvres frémissantes et des cheveux d’un brun doré. Il n’y avait rien de vulgaire ni de grossier dans ses manières, un je-ne-sais-quoi en elle paraissait même mélancolique et craintif. Pas tout à fait les façons de faire d’une grande dame, et pourtant rien d’une femme de basse condition. La voix, pour le peu de paroles que j’avais entendues, avait quelque chose de mécanique et de calme également, bien que l’élocution fût rapide. Mon interlocutrice tenait en main un petit sac, et ses vêtements, d’après ce que je pus en juger, n’étaient pas luxueux. Elle était mince, et de taille plutôt au-dessus de la moyenne. Sa démarche et ses gestes tout à fait normaux. Ce fut tout ce dont je pus me rendre compte dans la demi-obscurité et dans l’étonnement où me plongeait presque jusqu’à l’étourdissement cette rencontre inattendue, bizarre. Quelle sorte de femme était-ce ? Et comment se trouvait-elle seule, sur la grand-route, en pleine nuit ? Je n’essayai pas de le savoir. J’étais certain d’une chose : l’homme le moins pénétrant ne se serait pas trompé sur le sens de ses paroles, même à cette heure suspecte et en ce lieu désert.
– M’avez-vous entendue ? répéta-t-elle, aussi tranquillement et aussi vite, puis, sans attendre ma réponse, elle ajouta : je vous ai demandé si c’était bien le chemin de Londres.
– Oui, répondis-je, c’est le chemin qui conduit à St John’s Wood et Regent’s Park. Excusez-moi de ne pas vous avoir répondu tout de suite, mais votre apparition sur la route m’a quelque peu surpris et je ne me l’explique pas encore.
– Vous ne me soupçonnez pas d’avoir fait quelque chose de mal, au moins ? Je n’ai rien fait de mal, j’ai eu un accident et suis très malheureuse de me trouver seule ici à cette heure de la nuit. Pourquoi croyez-vous que j’aie fait quelque chose de mal ?
Elle parlait maintenant avec gravité et agitation en s’éloignant de moi. Je fis de mon mieux pour la rassurer.
– Je vous en prie, ne croyez pas que je songe à vous soupçonner, repris-je. Je n’ai d’autre désir que de vous aider, si je le puis. Je m’étonnais seulement de vous avoir vue apparaître sur la route, alors que celle-ci m’avait semblé déserte l’instant d’avant.
Elle se retourna et, me montrant une brèche dans la haie près du croisement des routes, elle reprit :
– Je vous avais entendu venir et m’étais cachée, afin de voir quel genre d’homme vous étiez avant de me risquer à vous parler. J’hésitais à le faire… J’avais peur… Vous étiez déjà passé quand enfin je me suis décidée… Alors, j’ai dû courir pour vous rattraper…
Courir pour me rattraper ? Pourquoi ne pas m’appeler, tout simplement ? Cela était assez étrange, assurément.
– Puis-je avoir confiance en vous ? Vous ne me jugez pas mal parce que j’ai eu un accident ? demanda-t-elle, confuse, en soupirant tristement.
La solitude et l’abandon de la jeune femme me touchèrent.
– Vous pouvez avoir confiance en moi, répondis-je doucement, et si cela vous trouble de m’expliquer votre étrange situation, n’en parlez plus. Je ne vous demande aucune explication. Dites-moi seulement comment je puis vous aider et je le ferai, si je le puis.
– Vous êtes bon et je suis très heureuse de vous avoir rencontré.
Pour la première fois, une expression d’émotion féminine perçait dans sa voix, mais aucune larme ne brillait dans ses grands yeux pensifs fixés sur moi.
– Je ne suis allée à Londres qu’une fois dans ma vie, continua-t-elle de plus en plus vite, et je ne connais rien de ce côté-ci. Pourrais-je trouver encore une voiture ou bien est-il trop tard ?… Je ne sais… Si vous vouliez me montrer où je pourrais en trouver et si vous vouliez seulement me promettre de ne pas me contrarier et de me laisser vous quitter quand je le voudrais !… J’ai une amie à Londres qui sera heureuse de me recevoir… Je ne désire rien d’autre… Voulez-vous me le promettre ?
Avec anxiété, elle regardait des deux côtés de la grand-route, en faisant glisser son petit sac d’une main dans l’autre et en répétant : « Voulez-vous me le promettre ? » Elle levait sur moi des yeux tellement suppliants et affolés que je cédai enfin.
Qu’aurais-je pu faire d’autre, d’ailleurs ? Une femme inconnue se confiait totalement à moi, s’en remettait à moi, une femme qui paraissait terriblement malheureuse. Aucune maison dans les environs, personne sur la route à qui demander conseil… Et je n’avais pas le droit d’user d’autorité sur cette femme, si même je l’avais voulu. J’écris ces lignes, tandis que le souvenir des événements qui se sont passés depuis assombrissent jusqu’aux feuilles sur lesquelles je me penche. Et aujourd’hui encore, je me pose la même question : qu’aurais-je pu faire d’autre ?
Je tâchai cependant de gagner encore un peu de temps en la questionnant.
– Êtes-vous sûre que votre amie de Londres vous recevra à une heure aussi avancée de la nuit ? demandai-je.
– Certaine. Promettez-moi seulement que vous me laisserez partir quand je le désirerai et que vous ne me contrarierez pas ?
En répétant ces paroles pour la troisième fois, elle se rapprocha de moi et posa sa petite main sur mon cœur. Quand j’enlevai cette main, je m’aperçus qu’elle était glacée malgré la chaleur étouffante de la nuit. Souvenez-vous que j’étais jeune et que la main que je touchais était une main de femme !
– Voulez-vous me le promettre ?
– Oui.
Un seul mot ! Un petit mot si familier que nos lèvres répètent cent fois par jour, et cependant j’en frémis encore aujourd’hui rien que de l’écrire. Nous nous dirigeâmes vers Londres, moi et cette femme dont le nom, le rang social, l’histoire, les aspirations dans la vie, et jusqu’à la présence, en ce moment, à mes côtés, étaient pour moi autant de mystères. C’était comme un rêve. Étais-je bien Walter Hartright ? Étions-nous sur cette route si fréquentée, agréable aux promeneurs du dimanche ? Avais-je réellement quitté, il n’y avait guère plus d’une heure, l’atmosphère paisible, l’atmosphère familiale et conventionnelle de notre maison de Hampstead ? Trop étourdi, j’éprouvai comme un remords de poursuivre cette conversation. Ce fut à nouveau la voix de la jeune femme qui rompit le silence.
– Je voudrais vous demander quelque chose, dit-elle soudainement. Connaissez-vous beaucoup de monde à Londres ?
– Oui, beaucoup.
– Beaucoup de personnes occupant une situation élevée ou possédant un titre ? ajouta-t-elle d’un ton soupçonneux.
J’hésitai.
– Oui, quelques-unes, répondis-je enfin.
– Beaucoup d’hommes… portant le titre de baronnet ? questionna-t-elle avec anxiété.
Trop étonné pour répondre, je lui dis :
– Pourquoi me demandez-vous cela ?
– Parce que j’espère, pour mon salut, qu’il existe un baronnet que vous ne connaissiez pas !
– Voulez-vous me dire son nom ?
– Je ne puis… je n’ose pas… je me suis oubliée en disant cela…
Elle parlait d’une voix forte et presque fâchée en agitant violemment une main dans l’air, puis, reprenant son contrôle, elle ajouta dans un murmure :
– Dites-moi les noms de ceux que vous connaissez.
Je pouvais difficilement lui refuser ce plaisir futile et je nommai trois noms, ceux des pères de deux de mes élèves, le troisième étant celui d’un célibataire qui m’avait emmené faire une croisière sur son yacht, dans le but de prendre des esquisses pour lui.
– Ah ! Vous ne le connaissez pas ! s’écria-t-elle avec un soupir de soulagement. Êtes-vous vous-même un homme qui occupez une haute situation ? Ou êtes-vous titré ?
– Loin de là ! Je ne suis qu’un simple professeur de dessin.
Tandis que cette réponse passait mes lèvres, avec quelque amertume peut-être, elle saisit violemment mon bras.
– Un homme qui n’occupe aucune situation élevée et qui ne possède pas de titre, répéta-t-elle. Dieu soit loué ! alors je puis avoir confiance en lui !
J’avais décidé de dominer ma curiosité, par considération pour ma compagne, mais je ne pus y résister cette fois.
– Je crains que vous n’ayez eu de sérieuses raisons de vous plaindre des hommes titrés ou haut placés ? J’ai bien peur que le baronnet, dont vous me cachez le nom, ne vous ait causé un grave dommage ? Est-ce à cause de lui que vous vous trouvez dehors à pareille heure ?
– Ne me questionnez pas, ne me faites pas parler de cela, supplia-t-elle, je ne suis pas en état de le faire pour le moment. J’ai été cruellement traitée et l’on m’a fait un tort injuste… mais… Vous seriez si bon de marcher un peu plus vite et de ne plus me parler : Je désire tellement marcher en silence et si possible reprendre mon calme !
Nous avançâmes d’un pas rapide, et, durant au moins une demi-heure, pas un mot ne fut échangé entre nous. N’ayant pas la permission de l’interroger, je me risquais de temps à autre à examiner son visage. Il était impassible, les lèvres serrées, les sourcils froncés, les yeux fixés devant elle, parfois attentifs et parfois absents. Nous avions atteint les premières maisons près du nouveau Wesleyan College, lorsqu’elle recommença à parler.
– Habitez-vous Londres ? me demanda-t-elle.
– Oui.
Tout en répondant, je songeai qu’elle comptait peut-être sur moi pour l’aider ou pour la conseiller et, afin de lui épargner toute déception, j’ajoutai :
– Mais, demain, je quitte Londres pour quelque temps. Je vais à la campagne.
– Où allez-vous ? Dans le nord ou dans le sud ?
– Dans le nord, dans le Cumberland.
– Dans le Cumberland ? s’exclama-t-elle avec émotion. Ah ! comme j’aimerais y retourner, moi aussi. J’ai été si heureuse dans le Cumberland !
J’essayai de nouveau de soulever le voile mystérieux qui l’enveloppait.
– Peut-être est-ce dans cette merveilleuse région des lacs que vous êtes née ?
– Non, répondit-elle, je suis née dans le Hampshire, mais j’ai été quelque temps en classe dans le Cumberland. Des lacs ? Je ne me souviens d’aucun lac. C’est le village de Limmeridge et Limmeridge House que je voudrais revoir !
Ce fut à mon tour cette fois de m’arrêter brusquement. Dans l’état de curiosité où je me trouvais à ce moment, le nom de l’habitation de Mr Fairlie venant sur les lèvres de mon étrange compagne m’étonnait au plus haut point.
– Avez-vous entendu quelqu’un appeler ? demanda-t-elle en regardant sur la route avec effroi.
– Non ! non ! j’ai été simplement frappé par le nom de Limmeridge House, dont j’ai entendu précisément parler ces jours derniers par des personnes habitant le Cumberland.
– Oh ! ce ne sont pas « mes personnes » ! Mrs Fairlie est morte et son mari aussi, et leur petite fille doit être mariée et partie au loin depuis longtemps. Je ne sais qui habite à Limmeridge House actuellement, mais s’il existe encore quelqu’un de la famille, je l’aime en souvenir de Mrs Fairlie.
Elle semblait vouloir en dire davantage, mais nous arrivions en vue de la barrière du péage au-dessus de l’avenue Road. Sa main s’agrippa à mon bras et elle regarda la grille avec inquiétude.
– L’homme de la barrière nous regarde-t-il ? demanda-t-elle.
Personne ne s’occupa de nous tandis que nous passions la barrière. La vue des réverbères et des maisons parut la rendre nerveuse.
– C’est Londres, n’est-ce pas ? Ne voyez-vous aucune voiture ? Je suis fatiguée et j’ai peur. Je voudrais m’enfermer dans une voiture qui m’emmènerait au loin…
Je lui expliquai que le stationnement de fiacres se trouvait à quelque distance et qu’il fallait encore marcher un peu, à moins qu’une voiture inoccupée n’arrivât à notre rencontre.
J’essayai alors de reprendre la conversation sur le Cumberland, mais elle était hantée par l’obsession de trouver une voiture et ne m’écoutait plus.
Au tiers de l’avenue, j’aperçus un fiacre s’arrêtant devant une maison et vis un homme en descendre et payer le cocher. Je le hélai aussitôt et me dirigeai vers lui. Comme nous traversions la route, ma compagne devint impatiente au point qu’elle m’obligea presque à courir.
– Il est si tard, disait-elle… Si je suis pressée, c’est parce qu’il est si tard !
– Je ne puis vous prendre, monsieur, si vous n’allez pas du côté de Tottenham Court, déclara le cocher poliment, tandis que j’ouvrais la portière. Mon cheval est fourbu, il n’est plus capable de dépasser son écurie.
– Oui, oui, cela ira pour moi. Je vais de ce côté… Je vais de ce côté…
Elle parlait avec agitation en entrant précipitamment dans le fiacre. Je m’assurai que le brave homme était sobre et convenable puis, lorsqu’elle fut assise à l’intérieur, la priai de me permettre de l’accompagner à bon port.
– Non, non, non ! s’écria-t-elle vivement. Je suis tout à fait en sécurité maintenant et parfaitement heureuse. Si vous êtes un gentleman, souvenez-vous de votre promesse. Dites-lui de rouler jusqu’à ce que je l’arrête. Merci ! oh ! merci ! merci !
Elle saisit ma main qui tenait la portière et l’embrassa plusieurs fois, puis la repoussa brusquement.
La voiture se mit en marche, et je restai au milieu de la route avec une vague envie de l’arrêter aussitôt – pourquoi ? je n’aurais pas su le dire moi-même –, mais la pensée que j’aurais pu effrayer la jeune femme ou lui déplaire me retint. Le bruit des roues s’éloigna, et la voiture se perdit dans la nuit. La dame en blanc avait disparu !
Pendant plus de dix bonnes minutes je restai au même endroit, me demandant si cette aventure était bien réelle. L’instant d’après, je ne savais plus si j’avais bien ou mal agi, mais qu’aurait-il fallu faire ? C’est à peine si je savais encore vers où je me dirigeais. Je n’avais conscience de rien, sinon de la confusion de mes pensées, lorsque, tout à coup, je fus rappelé à la réalité – je fus éveillé, pourrais-je dire – par un bruit de roues qui s’approchaient rapidement derrière moi. Je me trouvais sur le côté sombre de la route, ombragé par les arbres touffus d’un jardin, je me retournai. De l’autre côté de l’avenue – celui éclairé par la lune, un policeman marchait dans la direction de Regent’s Park.
Un cabriolet occupé par deux hommes me dépassa. Soudain, j’entendis une voix crier :
– Arrêtez, voici un agent de police, questionnons-le.
Le cheval se cabra et s’arrêta à quelques mètres de moi.
– Policeman ! cria la même voix. N’avez-vous pas vu une femme ?
– Quelle espèce de femme ?
– Une femme vêtue d’une robe couleur lavande.
– Mais non, interrompit l’autre homme, les vêtements que nous lui avions donnés se trouvaient sur son lit, elle a dû remettre ceux qu’elle portait en arrivant chez nous, des vêtements blancs. Une femme tout en blanc, policeman ?
– Je ne l’ai pas vue, monsieur.
– Si vous ou l’un de vos hommes la rencontrez, arrêtez-la et ramenez-la avec ménagement à cette adresse. Je rembourserai les frais et donnerai une bonne récompense.
Le policeman regarda la carte qu’on lui tendait.
– Pourquoi devons-nous l’arrêter ? Qu’a-t-elle fait ?
– Fait ! Mon Dieu ! elle s’est enfuie de notre asile. Souvenez-vous… une femme tout en blanc… Au revoir !
5
« Elle s’est enfuie de notre asile ! »
J’avoue que la signification terrible de ces mots ne m’étonnait qu’à demi. Les questions et les réponses bizarres que m’avait faites cette femme après que je lui eus promis assez inconsidérément de la laisser libre d’agir à sa guise m’avaient déjà donné à penser ou bien qu’elle était d’un naturel capricieux, instable, ou bien qu’à la suite d’une très forte émotion elle souffrait d’un déséquilibre mental. Mais la pensée qu’elle pouvait être réellement folle ne m’était jamais venue à l’esprit.
Qu’avais-je fait ? Aidé à fuir la victime d’un horrible emprisonnement injustifié, ou abandonné aux hasards de la grande ville une pauvre créature incapable de se diriger ? Je n’osais y penser.
Rentré chez moi à Clement’s Inn, dans l’état d’esprit où je me trouvais, il était inutile de songer à me mettre au lit. Dans quelques heures d’ailleurs, je devais partir pour le Cumberland. J’essayai de dessiner, puis de lire, mais en vain. Qu’était devenue la pauvre femme que j’avais abandonnée à son sort ?
Ce fut un réel soulagement pour moi de voir arriver l’heure de dire adieu à Londres et de m’en aller vers une nouvelle vie. Le tintamarre assourdissant de la gare me fit presque du bien. D’après les instructions, je devais changer de train à Carlisle afin de bifurquer vers la côte. La malchance fit que notre locomotive tomba en panne entre Lancaster et Carlisle, ce qui me fit manquer la correspondance. Je dus attendre plusieurs heures le train suivant, qui me déposa à la station la plus rapprochée de Limmeridge House aux environs de dix heures du soir. La nuit était si dense que je distinguai à peine le cabriolet que Mr Fairlie avait envoyé à mon intention.
Le cocher, déconcerté par mon arrivée tardive, avait cet air respectueusement maussade particulier aux domestiques anglais. En silence, la voiture se mit en marche avec prudence à travers la nuit sombre. Le mauvais état des routes et l’obscurité opaque rendaient le chemin difficile, aussi y avait-il plus d’une heure que nous roulions lorsque j’entendis au loin le murmure de la mer et le crissement du gravier sous les roues. Nous avions franchi une grille avant de nous engager dans l’allée et nous en passâmes encore une seconde avant d’arriver à la maison. Accueilli par un solennel domestique sans livrée, je fus informé que la famille s’était retirée pour la nuit et conduit dans une pièce spacieuse où mon souper m’attendait à l’extrémité d’une grande table en acajou.
J’étais trop fatigué et trop préoccupé pour boire ou manger beaucoup, surtout avec la présence, derrière moi, du solennel domestique prévenant tous mes gestes, comme si plusieurs invités étaient à table, au lieu d’un homme solitaire. En un quart d’heure, j’eus terminé. Le domestique, toujours aussi rigide, me conduisit dans une chambre joliment meublée, me dit : « Déjeuner à 9 h, monsieur », jeta un coup d’œil autour de lui pour voir s’il ne manquait rien et disparut sans bruit.
Qui allais-je voir dans mes rêves ? me demandai-je en éteignant la bougie. La Dame en blanc ? Ou les habitants inconnus de cette maison ? C’était une sensation étrange d’y dormir comme un ami de la famille et de n’y connaître personne !
6
Lorsque je m’éveillai le matin et ouvris mes volets, la mer m’apparut dans toute sa splendeur sous le soleil éclatant du mois d’août. La côte d’Écosse bordait de bleu l’horizon lointain.
Ce spectacle était une telle surprise pour moi, un tel changement après le paysage monotone des briques et du mortier de Londres, que j’eus l’impression de commencer réellement une nouvelle vie. Il me donna la troublante sensation d’avoir soudain rompu avec le passé, sans avoir acquis cependant aucune certitude quant au présent ou à l’avenir.
Tout ce qui s’était passé les derniers jours s’effaçait dans mon souvenir comme si, au contraire, des mois et des mois s’étaient écoulés depuis lors. L’étrange nouvelle de Pesca, m’annonçant qu’il avait trouvé pour moi une situation ; la soirée d’adieu chez ma mère et ma sœur ; et même mon aventure si mystérieuse sur la route de Hampstead alors que je revenais en ville, tout cela vraiment m’apparaissait comme autant d’événements appartenant à une époque déjà lointaine de mon existence. Si je pensais toujours à la Dame en blanc, son image pourtant devenait indistincte, floue.
Un peu avant 9 h, je descendis au rez-de-chaussée. Le domestique de la nuit dernière, me trouvant déambulant dans les couloirs, me montra charitablement le chemin de la salle à manger.
Tandis qu’il ouvrait la porte, un premier coup d’œil me fit apercevoir au milieu de la pièce éclairée par de nombreuses fenêtres une longue table abondamment garnie.
Près d’une des fenêtres se tenait debout une jeune femme qui me tournait le dos. Mes yeux se fixèrent un moment sur elle, et je fus frappé de la rare perfection de son corps et de la grâce naturelle de son maintien. Grande, mais non trop, bien faite et épanouie, mais non trop forte, elle charmait vraiment les yeux d’un homme. Elle ne m’avait pas entendu entrer ; je pris la liberté de l’admirer tout à mon aise pendant quelques instants avant de remuer une chaise afin d’attirer son attention. Elle se retourna aussitôt. L’aisance de tous ses mouvements tandis que, du fond de la pièce, elle s’avançait vers moi, me rendait impatient de voir clairement son visage. Elle avait de beaux cheveux noirs, elle était jeune ! Elle s’approcha encore de quelques pas, et je vis qu’elle était laide !
Jamais le vieil adage selon lequel la nature ne se trompe en aucun cas ne s’était révélé plus faux – jamais la promesse de beauté que donne une silhouette charmante n’avait été plus cruellement démentie qu’ici par le visage. Le teint était mat, une moustache teintait d’une ombre foncée la lèvre supérieure. La bouche était grande et masculine, les yeux bruns, proéminents, perçants, résolus. La chevelure épaisse, d’un noir de jais, prenait naissance extraordinairement bas sur le front. Tandis que la jeune femme restait silencieuse, son expression, quoique franche, ouverte et intelligente, semblait manquer des attraits féminins de douceur et de tendresse sans lesquels la beauté de la plus jolie femme est incomplète. Voir ce visage sur des épaules si admirables qu’un sculpteur eût sans doute désiré les avoir pour modèle ; avoir été séduit par les gestes discrets et gracieux que laissait deviner la perfection des bras et des jambes, et sentir une véritable répulsion devant l’air et les traits masculins du visage, cela vous donnait une sensation ressemblant étrangement à celle, extrêmement désagréable, que nous connaissons tous, lorsque, pendant notre sommeil, nous ne parvenons pas à nous expliquer les étranges contradictions d’un rêve.
– Mr Hartright, je suppose, demanda-t-elle, tandis que son visage s’adoucissait en s’éclairant d’un sourire. Nous désespérions de vous voir arriver hier soir et sommes allés nous coucher comme d’habitude. Acceptez mes excuses pour notre manque d’attention et permettez-moi de me présenter comme l’une de vos futures élèves. Serrons-nous la main, voulez-vous ? Nous devrons quand même y arriver tôt ou tard, alors autant tout de suite, n’est-ce pas ?
Ces étranges paroles de bienvenue étaient prononcées d’une voix claire, sonore et agréable. La main offerte était plutôt grande mais admirablement faite et tendue vers moi avec l’aisance d’une femme du monde.
Nous nous mîmes à table comme si nous nous connaissions depuis toujours et nous retrouvions à Limmeridge House pour y échanger de vieux souvenirs.
– J’espère que vous êtes venu ici bien déterminé à tirer le meilleur parti possible de votre situation, continua-t-elle. Vous devrez commencer par vous contenter de ma présence, ce matin. Ma sœur est dans sa chambre ; elle a un peu de migraine, et son ancienne gouvernante, Mrs Vesey, la soigne avec amour. Mon oncle, Mr Fairlie, ne nous rejoint jamais pour le repas : étant infirme, il se cantonne en célibataire dans ses appartements. Il n’y a personne d’autre que moi dans la maison. Deux jeunes filles ont passé dernièrement quelque temps ici, mais sont parties hier, désespérées, ce qui n’est pas étonnant. Durant tout leur séjour et à cause de l’état de santé de Mr Fairlie, nous ne leur avons pas présenté un seul être masculin avec qui elles eussent pu causer, danser ou flirter. Aussi nous sommes-nous disputées sans arrêt, surtout pendant les repas. Songez donc ! Quatre femmes en tête à tête continuel ! Vous voyez que je n’entretiens pas de grandes illusions sur mon propre sexe, Mr Hartright ; aucune femme n’en a d’ailleurs, mais bien peu l’avouent ! Prenez-vous du thé ou du café ? Mon Dieu, comme vous avez l’air embarrassé ! Êtes-vous en train de vous demander ce que vous allez prendre pour déjeuner ou bien est-ce ma façon désinvolte de parler qui vous surprend ? Dans le premier cas, je vous conseille en amie de ne pas toucher à ce jambon, et d’attendre plutôt l’omelette. Dans le second cas, je vais vous verser un peu de thé pour vous aider à vous remettre et tâcher de tenir ma langue quelques instants.
Elle me passa une tasse de thé en riant. Son bavardage piquant et familier vis-à-vis d’un étranger s’accompagnait d’une telle aisance et d’une telle assurance, que celles-ci pouvaient garantir à elles seules le respect du plus audacieux des hommes. S’il était presque impossible de demeurer formaliste en sa compagnie, il était tout aussi impossible de manquer de tenue envers elle, n’eût-ce été qu’en pensée.
– Oui, oui, continua-t-elle lorsque j’eus expliqué tant bien que mal mon air ahuri. Je comprends ! Étant complètement étranger ici, vous êtes intrigué par les habitants de cette maison. C’est naturel. J’aurais dû songer déjà à vous en parler. Je commence par moi, si vous le permettez, afin d’en avoir plus vite fini. Mon nom est Marian Halcombe et je suis aussi imprécise que toutes les femmes en appelant Mr Fairlie mon oncle et miss Fairlie ma sœur. Ma mère s’est mariée deux fois ; la première fois avec Mr Halcombe, mon père, la seconde fois avec Mr Fairlie, le père de miss Fairlie, qui est donc ma demi-sœur. Excepté le fait que nous sommes toutes deux orphelines, nous sommes aussi différentes l’une de l’autre que possible. Mon père était pauvre et le sien riche. Je n’ai rien et elle possède une grande fortune. Je suis brune et laide, et elle est blonde et jolie. Tout le monde me trouve revêche et bizarre (avec raison d’ailleurs !) et tout le monde la trouve douce et charmante (avec encore plus de raisons !). En résumé, c’est un ange et je suis… Essayez un peu de cette marmelade, Mr Hartright, et achevez vous-même ma phrase. Que vous dirais-je de Mr Fairlie ? Ma parole, je ne sais plus ! Il vous enverra certainement chercher après le déjeuner et vous en jugerez vous-même. Ce que je puis vous dire, c’est qu’il est le plus jeune frère de feu Mr Fairlie, qu’il est célibataire et qu’il est le tuteur de miss Fairlie. Je ne voudrais pas vivre sans elle, et elle ne peut vivre sans moi, c’est pourquoi je suis à Limmeridge House. Ma sœur et moi, nous nous adorons, ce qui est inexplicable, vu les circonstances. Vous devez, vous, plaire à toutes les deux, Mr Hartright, ou ne plaire à aucune ; ce qui est pire, c’est que vous allez être tout le temps dans notre compagnie. Mrs Vesey est une excellente personne ayant toutes les vertus cardinales et ne comptant pour rien. Quant à Mr Fairlie, il est trop infirme pour être un compagnon pour qui que ce soit. Nous attribuons tous son infirmité aux nerfs et, au fond, aucun de nous ne sait pourquoi. Je vous conseille toutefois de flatter ses petites manies quand vous le verrez. Admirez sa collection de pièces de monnaie et de gravures et vous gagnerez son cœur. Si vous pouvez vous contenter d’une existence calme, à la campagne, je ne vois pas pourquoi vous ne vous plairiez pas ici. Du déjeuner au lunch, les estampes de Mr Fairlie vous absorberont. Après le lunch, miss Fairlie et moi prendrons nos cahiers de croquis et irons, sous votre direction, étudier les beautés de la nature, et les déformer en ayant l’illusion de les représenter. Le dessin est son caprice favori, pas le mien. Les femmes ne savent pas dessiner ! Leur imagination est trop féconde et leurs yeux trop inattentifs.
» N’importe ! ma sœur l’aime, aussi, je gaspille couleurs et papier pour lui faire plaisir. Quant aux soirées, je crois que nous pourrons vous les rendre agréables. Miss Fairlie joue délicieusement du piano. Pour ma part, je ne distingue pas une note d’une autre, mais je puis vous battre aux échecs, au trictrac, à l’écarté et, par une anomalie toute féminine, même au billard.
» Que pensez-vous du programme ? Croyez-vous que vous pourrez vous adapter à notre vie tranquille et régulière ? Ou bien aurez-vous soif de changement et d’aventures ?
Elle avait débité tout cela d’un seul trait et d’un air quelque peu railleur. Mais, malgré le ton léger avec lequel elle l’avait prononcé, le mot « aventures » me donna l’impérieux désir de savoir quel avait été le lien de parenté, si toutefois elles avaient été parentes, entre Mrs Fairlie, ancienne maîtresse de Limmeridge House, et la fugitive sans nom de l’asile.
– Même si j’étais le plus changeant des hommes, répondis-je, il n’y aurait aucun danger que j’aie soif d’aventures pendant quelque temps, car la nuit qui précéda mon arrivée ici, j’en ai vécu une dont l’étrangeté et le mystère me poursuivront durant tout mon séjour à Limmeridge House, je vous le certifie, miss Halcombe.
– Vraiment ? Puis-je la connaître ?
– Vous y avez un certain droit. L’héroïne principale de cette aventure vous est sans doute aussi étrangère qu’à moi, miss Halcombe, mais elle a mentionné le nom de la dernière Mrs Fairlie en termes empreints de la plus sincère gratitude et du plus profond respect.
– Le nom de ma mère ! Vous m’intéressez au-delà de toute expression. Je vous en prie, continuez.
Je racontai les circonstances de ma rencontre avec la Dame en blanc et répétai mot par mot ce que celle-ci m’avait dit au sujet de Mrs Fairlie.
Les grands yeux honnêtes de miss Halcombe me fixaient avec ardeur tandis que je parlais. Son visage exprimait de l’intérêt et de l’étonnement, mais rien de plus. Il était évident qu’elle ne connaissait pas la femme dont je parlais.
– Êtes-vous tout à fait certain des paroles qu’elle a prononcées au sujet de ma mère ? demanda-t-elle.
– Absolument. Qui qu’elle puisse être, cette femme fut un jour élève à l’école du village de Limmeridge et y fut traitée avec une bonté spéciale par Mrs Fairlie. En souvenir de cette bonté, elle garde un intérêt affectueux à tous les survivants de la famille. Elle savait que Mrs Fairlie et son mari étaient morts et parlait de miss Fairlie comme si elle l’eût bien connue étant enfant.
– Vous avez dit, je pense, qu’elle niait avoir habité cette contrée ?
– En effet ; elle m’a dit qu’elle était originaire du Hampshire.
– Et vous n’êtes pas parvenu à connaître son nom ?
– Non.
– Étrange ! Je trouve que vous avez eu parfaitement raison de donner la liberté à cette pauvre créature, Mr Hartright, car elle ne semble pas avoir fait, en votre présence, quelque chose qui prouvât qu’elle ne fût pas capable d’en jouir. J’aurais cependant voulu que vous fussiez plus résolu, pour découvrir son nom. De toute façon, nous devons éclaircir ce mystère, mais vous feriez mieux de n’en parler ni à Mr Fairlie ni à ma sœur. Tous deux, j’en suis persuadée, ignorent tout de cette femme. Ils sont, chacun dans leur genre, nerveux et impressionnables, et vous ne pourriez qu’agiter l’un et alarmer l’autre, sans résultat. Quant à moi, je suis folle de curiosité et, à partir de cet instant, je vais consacrer toute mon énergie à éclaircir ce mystère. Lorsque ma mère vint ici après son second mariage, c’est elle qui créa l’école du village telle qu’elle existe encore aujourd’hui, mais tous les vieux professeurs sont morts ou partis, il n’y a plus aucune lumière à espérer de ce côté. La seule possibilité à laquelle je songe est…
À ce moment, nous fûmes interrompus par l’entrée d’un domestique porteur d’un message de Mr Fairlie, m’informant, qu’il serait heureux de me voir, aussitôt que j’aurais terminé mon déjeuner.
– Attendez dans le hall, dit miss Halcombe, répondant à ma place, de son ton sec habituel, Mr Hartright va arriver tout de suite… J’allais vous dire, continua-t-elle en se tournant de nouveau vers moi, que ma sœur et moi possédons de nombreuses lettres de ma mère adressées à mon père et au sien. En l’absence d’autres moyens d’information, je vais passer toute la matinée à examiner cette correspondance avec Mr Fairlie. Celui-ci adorait Londres et était constamment absent de sa maison de campagne. Ma mère avait l’habitude de lui écrire tout ce qui se passait à Limmeridge. Ses lettres sont pleines de renseignements sur l’école qui l’intéressait tant et je pense qu’il y a beaucoup de chances pour que j’aie découvert quelque chose d’intéressant quand nous nous reverrons. Le lunch est à 2 h, monsieur, et j’aurai le plaisir de vous présenter à ma sœur. Nous emploierons l’après-midi à vous montrer le voisinage et tous les jolis points de vue des environs. À 2 h. Au revoir !
Elle me salua avec toute la grâce et l’aisance qui la caractérisaient et disparut.
Je sortis aussitôt dans le hall et suivis le domestique vers les appartements de Mr Fairlie.
7
Mon guide me conduisit, au premier étage, dans le corridor menant à la chambre que j’avais occupée la nuit dernière et, ouvrant une porte contiguë à celle-ci, me pria d’entrer.
– Mon maître m’a donné l’ordre de vous montrer votre petit salon particulier, monsieur, déclara-t-il, et de m’informer si vous approuvez la lumière et la situation.
J’aurais été bien difficile à contenter si je n’avais pas approuvé la pièce et sa disposition. La fenêtre donnait sur la même vue merveilleuse que celle que j’avais admirée, le matin, dans ma chambre. Les meubles étaient du plus grand confort et d’un goût parfait. Une table était couverte de livres joliment reliés, d’une écritoire élégante et d’un vase contenant de superbes fleurs. Sur l’autre table, devant la fenêtre, s’étalait tout un nécessaire de peinture. Les murs étaient tendus de toile de Perse et le plancher recouvert d’une natte de Chine de deux teintes : ocre et rouge. C’était le plus joli studio que j’aie jamais vu et je l’admirai avec enthousiasme.
Le solennel domestique était trop bien stylé pour trahir la moindre satisfaction. Il s’inclina avec déférence, lorsque j’eus épuisé mes termes élogieux, et m’ouvrit silencieusement la porte. Nous contournâmes un coin, nous nous engageâmes dans un long corridor, montâmes quelques marches, traversâmes un petit hall circulaire et nous nous arrêtâmes enfin devant une porte recouverte d’un drap vert sombre. Le domestique l’ouvrit, puis il fit de même avec une seconde porte à peu près identique, et sans bruit écarta une tenture de voile vert pâle, en articulant d’une voix douce : « Mr Hartright », puis il me quitta.
Je me trouvai dans une chambre haute et spacieuse, au plafond merveilleusement sculpté et au plancher recouvert d’un épais tapis, doux et moelleux. D’un côté, il y avait une longue bibliothèque d’un bois rare incrusté que je ne connaissais pas, sur laquelle étaient rangées des statuettes de marbre. De l’autre côté, se trouvaient deux armoires anciennes entre lesquelles était pendue au mur une reproduction de la Vierge à l’Enfant de Raphaël. À droite et à gauche de la porte, enfin, une chiffonnière et un socle en marqueterie, supportant des porcelaines de Dresde, des ivoires, des curiosités incrustées d’or et de pierreries.
À l’autre extrémité de la chambre, en face de moi, les fenêtres étaient condamnées et l’ardeur du soleil était tempérée par de grandes tentures du même ton que la portière. La lumière ainsi obtenue était extrêmement douce, mystérieuse ; elle éclairait uniformément tous les objets et rendait plus sensible encore le silence profond qui régnait dans la pièce, et plus sensible aussi son atmosphère de retraite ; elle entourait à souhait d’un halo paisible la silhouette solitaire du maître de la maison, assis nonchalamment dans un grand fauteuil, aux bras duquel étaient fixés d’un côté un petit chevalet de lecture et, de l’autre, une petite table.
Si l’apparence permet de deviner l’âge d’un homme qui sort de son cabinet de toilette, j’aurais donné à celui-ci de 50 à 60 ans. Son visage rasé de frais était mince, fatigué et d’une pâleur transparente, mais sans ride. Son nez était grand et crochu, ses yeux étaient d’un gris-bleu indéfinissable et proéminents, et les paupières bordées de rouge. Ses cheveux étaient rares, fins – des cheveux de ce blond clair qui ne laisse apparaître qu’assez tard le grisonnement.
Il était vêtu d’un veston foncé, coupé dans un tissu très léger, d’un gilet et d’un pantalon d’un blanc neigeux. Les pieds, aussi petits que des pieds de femme, étaient chaussés de bas de soie de couleur chamois et de délicates pantoufles de cuir brun. Deux bagues de prix ornaient ses mains, qu’il avait fines et blanches.
Son regard avait quelque chose de singulier et de déplaisant chez un homme, il était languissant et incertain.
Ma conversation du matin avec miss Halcombe m’avait disposé à trouver tout le monde charmant à Limmeridge House, mais la vue de Mr Fairlie suscita en moi une antipathie profonde.
En me rapprochant de lui, je m’aperçus qu’il n’était pas aussi inactif que je l’avais cru tout d’abord. Au milieu des objets rares, qui couvraient une grande table ronde placée non loin de lui, se trouvait une petite armoire d’ébène et d’argent, contenant des pièces de monnaie de toutes les formes et de toutes les grandeurs, rangées soigneusement dans de petits tiroirs drapés de velours rouge sombre. L’un d’eux était posé sur la tablette fixée au bras du fauteuil ainsi que quelques brosses minuscules de bijoutier, une peau et une petite bouteille. Lorsque je m’avançai pour saluer Mr Fairlie, ses maigres doigts blancs manipulaient tendrement quelque chose qui, à mes yeux inexpérimentés, ressemblait à une médaille sale aux coins usés.
– Si heureux de vous avoir à Limmeridge House, Mr Hartright, dit-il d’une voix dolente et éraillée. Asseyez-vous, je vous prie, sans reculer la chaise, s’il vous plaît, car dans le triste état où se trouvent mes nerfs, n’importe quel bruit m’est pénible. Avez-vous vu votre studio ? Vous plaît-il ?
– Je viens justement de le voir, Mr Fairlie, et je vous assure…
Il m’arrêta d’un geste implorant, en fermant les yeux.
– Je vous prie de m’excuser, mais ne pourriez-vous pas essayer de parler sur un ton moins élevé ? Dans le triste état de mes nerfs, les sons criards me torturent. Vous pardonnez à un infirme, n’est-ce pas ? Je ne fais que vous dire ce que mon lamentable état de santé m’oblige à dire à tout le monde. Oui… alors, vous aimez votre studio ?
– Je ne pourrais souhaiter rien de plus joli et de plus confortable, répondis-je, abaissant la voix et me disant à part moi que l’égoïsme de Mr Fairlie et ses nerfs ne constituaient qu’une seule et même chose.
– Si heureux !… Vous serez traité dignement dans cette maison, Mr Hartright, et vous n’y trouverez pas ces horribles sentiments de barbarie anglaise vis-à-vis du rang social d’un artiste. J’ai passé une si grande partie de ma jeunesse à l’étranger que je me suis complètement dépouillé de ces préjugés nationaux. Je voudrais pouvoir en dire autant de la gentry du voisinage, mais ce sont de vrais sauvages quant à l’art, Mr Hartright. Cela vous dérangerait-il beaucoup de remettre ce tiroir dans la petite armoire et de me donner le suivant ? Dans le triste état de mes nerfs, tout mouvement est pour moi un supplice. Oui… merci.
Je remis le tiroir en place et lui en passai un autre avec politesse. Il recommença immédiatement son nettoyage, en continuant à me parler.
– Mille mercis et mille excuses. Aimez-vous les pièces de monnaie anciennes ? Oui ?… si heureux ! Voilà un autre goût que nous avons en commun, en plus de l’art. Maintenant, au sujet des arrangements pécuniaires, dites-moi, sont-ils satisfaisants ?
– Des plus satisfaisants, Mr Fairlie.
– Si heureux !… Et… ensuite ? Ah ! je me souviens, oui… en considération de l’amabilité avec laquelle vous voulez bien mettre votre talent à mon service, mon valet de chambre se mettra entièrement à votre disposition dès la fin de la première semaine de votre séjour. Et… après ? C’est curieux, n’est-ce pas ? Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à vous dire et j’ai tout oublié. Cela ne vous dérangerait-il pas de sonner dans ce coin !… Oui… merci.
Je sonnai, et sans bruit un autre domestique apparut, un étranger sans nul doute, au sourire étudié, aux cheveux bien brossés, le vrai valet de chambre, quoi !
– Louis, dit Mr Fairlie époussetant rêveusement le bout de ses doigts à l’aide d’une des petites brosses, j’ai fait des annotations sur mes tablettes ce matin. Allez me les chercher… Mille pardons, Mr Hartright, je crains de vous importuner.
Comme il fermait les yeux d’un air las, et comme, en effet, il m’importunait au-delà de toute expression, je me dispensai de répondre et attendis en examinant la Vierge à l’Enfant, de Raphaël.
Le valet revint bientôt portant un petit livre à couverture d’ivoire. Après avoir poussé un soupir, Mr Fairlie l’ouvrit d’une main tandis que, de l’autre, il faisait signe au domestique d’attendre.
– Oui, c’est cela. Louis, prenez ce carton, dit-il en désignant une étagère en acajou près de la fenêtre. Non ! pas celui qui a le dos vert, il contient mes estampes de Rembrandt. Mr Hartright, aimez-vous les eaux-fortes ? Oui ?… si heureux !»
» Encore un goût de commun. Le carton au dos rouge, Louis. Ne le laissez pas tomber surtout !… Vous ne vous faites pas une idée de la torture que j’endurerais, Mr Hartright, si Louis laissait tomber ce carton. Dites, est-il en sécurité sur cette chaise ? Oui ?… Si heureux ! Voudriez-vous avoir maintenant l’obligeance d’examiner ces gravures, si toutefois vous êtes certain qu’elles sont en sécurité là. Louis, allez-vous-en ! Quel âne vous êtes ! Ne voyez-vous pas que j’ai toujours les tablettes en mains ? Croyez-vous par hasard que je désire les garder ? Alors pourquoi ne m’en débarrassez-vous pas sans que je vous le dise ? Mille excuses, Mr Hartright, les domestiques sont de tels ânes, n’est-ce pas ?… Dites-moi, que pensez-vous de ces gravures ? Elles sont arrivées d’une vente, dans un état honteux, et je trouvais qu’elles sentaient encore les doigts de brocanteurs la dernière fois que je les ai examinées.
Pour moi, si ni mon odorat ni mes nerfs n’étaient assez sensibles pour que l’odeur des doigts plébéiens les irrite, j’avais le goût assez sûr pour apprécier la valeur réelle des aquarelles. Car c’étaient, en réalité, de beaux spécimens de l’aquarelle anglaise et ils auraient mérité un meilleur traitement que celui qu’on leur avait fait subir.
– Ces aquarelles ont besoin d’être sérieusement retouchées et restaurées, répondis-je ; mais, assurément, à mon avis, elles valent…