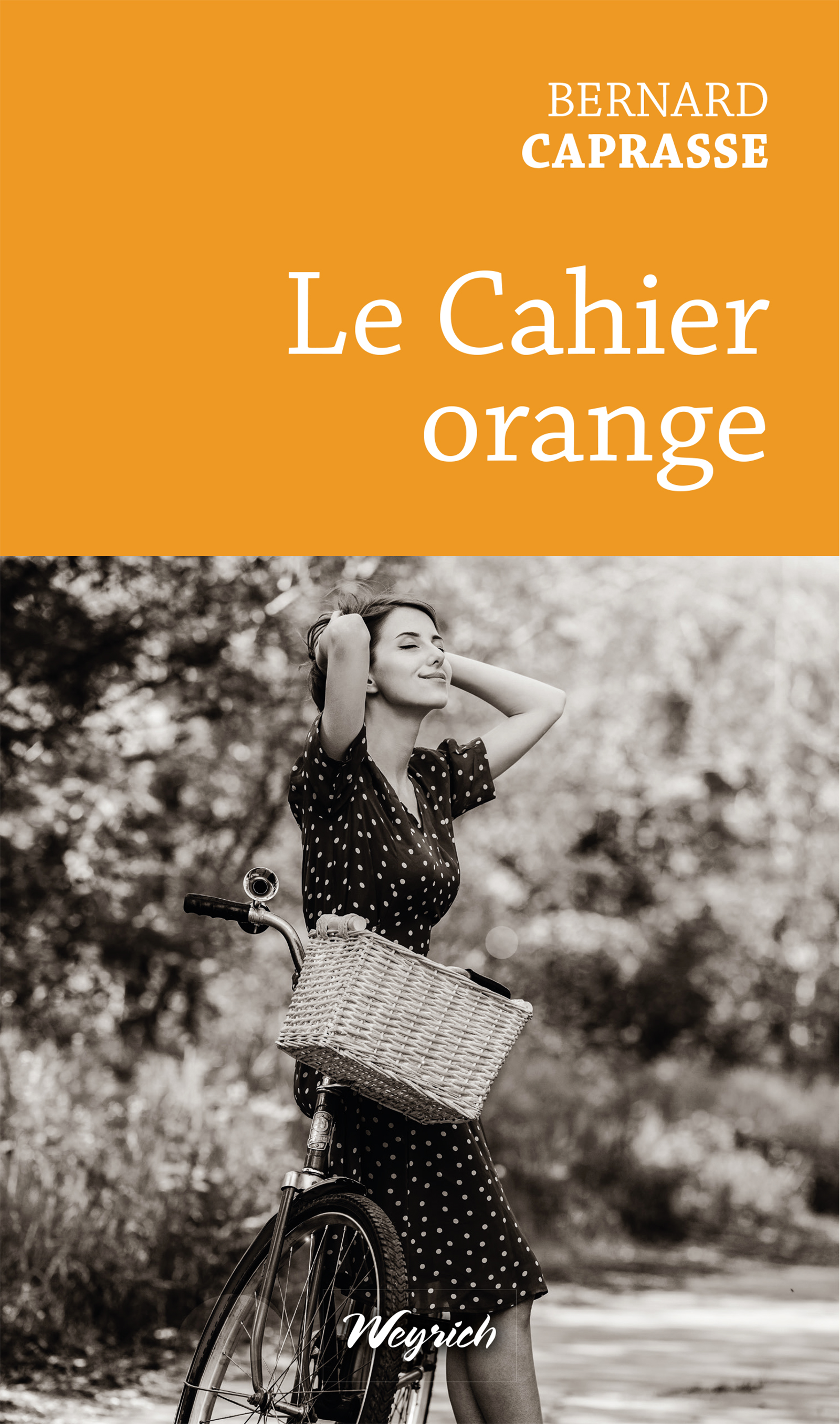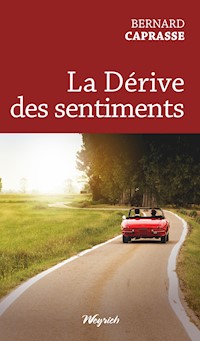
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À sa naissance, Héloïse est rejetée par son père. Cet aristocrate campagnard la rend responsable de la mort de son épouse lors de l’accouchement. Affectée d’un pied bot, l’enfant l’apprivoisera pourtant.
Pour lui trouver un prétendant que ne rebute pas son handicap, il convie à une fête somptueuse le gratin de la noblesse. Quelques jeunes gens supputent l’étendue de sa fortune, mais rien ne se passe comme prévu…
Entre passions et manipulations, drame et rédemption, l’histoire d’Héloïse de Sterpigny et de sa famille traverse tout le vingtième siècle.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ancien avocat successivement aux barreaux de Bruxelles et de Marche-en-Famenne,
Bernard Caprasse a été Gouverneur de la Province de Luxembourg. Auteur de théâtre, il signe ici son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prologue
Barbara
1
Il ne pardonnerait pas à Dieu. C’était trop. Ce devait être la nuit du bonheur. Ce fut celle du cauchemar. Barbara Valensky, allongée sur le lit, attendait l’arrivée du médecin qui devait l’accoucher. Jean de Sterpigny l’avait appelé par téléphone. Six kilomètres à parcourir, sur une route pavée en bon état, pour rejoindre le village dont l’aristocrate portait le nom. En ce mois d’octobre 1921, une douceur rappelant l’été nimbait les soirées de villageois assis sur les bancs disposés devant leurs maisons. Ils saluèrent la Renault du médecin, l’une des rares voitures à parcourir leur campagne lointaine.
La servante, en compagnie d’une voisine, avait préparé les serviettes, les linges, les gants de toilette, les bassines d’eau chaude. La grossesse s’était déroulée normalement. Le docteur se savait seul, dépourvu de tout si un accident se produisait. Il fit face, donnant ses injonctions, sans se départir de son calme lorsqu’arrivèrent les difficultés. L’accouchante criait, abrutie par la douleur qui lui brûlait les entrailles. Il fallut, aux forceps, arracher le bébé au ventre de sa mère. Sa maman eut un sourire épuisé. Elle articula quelques mots inaudibles, tournée vers Jean, son mari. L’hémorragie ! Le docteur posa les gestes appris d’une longue expérience. Il ne put la juguler. Livides, les deux hommes échangèrent un regard d’impuissance pour l’un, d’incompréhension pour l’autre. Jean se pencha sur son épouse, la prit dans ses bras, l’embrassa sur des lèvres déjà bleuies. Il enfouit son visage dans le cou inondé de sueur de la mourante, resta ainsi un long moment, indifférent à l’enfant, indifférent à tout. La gorge cimentée par l’horreur l’empêcha de hurler. Ce silence signait son désespoir plus que les pleurs et les cris. Hagard, il finit par tourner la tête. C’était une fille. Le médecin ne lui dissimula pas la vérité. Comment aurait-il pu ? Un petit pied tordu ! Le diagnostic vint dans un souffle : « Son pied droit, un pied bot varus équin, très prononcé. » Il se tourna vers le chevalier : « Jean, ta fille est très fragile. Je voudrais la baptiser tout de suite. » Jean prononça un mot : « Héloïse ».
Elle fut baptisée. Il perdit la foi.
2
Ces grands bourgeois reçurent Jean de Sterpigny avec faste. L’Ardennais, abonné à l’austérité, s’y était préparé. Les affaires l’exigeaient, il ferait honneur à ses hôtes. Ceux-ci l’avaient invité dans leur hôtel particulier niché dans une rue privée de la capitale. Une demeure, dessinée par Horta, que la maîtresse de maison s’empressait de faire visiter, cédant aux sollicitations polies des invités, les devançant parfois. Elle leur débitait sa leçon de modernisme après avoir retenu, au prix de quelques approximations, ce que l’architecte avait bien voulu lui enseigner. Prise au dépourvu par une question, elle inventait avec aplomb la réponse, certaine de n’être pas contredite. La bienséance l’interdisait.
Le lieu plut au chevalier qui jugea avec indulgence l’emphase de Madame. Au moins, ces nouveaux riches dévoilaient-ils leur réussite en s’entourant d’artistes. Leur vanité n’était pas dépourvue de vertus. Il leur avait acheté à un prix satisfaisant une centaine d’hectares d’épicéas qui prolongeraient l’une des propriétés forestières de la famille, à Sibret, non loin de Bastogne. Une plantation trop jeune pour contenter l’appétit de rentabilité des vendeurs tentés par les gains rapides d’une bourse prometteuse. Le terrien de son côté aimait à profiter de la patience des arbres.
En ce printemps 1919, au sortir d’une guerre rythmée par les privations, le déjeuner promettait d’être long. Les services se suivraient agrémentés de champagne, vins et liqueurs. Une dizaine de personnes avaient été conviées. Jean reconnut quelques fortunes. Par rapport à l’argent, ces hôtes avaient fait leur chemin.
Lorsqu’elle apparut, il se contint pour ne pas rester bouche bée et fit semblant de suivre encore les conversations. Il se contentait de sourires convenus, de rires factices, de mots enchaînés sans conviction. Assez pour leurrer ses voisins enfilant potins et banalités, attentifs surtout à leurs propres propos.
Elle assurait la deuxième partie du service avec une aisance altière. Il dissimulait le regard dont il la poursuivait. Pas assez pour que Madame ne finisse par s’en apercevoir. Elle profita d’un retour en cuisine de la servante pour s’adresser à son voisin à mi-voix :
— Vous l’avez remarquée. Elle n’est pas ordinaire, n’est-ce pas ?
Pris en défaut, il bafouilla ce qui devait ressembler à une approbation, en affichant un air niais.
— C’est la comtesse Valensky. Elle a fui la révolution bolchevique, malheureusement en laissant ses parents là-bas. Elle n’a aucune nouvelle. Quelle tristesse ! Elle a de l’allure. Ça nous change de, comment dire, du tout-venant. Une aubaine…
Le chevalier approuva d’un signe de tête en cachant son irritation. Une aubaine. Un mot mal choisi et, sous le vernis de l’élégance, la vulgarité se dévoile. Il renchérit avec une ironie que ne perçut pas sa voisine :
— Une belle acquisition en quelque sorte.
Elle s’esclaffa, attirant les regards. Elle s’excusa :
— Ce n’est rien, on devise Jean et moi, il est si amusant.
Elle termina en se penchant vers lui comme si elle lui confiait un secret :
— Une belle acquisition, j’adore.
Elle adorait. L’expression lui parut triviale. Le vernis s’écaillait vite.
Il la regarda comme s’il acquiesçait et pensa : « Je vais vous la voler. »
Un vieil armagnac vint à bout des résistances. Une satisfaction somnolente avachissait les corps, embrumait les esprits. Jean prit congé. Une silhouette discrète, presque évanescente s’était emparée de lui. Il était un peu plus de cinq heures. Une langueur moite l’enveloppait. Tapi au coin de la rue, il guettait la sortie de la servante. Il la suivit, sautant de justesse sur la plateforme du tram qu’elle emprunta. Destination Place de Brouckère. Une filature discrète. Elle habitait une impasse. Le lendemain à la même heure, sur la même place, il fit semblant de la rencontrer par hasard ; elle le reconnut et le salua d’un sourire qui le laissa dévasté. Il s’enhardit : « Ma journée a été longue. J’ai un creux… Si ça vous dit. »
Elle accepta. Ce repas, au moins, ne lui coûterait rien.
Les salons de l’hôtel Métropole étaient fréquentés par des clients bien éduqués. On n’y dévisageait pas les arrivants, les coups d’œil étaient furtifs, on ne se retournait pas sur les dames. L’impolitesse fut collective. En quelques pas, la comtesse Valensky démoda les élégantes engoncées dans leurs robes surchargées. Son style, sobre, soulignait une silhouette raffinée. Des cheveux blonds coiffés court dégageaient un visage au nez fin, aux lèvres ourlées, aux joues légèrement creusées. Des yeux lavande étirés donnaient au regard une étrange mélancolie. Elle irradiait.
Dès cette rencontre, Jean se départit de l’affectation taciturne qui lui plombait les traits depuis la mort de ses parents, survenue quelques semaines plus tôt. Férus d’automobiles, ces derniers avaient inauguré, sous les applaudissements du village, leur Impéria, une fabrique de rêves en ces temps juste sortis des abominations de la guerre. La voiture, dans un virage, mordit l’accotement herbeux et termina sa course dans un arbre. Jean retrouva sa mère éjectée contre une clôture de barbelés, son père accroché au volant, le thorax défoncé par la colonne de la direction. La tragédie le laissa seul. Il dut assumer, sans préavis, la gestion des affaires familiales. Les obligations journalières lui permettaient des pauses dans le chagrin. Mais le soir venu, celui-ci rôdait dans le manoir silencieux tel un fantôme portant tour à tour le visage des disparus.
À Sterpigny, il se surprenait à parcourir les chemins forestiers en roulant les « r », escamotant articles et syllabes pour imiter l’accent qui l’ensorcelait. Il parlait d’elle aux arbres qui l’écoutaient avec une bienveillance muette.
Le chevalier se regardait sans concession. Un corps noueux sans grand élancement, le visage glabre dépourvu du ton laiteux propre aux gens de sa condition, les cheveux drus, taillés près du crâne, qu’avait-il d’attirant ?
Barbara Valensky sut voir au-delà des apparences. Dans le regard sombre de ce campagnard, elle comprit ce qu’il avait d’authentique. Il s’intéressait à elle avec sincérité et gentillesse loin de la morgue de ceux qu’une domestique indifférait. Or, elle avait de quoi comparer.
Chez ses patrons, elle observait les invités. Une peuplade d’esprits communs. Elle repérait les exceptions à leur ennui d’être là. Personne ne lui parut à la hauteur de celui qui l’avait accostée. Le charme naît de la singularité. Jean de Sterpigny fut choisi bien avant qu’il le sache. Elle prit son temps. Pour l’éprouver ? Sans doute. Par respect des convenances aussi. Le moment venu, elle accepta la demande en mariage. Ce fut une passion lumineuse et dévorante.
3
À Sterpigny, la comtesse Valensky sut se faire aimer.
À la satisfaction du curé, elle avait été baptisée en l’église Sainte-Catherine de Saint-Pétersbourg. Une catholique, cela ne pouvait mieux tomber. Elle avait fui le bolchevisme, l’incarnation de Satan. Sans demander l’avis de l’intéressée, il se saisirait de son histoire pour dénoncer en chaire de vérité les maléfices du communisme.
La comtesse demanda à rejoindre Le Cercle des fermières. Ces associations érigeaient les femmes de la terre en héroïnes de l’éducation des enfants, de l’alimentation saine, de l’hygiène au logis. Leur dévouement et leur sacrifice sauveraient le monde rural. De quoi ? Du diable rouge qui rôdait dans les villes. Il fallait conserver aux campagnes leurs vertus salvatrices en vivant au rythme de l’angélus. Ces courageuses s’embarrassaient peu de politique. On ne leur demandait d’ailleurs pas leur avis. Elles trouvaient dans leurs réunions la liberté de parole que leur ordinaire brimait. Elles s’y moquaient de la superbe des hommes avec une justesse d’autant plus redoutable qu’elle n’était pas méchante. La comtesse fut accueillie avec une surprise joyeuse. Elle se tut le temps d’être acceptée. Puis à la demande des paysannes, elle parla avec passion de « sa Russie ». La comtesse les invita au manoir. Dans l’exil, elle avait emporté un samovar. Pour la première fois, les Ardennaises dégustèrent du thé.
Elle persuada son époux de financer la construction d’une salle capable d’accueillir les fêtes de village. Ce ne fut pas sans mal. On devient rarement riche sans être pingre. L’ouvrage n’était pas donné. Il résista, sachant qu’il finirait par capituler.
La promesse d’un enfant les combla de joie.
Il y eut cette nuit déchirante.
Dans l’aube naissante, Jean de Sterpigny serrait encore son épouse dans ses bras. Le docteur dut partir précipitamment. Sa femme avait téléphoné au manoir pour le rappeler. Une urgence l’attendait. La voisine n’osait entrer. À travers la porte, elle avait supplié le chevalier de venir, ne fût-ce qu’une minute, auprès du bébé qui s’était endormi. Il avait refusé et, d’une voix atone, avait ajouté : « Je déteste cet enfant. Il a tué ma femme. »
Le bonheur absolu existe-t-il ? Un bonheur que rien ne viendrait contrarier, pas même les aléas vulgaires du quotidien. Un bonheur linéaire, pur, cristallin comme un torrent de montagne épargné par les souillures de l’homme. Jean eut le sentiment d’avoir vécu ce bonheur nourri d’une passion transcendante, pendant deux ans. Une parenthèse ardente qui avait effacé les chagrins du passé, mais qui ne le protégea pas des tourments à venir.
La mort de Barbara fut un écroulement. Elle enténébra le cœur du chevalier, ombra son esprit, fissura son âme.
Première partie
Héloïse
1
Jean de Sterpigny s’arma de froideur.
Il éconduisit le curé venu lui rendre visite quelques jours après l’enterrement. L’abbé s’était emberlificoté dans ses propos vantant la valeur rédemptrice de la souffrance. Il essuya un ricanement qui n’avait rien d’aristocratique. Cela servit de leçon. La meilleure manière de pratiquer la compassion, c’est de ne pas s’y risquer. Se taire. Le chevalier ne supportait rien d’autre que le silence. Lui-même s’y terrait. Il n’en sortait qu’à des fins utilitaires. Il se réfugia dans l’écume des jours. Les affaires, sans combler le vide, en dissimulaient par moments la profondeur.
Le village de Sterpigny, quelques dizaines de foyers plantés pour la plupart le long d’une grand-route en pente presque rectiligne, s’émut du sort d’Héloïse. Il décida, sans qu’il fût besoin de longs conciliabules, de la protéger. Moquer sa fragilité ne serait pas toléré. Chacun garda pour soi le jugement qu’il portait sur l’attitude de l’aristocrate. La petite communauté s’épargna de la sorte le venin des divisions et des ragots. Ils étaient quelques-uns, presque tous à y regarder de plus près, à être les obligés de ce dernier.
Sans instructions de la part du père, la voisine, Madame Lescrenier, décida d’emmener le bébé. Son apparence rugueuse, façonnée par les ingratitudes du labeur, dissimulait une âme généreuse, imperméable aux passions tristes. Elle et son mari habitaient une ferme dépendant du manoir. Le père de l’enfant s’accommodant de la situation proposa à ses locataires de s’occuper du nourrisson. Il les exempterait du fermage, paierait une pension confortable, couvrirait tous les frais.
Les Lescrenier acceptèrent le marché. Madame Lescrenier sut qu’il y allait de la santé d’Héloïse. Le rejet auquel elle avait assisté l’avait effrayée. Son mari ne protesta pas. La contribution financière n’était pas à dédaigner. Il calcula qu’il allait enfin pouvoir économiser. Même s’il s’en voulut furtivement de penser ainsi, le surcroît de travail serait de toute façon pour sa femme.
Le couple avait une fille âgée de deux ans. Héloïse devint sa sœur de lait.
Madame Lescrenier s’inquiéta de la malformation impressionnante du pied de l’enfant. Elle fit appel à un rebouteux qui vivait dans une roulotte en marge du village. Son savoir-faire, acquis auprès des soldats que le front rendait brisés, était connu loin à la ronde. Il le réservait à ces derniers, aux paysans noués par le travail des champs, aux bûcherons usés par leur cognée. Il se rémunérait chichement, sollicitant davantage le portefeuille des nantis qui le consultaient avec un peu de gêne. Il ne jugea pas l’indifférence du père pour le handicap de sa fille. Il en avait vu d’autres. S’intéresser à ce bébé fut un choix du cœur. Il économisa ses mots. « Le pied est tourné vers l’intérieur, le talon soulevé. Dès qu’elle voudra marcher, je la conduirai chez un cordonnier à Renval, un type doué. On fabriquera une chaussure sur mesure selon mes indications. La marche sera plus facile. Je masserai le pied, je tenterai de le redresser. Si j’y parviens, ce sera loin d’être parfait, voilà… » Le rebouteux fit ce qu’il put. Héloïse ne l’oublia pas. Grâce à elle, vieillard délaissé par ceux à qui il n’était plus utile, la misère ne l’accabla pas.
La difformité n’occasionnait pas de douleurs à l’enfant qui ne manqua pas d’agilité. La souffrance naîtrait un jour du regard des autres.
2
Madame Lescrenier comprenait le désarroi du veuf, mais moins qu’il ne le surmontât pas. Chaque famille avait son lot de souffrances aggravé encore par un conflit les laissant endeuillées et meurtries. Une fatalité que les foyers modestes, les plus nombreux, affrontaient avec au ventre le souci de l’immédiat. La mélancolie était un loisir de riches. Elle n’excusait pas l’abandon d’un enfant.
Si Jean de Sterpigny la croisait seule dans le village, il la saluait avec courtoisie, sans demander comment se portaient les siens, certain qu’ainsi le sort du bébé ne serait pas évoqué. S’il la rencontrait poussant un landau, il lui jetait un regard de dégoût comme si elle promenait un rat pelé.
Il payait avec une ponctualité sourcilleuse au-delà de la pension convenue, en glissant une enveloppe sous la porte. Au crépuscule. Une générosité honteuse qui semblait emmurer la conscience du chevalier.
La nuit du premier anniversaire de la mort de la comtesse Valensky, les villageois crurent que le manoir brûlait. Derrière chaque fenêtre, des cierges se consumaient offrant des langues de feu tordues par un souffle obscur.
Les paroissiennes de l’aube commentèrent cet étrange cérémonial à la sortie de la première messe du lendemain. Un cercle de propos atterrés où l’on s’inquiétait de la santé mentale de « Monsieur » en guettant la réaction de Madame Lescrenier qui lâcha : « Quelle comédie ! » Les dévotes suffoquèrent en groupe comme si elles venaient d’assister à un sacrilège.
À dix heures du matin, la fermière, la traite terminée, se présenta à la porte du château, Héloïse dans les bras.
Jean lui ouvrit, l’œil parsemé de stries rougeâtres, le teint blafard sous la barbe naissante. Une chemise sans col sortait d’un gilet dégrafé parsemé de fils de cire, avatars de bougies capricieuses. Il l’apostropha d’un ton aigre :
— Vous tombez mal, que voulez-vous ?
Il n’avait pas prêté attention au contenu du fardeau.
— Bonjour, monsieur, avec ce que je porte, il n’y a pas de bons moments pour tomber chez vous ! Pardonnez-moi d’être directe. Je suis venue vous rendre Héloïse.
— Quoi ? Mais que vous prend-il, Madame Lescrenier ? Entrez.
Il la précéda dans un petit salon qui n’était pas chauffé, resta debout, dodelinant de la tête, incrédule.
— Un an, monsieur, sans nouvelles ! Mais cette petite n’est coupable de rien et vous l’abandonnez, en sauvant les apparences, c’est tout. Je ne le supporte plus. Alors, allez au bout, abandonnez-la vraiment, déposez-la dans un orphelinat, chez les bonnes sœurs. Et bon Dieu, que cela se sache !
Le chevalier s’assit, abasourdi :
— Vous ne parlez pas sérieusement. Je vous paye. Elle est bien chez vous.
Le soir même, se remémorant la scène, elle s’étonnerait de la détermination glaciale qu’elle avait affichée devant cet homme habitué aux révérences.
— Je parle le plus sérieusement du monde. Vous la voyez, Héloïse, là, dans mes bras, regardez-la.
Elle dégagea le capuchon.
— Si elle avait les yeux ouverts, vous y verriez le reflet de ceux de la comtesse. Elle aura le regard de sa maman. Où qu’elle aille, elle aura son regard !
Qu’aurait-elle pu dire de plus ? Elle attendit, priant que de ces mots râpeux surgisse une étincelle.
— Gardez-la, gardez-la. Je ne veux pas qu’il lui arrive du mal… Je… je…
Ses mains tremblaient. Il les posa l’une sur l’autre, puis d’une voix proche du silence :
— Je prendrai de ses nouvelles, je la verrai, je la verrai.
Avait-il pris peur ou l’indifférence s’était-elle lézardée devant la frimousse candide de la petite endormie ? La fermière ne s’embarrassa pas de ces questions. Elle s’exprima avec délicatesse :
— Je propose de vous présenter Héloïse chaque semaine. Ce sera plus convenable que de vous obliger à venir jusqu’à la ferme.
Il acquiesça de la tête. Elle poursuivit :
— Je lui parlerai de son papa. Vous verrez, elle vous aimera.
À ce dernier mot, il tressaillit.
Il les reçut d’abord distant, gauche, maladroit. Il s’adressait à Madame Lescrenier en évoquant les aléas que le temps et la nature leur réservaient, un ramassis de banalités. Un jour, la petite lui saisit un doigt fixant ce jouet de ses yeux concentrés. Il n’osa le retirer.
Sous un ciel de printemps nettoyé par un gel tardif, apercevant de sa fenêtre le landau secoué par les pavés de la cour, il sortit au-devant des promeneuses. Héloïse sourit à ce visage penché sur elle.
Au fil d’une routine qui s’enracinait dans ses semaines, Jean se mit à commenter les métamorphoses de l’enfant, enchaînant des considérations sans originalité, n’était qu’elles venaient de lui. Héloïse, il prononça son prénom de plus en plus souvent.
Elle venait d’avoir trois ans lorsque, bras ouverts, elle se précipita vers son père en sautillant comme un faon au sabot blessé. Il l’accueillit d’instinct. Il sentit les boucles blondes dans son cou. Un éclair d’orage à fendre un rocher. Jean serra sa petite fille contre lui, longtemps, sans un mot.
Elle fréquenta l’école du village. Le maître assurait les leçons d’une trentaine de filles et garçons répartis en six années. L’épaisse chaussure d’Héloïse suscita des regards curieux. Au cours d’une promenade de la classe le long de la Manouée, un ruisseau peu profond qui coulait à travers champs, elle se déchaussa. Sous des yeux écarquillés, elle mit les pieds dans l’eau. L’instituteur, avec bon sens, la laissa faire. Elle expliqua qu’elle était née « comme ça ». Ce fut tout. Les autres enfants l’imitèrent. Sous les remous transparents, les pieds nus heurtaient les galets. Chacun prenait soin des siens sans s’occuper de ceux du voisin. Héloïse était comme les autres, seule à contempler ses orteils crispés par le courant.
Une insouciance tissée de joies l’abrita des blessures qui parfois étrillent l’enfance. Son père devint une récompense. Il l’emmenait promener, lui enseignait les arbres, lui passait ses jumelles. « Regarde, chut, on a de la chance, le vent vient vers nous. Là-bas, dans la prairie, en bordure des sapins. » Des chevreuils broutaient en lisière de forêt. Instants oniriques, refuges aimés d’Héloïse lorsque le chagrin la happerait.
Héloïse n’aurait pas vu d’inconvénient à patienter sur les bancs de l’école jusqu’à ses quatorze ans accomplis. C’était le choix, parfois contraint, de la plupart de ses condisciples. Leur obligation scolaire remplie, ils se consacreraient aux travaux de la ferme ou s’engageraient comme manœuvres dans l’une ou l’autre entreprise. Elle était trop douée pour cela, et ne l’eût-elle pas été, son milieu n’aurait pas toléré un surplace sans perspective. Son père voulait l’excellence. Il fit le choix d’une école de la capitale, refuge des enfants de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie. Héloïse s’y résigna. À la fin des vacances, elle prit le train à Gouvy pour Bruxelles. Madame Lescrenier l’accompagna jusqu’à Liège. Sur le quai de la correspondance, l’au revoir tendu par les larmes se prolongea jusqu’à la dernière minute. Madame Lescrenier ne logerait plus cette enfant fragile lui témoignant, plus que sa propre fille, une affection profonde.
L’adolescente rentrerait au manoir tous les trimestres. Elle n’y avait, dans l’enfance, passé que de courtes vacances. Son père avait jugé préférable, non sans bon sens, qu’elle habitât chez ses fermiers le temps de l’école primaire.
Au lycée Notre-Dame de l’Espérance, ce fut le début d’une autre vie.
Une chambre spartiate, une vasque à remplir tous les jours à l’aide d’une cruche à défaut d’eau courante, des couloirs sans fin, des classes en enfilade, des cours de récréation cernées de chênes eux-mêmes contenus par de hauts murs, un lieu décrit comme unique, tout entier dédié au savoir, à l’éducation d’une élite en devenir. Elle y apprendrait, sous la conduite d’une escouade de religieuses, les valeurs à défendre, les bonnes manières à perpétuer.
Héloïse y vécut en recluse. Les champs lui manquaient. De la fenêtre ouverte de sa chambre, en tendant le bras, elle pouvait presque toucher un mur d’enclos qui lui fermait l’horizon.
Elle ne se plaignait pas lorsque son père lui demandait si elle se plaisait. Il lui rendait visite un dimanche sur trois. Lorsqu’il était à Bruxelles pour ses affaires, la direction du lycée l’autorisait à rencontrer sa fille bien que ce fût en semaine. Une exception au règlement. Les œuvres de la congrégation fondatrice de l’établissement y trouvèrent leur compte. Jean ouvrait son portefeuille à bon escient.
Au début, l’effervescence dominicale de Bruxelles l’effraya. Puis elle apprécia d’arpenter la Grand-Place dans le tohu-bohu des marchands ambulants, de découvrir les trams aux cloches sans cesse résonnantes, les fontaines, la fontaine Anspach avait sa préférence, les crieurs de journaux, les piétons agglutinés sur les trottoirs, les cinémas, les voitures qu’elle imaginait embouteiller le village de Sterpigny. Il n’y eut pas que des éblouissements. La place de la Chapelle, d’autres lieux que son père tint à lui montrer, « tu vas voir, Héloïse, tout n’est pas grandiose chez les citadins », révélaient un peuple démuni, délaissé, agglutiné le long de ruelles étroites aux pavés disjoints. Une misère cantonnée, concentrée, qui choqua la campagnarde. À l’école primaire de son village que la pauvreté n’épargnait pas, les enfants se mélangeaient sans se soucier de leurs origines.
Elle étonna son père par sa connaissance des peintres flamands lorsqu’ils visitèrent les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
— Mais quand as-tu appris tout ça ?
— Les dimanches sont gris lorsque je ne vous vois pas, alors je pille la bibliothèque. J’aime beaucoup Brueghel.
Jean terminait ces moments de tendre complicité en emmenant sa fille pour un goûter à l’hôtel Métropole. La première fois, elle remarqua le regard perdu de son père.
— Ça va, papa ? On dirait que vous n’êtes pas bien.
— Ta maman, j’ai dîné avec elle ici, un premier soir sublime.
Il avait placé une main devant sa bouche comme pour éviter que ne débordât une nostalgie triste. Elle l’embrassa sur la joue. Il lui confia :
— Comme ta maman t’a aimée, attendue.
3
Boitillon !
« On va devoir se coltiner Boitillon ! »
Elles étaient quelques-unes au bout du couloir des chambrées, submergées par l’excitation. Une sortie dans les rues de Bruxelles, en rangs disciplinés, pour gagner la salle de spectacle du collège Saint-Quirin, le pendant pour garçons de leur pensionnat huppé. Une séance de cinéma mixte. Le père supérieur avait pu convaincre l’autre supérieure, la mère, de tenter l’expérience d’un projet commun aux deux établissements. Une manière aussi de rentabiliser la location du film de Marcel Pagnol La Femme du boulanger. Audacieux, innovant, mais encadré.
Boitillon !
Au moment de sortir de sa chambre, porte entrouverte, elle avait surpris la conversation de ses camarades d’étage. Elle ne savait pas qu’on la surnommait ainsi. Parfois, le silence de quelques groupes, lorsqu’elle s’en approchait dans la cour de récréation, suivi de sourires niais, l’avait interpellée. Pas de moqueries apparentes. La jeune religieuse chargée de la surveillance, généreuse, attentive aux plus faibles, ne l’aurait pas toléré.
Le pas claudicant d’Héloïse fit taire les médisantes.
« Ah, te voilà. On t’attendait. D’ailleurs, la cloche sonne. On doit y aller. On va bien s’amuser. Ça va être formidable ! »
Héloïse ne put dire laquelle l’avait ainsi accueillie avec une contenance baveuse.
Dès ce jour, elle sut que sa chaussure démesurée, attelée sous le genou, serait un repoussoir.
Elle tut sa blessure et décida de ne pas se faire remarquer. On la distinguait assez comme cela. Cette enfant douée devint une élève moyenne. Elle se fondit dans la masse de celles qu’épargne l’excès de talent ou de médiocrité. Elle ne s’apitoya pas sur son sort. L’eût-elle voulu que les circonstances l’en eussent dissuadée. En juillet 1939, la parenthèse bruxelloise se referma. Rentrée à Sterpigny définitivement, après avoir beaucoup insisté, elle persuada son père de l’intégrer à la vie de ses affaires. Il n’était pas d’usage qu’une jeune aristocrate travaillât. Quelques mois plus tard, la guerre ravagea le pays. Les Sterpigny choisirent de ne pas « évacuer » selon l’expression consacrée. Il ne pouvait être question de se réfugier en France en délaissant le manoir, les bois, les terres, sans parler d’autres biens et sociétés dont Héloïse découvrit l’ampleur avec étonnement. Ils rusèrent pour céder le moins possible aux réquisitions de l’ennemi ; le maquis profita d’un ravitaillement régulier. L’Ardenne vécut la Libération dans la liesse. Un répit de courte durée, brisé par l’offensive Von Rundstedt. 16 décembre 1944. L’assaut désespéré des nazis fut un mois de sauvageries, dans un décor sibérien. Des villages éventrés, des cadavres partout, derniers vomissements d’un monstre à l’agonie.
À la mi-janvier, la salle d’apparat du manoir servit d’infirmerie tandis que les Américains reprenaient aux Allemands le village maison par maison.
Les blessés s’y entassaient, gémissants, hurlants, moribonds. Quelques infirmiers manquant de tout se livraient à un tri impitoyable. Sauver ceux qui avaient le plus de chance d’en sortir, abréger la souffrance des autres. Même cela vint un moment où on ne le pouvait plus.
Héloïse vida les armoires de tout le linge de maison, découpé, déchiré à la hâte pour panser, garrotter. Elle prit la main d’agonisants, effleurant les cheveux de jeunes gens de son âge qui ne reverraient plus les grands espaces de leur enfance ou les quartiers noirs flanquant les grandes métropoles de leur pays.
Parfois, son père la grondait : « Tu en fais trop, vas te reposer ! Je ne te le demande pas, je te l’ordonne ! » Elle répondait : « Oui, papa, dans deux minutes » et se félicitait de ce qu’une horloge ne soit pas accrochée aux murs du dispensaire de fortune.
Il y eut le silence épais des combats finissants. De jeunes SS épouvantés, qui s’étaient réfugiés dans les écuries du château, heureusement épargnées, accueillirent leur arrestation comme une délivrance. Jean de Sterpigny éloigna de la cour quelques cochons qui reniflaient les gisants face contre terre ou les yeux figés vers le ciel. Les blessés quittèrent le château. Ceux qui le pouvaient saluèrent Héloïse. Un geste de la main, une caresse du bout des doigts. Elle regarda partir les grabataires, mutilés, défigurés.
« Qui pourra aimer ces corps meurtris ? » À cette réflexion, Héloïse trembla d’effroi. Elle pensa presque en même temps : « Et moi, qui va m’aimer ? »
4
Non sans dérision, Jean de Sterpigny se définissait comme un hobereau rivé à ses terres. Au bas de la hiérarchie nobiliaire, portant le titre de chevalier, il avait sur nombre de ses pairs, barons, comtes ou vicomtes, un avantage qui comptait dans ce milieu pratiquant les comparaisons avec une discrétion féroce. Sa famille avait reçu ses lettres d’anoblissement le 17 septembre 1679 de Charles II, roi d’Espagne, en reconnaissance d’un passé militaire glorieux. L’ancienneté du blason. Elle forçait à la modestie les élus de fraîche date, anoblis par les rois des Belges après 1830 au détour de quelques mérites souvent avérés, parfois contestables. Encore cette réserve s’affichait-elle uniquement en présence de l’intéressé. Hors celle-ci, les saillies moqueuses ne manquaient pas. Les mains épaisses et calleuses du nobliau, celles d’un paysan, le disqualifiaient auprès des délicats qui affichaient leur raffinement. Pas dupe, il se vengeait à sa manière en écrasant avec vigueur et gourmandise les phalanges des élégants contraints de le saluer.
Jean, le hobereau, proche de ses métayers, de ses bûcherons, au point de ne pas dédaigner les accompagner dans leurs tâches.
Son manoir se situait en contrebas du village. Un quadrilatère imposant fait de moellons enduits et blanchis à la chaux, qui s’ouvrait sur une vaste cour intérieure. Son ancêtre Gaëtan de Sterpigny l’avait, en 1606, doté d’une tour d’angle permettant de surveiller les chemins qui se croisaient à proximité, et presque à l’abri des regards, d’une échauguette à l’usage prosaïque. Elle abritait des latrines.
En compagnie de sa fille, Jean menait une vie dans laquelle la simplicité s’imposait d’elle-même. Les forêts avoisinantes fermant l’horizon, heurtées par des prairies et des pâturages silencieux, n’était à la belle saison le beuglement des troupeaux, éloignaient les tentations. Des chemins caillouteux, quelques routes pavées, tortueuses, dangereuses lors d’hivers inhospitaliers n’incitaient pas davantage à la témérité.
Les campagnards se contentaient de cet isolement. On mariait la fille ou le prétendant d’un village voisin, rencontré lors des bals de « kermesses » dont le calendrier couvrait l’année à l’exception des mois d’hiver. Les plus hardis ramenaient une demoiselle de la ville, une attraction qui se démodait le temps pour elle de s’acclimater, d’affronter la jalousie des natives de l’endroit en mal de soupirants. La hantise de terminer vieille fille rôdait. Le célibat subi, à moins d’être veuve, se vivait comme une expiation de tares affectant le physique ou le caractère. Il convenait de se marier jeune, de faire des enfants dans la vigueur des années fertiles. Pauvres femmes que l’amour dédaignait, elles traversaient l’existence, le dos accablé de propos compatissants, ironiques ou méchants. Le mal n’épargnait ni les dames de la noblesse ni les bourgeoises auxquelles leur milieu réservait des commentaires d’une cruauté ciselée.
Héloïse fut le témoin de mariage de Nadia Lescrenier, sa « sœur », son aînée de deux ans dont elle partageait les confidences. « La Lescrenier », comme on la désignait loin alentour, réputée pour sa beauté, n’avait succombé à aucune des avances des paysans du coin. Elle avait choisi un Liégeois, fonctionnaire des postes, un emploi stable, en costume, qui officierait au guichet de Gouvy. L’union se déroula au mois d’août 1944 dans l’euphorie de la première libération du pays. La mariée, il s’en fallut de peu, ne coifferait pas sainte Catherine selon l’expression consacrée, encore que personne n’eût de doute sur ses chances de convoler. La guerre pouvait excuser quelques retards.
Au sortir des noces, le chevalier présent au banquet, un honneur pour les époux, profita du trajet les ramenant à Sterpigny pour bavarder avec sa fille. Il paraissait se concentrer sur la conduite de la voiture comme s’il s’agissait d’une conversation anodine.
— Un beau mariage, simple comme tous ces gens. C’était bien. C’est important, le mariage.
Une interrogation plus qu’une affirmation. Une subtilité qui ne pouvait échapper à Héloïse.
— Et moi, papa, à quand le mariage, c’est ça ?
Jean masqua son embarras.
— Mais non, la guerre a tout retardé, maintenant tu dois en profiter, rencontrer du monde, prendre la voiture pour aller un peu plus loin que nos sapins.
— Tu as vu aujourd’hui, on ne peut pas dire que j’attire les regards.
Il s’offusqua.
— Enfin, Héloïse, c’est, comment dire, normal. Tu n’es pas du monde de ces garçons, ils le savent. Je te le répète, tu dois sortir ailleurs. Écoute, il faut que tu m’accompagnes plus souvent à Bruxelles. Moi-même, je dois faire un effort.
— Un effort, comment ça ?
— Sortir de ma solitude, j’ai l’impression qu’elle rejaillit sur toi. Elle me convient assez, mais elle n’est pas faite pour toi.
Jean la présenta lors de quelques dîners ou vernissages bruxellois avec parfois une insistance qui la gênait. Les campagnards partis, l’aristocratie virevoltante ne se privait pas de sarcasmes. Sterpigny ? Une petite noblesse sentant la bouse qui promenait sa fille, une jument fourbue.
Le célibat d’Héloïse inquiétait son père. Il finit par le tourmenter. Une future vieille fille desséchée ? L’absence de descendance ? Insupportable. Il connaissait l’obstacle, ce pied, un sujet tabou. Il ne pouvait croire qu’il fût insurmontable. À part ce handicap, elle possédait tout. Posséder, le mot qui convenait.
Les châteaux peuvent être des cache-misères et la guerre avait écorné quelques patrimoines. Pas celui des Sterpigny. De quoi intéresser de jeunes aristocrates désargentés.
Il se résolut à préparer l’appât.
5
Les derniers combats de l’hiver 1944-1945 avaient endommagé ou détruit les demeures et dépendances de quelques châtelains de la Haute Ardenne. Vivre, fût-ce de manière épisodique, au milieu de ruines, dans ce pays désolé, les rebutait. Ils attendraient de percevoir « les dommages de guerre », pour entamer des travaux d’envergure, se limitant à quelques réparations de fortune. L’impraticabilité de la chasse à courre justifiant ces résidences secondaires les désolait. Comme pour toute passion inassouvie, ils en souffraient à l’excès. La guerre avait démantelé les équipages. Les écuries, déchirées par les obus, étaient inutilisables ou servaient d’entrepôt rassemblant ce que l’on avait pu sauver des décombres.