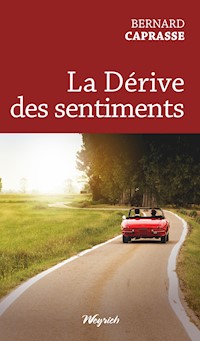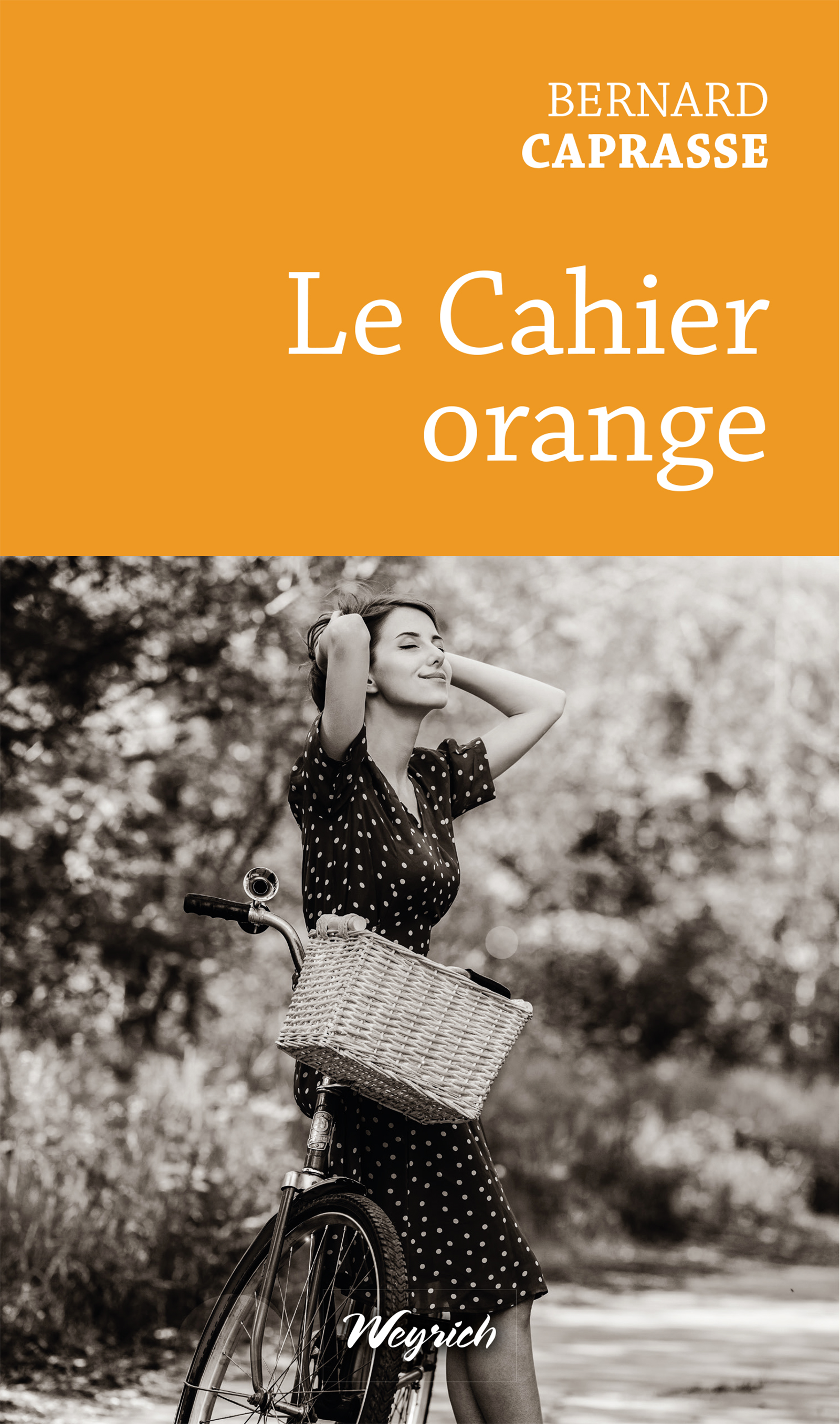Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un testament peut parfois se transformer en une vraie bombe à fragmentation. Celui du comte d’Autremont va bouleverser la vie de plusieurs personnes de par le monde. Celle d’un grand avocat new-yorkais comme celle d’une ancienne déportée au goulag sibérien, d’un artiste russe banni ou d’une brillante juriste bruxelloise…
Ce roman puissant nous emmène dans un passionnant voyage dans l’espace et dans le temps, sur la trace de certains des personnages déjà rencontrés dans "Le Cahier orange".
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ancien avocat, successivement aux barreaux de Bruxelles et de Marche-en-Famenne,
Bernard Caprasse a été Gouverneur de la Province de Luxembourg. Il vit à Bruxelles et se consacre à l’écriture. Après "Le Cahier orange" et "La Dérive des sentiments", il signe ici son troisième roman dans la collection « Plumes du Coq ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
À propos de ce que découvrit Anton Scarzini en 1990 et de ce qui s’ensuivit
Dans Le Cahier orange, j’ai raconté comment Anton Scarzini, célèbre avocat de New York, avait percé le secret de ses origines après le décès accidentel de sa mère Claudia Stanton et de son mari Carlo Scarzini.
J’ai décrit les vengeances auxquelles cette découverte le conduisit.
J’ai relaté pourquoi il fit le choix de ne rien dire de ce qu’il apprit et comment il se réfugia dans ce silence de manière obsessionnelle, au prix d’une aigre solitude.
Dans sa quête de vérité, il rencontra parmi d’autres un personnage singulier et flamboyant, le comte Aymeric d’Autremont. Celui-ci fut l’influent et anonyme complice de la renaissance de sa mère.
Voici qu’en 1993, l’aristocrate resurgit de manière inattendue dans l’existence d’Anton. Le passé se conjuguera donc pour partie au présent.
Cependant, pour comprendre les événements que je vais vous rapporter, il n’est pas nécessaire d’avoir lu Le Cahier orange. Les premières pages du récit suffiront à saisir l’essentiel des faits anciens. Pour ceux qui l’ont lu, des souvenirs émergeront sans doute. Pour ma part, à l’instant, je pense à Olga, l’héroïne que j’ai tant aimée…
En revanche, pour éclairer le début de cette histoire, je crois utile de tracer une très sommaire généalogie de la famille d’Autremont. Elle se présente comme suit au moment où tout commence.
Vous le constatez, les trois frères de la première branche sont décédés. Restent les neveux et la nièce d’Aymeric qui le sont aussi de Jean.
Étrange famille d’Autremont dont les vivants et les morts vont peser sur le destin d’Anton Scarzini. Un parcours déroutant attend l’avocat.
Et, une fois de plus, Anton va éprouver cette évidence immuable : ce sont les rencontres bonnes ou fâcheuses, heureuses ou tragiques, qui façonnent notre vie.
Avant que les eaux ne se mêlent
1
Tcherkassy en Ukraine, le 17 février 1944
La Gniloï-Tikitch, rivière de sang, charriait dans ses eaux tumultueuses les corps tordus de soldats heurtés par des blocs de glace. Quelques chevaux apeurés tentaient de gravir les bords abrupts des rives, d’autres, éventrés, glissaient dans le courant. Le vacarme était épouvantable. Des milliers d’hommes exténués, ombres hallucinées titubant dans la neige boueuse, sous un ciel bas, se pressaient le long de la berge. Un dernier obstacle avant la délivrance. Quelques mètres de flots épais parmi les marécages. Infranchissables pour beaucoup. Aucun pont ! Les grabataires seraient abandonnés à l’ennemi. Sans illusions, certains se suicidaient, d’autres n’en avaient plus la force. Ceux qui pouvaient marcher s’en sortiraient pourvu que les épargnent les obus de l’Armée rouge ou le torrent glacé.
L’abbé Augustin Servais s’était détourné du regard suppliant de ceux qu’on laissait. Sauver sa peau, comme tous les autres. Sur leurs paillasses, perdus parmi leurs camarades allemands, quelques légionnaires wallons, eux pour qui il était venu jusqu’ici, l’avaient reconnu, appelé. Il s’était éloigné, la peur au ventre. L’instinct de survie, en son ressort ultime, est égoïste. L’aumônier de la Légion lui céda avec effroi. Il paierait cet abandon, de remords, de cauchemars, et plongerait dans une mélancolie purulente. Juché sur un cheval de trait, il avait entrepris la traversée agrippé à la crinière. Parvenu devant l’autre rive, un Allemand lui permit de prendre pied tandis que la bête trop lourde se noyait en de vains efforts. Le soldat d’un geste lui montra la route et, sans plus se soucier de lui, secourut encore quelques malheureux agrippés à de maigres arbustes. L’abbé ne revit pas son sauveur, tenta de l‘oublier. En vain. La nuit, cet homme au visage serein lui tendait un miroir qu’il n’osait affronter.
Augustin Servais aurait pu se pardonner. Le poids de la chasuble l’en empêcha. Au dernier moment, l’héroïsme lui avait manqué. Il fut un homme ordinaire parmi des milliers d’autres poussés comme lui dans la fange, affamés, fatigués. Ils cherchaient tous à fuir le chaudron de Tcherkassy. Au long de ces jours et de ces nuits d’enfer, l’aumônier de la Légion Wallonie s’était astreint à son devoir. Il courait de l’un à l’autre, mangeait moins qu’eux, s’abritait le dernier sous la mitraille, se taisait lorsque sous un sol spongieux il piétinait les cadavres que le gel ne protégeait plus. Sept jours de combats dans une retraite dantesque pour échapper à l’encerclement de l’adversaire, parmi les véhicules calcinés, les charrettes tirées par des chevaux épuisés, les mutilés hurlant de douleur et la mort partout, compagne vorace au côté de soldats qu’entre Komarovka et la rivière elle dévora sans relâche. Il survécut dans cet étroit corridor de douze kilomètres, insecte misérable d’une colonie massacrée sous les coups de bottes sans pitié des Russes. Au dernier moment, l’héroïsme lui avait manqué et le cri des abandonnés ne cessa de le poursuivre. Il s’était engagé non par conviction nazie, il abhorrait Hitler, ni même par anticommunisme ; il n’aimait ni ne croyait Degrelle. Ce fut le choix de son sacerdoce. Aller là où, disait-il, « des âmes en souffrance avaient besoin d’un prêtre ». Jean d’Autremont, de quinze ans son cadet, son élève le plus brillant au collège Saint-Quirin de Bruxelles, aristocrate élégant, l’avait supplié de rejoindre les Wallons. Une supplique qui lui parut un appel. Son confesseur l’encouragea. « Qu’y avait-il de plus noble que l’esprit de sacrifice ? » Sa hiérarchie laissa faire.
À Burki, lieu de regroupement après la bataille, la Légion ne comptait plus que six cents hommes. Plus de mille morts ou disparus, vaillante arrière-garde sans cesse au contact de l’ennemi. Augustin maudit Degrelle et se retint de le dire. Ses camarades aveuglés vouaient au chef qui s’était battu avec eux, courageux et téméraire, un culte intact.
Il chercha Jean d’Autremont dont il avait perdu la trace au cœur de l’horreur. Le commandement n’avait aucune nouvelle de lui et le considérait comme disparu. Il se cacha pour pleurer et se souvint de leur conversation à Korsoun.
Le jeune sous-lieutenant de vingt-cinq ans, radieux à l’orée du pire, s’était confié :
— Monsieur l’Abbé, s’il devait m’arriver malheur, il faudra tout raconter à Aymeric mon frère aîné, absolument tout. Ça risque d’être compliqué. Il doit haïr mon engagement. On n’est pas dans le même camp, vous le savez bien. Lui, c’est le résistant, sûrement un grand résistant. C’est d’abord mon grand frère. Je veux qu’il sache, qu’il sache tout. J’aurai été heureux, il comprendra, enfin je l’espère… Et dites-lui bien que je l’aime.
— Enfin, Jean, il ne t’arrivera rien. Tu es né sous une bonne étoile, le prêtre enfilait les propos rassurants, bien sûr je te promets…
Ils avaient haussé les épaules en riant.
Une promesse à tenir désormais.
Pendant des jours, Augustin serait pris de dégoût et de vertiges devant le fanatisme imbécile des thuriféraires nazis. Une débâcle totale maquillée en victoire. De leurs bureaux berlinois, ils vantaient l’exploit de l’encerclement brisé, la honte de l’Armée rouge, et taisaient qu’à Tcherkassy, en Ukraine, dans ce bout de plaine désolée, par la folie d’un tyran, plus de vingt mille hommes furent sacrifiés.
2
New York, 15 octobre 1993
Le front contre la vitre, Anton Scarzini méditait, indifférent au scintillement infini de la ville perçant la nuit.
La requête singulière formulée à son endroit dans le testament du comte Aymeric d’Autremont ne préoccupait pas l’avocat.
Il avait chargé John Faireman de l’affaire, un homme talentueux, son ami et confident. Elle pourrait être longue à résoudre, leur réserverait, comme tant d’autres dans le cabinet, ses surprises, ses déceptions peut-être. C’était en somme un dossier ordinaire, enfin pas tout à fait.
L’aristocrate ne l’avait pas choisi par hasard. Pourtant, rien dans le document notarial n’évoquait ses raisons, pas la moindre allusion au passé qui les liait. Il y avait donc des mots sous les mots, un message se devinait qu’eux seuls pourraient comprendre, inaltérable et puissant.
Il y avait autre chose. Un nom lui vrillait l’âme.
Le défunt avait désigné Diane Capon comme gardienne et exécutrice de ses dernières volontés. Elle avait travaillé dans le bureau bruxellois du cabinet Scarzini, avant de créer le sien. Il était peut-être au courant. En revanche, il ne pouvait pas connaître l’essentiel.
Anton aimait Diane.
Prisonnier du secret de ses origines, il avait choisi de ne jamais le lui exprimer, malgré son intuition d’un sentiment réciproque. Fils de Boche, seul, enfin presque seul, à le savoir. Un aveu impossible sauf à ternir l’image de sa mère et ombrer de scandale une famille, la sienne, riche et réputée. Ne rien lui dire revenait à lui mentir. Une omission malsaine à laquelle il ne pouvait se résoudre pas plus qu’à la vérité.
Une solitude comme une plaie béante.
Il la reverrait, c’était inéluctable. Un moment attendu et redouté.
3
Renval, en Ardenne, 15 juillet 1992
Aymeric d’Autremont se reposait sur la terrasse. De son ottomane, il contemplait le parc du château, guettait en ce début de crépuscule la harde qui lui était familière. Parfois, elle s’approchait de lui ; une biche, toujours la même, le regardait de ses yeux noirs, immobile. Elle semblait attendre le salut de la main déployée en un geste lent. Bien que ce fût l’été, il se gardait de la possible fraîcheur des débuts de nuit ardennaise, un plaid posé sur ses genoux, cadeau d’une vieille baronne anglaise dont il était sans nouvelles. La maladie l’isolait. Il n’avait pas dû faire d’effort pour éloigner les importuns. La déchéance n’attire pas.
Le comte se décharnait mais refusait l’hôpital. Il allait mourir de toute façon et tenait à ce que ce fût chez lui. Son cancer l’indifférait ; sa lucidité était entière. Il se persuadait que la faiblesse du corps avait affûté les forces de l’esprit. Tout était prévu lorsque celles-ci l’abandonneraient. L’échéance avait été évoquée avec son ami le docteur René Capon, sereins l’un et l’autre comme peuvent l’être ceux dont les épreuves ont balafré la vie.
Il fut heureux d’apercevoir la voiture du médecin s’avancer dans l’allée. Une visite impromptue, de quoi le réjouir en ce temps de solitude.
Après quelques digressions à propos de la situation politique, peu de responsables échappaient à leurs commentaires féroces, la conversation se peupla de souvenirs.
Le vieil homme ne se targuait pas de sa réussite, un empire bâti de par le monde.
— On se souviendra de moi pour ce que j’ai construit, pas pour ce que je suis. D’ailleurs qui suis-je ? À l’heure du bilan, il serait temps que je le sache. Qu’en penses-tu ?
— Tu me demandes comment je te considère ?
Aymeric acquiesça d’un signe de tête.
— Je pourrais t’abreuver de compliments. Je te décevrais même si tu mérites des éloges. Je vais te raconter une histoire. Elle m’a montré qui tu étais alors que je te connaissais à peine. Cette histoire nous a liés pour toujours. Tu te rappelles le mois d’octobre 1944 ?
* * *
Ce mois-là, René l’avait sollicité pour qu’il l’aide à organiser la disparition d’Olga Marren. Des maquisards s’étaient jetés sur elle, le 10 septembre 1944, jour de la libération de Renval. Une foule avide attendait la tonte de la « saucisse allemande », la putain du nazi. Les héros du jour, paons sous le soleil, turent ce qu’ils lui devaient et plus encore les raisons sordides de cette ignominie. Le toubib l’avait sauvée de cette cohorte d’imbéciles et l’avait recueillie chez lui. Lorsqu’elle apprit qu’elle était enceinte, Olga voulut quitter à jamais ce village ingrat. S’enfuir le plus loin possible. Aymeric se chargea de cet effacement.
À ce rappel, le regard de l’aristocrate se fit presque enfantin :
— Sur ce coup-là, on a été bon.
— Pas « on », toi, tu as été très fort, une sacrée générosité.
Le comte se contenta d’un signe pour relativiser le propos, laissa le passé émerger :
— Chez moi à Paris, elle rayonnait. Un charme convoité. Carlo Scarzini a succombé, il a mis le temps pour la convaincre. Elle aimait le Boche, a choisi l’Américain plus par raison que par passion, c’est la vérité. Un mariage de raison pour protéger l’enfant. Tu te rappelles comment on traitait ces pauvres gosses ? Fils de pute nazie, bâtard allemand, etc., quelle cruauté venue de gens ordinaires, paisibles, c’en était sidérant ! Un mariage de raison, je m’inquiétais de son choix, la raison, pas l’amour fou, tu vois ce que je veux dire, et pourtant quel mariage, indestructible.
Olga devint Claudia Stanton, la généreuse, la bienfaitrice des artistes, une galeriste renommée de New York. Ils la revoyaient ensemble, chaque année en secret. Elle parlait de son fils, l’enfant, l’adolescent, l’homme, relatait ses inquiétudes, sa fierté, son amour. Anton s’épanouissait sous leur regard lointain sans les connaître.
— Jusqu’au moment où il découvrit le secret de sa mère. Tout ça à cause du cahier que j’avais donné à Olga pour qu’elle y écrive je ne sais quoi, je ne l’ai pas lu, mais lui l’a trouvé.
Un soir, il s’est présenté à ma porte à l’improviste. Un choc ? Pas vraiment, c’est comme si je l’attendais depuis longtemps. Mais une révélation pour lui, pour moi. Quel bonhomme ! Et je te l’ai présenté…
Aymeric dodelina de la tête, se remémora la reconnaissance émue d’Anton à son égard, se redressa dans son fauteuil, l’œil vif :
— Et les événements qui ont bouleversé Renval ? Quelle affaire ! Derrière tout ça, c’était lui évidemment, on ne sait pas tout, mais on n’est dupe de rien.
— Je préfère ne pas tout savoir, la vengeance ne justifie pas les exactions, le terme est trop faible, je suis médecin, les sévices, je n’encaisse pas.
Le comte, après un temps de réflexion, relativisa d’un geste de la main :
— Je peux le comprendre, une bande de salauds qui expient, je ne les plains pas, Anton en assume les conséquences. C’est une raison de plus pour lui de garder le secret. Tu imagines un avocat accusé d’avoir commandité un enlèvement… et le reste ? Même son frère, Carlo junior, n’est au courant de rien, absolument rien !
Ils parlèrent encore de la réhabilitation d’Olga, lors d’une cérémonie en l’honneur de la résistante enfin reconnue.
— Ta fille Diane a été exceptionnelle lors de son éloge.
Le médecin, le sourire narquois, parcourait de l’index la cicatrice lui barrant le nez, un avatar de la guerre.
— Le comble, elle a travaillé quelques années pour le cabinet Scarzini à Bruxelles, sans savoir qui était vraiment Anton.
Aymeric se tint les yeux clos, somnolant sous la contemplation affectueuse de son complice. Il se réveilla en sursaut :
— Aide-moi à rentrer. Se souvenir d’Olga, pour moi, c’est entrouvrir la porte du paradis. Ce n’est pas mal pour un pédé promis à l’enfer…
Une lassitude mélancolique estompa ses derniers mots.
— Merci, très cher ami, d’avoir toujours été là.
4
Bruxelles, 15 septembre 1993
Patrick d’Autremont estimait que seule sa lignée était digne de son prestigieux patronyme.
Son père, Léopold, veuf éploré, survécut quelques années à son épouse. Ce terrien conservateur, souvent vêtu d’un pantalon de velours au fond renforcé et d’une veste de tweed aux coudes garnis de cuir, affectait une rigueur morale, le distinguant, pensait-il, de Jean et Aymeric, ses deux frères. Le premier, idéaliste échevelé, choisit de trahir son pays. Il n’était jamais revenu du front de l’Est. Léopold s’en trouva soulagé. Au moins le déshonneur d’une condamnation serait-elle épargnée à la famille. Aymeric ne se contenta pas de gérer en bon père de famille sa confortable part d’héritage. Il choisit de s’enrichir sans vains scrupules. Pour l’entourage, il y avait pire. Il courait les hommes avec succès, s’amusait de la réprobation effrayée de son milieu. Léopold s’en serait accommodé tant bien que mal s’il avait été discret. Il prêcha auprès de l’égaré les ressources de l’hypocrisie, paravent idéal des turpitudes, s’attira un ricanement, ne s’en remit pas. Il eut le bon goût d’attendre que ses trois enfants soient majeurs avant de mourir, une manière de leur épargner la tutelle de cet oncle dépravé. C’était à l’aube des années septante.
Patrick en effet avait une sœur, Juliette, la petite dernière, la préférée. Le père lui pardonnait ses penchants révolutionnaires, une lubie de jeunesse que la vraie vie se chargerait d’éreinter. Il se trompait. La jeune fille contestataire se mua en une « emmerdeuse gauchiste » selon l’expression de Benoît, le frère du milieu. Il la détestait et méprisait son frère aîné avec le même entrain. Il ne supportait pas davantage sa belle-sœur, Ermesinde, une quasi-demeurée, sèche, noueuse, à la trentaine à peine passée. Portant un nom désargenté, mais très ancien, elle avait trouvé auprès de son mari l’aisance financière qui lui manquait. Elle y prit goût au point de ne plus s’en satisfaire. Dépasser le confort d’une existence bourgeoise, accéder au luxe des vrais riches, rivaliser, pourquoi pas, avec l’oncle maudit, une ambitieuse sommeillait sous les eaux dormantes du quotidien. Elle sciait son mari sourd à ses rêves de grandeur. Habité par une prudence de rentier, ce dernier se contentait des revenus de leur domaine, une sagesse sans fatigue. Il façonnait de la sorte leur fils unique, terne rejeton arrivé sur le tard, qu’un collège huppé affûterait un peu.
Benoît avait flairé les frustrations d’Ermesinde. Il l’approcha, son dédain remisé, pour suggérer une affaire d’envergure, sans grand risque, mais qui nécessitait une association entre les frères. Enfin un projet concret ! Flattée de la confidence, elle fut son alliée, joua à la perfection son rôle d’entremetteuse.
L’idée était simple. Sur de vastes prairies nichées entre leurs sapinières, ils érigeraient un village de vacances. Un concept à la mode en cette fin de siècle. Les saveurs de l’Ardenne en prêt-à-porter, avec en prime l’agrément de bassins tropicaux. Juteux, autrement profitable que les fermages ridicules versés par des locataires enracinés sur ces terres comme s’ils en étaient les propriétaires.
L’enthousiasme de son épouse – elle paraissait revivre – persuada Patrick. Il éviterait ainsi la momification d’un mariage dont les rares saveurs se tarissaient.
En cette après-midi d’une fin d’été, le malheureux regrettait un engagement lui voûtant les neurones.
Depuis trois ans, les ennuis s’accumulaient. Protestations véhémentes des fermiers, contestations des villageois alentour épaulés par une cohorte d’urbains, seconds résidents jaloux de leur tranquillité, tous criaient au meurtre de l’Ardenne. Les autorités, un temps sensibles aux emplois promis, vacillaient.
Assis à la table de conférence d’une banque privée dans un immeuble discret de l’avenue de Tervuren, l’aristocrate ressassait les chiffres. Les études, les plans, quelques surprises géologiques, les premiers travaux de voirie suspendus, les recours sans fin, les frais d’avocats, l’addition ne cessait de s’élever ; une spirale vertigineuse que Benoît prétendait maîtriser, en concédant néanmoins qu’un emprunt « de consolidation » serait le bienvenu. Tel était l’objet du rendez-vous bruxellois.
Il n’y eut pas d’euphorie. Le banquier, avec une délicatesse travaillée, leur annonça « qu’en l’état », le prêt ne serait pas accordé. Si la phase de consultation se terminait bien, si l’administration suivait, si les recours en justice étaient abandonnés, en ce cas, une avance importante pourrait leur être consentie moyennant quelques hypothèques. Un mot insupportable à l’oreille de l’aîné. Dans la pièce peuplée de silence contrit, le bipeur de Benoît résonna comme une diversion bienvenue.
Après l’avoir consulté, il salua debout le directeur en charge de leur dossier, d’un air compassé :« Nous n’aurons plus besoin de vous, Monsieur, l’inverse sera peut-être vrai un jour, qui sait ? »
Sous les marronniers de l’avenue, il montra à son frère interloqué le message porteur d’une bonne nouvelle :« Aymeric d’Autremont est décédé. »
Restait la fortune du vieux célibataire. Ils en étaient les héritiers. Ils faillirent danser de joie. Devant les nombreux passants, ils se retinrent.
Le testament
1
Les héritiers, mains crispées sur les genoux, ont la raideur inquiète.
Benoît, Patrick, flanqué d’Ermesinde triturant son sac à main, sont aux aguets en une attente éprouvante.
Le notaire leur a demandé quelques minutes de patience.
Elle entre enfin avec un retard désinvolte dont ils n’osent s’offusquer. Un sourire en guise d’excuse. Juliette affiche une décontraction insolente. Assise, jambes croisées, elle laisse sa courte jupe remonter encore. La quarantaine pétulante, elle ringardise les trois autres. Une décennie les sépare, mais leur allure désuète – ils ont l’air de cache-poussière – double la différence.
Ils ne lui parlent plus depuis longtemps. La communiste tient des discours effrayants, en rajoute, le verbe spoliateur. Ces grands propriétaires la fuient comme s’ils craignaient d’être les premiers détroussés. Elle est là. Impensable de déguerpir. Dans leur impatience, ils auraient toléré la présence du diable.
Patrick heurte Benoît du coude. Ils se comprennent, l’antibourgeoise ne refusera pas son lot.
Maître Lansdau leur explique la forme du testament international rédigé deux mois avant le décès. Un acte rare, mais adéquat par rapport aux avoirs du défunt disséminés de par le monde. Il livre l’exégèse des conditions requises, l’opposabilité de l’acte dans de nombreux pays. Des détails techniques à n’en plus finir livrés dans le désintérêt brumeux des récipiendaires. Les frères n’en peuvent plus, trépignent, prêts à lui hurler d’aller à l’essentiel.
La délivrance lorsque la voix de l’officiant devient monocorde.
La lecture commence.
2
Mes chers neveux, ma chère nièce,
Voici mon testament.
Vous vous souviendrez de ce 20 juillet 1975. Je vous avais invités au château. Vous étiez jeunes encore. Juliette, tu étais resplendissante. Tu l’es restée.
Le temps passe comme une ombre. Évanescente, elle ne permet pas de dissimuler qui nous sommes. Autant le savoir et tenter de laisser derrière nous la trace d’un peu de bien.
Nous avons évoqué vos parents partis trop tôt et surtout ce sujet douloureux, une honte enfouie, mortifiante pour les d’Autremont.
L’engagement fasciste de mon jeune frère Jean, votre oncle, fut une désolation cruelle.
Disparu, nous sommes toujours sans nouvelles de lui. Il convenait, le délai légal depuis la reconnaissance de son absence s’étant écoulé, je sais, trente ans, c’est long, de prendre les dispositions concernant le règlement de sa succession.
Je vous ai, lors de notre déjeuner, raconté, avec beaucoup de détails au point de solliciter votre patience, mon entrevue avec l’abbé Servais qui, au moment où j’écris ses lignes, me bouleverse encore.
Le notaire s’est arrêté comme s’il attendait une explication, à moins qu’il ne laisse le temps à la famille de se remémorer les ingrédients du repas.
Patrick d’Autremont se tortille sur sa chaise, Ermesinde se raidit plus encore, agrippe le bras de son époux, Benoît soupire, hausse les épaules, d’un revers de la main, lent et solennel, invite à la poursuite de la lecture. C’est oublier Juliette.
— Ce déjeuner, notaire, un grand moment. Vous avez remarqué comment le cerveau en quelques secondes est capable de nous restituer une histoire entière ?
— C’est vrai.
Juliette le remercie d’un sourire. Elle se tourne vers les autres, croise des regards avachis.
— Je suis certaine, mes chers frères, toi aussi Ermesinde, que vous vous souvenez de tout.
3
Aymeric d’Autremont avait quitté l’hôtel situé le long du Lot dans la fraîcheur du petit matin. Il éviterait la touffeur d’une journée écrasée par un soleil fendillant les prés desséchés. Une trentaine de kilomètres à parcourir par une route sinueuse bordée çà et là de maisons de pierre aux fenêtres étroites. Il grimperait jusqu’au village de Montcuq signalé de loin par une tour médiévale. Là, il demanderait son chemin pour le presbytère de ce hameau, dans la crainte de ne pas le découvrir par lui-même.
L’aristocrate voyageait seul au volant d’une modeste voiture de location.
L’abbé Augustin Servais lui avait donné rendez-vous après sa messe de sept heures. Aymeric attira le regard de quelques vieilles pressées de rentrer chez elles après l’office, réjouies d’avoir une anecdote à raconter. Un étranger en visite à la cure. Pour la discrétion, c’était raté ; quelle importance après tout.
Il pénétra dans l’église, étonné du dénuement de l’édifice. Murs blanchis, vitraux transparents, chaises posées sur des pavés inégaux, un autel invisible sous une nappe sans broderies et, dans le fond du chœur, un christ sans croix pendu par les poignets à une double chaîne de fer. Un dépouillement mystique, plutôt le signe d’une paroisse misérable, pensa le comte.
— Venez par ici, Monsieur d’Autremont, ce doit être vous à cette heure. Au fond à droite, je suis dans la sacristie.
L’officiant rangeait l’aube. Dans la pénombre se distinguait une silhouette émaciée.
Ils gagnèrent le presbytère par une porte de côté.
Aymeric ne se souvenait pas de curés logés dans un tel abandon. En Ardenne, les maisons curiales, sans être cossues, sont confortables et le contenu de leurs caves à vin souvent réputé. Ici, les murs tordus, le carrelage ingrat, le mobilier disparate suintaient la pauvreté.
Assis à la table couverte d’une toile cirée, Augustin, un bol de café noir entre les mains, s’adressa à son hôte, sans le regarder. La tête de côté laissait paraître un demi-visage raviné.
— Pourquoi avoir attendu trente ans avant de vous contacter comme je l’avais promis à Jean ? La peur d’abord, la peur d’être arrêté après mon retour en Belgique en 1944. Sept ans de clandestinité caché par ma famille qui a pris pas mal de risques.
L’aristocrate l’avait interrompu :
— Je comprends, le moine parti comme aumônier de la Légion n’a pas eu votre chance. Quinze ans de prison, ça fait réfléchir…
L’abbé avait acquiescé d’un sourire contrarié.
— Après j’ai abouti dans cette région éloignée, couvert par, disons, ma hiérarchie. La crainte toujours présente d’être reconnu, arrêté, extradé. Maintenant, je ne risque plus rien, la prescription, l’oubli. Mais il n’y avait pas que la peur. J’avais honte aussi. Pas d’avoir été avec les Boches. D’ailleurs je n’étais pas là pour eux. Mais d’avoir abandonné mes camarades, oui, un curé qui abandonne des mourants, par trouille de sa propre mort. La culpabilité, vous voyez… On ne s’en remet pas, enfin, moi, je ne m’en remets pas…
Le comte posa la main sur la manche de son interlocuteur :
— Mon frère Jean, c’est pour lui que je suis ici à votre demande. Pardon pour votre histoire, mais…
— Vous avez raison, je ne vais pas pleurnicher, c’est un peu tard. Je devrai malgré tout parler encore un peu de moi. Il faut que vous compreniez ce qui me liait à votre frère. Je vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Tenir ma promesse, un peu de fidélité, ça va me soulager.
Aymeric l’encouragea, le regard bienveillant.
— Je ne vous jugerai pas, monsieur le curé. Ce n’est ni mon rôle ni mon envie.
4
Augustin Servais vouait à la Vierge une intense dévotion. Il aimait à se recueillir lorsque le crépuscule tombait dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Délivrance. Celle-ci flanquait la droite du déambulatoire de la cathédrale desSaints-Michel-et-Guduledominant le cœur de Bruxelles.
Parcourir du regard les vitraux, ode à la vie de Marie, l’apaisait et suffisait à le convaincre de la justesse de sa vocation. Il s’efforçait de la vivre à son image, avec humilité.
Ce soir-là, arc-bouté à son prie-Dieu, frissonnant sous la fraîcheur de l’automne malgré le gilet de laine, un tricot de sa mère, il sentit une présence qu’aucun bruit n’avait annoncée.
Il reconnut Jean d’Autremont. Son ancien élève semblait l’attendre, debout, les mains jointes sur un calot frappé d’un insigne. L’uniforme le dérangeait, il le lui dit, mais la supplique enflammée de ce garçon brillant le toucha. Une imploration au nom de leur foi commune à rejoindre les jeunes légionnaires wallons engagés sur le front de l’Est. Les prêtres manquaient pour les réconforter. Il y vit un appel à secourir des hommes sur le chemin choisi de la mort, un signe plus fort que les réticences à l’égard d’un engagement dont la dangereuse ambiguïté ne lui échappait pas. Il décida, non sans orgueil, que seul compterait le jugement de Dieu. Au-dessus de lui, personne ne le dissuada.
À Meseritz dans le Brandebourg, à la veille de la Noël 1942, il enfila, sans joie, la tenue de la Wehrmacht sous l’œil fier du jeune aristocrate.
À cet instant de son récit, l’abbé marqua une pause. Aymeric d’Autremont, impatient, l’encouragea à continuer.
— Plus tard, j’ai refusé de porter l’uniforme de la SS, l’autre suffisait ! Je vous épargne les pérégrinations de la Légion, les combats, mes désillusions, les messes n’attiraient guère, mais, aux portes de l’enfer, nous y sommes entrés à Tcherkassy, un ange apparut. Je ne dis pas ça pour ménager un effet. Je l’ai ressenti comme ça et, pour Jean, j’ai tout de suite compris.
Une femme évidemment, pensa Aymeric.
Tout se passa durant le terrible hiver 1943-1944, entre Korsoun et Baibusy encerclés par l’Armée rouge.
— Elle s’appelait Olena, Olena Kovalenko.
Augustin, le visage perdu dans les mains, étouffa un long soupir comme harassé déjà de ce qu’il s’apprêtait à raconter. Aymeric observait avec compassion l’émotion de cet homme que les mauvais plis de l’Histoire ne cessaient d’entraver.