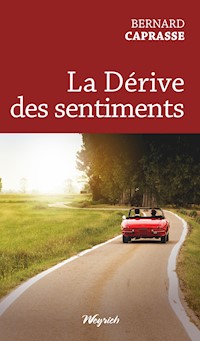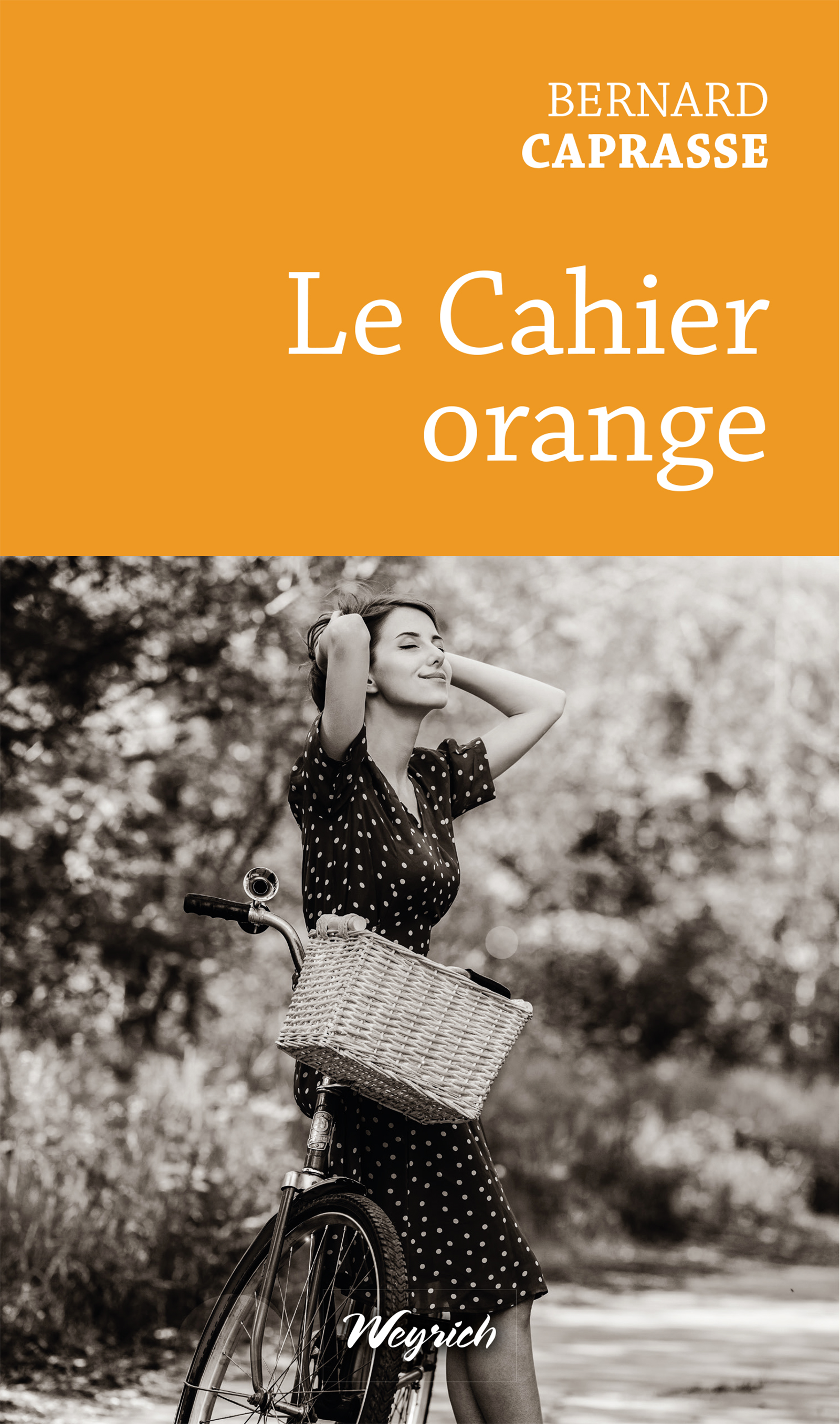
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
New York, 24 janvier 1990.
Anton, avocat réputé, contemple les cercueils de ses parents, posés à même le sol, indifférent à la foule qui se presse dans la cathédrale Saint-Patrick.
Renval en Ardenne, 9 septembre 1944.
Des maquisards attaquent deux chars allemands.
Entre les deux événements : un cahier orange dont la lecture va bouleverser la vie d’Anton et l’entraîner vers sa part d’ombre.
Olga, sais-tu qui tu aimes ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ancien avocat successivement aux barreaux de Bruxelles et de Marche-en-Famenne,
Bernard Caprasse a été Gouverneur de la Province de Luxembourg. Auteur de théâtre, il signe ici son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’ABSENCE
1
New York, vingt-quatre janvier 1990. Une journée froide sous un ciel limpide.
Anton contemple les cercueils de ses parents posés à même le sol, indifférent à la foule qui se presse dans la cathédrale Saint-Patrick.
Le chagrin a eu raison de ses larmes.
Il se remémore la dernière conversation avec sa mère dix jours plus tôt lors de leur promenade hebdomadaire dans Central Park. Il pouvait tout lui dire. De lui, elle pouvait tout entendre avec une attention affectueuse, mais sans complaisance comme ce jour-là.
— Anton, parfois tu m’effrayes.
— Je vois… la soirée d’hier… ma rupture avec Laura.
Agacée, elle avait poursuivi :
— Tu t’es débarrassé d’elle brutalement devant tout le monde en plein vernissage de l’exposition, dans ma galerie…, c’était choquant.
— Je ne connais pas de bonnes manières de quitter une femme. J’ai manqué d’élégance.
Elle s’était arrêtée, l’avait regardé fixement, en silence. Puis, reprenant sa marche :
— Seulement un manque d’élégance ? C’est pire que cela. Tu l’as humiliée devant tout le monde. Insupportable !
Il s’était souvenu des regards gênés qui avaient accompagné le départ de la jeune femme en larmes et en avait conçu pour la première fois un vague remords.
— Laura, après tant d’autres, ce n’est pas la première que je vois passer. Quand vas-tu, comment dire, te poser ? Tu auras bientôt quarante-cinq ans.
Il avait soupiré. Il ne se considérait ni comme un cavaleur, ni comme un séducteur. À chaque fois, il aimait sincèrement. Puis, la passion s’étiolait. Les qualités de ses compagnes finissaient par ressembler à des défauts. Laura par exemple, si ordonnée, lui parut maniaque.
— Maman, je ne sais pas pourquoi je tombe amoureux, mais je sais toujours pourquoi je ne le suis plus.
— On ne construit rien de durable s’il n’y a que la passion, Anton. Elle peut te foudroyer.
— Et quel est le paratonnerre ?
— La raison.
— Pardon, maman, mais venant de toi… Le New York Times dans son dernier article sur ta galerie te décrit fougueuse, entière, passionnée.
— On parlait d’amour, mon chéri. Être amoureux sans raison, oui… c’est sublime. Mais il vaut parfois mieux trouver des raisons d’aimer. Tu vois, moi, je crois que c’est le plus sûr moyen de bâtir quelque chose de fort, quelque chose qui dure. Évidemment, c’est moins romantique…
— Je ne veux pas me tromper. Regarde papa et toi. Un couple d’enfer depuis toujours. On dirait que le mal n’ose pas s’approcher de vous.
À nouveau, elle s’était arrêtée. Elle souriait.
— Ton père, Anton ! C’est lui qui nous protège du mal. Depuis toujours. Au-delà de ce que tu peux imaginer.
Il avait pris sa maman dans ses bras.
Recueilli dans la cathédrale, il ressentit douloureusement la perte de la tendresse infinie de sa mère. Elle avait clos leur discussion comme elle le faisait à chaque fois, avec les mêmes mots : « mon fils, mon très cher fils. »
Les propos de sa maman n’étaient jamais anodins.
Il s’en rappellerait quelques semaines plus tard en découvrant que l’humiliation est le marchepied de la haine.
2
Anton souhaitait des funérailles célébrées dans l’intimité. Son frère cadet, Carlo junior, s’y opposa fermement.
— Anton, tu sais ce que représente notre famille. Nous sommes présents sur tous les continents. Nous comptons dans ce pays. Il y a tous ces gens que maman a aidés. La Fondation Scarzini, son travail dans le domaine des arts… Et ils ne pourraient pas saluer nos parents une dernière fois ? Je ne veux pas d’un enterrement à la sauvette. Il faut rencontrer l’émotion ! Ils sont morts ensemble ! C’est un choc pour tout le monde.
— Un enterrement n’est pas une opération de relations publiques.
— Bien sûr que si ! Ce n’est évidemment pas que cela, mais, dans notre situation, c’est cela aussi. N’y vois pas de cynisme.
— Juste un peu d’intérêt pour les affaires…
Le père Vincenzo, moine trappiste de l’abbaye Saint-Joseph de Spencer dans le Massachusetts, écoutait les deux frères. C’était le confident des défunts, Carlo et Claudia Scarzini. Il intervint d’une voix feutrée pour apaiser la tension qui s’aiguisait.
— C’est tellement difficile de trouver les mots justes, Anton. Carlo, ce que tu dis est assez maladroit… Mais ils seront tellement nombreux à vouloir rendre hommage à vos parents. Il y aura les obligés comme toujours. Ce ne seront pas les plus nombreux. Il y aura tous les autres, les petits, Anton, les artistes, tous ceux qui leur doivent tant. Je te conseille des funérailles à la hauteur de ce que tes parents étaient. La cérémonie peut être belle et simple à la fois.
— La simplicité, père Vincenzo, nos parents vivaient simplement !
— Je sais, Anton. Je vais vous faire une confidence à tous les deux. J’ai souvent parlé de la mort avec Claudia et Carlo. Je sais ce que vos parents souhaitaient pour leurs funérailles. Un cercueil de chêne clair posé sur le sol en signe d’humilité et en souvenir des origines misérables des Scarzini. Tu veux un symbole de simplicité, Anton, le voilà.
Carlo junior accepta en bougonnant. Les maîtres d’un empire à même le sol ! Mais après tout, ce n’était pas une mauvaise idée. L’image ferait le tour du monde. Anton n’insista pas. Il se sentait coupable d’avoir dû laisser à son frère la charge de tout ce qui avait suivi l’accident. C’est Carlo qui s’était rendu immédiatement à l’aéroport d’Anchorage où l’avion de ses parents avait heurté une déneigeuse au décollage. Il n’y avait pas eu de survivant. Lui encore qui s’était chargé des formalités, d’affronter la presse, de gérer les impondérables. Lui, enfin, qui organiserait les funérailles à Saint-Patrick.
Anton n’aurait pu faire autrement. Le procès de von Strafenberg, aristocrate autrichien accusé de l’assassinat de sa femme par empoisonnement, était entré dans sa phase cruciale au moment de la tragédie. Il était l’avocat de l’accusé. Il ne pouvait se dérober. Une certaine presse mit sur le compte de la compassion des jurés pour cet avocat, connu et très affecté, l’acquittement que beaucoup jugeaient improbable. Anton ne l’ignorait pas, le drame survenu en plein procès avait pu le servir. Il suffisait d’un juré vacillant sous l’émotion.
Son client avait accueilli le verdict de manière impassible. Il avait posé la main sur le bras de l’avocat et, narquois, avait chuchoté « Vous n’avez jamais cru à mon innocence, n’est-ce pas ? ». Anton lui avait répondu avec froideur : « Le jury y a cru, pour vous, c’est l’essentiel. » Il avait fait son métier en exploitant les failles du dossier, l’acquittement couronnait son travail. C’était tout.
Ce résultat inattendu en ce moment de tragédie ajoutait encore à son aura.
Maître Scarzini possédait une élégance naturelle. Le teint mat de son visage, l’acuité du regard, la chevelure drue et noire, rappelaient les traits de Claudia, sa mère. Son aisance en imposait. Ses adversaires le redoutaient. Les médiocres se consolaient de ne pouvoir le battre en le disant capable de tout. C’était exagéré. Cependant, maître Scarzini, créatif, déterminé, nanti d’une bonne dose de mauvaise foi, défendait ses clients avec acharnement.
3
Le père Vincenzo était assis au premier rang entre Anton et Carlo junior. Il était vêtu d’une soutane blanche, d’un scapulaire noir serré à la taille par une ceinture de cuir selon la règle des trappistes de stricte observance. La grande rosace percée par le soleil d’hiver, l’orgue monumental, la Pietà, copie géante de l’œuvre de Michel-Ange, tout dans la cathédrale conduisait à regarder vers le haut. L’ampleur du lieu soulignait l’humilité des deux défunts gisant au-devant de la nef centrale. De temps à autre, il posait sa main sur celle d’Anton ou de Carlo junior engourdi de douleur. Il pensait avec tristesse, sérénité aussi, à ce couple dont il était devenu l’ami. Il avait été convenu avec la famille et le cardinal qui présidait la cérémonie que le moine évoquerait leur personnalité. Il connaissait l’histoire des Scarzini. Il laisserait dans l’ombre ce qui devait y rester.
Peu avant de mourir – le besoin de soulager une dernière fois sa conscience ? –, Enzo, le grand-père d’Anton, lui avait raconté comment il avait réussi. « Autour de moi, toutes les fortunes ont une origine trouble, la mienne ne fait pas exception. » Le sang l’avait éclaboussée.
En 1910, il avait quitté les côtes de la Sicile. Il avait promis à ses parents, ses frères et sœurs, une famille de paysans miséreux, de revenir après avoir gagné de quoi les sortir du dénuement. Quelques années suffiraient. Il ne rentra jamais, non qu’il les abandonna, il les sortirait tous de la misère, mais l’Amérique l’avait happé. Maçon habile, travailleur, malin, il fit rapidement de l’ombre à quelques concurrents qui s’étaient partagé certains quartiers de New York. Il se querella violemment avec un Napolitain habitué aux coups bas. La police se fichait des bagarres entre Italiens. Enzo fit appel à la protection de la « Famille » Borsanno, originaire comme lui des environs de Marsala. L’intimidation du Napolitain avait mal tourné. Il était mort dans l’incendie de son entrepôt. Pactiser avec le crime n’est pas gratuit. Enzo Scarzini dut associer ses protecteurs dans la gestion des restaurants qu’il avait acquis pour diversifier ses activités et pour combler son épouse Gina, une cuisinière douée. L’argent douteux gonflait les recettes des établissements. Lucratif et dangereux. Il finit par céder ses parts à ses associés qui ne demandaient que cela. Soucieux de mettre à l’abri son épouse et ses enfants, Carlo né en 1920 et Pietro deux ans plus tard, il s’éloigna un temps de New York pour gagner la Californie. Le bâtisseur y trouva son compte.
« Notre projet est prêt, il nous manque les capitaux. » Il avait surpris la conversation de jeunes gens enthousiastes à la table voisine de la sienne dans un restaurant de San Francisco. Il se fit expliquer le « projet » et, se fiant à son intuition, le finança. Il venait d’investir dans la fabrication des semi-conducteurs. L’électronique, nouvel eldorado !
À sa mort en 1965, il laisserait à ses fils Carlo et Pietro une fortune bâtie au fil des opportunités que le petit maçon, dépourvu de préjugés, avait su saisir.
À eux de la faire prospérer. Ce ne fut pas sans soubresauts. Le père Vincenzo assista impuissant aux déchirements de la famille.
Les frères ne s’entendaient pas. Pietro avait été un enfant à la santé fragile couvé par sa mère. Peu enclin au travail, libertin, il ne comprenait pas l’acharnement de Carlo à développer encore les affaires. Il se gaussait de « l’empire », ne dédaignant toutefois pas d’en profiter. Il finit par céder ses actions à Carlo. Largement dédommagé, délesté de toute responsabilité, il fit ce qu’il savait faire de mieux : s’amuser. Sa déchéance fut d’une banalité terrifiante. L’alcool, la drogue, les filles, les faux amis attirés par l’argent facile… Il mourut d’une overdose à Las Vegas. Il avait cinquante ans.
Carlo soutint comme il put celle dont il n’était pas le fils préféré. Ils décidèrent ensemble de céder à une fondation luttant contre les addictions ce qu’il restait des avoirs de Pietro. Gina ne survécut pas longtemps à son fils, mais elle mourut apaisée sachant qu’avec Carlo, l’honneur retrouvé des Scarzini serait désormais protégé.
Triste et contraint, Carlo respecta le choix de son fils aîné de se consacrer au développement de son cabinet d’avocats. Anton avait ouvert des bureaux en Europe et en Asie. Sa profession l’éloignait des affaires familiales. C’est à Carlo junior que son père confia des responsabilités. Il fit ses preuves. En ces moments funestes, il était prêt à assumer la succession.
Anton n’en concevait aucune jalousie. Les frères s’appréciaient à la satisfaction de leur père, marqué par le souvenir douloureux de sa mésentente avec Pietro. Leurs dissemblances les unissaient. Si Anton était brillant, Carlo était rusé. L’un était éloquent, l’autre savait compter. Ils avaient en commun d’être, chacun dans leur domaine, redoutablement efficace.
Les méandres de la fortune des Scarzini, cette réussite matérielle qui subjuguait, ne tenaient pas de place dans le cœur du père Vincenzo. Il aimait Carlo et Claudia, parce qu’il y avait eu chez eux une autre dimension. Celle qui leur valait en ce jour l’hommage d’une foule dépassant le périmètre du monde des nantis et des puissants. Ces derniers étaient présents. Il était inconcevable de ne pas se montrer auprès de la famille, sous l’œil des caméras qui balayaient les travées. Les funérailles sont un moment rare où hypocrisie et sincérité font bon ménage. Il y avait tous les autres. Ils étaient là pour leurs bienfaiteurs. « À eux seuls, ils justifient cette cérémonie. Le père Vincenzo avait raison », pensa Anton. Ils étaient émus, ces gens peu coutumiers de la Cinquième Avenue. Ils devaient beaucoup à la Fondation Scarzini. De nombreuses mamans venues de Harlem avaient tenu à saluer une dernière fois Claudia, la présidente de la fondation qui encourageait et finançait les bénévoles assurant le tutorat de leurs enfants après l’école. La générosité des Scarzini n’avait rien d’ostentatoire. Elle s’était imposée auprès d’eux comme une discrète évidence.
C’est cela qu’évoqua Vincenzo, cette bienveillance que la fortune servit sans jamais la dévoyer.
Si les jours de funérailles sont douloureux, les lendemains sont cruels. Ils installent l’absence. Elle vous cueille au détour d’une porte, d’un lit, en présence d’un vêtement.
À Anton, elle ne laissa aucun répit. Elle l’entraîna sur des chemins inattendus.
4
Anton Scarzini habitait dans Parkslope au nord-ouest de Brooklyn, dans une de ces maisons de grès rouge construites au début du vingtième siècle. Il aimait ce coin élégant de New York, loin de l’agitation du quartier des affaires. Sa demeure aux boiseries et au parquet d’époque était agrémentée d’un jardin à l’arrière. Son raffinement discret déroutait ceux qui s’attendaient à l’étalage des signes de la réussite. La maison de l’aîné des Scarzini était mitoyenne de celle, à peine plus grande, de ses parents. Sa mère avait choisi ce quartier calme et la rue bordée d’arbres. Elle ne supportait pas les villas boursouflées de certaines de leurs relations avides de reconnaissance. Elle trouvait cette manie enfantine. L’épouse de son fils cadet Carlo junior ne partageait pas ce goût, selon elle immodéré, pour la discrétion. Hillary avait insisté pour acquérir un appartement dont la vue sur Central Park impressionnait. Elle ne comprenait pas à quoi cela servait d’être riche si ce n’était pas pour le montrer. Carlo et Claudia pardonnaient beaucoup à cette femme excentrique. Elle leur avait donné deux petits-enfants, dont une fille. Dans cette famille abonnée aux garçons, ce fut une arrivée bienvenue. Anton aimait ses neveux Roberto et Angela. Celle-ci, tout en poursuivant un master en droit à l’université de New York, se rendait régulièrement au cabinet de son oncle situé dans une tour appartenant à la famille, avenue des Amériques, communément appelée Sixième Avenue par les New-Yorkais. Il s’amusait aussi de ce que sa belle-sœur fut plus grande que Carlo junior tout en étant soulagé qu’elle soit plus petite que lui. En mesurant un mètre quatre-vingt-six, il ne courait guère de risque.
Il l’observait dubitatif. Avec Hillary, pas besoin de magazine de mode, elle en était l’incarnation. Belle jusqu’au bout des ongles, un peu de négligé lui aurait peut-être donné le charme qui lui faisait défaut. Anton gardait ses commentaires pour lui. Après tout, le couple de son frère paraissait solide, l’éducation des enfants était à la hauteur des exigences familiales. Quant à lui, la famille se désolait de son célibat tissé de relations avortées. Le défilé des postulantes, feuilleton haletant, irritait son père : « Tu finiras en vieux beau ratatiné, un fruit sec sans progéniture. » Mais voilà, ses exigences n’étaient pas négociables et le temps passait…
Anton était rentré chez lui après les funérailles, tard dans la soirée. Il avait donné congé pour le lendemain au personnel de maison et à son chauffeur Fredo. Tout le monde avait besoin de repos. Il voulait être seul pour affronter la journée à venir. Pénétrer dans la maison déserte de ses parents serait une épreuve.
Surtout, il lui faudrait ouvrir le bureau de sa mère. Elle l’y recevait lorsqu’il souhaitait lui confier ce que seule une mère peut entendre. Elle l’écoutait, l’apaisait, le conseillait, l’admonestait parfois. Cette confiance totale et réciproque, cet entrecroisement de l’amour filial et maternel le rassuraient dans les épreuves. Il savait aussi à quel point Claudia était indispensable au clan. Elle en était la gardienne, capable d’une détermination féroce si elle sentait l’un des siens en danger. Selon l’expression de Carlo, son mari, « elle était le point fixe et la référence ultime de la famille. » Parvenu devant le bureau, il n’osa pas faire de bruit, comme s’il avait peur de la déranger. La porte grinça. Il sursauta tendu. Sur le dos du fauteuil de bureau derrière la grande table de travail, un cardigan était posé. Il s’approcha, le saisit, le porta à son visage. L’odeur de sa maman, son parfum, sa chaleur. Comment ne pas pleurer, comment ne pas pleurer comme l’enfant qu’il redevint ? Il s’assit dans le fauteuil, fatigué, effondré. Il l’appela… maman… Il fallait qu’il se ressaisisse. Une première inspection du domicile de ses parents était indispensable. Son regard parcourut la pièce, s’arrêta sur le coffre imposant planté dans un coin comme un intrus dans ce décor soigné. Je dois l’ouvrir, pensa-t-il. Il n’avait pas la combinaison. Il appela John Faireman, le chef du service Enquêtes de son cabinet. Dans une heure, le serrurier serait sur place.
Il examina la bibliothèque composée de livres d’art, ouvrit les tiroirs d’une commode où s’empilaient les albums de photos qui condensaient l’histoire familiale. Beaucoup de clichés avaient été pris par Claudia, qui était la moins présente dans ces souvenirs. Dans les armoires, de nombreux dossiers classés par année et par ordre alphabétique concernaient les œuvres acquises par la galerie Claudia Stanton, du nom de jeune fille de sa maman.
Sur la table dépourvue de tiroirs, quelques photos. Elle, toute jeune, le regard rivé à celui de Carlo qui lui souriait. Lui, enfant, adolescent, jeune adulte lors de la proclamation de son master. Il était en toge, entouré de ses parents. Carlo junior avec son épouse et ses enfants.
Une feuille de papier était posée sur le sous-main : « à faire à mon retour ».Suivait une liste de tâches qui touchaient à la gestion de la fondation. Il faudra que je m’en occupe, pensa Anton.
Le serrurier, accompagné du chef du service Enquêtes, était arrivé. Il était à l’œuvre. « Ce coffre n’a plus été ouvert depuis longtemps. » Il ausculta le mécanisme de fermeture à l’aide d’un stéthoscope. « C’est pour percevoir les clics qui me permettent de déchiffrer la combinaison. »
Anton observait en silence.
Il fut surpris de l’apparente facilité avec laquelle les défenses cédèrent. Il remercia les deux hommes qui prirent congé.
Anton ouvrit le coffre qui semblait ne rien contenir. Il l’inspecta minutieusement. Au fond de l’étagère du milieu, ses doigts heurtèrent un document. Il le retira. Il tenait entre ses mains un cahier à la couverture orange. Cette découverte dans un coffre vide le troubla. Un oubli ? Rien d’important ? Ou quelques secrets enfouis ? Il parcourut le cahier rapidement. Un malaise diffus l’avait gagné. Quelques dizaines de pages couvertes de mots alignés à l’encre bleue, presque sans ratures lui sembla-t-il, agencées en chapitres, paraissaient livrer un récit parsemé de noms qui ne lui disaient rien.
Cette écriture ample et droite était celle de sa mère. Un texte en français. Elle maîtrisait cette langue. Elle en avait transmis l’amour à ses deux fils.
Ému, perplexe, il s’assit dans le fauteuil de sa maman, alluma la lampe de bureau et commença à lire.
Olga sais-tu qui tu aimes ?
Le début d’un roman.
Il allait veiller un long moment.
LE ROMAN
1
— Olga, sais-tu qui tu aimes ?
Tu t’es assis comme si tu étais chez toi. Mâchoire crispée, yeux plissés, torse droit, mains posées sur la table, tu dégages cette autorité naturelle qui force le respect de tes hommes. Ce soir, imprudent, tu as décidé de me rejoindre. Tu as quitté la cave où je te cache après tant d’autres, pour me poser cette question. C’était plus fort que toi.
— Olga, sais-tu qui tu aimes ? Enfin, sais-tu qui tu crois aimer ?
Le ton est sentencieux, péremptoire comme celui d’un interrogatoire. Je suis irritée. Je ne « crois » pas aimer. J’aime ! Je prends le temps de te répondre. Je t’observe, assise en face de toi, sans ciller.
— Un boche… J’aime un boche.
Tu secoues la tête.
— C’est insensé.
Je poursuis, légère.
— Pire, j’aime un officier. Beau, intelligent, cultivé. Cultivé pour la servante que je suis, cela compte, Marc.
Tu as failli bondir.
— Arrête, c’est de la provocation.
Je te rétorque, ironique :
— À quoi t’attendais-tu ? Oh ! Marc c’est vrai… je devrais avoir honte !
— Tu fréquentes l’ennemi ! Je préfère dire fréquenter qu’aimer. Tu as beau être discrète, tout le monde est au courant. Tu sais ce que l’on dit de toi ?
— Tiens, on s’intéresse à ma petite personne !
— Ne fais pas l’innocente.
Tu as réussi à me mettre en colère. Je te hurle à la figure :
— La putain du boche, la saucisse de l’occupant et le reste… Mais je m’en fous, je m’en fous complètement. Tu me fais penser aux vieilles pies du village. Elles s’emmerdent à longueur de journée. Elles devraient me payer, je les distrais. Et puis n’oublions pas les coqs jeunes ou déplumés. Tu as vu comme ils me reluquent… ils se verraient bien à la place de l’Allemand…
— Olga dans toute sa splendeur ! Tu te plantes complètement ! Tu es totalement inconsciente.
— Inconsciente ? Et quand j’abrite chez moi les clandestins que tu me confies depuis des mois, je suis quoi ? Et quand je les guide parfois à travers bois vers d’autres rendez-vous. Si je croise une patrouille de boches ? Tu sais ce qui m’attend ? C’est pas de l’inconscience cela ?
— Tu mélanges tout.
— Je le fais exprès. Je ne trie pas. Tout cela devrait t’arranger.
— Ah bon et pourquoi ?
— Pourquoi ? Tu ne vois vraiment pas ? Tu me prends vraiment pour une demeurée. Ma liaison avec le patron de la Feldgendarmerie n’a pas que des inconvénients. Il m’est arrivé de recueillir des renseignements utiles. Tu t’en souviens ? Tu pourrais exprimer un peu de reconnaissance ou t’inquiéter des dangers que je cours. Non, c’est normal ! Mais tu t’inquiètes de mes amours. Merci beaucoup !
Tu me parais sincèrement accablé. Tu t’exprimes à mi-voix :
— Je n’arrive pas à croire que tu l’aimes. Je ne l’accepte pas, ce n’est pas possible ! Cela m’est insupportable.
— Quel aveu ! Il t’insupporte que je te préfère cet homme ou tout simplement que je te préfère un autre homme ?
Je te connais depuis l’enfance, Marc. Notre histoire est celle d’un rendez-vous manqué. Tu sais pourquoi. Maintenant, c’est trop tard. Je suis amoureuse, follement amoureuse.
Puis il y eut ce bruit de pas sur le gravier du sentier. Tu t’es levé sans précipitation. D’instinct, tu t’es posté dans le coin de la salle à manger d’où tu pouvais tout surveiller. La lueur de deux quinquets projetait nos ombres mouvantes sur le papier kraft occultant les fenêtres, couvre-feu oblige. J’ai éteint celui qui était le plus proche de moi. La pièce était dans la pénombre. Debout, inquiète, j’ai attendu.
2
Lorsque tu es morte, maman, tout s’est effondré. Une péritonite. Le médecin n’a rien pu faire. Je t’ai perdue, toi qui me couvrais de tendresse, m’encourageais, canalisais ma fougue adolescente. Tu étais fière de mes résultats au lycée. La fille du cordonnier toujours première de sa classe. Tu racontais aux voisines au sortir de la messe dominicale comment je dévorais les livres empruntés à la bibliothèque paroissiale. Tu me pardonnais la lecture de romans mis à l’index par le clergé, que me prêtait Marc Lansdau, le fils du notaire. Tu encourageais ma curiosité.
Le pire m’attendait. J’ai dû te remplacer. Sans délai. Je n’ai même pas terminé le trimestre en cours. Cinq jours après ton enterrement, la servante était au poste. Octave Maren, mon père, ne pouvait attendre. « La maison doit être tenue », nettoyer, refaire les lits, vider les pots de chambre, lessiver, repasser, cuisiner, monter le charbon, le bois, tel serait mon quotidien. Lorsque je suis rentrée chez nous après ce dernier jour au lycée, j’ai pleuré toute la nuit. Je te l’avoue un peu honteuse, maman, j’ai pleuré plus qu’au moment du dernier baiser sur ta joue froide.
J’ai accepté ce destin comme tant d’autres. Protester ? Batailler ? Personne n’aurait compris. Aller au-delà de l’école primaire, c’était un luxe pour les filles de fermiers ou de petits commerçants. Le luxe justement existe pour que l’on puisse s’en passer.
Je savais lire, écrire, si bien, et compter mieux que beaucoup dans le village paraissait-il. Bien compter ! Un atout précieux pour mon père. J’étais sa fille. Je devins sa domestique. J’ai cessé de t’aimer, papa, petit à petit. Tu m’as soumise, humiliée, souillée. L’évaporation des sentiments, l’indifférence, puis la haine en découvrant qui tu étais vraiment.
J’ai ravalé mes larmes, enfoui ma rancœur, détruit mes rêves. Tous les jours, les doigts rougis, j’ai récuré avec soin.
Funeste année 1934. Je venais juste d’avoir seize ans.
3
La devanture ne portait pas d’enseigne. Le magasin se suffisait à lui-même. La réputation de la cordonnerie de mon père s’étendait loin dans les campagnes environnantes. Des richelieus aux sabots, le choix ne manquait pas. Bourgeois, ouvriers, paysans s’y côtoyaient sans façon. La guerre cependant affectait le commerce. Octave Maren palliait les effets de la pénurie et du rationnement avec imagination.
Il fabriquait pour un prix modique des sandales pour dame en grosses tresses de raphia montées sur des semelles de bois. Succès garanti auprès des élégantes. Celles qui en avaient les moyens achetaient des paires de couleurs différentes pour mieux les assortir à leurs robes. Le cordonnier avait pêché l’idée dans un magazine féminin autorisé par l’occupant. Pressentant les difficultés à venir, il avait acquis, peu avant le conflit, un important lot de cuir et des peaux à des conditions intéressantes. Il les utilisait pour la confection sur mesure de molières et de bottes que des aristocrates et de riches entrepreneurs lui payaient sous le manteau. Les jours de marché, la porte de la boutique, idéalement située sur la place du village, restait grande ouverte. En commerçant avisé, il avait inventé l’entrée libre. Les chalands allaient et venaient sans être gênés de quitter les lieux les mains vides, un comportement incongru en temps ordinaire.
Lorsqu’il n’était pas au magasin, mon père se tenait dans l’atelier. Thomas, son ouvrier, travaillait à ses côtés. Il avait perdu l’œil gauche dans un corps-à-corps lors de la Première Guerre. Cela n’entamait pas sa dextérité. C’était un compagnon joyeux. Doté d’une voix de contralto, il animait les cafés concerts de la région. Cette étrange texture vocale alimentait la rumeur. On prétendait qu’il avait été, le pauvre, émasculé lors d’un assaut sur les bords de l’Yser. On ne lui connaissait d’ailleurs pas le moindre béguin. C’était bien la preuve. Thomas laissait dire. Inutile de clamer alentour que ses préférences étaient ailleurs. J’adorais Thomas. Son affection compensait la froideur de mon géniteur. C’était aussi un bon professeur. Luc, mon frère cadet, profitait de cet enseignement et, apprenti doué, progressait rapidement. Il avait cependant la mauvaise habitude de tenir en bouche les clous dont il se servait pour réparer les chaussures. Un jour de moindre concentration, il les avala. Opéré, il s’en tira sans trop de dommages. Il ne retint pas la leçon. Luc mouilla ses clous sa vie de cordonnier durant.
Un carillon formé de douilles, vestiges de la Première Guerre, heurté par la porte d’entrée du magasin, avertissait l’atelier dès qu’un client se présentait. Le tintamarre, à défaut d’harmonie, était efficace. Octave Maren se précipitait, se déployait. Les boîtes s’accumulaient, sur le comptoir, à même le sol. Il conseillait, tâtait le bout de la chaussure pour évaluer la position des orteils. Une serviabilité non feinte. Il aimait son métier. Mon père était un commerçant doué. Il avait au moins cela pour lui.
Il était près de ses sous. Mais si l’intérêt de ses activités le commandait, il ouvrait sa bourse. Il marchandait, maugréait, faisait pitié, jamais cependant au point de rater une affaire. Je connaissais cette disposition d’esprit. Il me fallut du courage pour en profiter.
C’était un peu avant le début du conflit. Je le servais, soumise à en étouffer depuis cinq ans. Je l’ai provoqué d’un ton abrupt que je ne me croyais pas capable d’employer. J’avais choisi un jour de marché. Les ventes avaient été nombreuses. On aurait dit que la moitié du village avait besoin de nouvelles chaussures. Il était de bonne humeur, c’était déjà ça.
— Papa, le comte d’Autremont a mis en location la maison en lisière de forêt.
— Grand bien lui fasse.
— Je veux la louer.
— Pardon ?
— Je veux louer la maison du comte d’Autremont.
— Tu veux ?
— Oui, je veux.
— Moi, je ne veux pas. Je te loge et je te nourris.
Je poursuivis d’un ton égal.
— J’ai vingt et un ans.
— Figure-toi que je le sais. Tu restes ici. La conversation est terminée.
— Demain, je suis partie. Les places de servante ne manquent pas. Tiens, chez les aristocrates. Tu as déjà compté le nombre de châteaux qu’on a dans le coin ? Ils ont sûrement besoin de personnel.
— Tu vas te taire ?
— Non, je ne me tais pas ! Je veux louer cette maison. Je veux aussi que tu me payes. Si je n’étais pas là, tu devrais bien payer une servante. Je veux des gages pour payer le loyer.
— Quoi ? Tu veux ? Tu oses me parler ainsi ? Tu vas m’obéir, oui ?
— Papa, je ne veux pas te fâcher, mais je suis prête à partir.
— On en reparle ce soir, je dois travailler. On a beaucoup de travail. Je n’ai pas le temps pour tes caprices.
— Non, ce soir, ce sera trop tard.
Il a cédé ! La loi de l’offre et de la demande ! Même à ce prix-là, j’étais encore une bonne affaire. Une « bonne à faire » ! Il avait vite perçu une autre opportunité. Le comte était un client régulier aux relations multiples.
— C’est bon. J’irai moi-même négocier le loyer. Tu auras tes gages. Tu seras ici tôt le matin. Tu partiras après le souper.
Il rejoignit l’atelier sans attendre que je lui dise merci. Il dut pressentir que j’allais m’en passer.
Enfin un peu de liberté. J’avais osé ! J’avais été capable d’oser. Il suffit d’une fois pour avoir envie de recommencer.
4
Ma maison avait longtemps abrité l’un des gardes forestiers du comte d’Autremont, propriétaire d’un domaine boisé de plus de mille hectares. Il me la loua pour une somme modique, non grâce au talent de négociateur de mon père, mais « parce que c’était moi » comme il me le précisa lorsque je vins prendre possession des clés. Il m’avait ouvert la porte lui-même et accueillie avec un sourire bienveillant lorsque je m’étais présentée. J’en avais été étonnée car je m’attendais à être reçue par un domestique. Aymeric d’Autremont était une personnalité respectée. Il se rendait souvent à Paris. Cela impressionnait. On le disait « riche comme Crésus », une expression un peu mystérieuse dans les campagnes. Le comte m’intimidait, surtout lorsque, m’apercevant dans le village, il venait à ma rencontre sous des regards étonnés. « Vous allez bien, Olga ? Et la maison, aucun problème ? » Je répondais en bafouillant que tout allait vraiment bien.
J’étais chez moi en ce lieu isolé, assez inhospitalier, accessible par un étroit sentier qui, au bout d’une cinquantaine de mètres, débouchait sur un chemin empierré à peine carrossable.
Au nord, une vaste parcelle d’épicéas s’arrêtait à quelques mètres du mur plein de la maison. Une jeune sapinière la heurtait en un endroit, dissimulant une porte comme une protection dont l’utilité se révélerait plus tard. Le soleil de l’été abandonnait quelques traits de lumière dans les sous-bois, là où les troncs les plus vieux avaient été élagués. Les ouvertures donnaient toutes au sud. Une coupe à blanc récente dégageait l’horizon. Je pouvais d’un regard parcourir les collines qui finissaient par s’estomper dans le lointain. Celle sur laquelle reposait la maison avait donc été dénudée. Il faudrait attendre quelques années avant qu’elle ne soit replantée. Ce serait une chance lorsque viendraient les années sombres. Beaucoup y glaneraient des branches mortes pour les nouer en fagots. L’hiver, sous la bise infernale que plus rien n’arrêtait, quelques femmes aux corps courbés s’agripperaient ainsi, chaque jour, entre les souches, à cette terre couverte d’aiguilles mortes. Je les rejoindrais régulièrement pour approvisionner la cordonnerie et mon foyer.
Je m’étais contentée des meubles existants. Je n’avais de toute façon pas de quoi en acquérir d’autres. C’était suffisant à mon confort. Les Ardennais savent heureusement se satisfaire de peu. Sur l’un des murs de la pièce principale, quelques planches posées sur des tiges de fer servaient d’étagères. J’y avais rangé mon trésor, mon seul luxe : mes livres. Le Grand Meaulnes d’Alain Fournier que nous avions analysé en classe, des romans de François Mauriac et, sacrilège, d’André Gide, cet écrivain sulfureux. Marc m’avait prêté nombre de ces ouvrages à l’époque du lycée. Je ne les lui avais jamais rendus… J’en avais acheté quelques-uns à bon compte auprès du tenancier de la procure de l’école, un abbé desséché et sans joie. Il me les avait conseillés pour « leur haute élévation morale ». René Bazin, catholique d’abord, romancier ensuite, avait sa préférence, nullement la mienne, mais enfin c’étaient des livres et j’aurais lu n’importe quoi… La lecture serait souvent mon refuge lors de ces années épouvantables.
Là-haut, je me sentais bien. En poussant ma bécane, je parcourais à pied la distance séparant la maison de la route pavée qui menait à Renval. Je poursuivais à vélo. Mon village se trouvait dans la vallée, ceinturé par un méandre de l’Ourthe, large rivière affluent de la Meuse. Le trajet du retour me demandait des efforts. La pente était rude. La pluie ou le froid glacial des hivers ardennais pouvaient le rendre pénible. Cela ne me décourageait pas. J’avais acquis un peu d’indépendance, c’était l’essentiel. Mais ce jour-là, tout de même, j’avais pesté, tout au long du parcours, contre cette bise polaire qui m’engourdissait. J’avais croisé non loin de l’entrée du village quelques Kubelwagen de la Feldgdarmerie en patrouille. Lorsque je les apercevais, je pédalais plus vite. C’était instinctif. Si tôt le matin, c’était mauvais signe. Une chasse aux réfractaires au travail obligatoire en Allemagne devait être en cours. Sinistre besogne. On haïssait les boches en silence.
Lorsque j’atteignis la cordonnerie, tout était calme. Luc me confirma qu’ils avaient traversé le village sans s’arrêter. Le péril serait pour d’autres. C’était un lâche soulagement que l’on gardait pour soi.
De la fenêtre de la cuisine, je vis les passants qui arpentaient la place du village presser le pas et disparaître. Le bruit des moteurs m’alerta. Deux side-cars pilotés par des militaires engoncés dans de lourds manteaux précédaient une Kubbelwagen. Ils s’arrêtèrent presque en face du magasin. Aucun doute possible. Le hausse-col en acier ne trompait pas. Feldgendarmerie. Les chiens du quartier avaient cessé d’aboyer. Quelques silhouettes aux fenêtres se dissimulaient derrière les rideaux fermés à la hâte. Le temps s’étirait. Il sortit du véhicule en uniforme. Il avait dû y laisser son manteau. Après un regard aux alentours, il se dirigea résolument vers notre maison. Mon teint mat m’empêchait de blêmir, mais je sentis le sang quitter mes joues. J’avais les mains moites. Je serrais mon balai. Le carillon, le pas de mon père. Une porte sans épaisseur séparait la cuisine du magasin. Octave Maren pouvait de la sorte écouter les échanges entre les clients et Thomas qui le remplaçait parfois à l’heure des repas.
Je n’ai jamais suivi une conversation avec autant de concentration, l’oreille collée à la porte, maîtrisant comme je le pouvais ma respiration, attentive à ne pas faire de bruit. La vaisselle attendrait.
— Bonjour, monsieur Maren, je suis le major Kurt Molte de la Feldgendarmerie. Votre magasin dispose d’un atelier de cordonnerie à l’arrière. Je souhaite le visiter.
Le ton était courtois, le français impeccable. Je réfléchissais aussi vite que possible. Qu’y avait-il de suspect dans l’atelier ? Les cuirs ? Les peaux ? Achetés avant la guerre, les bordereaux d’achat le prouveraient. Des marchandises acquises au marché noir ? Il y en avait mais pas à cet endroit. L’officier poursuivit comme s’il devinait les pensées.
— Ne vous inquiétez pas. Vous n’êtes suspecté de rien. Je n’ai jamais visité de cordonnerie. L’occasion se présente. Simple curiosité de ma part.
Je devinais l’angoisse de mon père. Que dire de la mienne ? Simple curiosité, c’était vite dit. Cela commence ainsi, puis le flic se réveille.
— Volontiers, major, suivez-moi.
Je les entendis quitter le magasin. Ils traverseraient la réserve pour rejoindre l’atelier. Mes galoches à la main pour ne pas faire de bruit, j’empruntai un couloir parallèle pour suivre les événements depuis l’encoignure d’une porte.
Bouche bée, marteau en l’air, livides, Thomas et Luc étaient figés de stupeur. Le hausse-col de l’Allemand, rare pourtant chez les officiers, occupait tout l’espace. Feldgendarmerie en lettres d’or démesurées, aigle impérial aux ailes déployées, croix gammée, une chaîne de cou aux larges maillons retenant le plastron, l’attirail était impressionnant. J’étais tendue, inquiète pour nous tous.
Octave Maren intima d’un geste de la main à ses deux ouvriers de se lever. Il fit les présentations, insista pour qu’il soit répondu à toutes les questions « con-cer-nant le tra-vail ». Il détacha lourdement les syllabes espérant, je suppose, que son message serait compris. Être disert sur le métier, muet pour le reste. L’officier sourit. Il avait sans doute perçu le sens de cette intonation. Il posa ses questions de manière courtoise, à Luc d’abord, à Thomas ensuite. Tout y passa. Le poids des enclumes universelles à trois branches, l’utilité des différents marteaux, « celui-ci, c’est pour battre la semelle, celui-là sert à clouer », des pinces « à poser les œillets, à les enlever, à faire des trous pour passer les lacets ». Luc, de plus en plus volubile, expliquait, démontrait, finalement jubilait. Thomas, sur la réserve, s’en tenait à quelques mots. Il enclencha le moteur de l’imposante machine dressée contre le mur. Fichées sur l’axe horizontal, les brosses à poncer, à cirer, à reluire se mirent à tourner. L’officier s’était approché.
— Vous êtes un vétéran ?
Le ton était bienveillant.
— Oui, mon œil perdu, c’est le souvenir que m’a laissé l’un des vôtres.
Il y avait comme un défi dans la réponse. Octave Maren commençait à s’agiter, toussant bruyamment.
— Mon père est mort en 1914, lors de la bataille des frontières, dans les Ardennes françaises, après une épouvantable traversée de la Belgique. Une boucherie sauvage, inutile.
Kurt Molte s’exprimait d’une voix sourde. Il ajouta :
— Je comprends ce que vous ressentez.
Puis il se tourna vers le maître des lieux. Il l’interrogea sur les tranchets. Leurs lames affûtées en faisaient des armes redoutables. Efficaces dans la découpe des cuirs épais, ils pouvaient aussi bien vous trancher la gorge d’un seul coup. Quelques explications encore à propos du coticule, pierre à aiguiser de couleur beige dont l’efficacité était insurpassable. On n’en connaissait qu’un seul gisement dans le monde, dans les environs de Vielsalm, non loin de Renval. Il fallait l’extraire à la main au départ de veines verticales enserrées dans le schiste. Des ouvriers s’y employaient dans des carrières souterraines.
— Voilà, vous savez tout de la cordonnerie.
— Que pensez-vous de mes bottes ?