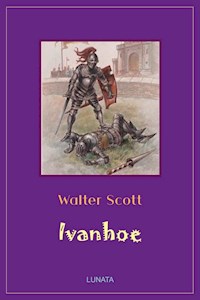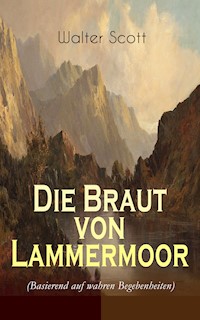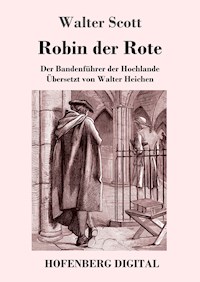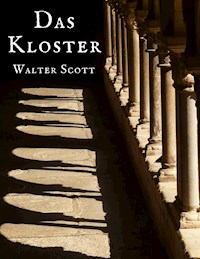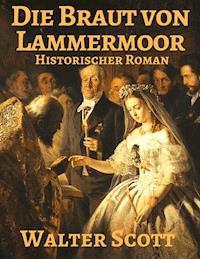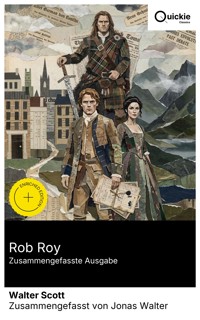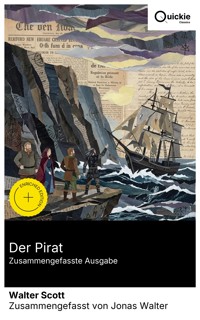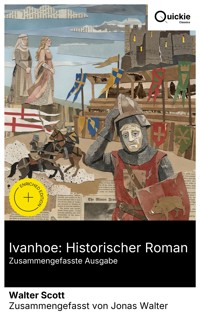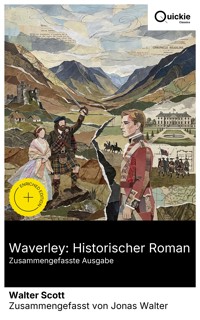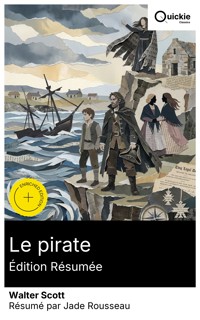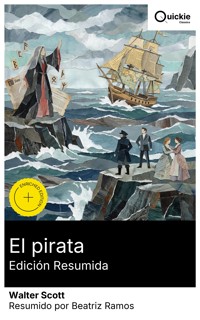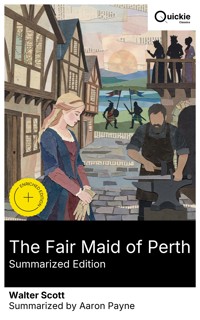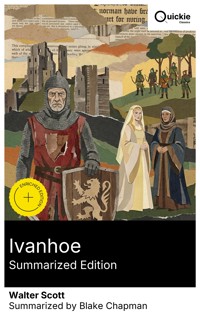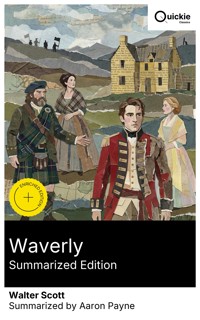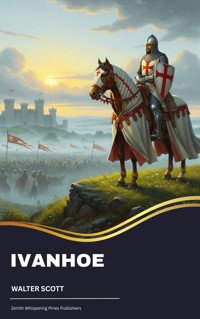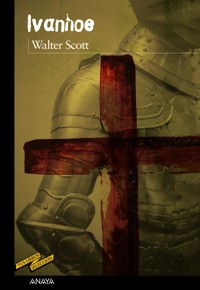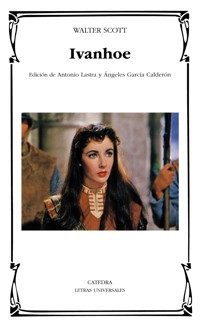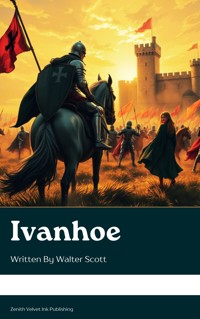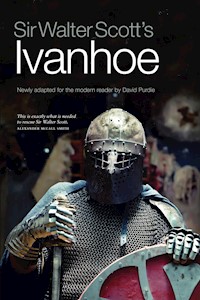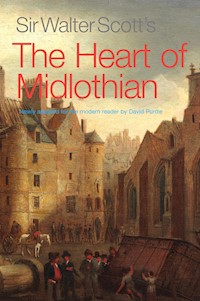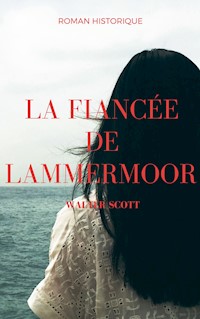
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Ceux qui ont eu le plaisir de voir et entendre le magnifique opéra de Donizetti, Lucia di Lammermoor, dont le livret est inspiré de ce roman, connaissent déjà en partie l'histoire qui nous est contée ici. Nous sommes en Écosse, au XVIIe siècle. Edgar de Ravenswood voue une haine mortelle à sir William Ashton qui a dépossédé son père de ses biens et l'a réduit à un état proche de la misère. Le jeune homme sauve la vie de Lucie, la fille de sir Ashton, sans connaître son identité. Très vite, l'amour enflamme ces deux êtres au coeur pur et Edgar est prêt à oublier la haine qu'il voue au père de sa bien aimée. Par ailleurs, Edgar pouvant rapidement être en position de reprendre ses domaines à sir Ashton, par suite d'un retournement politique dont l'époque a le secret, ce dernier ne verrait pas d'un mauvais oeil une union entre sa fille et le jeune Ravenswood. Mais le fatal Destin veille, et l'histoire ne se terminera pas bien...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Scott
LA FIANCÉE DE LAMMERMOOR
(1819)Traduction Auguste DefauconpretTitre original : The Bride of Lammermoor
Table des matières
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
CHAPITRE XXII
CHAPITRE XXIII
CHAPITRE XXIV
CHAPITRE XXV
CHAPITRE XXVI
CHAPITRE XXVII
CHAPITRE XXVIII
CHAPITRE XXIX
CHAPITRE XXX
CHAPITRE XXXI
CHAPITRE XXXII
CHAPITRE XXXIII
CHAPITRE XXXIV
CHAPITRE XXXV
Mentions légales
CHAPITRE PREMIER
En gambadant gagner son pain,
Faire des tours, faire mainte grimace ;
Joli métier qui mène un pèlerin
À porter longtemps la besace.
Ancienne chanson.
Peu de personnes ont connu mon secret pendant que je compilais ces récits, et il n’est guère probable qu’ils verront le jour du vivant de leur auteur. Quand même cela arriverait, je ne suis point ambitieux de la distinction honorable d’être montré au doigt, monstrari digito. J’avoue que, si je pouvais en sûreté me bercer de ce rêve, j’aimerais mieux rester invisible derrière la toile, comme l’ingénieux maître de Polichinelle et de sa femme Jeanne, pour jouir de l’étonnement et des conjectures de mes auditeurs. Je pourrais peut-être alors voir les productions de l’obscur Pierre Pattieson, louées par les esprits judicieux, admirées par les cœurs sensibles, charmant la jeunesse et séduisant jusqu’aux vieillards ; pendant que le critique en attribuerait la gloire à quelque grand nom littéraire, et que l’on discuterait dans mille cercles et mille coteries sur l’auteur de ces contes, et sur l’époque où ils ont été composés. C’est ce dont je ne jouirai jamais pendant ma vie ; mais je suis certain que ma vanité ne me pousserait pas à en désirer davantage.1
Je suis trop enraciné dans mes habitudes, trop peu poli dans mes manières pour envier les honneurs des auteurs mes contemporains. Je ne serais pas plus fier de mon petit mérite après avoir été jugé digne de jouer le rôle d’un lion ou de tout autre animal curieux, pendant un hiver, dans la grande métropole. Je ne saurais me lever, me retourner, me faire voir en tout sens, depuis ma crinière jusqu’à ma queue, rugir comme un rossignol2, et puis me coucher comme une bête bien dressée, tout cela pour la modique ration d’une tasse de café, et d’une tartine de pain et de beurre aussi mince qu’une hostie. Je digérerais fort mal l’insipide cajolerie que me prodiguerait la dame qui me montrerait dans son cercle, de même qu’elle donne des dragées à ses perroquets pour les faire parler devant le monde. Je ne puis me laisser tenter par ces marques de distinction, et, comme Samson captif, je préférerais, si telle était l’alternative, rester toute ma vie à tourner la meule pour gagner ma subsistance plutôt que servir de jouet aux dames et aux seigneurs Philistins. Ce sentiment ne provient d’aucune antipathie réelle ou affectée contre l’aristocratie des Trois-Royaumes ; mais l’aristocratie est à sa place, et je garde la mienne : tels que le pot de fer et le pot de terre de la fable, nous ne pourrions guère nous mettre en contact qu’à mon détriment. Il n’en est pas de même pour les livres que j’écris ; ils peuvent être ouverts et jetés de côté au gré de chacun : en s’en amusant les grands n’exciteront aucune fausse espérance ; en les négligeant ou en les critiquant, ils ne feront de la peine à personne ; et combien il est rare qu’ils puissent communiquer avec ceux qui ont travaillé pour leur plaisir sans faire l’une ou l’autre de ces deux choses !
Je citerai, en homme sage, ce qu’Ovide exprime dans un vers, pour le rétracter aussitôt dans le suivant ; et je puis dire à chacun de mes livres :
Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in urbe.
Je n’éprouve pas le regret de l’illustre exilé en pensant qu’il ne pouvait accompagner en personne le volume qu’il envoie au marché de la littérature, du plaisir et de la luxure. S’il n’y avait pas cent autres exemples, le destin de mon pauvre ami et camarade d’école, Dick Tinto, suffirait pour me tenir en garde contre le désir de chercher le bonheur dans la célébrité qui s’attache à celui qui cultive avec succès les beaux-arts.
Dick Tinto, quand il se déclarait artiste, n’oubliait jamais de prétendre tirer son origine de l’illustre famille Tinto, dans le comté de Lanark, et parfois il faisait entendre qu’il dérogeait en faisant du pinceau son principal moyen d’existence. Mais si la généalogie de Dick était exacte, quelques-uns de ses aïeux devaient avoir subi une décadence encore plus triste, puisque son père était tailleur dans le village de Langdirdum, métier nécessaire et honnête, j’aime à le croire, mais nullement distingué. Richard naquit sous son humble toit et fut destiné à l’état de son père contre son inclination. Le vieux M. Tinto n’eut guère à se féliciter d’avoir détourné le jeune génie de son fils de sa tendance naturelle. Il fit comme l’écolier qui cherche à arrêter avec son doigt la source d’une fontaine : irritée par le faible obstacle, l’eau s’échappe en mille filets imprévus, et l’inonde pour sa peine. De même, Tinto le père vit son apprenti non seulement épuiser toute sa craie pour faire des esquisses sur le comptoir, mais bien plus, y dessiner les caricatures des meilleures pratiques de la maison, qui commencèrent à se plaindre qu’il était un peu trop dur d’être à la fois défiguré par les vêtements du père et tourné en ridicule par le crayon du fils. Le vieux tailleur, voyant baisser son crédit chaque jour, céda à la destinée et aux instances de son fils, qui obtint enfin la permission de chercher fortune dans un état plus conforme à ses goûts.
Il y avait dans ce temps-là, au village de Langdirdum, un frère péripatétique du pinceau, qui, exerçant son métier sub frigido jove3, était un objet d’admiration pour tous les enfants de l’endroit, et surtout pour le jeune Dick.
À cette époque, on n’avait pas encore adopté, entre autres économies indignes, cet usage peu libéral de suppléer par des caractères de l’alphabet aux symboles des enseignes : ce qui prive les élèves des beaux-arts d’un moyen facile d’instruction et de profit. Il n’était pas permis d’écrire au-dessus d’une porte, ou sur une enseigne suspendue devant l’auberge, À la Vieille Pie ou À la tête du Maure, froide description substituée souvent de nos jours à l’image pittoresque de l’oiseau babillard ou au turban du terrible Sarrasin. Ce siècle, plus simple que le nôtre, songeait également aux besoins de tous les états et voulait que les symboles des cabarets et des auberges fussent à la portée de toutes les intelligences ; car un homme qui ne sait pas lire peut fort bien néanmoins aimer un pot de bonne ale, tout autant que son voisin mieux élevé, ou que son curé lui-même. D’après ce principe libéral, les publicains avaient des emblèmes peints pour enseignes ; et les peintres barbouilleurs, s’ils se régalaient rarement, ne mouraient du moins pas de faim.
Ce fut donc sous un artiste de cette profession en décadence que Dick Tinto se mit en apprentissage ; et, comme cela n’est pas rare parmi les grands génies dans cette branche des beaux-arts, il commença à peindre avant d’avoir les premières notions du dessin.
Son talent naturel pour observer la nature lui apprit bientôt à rectifier les erreurs de son maître et à se passer de ses leçons. Il excellait surtout à peindre des chevaux, qui sont une enseigne favorite des villages d’Écosse ; en étudiant ses progrès, il est curieux d’observer comment il sut par degrés raccourcir les croupes et allonger les jambes de ces nobles quadrupèdes, jusqu’à ce qu’ils fussent un peu moins semblables à des crocodiles. La calomnie, qui suit toujours le mérite, quelque rapide que soit son avancement, a répandu, il est vrai, qu’une fois Dick fit un cheval à cinq jambes au lieu de quatre. Je pourrais, pour l’excuser, m’en tenir à la licence qui permet aux artistes de sa profession toutes sortes de comparaisons singulières et qui va bien plus loin que d’ajouter un membre surnuméraire à un sujet favori ; mais la cause d’un ami défunt est sacrée, et je dédaigne de la défendre superficiellement. J’ai vu l’enseigne en question, qui est encore suspendue dans le village de Langdirdum ; et je suis prêt à déposer avec serment que ce qu’on a pris ou voulu prendre pour la cinquième jambe du cheval est dans le fait la queue de ce quadrupède, qui, eu égard à l’attitude dans laquelle il est peint, est exécutée avec une grande hardiesse et un rare succès : le cheval étant représenté les deux jambes de devant en l’air, la queue qui descend jusqu’à terre semble former un point d’appui, et donne à la figure la solidité d’un trépied. Sans cela, il serait difficile de concevoir comment le coursier pourrait se tenir sans tomber à la renverse. Cette conception hardie est heureusement entre les mains de quelqu’un par qui elle est appréciée à sa juste valeur. Car, lorsque Dick, devenu plus habile, douta que cet écart des règles fût convenable et proposa de faire le portrait du publicain lui-même en échange de cette production de sa jeunesse, cette offre obligeante fut refusée par l’aubergiste judicieux, qui avait observé que si son ale ne mettait pas ses hôtes en bonne humeur, l’aspect de son enseigne leur inspirait certainement l’hilarité. Il est étranger à mon but actuel de suivre pas à pas Dick Tinto acquérant une meilleure touche, et corrigeant par les règles de l’art le luxe de son imagination.
Ses yeux se dessillèrent quand il connut les esquisses d’un contemporain, le Teniers écossais, nom donné justement à Wilkie. Il laissa le pinceau, prit les crayons, et bravant la faim et l’incertitude, il poursuivit les études de sa profession sous de meilleurs auspices que ceux de son ancien maître. Cependant, les premières émanations de son génie (comme les vers que bégayait Pope enfant, si l’on pouvait les retrouver) seront toujours chères aux compagnons de sa jeunesse. Il y a à Gandercleugh un pot et un gril peints par Dick Tinto ;… mais, je sens qu’il faut que je m’arrache à un sujet qui me tiendrait trop longtemps.
Au milieu de ses besoins et de ses efforts pour parvenir, Dick Tinto eut recours, comme ses confrères, à la ressource de lever sur la vanité des hommes la taxe qu’il ne pouvait obtenir de leur goût et de leur générosité. En un mot, il fit des portraits. Ce fut à cette époque que Dick, ayant depuis longtemps pris l’essor loin de sa première occupation, dédaignant même de s’en souvenir, et absent depuis plusieurs années, revint à Gandercleugh où il me trouva dans mes fonctions de magister, tandis que lui peignait, à une guinée par tête, des copies de la face humaine que Dieu fit à son image. C’était un faible salaire, mais il suffisait dans les premiers temps aux besoins de Dick et au-delà ; de sorte qu’il occupait un appartement dans l’auberge de Wallace, disait impunément son bon mot, même aux dépens de mon hôte, et vivait très considéré de la fille, du garçon et du palefrenier.
Ces jours heureux étaient trop sereins pour durer ; quand Son Honneur le laird de Gandercleugh, sa femme et ses trois filles, le ministre, le commis de la douane, mon estimable patron M. Jedediah Cleishbotham, et une douzaine de fermiers eurent reçu un garant d’immortalité grâce au pinceau de Dick, les pratiques diminuèrent, et il fut impossible de tirer plus d’une couronne ou d’une demi-couronne aux paysans que l’ambition amenait à l’atelier de mon ami.
Cependant, quoique l’horizon se rembrunît, il n’y eut pendant quelque temps aucun orage. Mon hôte était un chrétien charitable avec un locataire qui avait bien payé, tant qu’il en avait eu les moyens. Un tableau où l’hôte lui-même avec sa femme et ses filles formaient un groupe dans le style de Rubens parut soudain dans la meilleure salle de l’auberge : preuve évidente que Dick avait toujours des ressources pour vivre.
Mais rien n’est précaire comme les ressources de ce genre. On observa que Dick, à son tour, devenait le but des quolibets de mon hôte sans oser se défendre ou riposter. Son atelier fut transféré dans un galetas où il pouvait à peine se tenir debout, et il ne venait plus au cercle hebdomadaire dont il avait été jadis l’âme et la vie. Bref, les amis de Dick Tinto craignirent qu’il n’eût fait comme l’animal appelé unau, qui ayant mangé jusqu’à la dernière feuille de l’arbre où il s’est établi, finit par tomber du faîte par terre et meurt d’inanition. J’en dis deux mots à Dick, lui conseillant de transporter son inestimable talent dans quelque autre sphère et d’abandonner le terrain qu’il avait épuisé.
– Il est un obstacle à mon changement de résidence, me dit mon ami en me serrant la main d’un air solennel.
– Vous devez à mon hôte, repris-je avec un sincère intérêt : si je puis vous offrir mes petits moyens ?
– Non, par l’âme de sir Josué Reynolds, répondit le généreux jeune homme, je n’envelopperai jamais un ami dans ma mauvaise fortune ; il est un moyen de reconquérir ma liberté, et il vaut mieux se sauver par un égout que de rester en prison.
Je ne compris pas ce que mon ami voulait dire. La muse de la peinture paraissait l’avoir abandonné : quelle autre déesse pouvait-il invoquer dans sa détresse ? C’était un mystère pour moi. Nous nous séparâmes sans plus d’explication, et je ne le revis que trois jours après, lorsqu’il m’invita au dîner d’adieu que lui donnait son hôte, avant son départ pour Édimbourg.
Je trouvai Dick de bonne humeur ; il sifflait en bouclant le havresac qui contenait ses couleurs, ses pinceaux, sa palette et sa chemise blanche. Il partait certainement d’accord avec mon hôte, comme le prouvait la pièce de bœuf froid, flanquée de deux pots d’excellente bière forte, que j’avais vue dans la chambre basse. J’avoue que je fus curieux de savoir ce qui avait si heureusement changé la face des affaires de mon ami. Je ne soupçonnai pas Dick d’avoir des intelligences avec le diable, et je me perdais en conjectures.
Il s’aperçut de ma curiosité, me prit la main, et me dit :
– Mon ami, je voudrais vous cacher à vous-même la dégradation à laquelle j’ai été forcé de me soumettre pour faire une retraite honorable de Gandercleugh. Mais pourquoi tenter de cacher ce qui se trahira de soi-même par son excellence ? Tout le village, toute la paroisse, tout le monde découvrira à quoi la pauvreté a réduit Richard Tinto.
Une pensée soudaine me vint ; j’avais observé que mon hôte portait, ce jour mémorable, une paire de culottes de velours jaune au lieu de son vieux haut-de-chausses.
– Quoi ! lui dis-je ; et je retirai ma main droite en pressant le pouce sur l’index, pour la porter de ma hanche à l’épaule gauche ; quoi ! vous avez eu la condescendance de revenir au métier paternel, vous avez retouché l’aiguille. Ah ! Dick !
Il repoussa cette conjecture injurieuse avec un geste et un air d’indignation ; et, me conduisant dans une autre chambre, il me fit voir appuyée contre le mur, la tête majestueuse de sir William Wallace, aussi terrible que lorsqu’elle fut détachée de son tronc par le traître Édouard.
Le tableau était exécuté sur une planche épaisse, dont le sommet était garni de fer pour suspendre cette honorable effigie en guise d’enseigne.
– Voilà, mon ami, me dit Tinto, voilà l’honneur de l’Écosse et ma honte, ou plutôt la honte de ceux qui, au lieu d’encourager l’art dans sa sphère, le réduisent à ces indignes extrémités.
Je cherchai à adoucir l’irritation de mon ami ; je lui rappelai qu’il ne devait pas, comme le cerf de la fable, mépriser ce qui l’avait tiré d’embarras ; surtout je louai l’exécution autant que la conception de son tableau, et lui dis que, loin d’encourir le déshonneur par l’exposition publique de ce chef-d’œuvre, il devait se féliciter de l’accroissement de célébrité dont il allait être la cause.
– Vous avez raison, mon ami, vous avez raison, reprit le pauvre Dick, l’œil étincelant d’enthousiasme : pourquoi fuirais-je le nom d’un… d’un… (il hésita pour chercher un synonyme) d’un artiste d’enseignes ? Hogarth s’est introduit sous ce costume dans une de ses meilleures compositions. – Le Dominiquin, ou quelqu’autre jadis, et Moreland, de nos jours, ont exercé leurs talents de cette manière. Pourquoi ne destiner qu’aux classes opulentes les jouissances d’un art qui doit les inspirer toutes ? Les statues sont placées en plein air ; pourquoi la peinture craindrait-elle d’exposer ses chefs-d’œuvre, comme sa sœur, la sculpture, expose les siens ? Cependant, mon ami, séparons-nous, l’heure approche où l’on va placer l’emblème ; et, je l’avoue, malgré toute ma philosophie et vos consolations, je voudrais quitter Gandercleugh avant de voir commencer cette opération.
Après le dîner d’adieu que nous fîmes avec mon hôte, j’accompagnai Dick jusqu’à un mille hors du village. Là nous nous séparâmes au moment où nous entendîmes les clameurs lointaines des enfants qui annonçaient l’inauguration de la tête de Wallace. Dick Tinto doubla le pas pour fuir ce bruit, tant il était loin d’être assez philosophe pour se réconcilier avec le rôle de peintre d’enseignes !
À Édimbourg, les talents de Dick furent découverts et appréciés ; il reçut des dîners et des avis de plusieurs juges distingués des beaux-arts ; mais ces messieurs étaient plus prodigues de leurs censures que de leur argent, et Dick croyait avoir plus besoin d’argent que de critique ; il alla donc à Londres, rendez-vous universel des talents, et où, comme dans tous les marchés, il y a toujours plus de marchandises en vente que d’acheteurs.
Dick, qui pouvait sérieusement espérer en son mérite, Dick, trop ardent et trop vain pour douter de ses succès futurs, se jeta dans la foule qui se pressait et luttait pour obtenir la gloire et la fortune. Il coudoya les autres, et fut coudoyé lui-même. Finalement, à force d’intrépidité, il parvint à se faire connaître. Il concourut pour les prix annuels, et eut des tableaux à l’exposition de Sommerset-House ; mais le pauvre Dick était destiné à perdre le but de son zèle. Dans les beaux-arts, il n’est guère d’alternative entre le succès complet et une défaite exclusive ; or, les efforts et l’industrie de Dick n’ayant pu lui obtenir la distinction qu’il cherchait, il encourut les malheurs de l’autre alternative. Il fut, pendant quelque temps, protégé par une ou deux de ces judicieuses personnes qui croient devoir se singulariser et se font un point d’honneur d’opposer toujours leurs opinions, en fait de goût, à celles de tout le monde : mais bientôt fatiguées du pauvre Dick, elles le laissèrent là, tel qu’un incommode fardeau, comme un enfant gâté laisse son joujou. La misère le poursuivit jusqu’à la tombe, où il descendit prématurément, après avoir été tourmenté dans un obscur galetas par son hôtesse, et serré de près par les sergents quand il sortait dans la rue. Le Morning-Post4 consacra à sa mort un quart de colonne, pour dire que sa manière prouvait un vrai génie, quoique son style sentît un peu l’ébauche, et pour ajouter que M. Varnish, célèbre marchand de gravures, avait encore quelques dessins de Richard Tinto, qu’il invitait les amateurs de collections à venir voir sans retard.
Ainsi finit Dick Tinto, preuve déplorable de cette grande vérité, que, dans les beaux-arts, la médiocrité est exclue ; et que celui qui ne peut monter au haut de l’échelle fera bien de ne pas y mettre du tout le pied.
La mémoire de Tinto m’est chère à cause du souvenir de maintes conversations que nous avons eues ensemble au sujet de ma tâche actuelle.
Il était charmé de mes contes, et parlait d’en faire une édition de luxe, avec des vignettes, des culs-de-lampe et autres ornements, pour lesquels il m’offrait son pinceau patriotique. Il avait déjà fait poser un vieux sergent invalide pour représenter Bothwell, le garde du corps de Charles II, et le sonneur de Gandercleugh pour David Deans ; mais, tout en se proposant de réunir ses talents au mien pour illustrer ces contes, il mêlait une critique salutaire aux louanges que j’étais assez heureux d’obtenir quelquefois.
– Vos personnages, mon cher Pattieson, jacassent trop, disait-il (expression que Dick avait apprise d’une troupe ambulante dont il avait peint les décorations). Il y a des pages entières de caquetage et de dialogue.
– Un ancien philosophe, lui répondis-je, avait coutume de dire : Parle, pour que je te reconnaisse, et un auteur peut-il mieux faire connaître ses personnages que par des dialogues où chacun d’eux soutient son caractère ?
– Fausse conséquence ! dit Tinto ; j’en fais aussi peu de cas que d’une pinte vide. Mon cher ami, je vous accorde que la parole a quelque valeur dans le cours des affaires humaines, et je n’insisterai même pas sur la doctrine de ce buveur pythagoricien qui prétendait que, devant une bouteille, les paroles nuisent à la conversation ; mais je ne conviendrai pas non plus qu’un professeur des beaux-arts ait besoin d’exprimer par le langage l’idée de sa scène pour produire de l’effet sur le lecteur et le pénétrer de la réalité. Au contraire, si jamais ces contes deviennent publics, j’en appelle à la plupart de ceux qui les liront. On dira avec moi que vous nous avez souvent donné, en une page de dialogue, ce que deux lignes nous auraient appris ; tandis que, si la situation, le caractère des personnages et les accidents étaient exactement dessinés et présentés avec le coloris convenable, vous auriez conservé tout ce qui en valait la peine, sans avoir recours à ces éternels dit-il et dit-elle dont vos pages sont surchargées.
– Vous confondez, répliquai-je, les opérations de la plume avec celles du pinceau. La peinture, cet art silencieux, comme l’a appelé un de nos poètes, parle nécessairement à l’œil, parce qu’elle n’a pas d’organes pour s’adresser à l’oreille. La poésie, au contraire, ou mon genre de composition, qui en approche, ne doit songer qu’à plaire à l’oreille, puisque les moyens manquent d’intéresser par l’intermédiaire des yeux.
Tinto ne fut pas convaincu par cet argument. – La description, dit-il, est pour un auteur ce que le dessin et le coloris sont pour un peintre. Les expressions sont ses couleurs ; et, s’il sait les employer à propos, il ne peut manquer de placer devant les yeux de l’esprit la scène qu’il veut peindre, avec autant de vérité que la toile peut la représenter à ceux du corps. Les mêmes règles s’appliquent donc aux deux arts, et des conversations trop fréquentes, dans un roman, ne servent qu’à le faire entrer dans le genre du drame, espèce de composition toute différente, et dont le dialogue est l’essence. Or, comme rien n’est plus insipide qu’une longue narration à laquelle on donne les formes dramatiques, les parties de vos histoires où vous avez introduit des conversations interminables deviennent froides et traînantes, et vous y perdez les moyens de fixer l’attention et de charmer l’imagination des lecteurs, ce à quoi vous avez assez bien réussi dans d’autres passages.
Je fis un salut de tête pour le remercier de ce compliment, qui m’était probablement adressé par manière de placebo ou de consolation, et j’exprimai le désir d’adopter un style plus précis de composition, où mes acteurs agiraient davantage, et parleraient mieux que dans mes premiers essais. Dick me fit un geste de protection et ajouta, d’un air approbateur, que, puisqu’il me trouvait si docile, il communiquerait à ma muse un sujet qu’il avait étudié sous le rapport de son art.
– La tradition, me dit-il, garantissait l’authenticité de l’histoire, mais les événements s’étant passés il y a plus de cent ans, on pourrait entretenir quelques doutes sur l’exactitude de tous les détails.
À ces mots, il feuilleta son portefeuille, et en tira les croquis d’après lesquels il se proposait d’exécuter, un jour, un tableau de quatorze pieds de haut sur huit de large. L’esquisse, qui était habilement exécutée, représentait un vieux château, d’après ce que nous appelons aujourd’hui le goût du siècle d’Élisabeth. Le jour, qui s’introduisait par une haute croisée, éclairait une femme d’une beauté rare, qui, dans l’attitude de la terreur muette, semblait attendre l’issue d’une querelle entre deux autres personnes. La première était un jeune homme dans le costume du temps de Charles Ier, qui, l’air fier et indigné par la manière dont il relevait la tête et étendait le bras, semblait réclamer un droit plutôt qu’une faveur d’une dame que son âge et ses traits désignaient pour la mère de la jeune femme, et qui semblait écouter avec un mélange de déplaisir et d’impatience.
Tinto nous montra cette esquisse avec un air de triomphe mystérieux, et il y fixait des yeux semblables à ceux d’un père qui regarde un enfant chéri quand il jouit en perspective de l’honneur qu’il lui fera un jour dans le monde. Il la tenait en main, tantôt l’approchant de moi, tantôt l’éloignant de toute la longueur de son bras. Il la plaça ensuite sur une commode, ferma la partie inférieure des volets pour que la lumière frappât d’en haut, se plaça à la distance et sous le jour convenables, appuya sur son front sa main étendue horizontalement afin de pouvoir fixer exclusivement sa vue sur ce seul objet, roula une feuille de papier en forme de tube et me la passa, afin que je pusse l’examiner avec encore plus d’attention.
Mon enthousiasme ne s’exprima probablement pas avec autant de force que Tinto l’aurait désiré. – Je croyais que vous aviez des yeux, M. Pattieson, me dit-il ; mais il faut être aveugle pour ne pas découvrir, du premier coup d’œil, le sujet de ce dessin. Je ne veux pas faire l’éloge de mon travail, je laisse cette ruse à d’autres ; je connais mes défauts, je sens que mon dessin et mon coloris ont besoin d’être perfectionnés par le temps que je veux consacrer à l’art ; mais la conception, l’expression, les poses, tout cela raconte l’histoire à ceux qui jettent les yeux sur ce croquis. Si je puis finir le tableau sans rien gâter de la conception originale, le nom de Tinto ne sera plus obscurci par les nuages de l’envie et de l’intrigue.
Je répondis que j’admirais son ouvrage, mais que pour en comprendre tout le mérite, il me semblait nécessaire d’en connaître le sujet.
– Voilà justement ce dont je me plains, répondit Tinto. Vous vous êtes tellement accoutumé à vos détails puérils que vous êtes devenu incapable de recevoir cet éclair de conviction instantanée qui frappe l’esprit quand on voit les heureuses et expressives combinaisons d’une seule scène, et qui vous fait connaître aussitôt non seulement l’histoire de la vie passée des personnages et la nature de l’affaire qui les rassemble, mais encore lève le voile de l’avenir, et vous fait deviner ce qui doit leur arriver.
– Dans ce cas-là, repris-je, la peinture l’emporte sur le singe du fameux Ginès de Passamont, car il ne se mêlait que du présent et du passé ; bien plus, elle surpasse la nature qui lui donne des sujets ; car je vous proteste, mon cher Dick, que si je pouvais pénétrer dans cet appartement du siècle d’Élisabeth et y entendre converser les personnes que vous y avez dessinées, je ne devinerais guère mieux leur histoire que je ne fais en ce moment. Tout ce que je puis entrevoir, grâce à l’air languissant de la jeune dame, et au soin que vous avez pris de donner une si jolie jambe au jeune cavalier, c’est qu’il y a quelque intrigue d’amour entre eux.
– Osez-vous former une conjecture si hardie ? s’écria Tinto ; – et l’indignation de cet homme ! – et l’accablement et le désespoir de la jeune dame ! – et l’air inflexible de l’autre plus âgée dont le visage exprime qu’elle sent combien elle a tort, mais qu’elle est déterminée à persister ! – Et si son visage exprime tout cela, mon cher Tinto, repris-je en l’interrompant, votre pinceau rivalise avec l’art de M. Puff ; qui, dans le Critique, devine toute une phrase compliquée par le branlement de tête expressif que fait lord Burleigh5.
– Mon bon ami Pierre, reprit Tinto, je vois que vous êtes incorrigible ; cependant j’ai pitié de votre lenteur de conception, et je ne veux pas vous priver du plaisir de comprendre mon tableau et d’acquérir en même temps un sujet pour votre plume. Vous saurez donc que, l’été dernier, prenant des esquisses dans le Lothian et le Berwickshire, je me laissai entraîner dans les montagnes de Lammermoor, par l’espérance d’y voir quelques restes d’antiquité. Je fus surtout frappé des ruines d’un ancien château où était cette chambre à l’Élisabeth, comme vous l’appelez. Je demeurai deux ou trois jours dans une ferme voisine, chez une vieille fée qui connaissait parfaitement l’histoire du château et des événements dont il avait été le théâtre.
Un de ces événements me parut si singulier et si plein d’intérêt que je fus partagé entre le désir de dessiner les vieilles ruines, et celui de retracer dans un tableau d’histoire le récit que la bonne femme m’en avait fait. Voici mes notes sur cette histoire, ajouta le pauvre Dick en me remettant un paquet de papiers, les uns barbouillés avec un pinceau, les autres avec la plume, et sur lesquels des esquisses de caricatures, de tourelles gothiques, de moulins et de vieux colombiers disputaient la place aux notes écrites de sa main.
Je me mis cependant à déchiffrer ce manuscrit aussi bien que je pus, et j’en ai tiré l’histoire qu’on va lire. J’ai suivi en partie, mais pas toujours, l’avis de mon ami Tinto, en cherchant à rendre mon récit plutôt descriptif que dramatique. Néanmoins, mon penchant naturel m’a plus souvent dominé ; mes personnages, comme d’autres dans ce monde bavard, parlent presque toujours beaucoup plus qu’ils n’agissent.
CHAPITRE II
Non, nous n’avons encor triomphé qu’à demi.
C’est peu d’avoir vaincu, terrassé l’ennemi :
Nous trouverons en lui toujours un adversaire…
SHAKESPEARE. Henry VI, partie II
Dans une gorge des montagnes qui s’élèvent au milieu des plaines fertiles du Lothian oriental, existait autrefois un château considérable dont on n’aperçoit plus aujourd’hui que les ruines. Ses anciens propriétaires étaient une race de barons puissants et belliqueux, nommés Ravenswood, nom qui était aussi celui du château. Leur famille remontait à une très haute antiquité et était alliée aux Douglas, aux Hume, aux Swinton, aux Hay et aux plus nobles familles du pays. Leur histoire se confondait souvent avec celle de l’Écosse, dont les annales consacrent leurs hauts faits. Le château de Ravenswood occupait, et, jusqu’à un certain point, commandait un défilé qui séparait le Lothian et le comté de Berwick, ou le Merse, comme on nommait alors la province d’Écosse située au sud-est. C’était une place importante en temps de guerre étrangère ou de discorde intestine. Elle fut souvent assiégée avec ardeur et défendue avec opiniâtreté, ce qui devait naturellement assurer à ses propriétaires une place distinguée dans l’histoire.
Mais tout a ses révolutions dans ce globe sublunaire, et cette maison avait subi les siennes. Elle déchut considérablement de sa splendeur vers le milieu du dix-septième siècle ; et à l’époque de la révolution qui fit perdre le trône de la Grande-Bretagne à Jacques II, le dernier propriétaire du château de Ravenswood se vit obligé d’aliéner l’ancien manoir de sa famille et de se retirer dans une tour solitaire dont les murs étaient battus par la mer, et qui, placée sur les côtes stériles situées entre Saint-Abb’s-Head et le village d’Eyemouth, dominait sur l’Océan germanique si souvent agité par des tempêtes. Le domaine qui entourait sa nouvelle résidence consistait en pâturages de qualité inférieure, et c’était tout ce qui lui restait de ses propriétés.
Lord Ravenswood, héritier de cette famille ruinée, n’avait pas su plier son esprit à sa nouvelle condition. Dans la guerre civile de 1689, il avait épousé le parti le plus faible ; et, quoiqu’il n’eût été prononcé contre lui ni sentence de mort ni confiscation de ses biens, il avait été dégradé de noblesse, privé de son titre, et ce n’était plus que par courtoisie qu’on l’appelait encore lord Ravenswood.
S’il n’avait pas hérité de la fortune de sa famille, il en avait conservé l’orgueil et l’esprit turbulent ; et, comme il attribuait la chute de sa maison particulièrement à un individu, il l’honorait de toute sa haine. C’était ce même homme qui était alors propriétaire de Ravenswood et des domaines qui en dépendaient, et dont le représentant de cette famille avait été obligé de se dépouiller. Il était descendu d’une famille beaucoup moins ancienne que celle de lord Ravenswood, et il devait aux dernières guerres civiles sa fortune et son importance politique. Destiné au barreau dès sa jeunesse, il s’était élevé à des places éminentes dans la magistrature, et avait la réputation d’un homme qui savait parfaitement pêcher en eau trouble dans un état déchiré par des factions et gouverné par une autorité déléguée ; aussi avait-il eu l’art d’amasser des richesses considérables dans un pays presque ruiné, augmentant tous les jours, par toutes les voies possibles, une fortune dont il connaissait bien la valeur, et la faisant servir avec adresse à étendre son influence et son autorité.
Un homme doué de pareils talents et possédant de semblables moyens était un adversaire dangereux pour le bouillant et imprudent Ravenswood. Avait-il fourni des motifs légitimes à l’inimitié que celui-ci lui avait vouée ? c’était un point sur lequel on n’était pas d’accord. Quelques-uns disaient que cette haine n’avait d’autre cause que l’esprit vindicatif et envieux de lord Ravenswood, qui ne pouvait supporter de voir entre les mains d’un autre le domaine et le château de ses ancêtres, quoiqu’ils y eussent passé par suite d’une vente juste et légitime. Mais la plus grande partie du public, composée de gens aussi portés à mal parler du riche en son absence qu’à le flatter quand ils sont devant lui, avait une opinion moins favorable. On disait que le lord garde des sceaux (car sir William Ashton s’était élevé jusqu’à cette dignité importante), avant d’acquérir définitivement le domaine de Ravenswood, avait eu avec le propriétaire de cet antique château des relations très étendues d’affaires pécuniaires ; et l’on ajoutait tout bas, plutôt comme une chose probable que comme une vérité avérée, qu’il était assez naturel de se demander lequel devait avoir eu l’avantage dans des affaires d’intérêt compliquées, du politique habile, de l’homme de loi doué d’un sang-froid imperturbable, ou d’un homme impétueux et imprudent qui avait pu donner tête baissée dans tous les pièges que l’astuce avait voulu lui tendre.
La situation des affaires publiques rendait encore ses soupçons plus vraisemblables : À cette époque il n’y avait pas de roi dans Israël. Depuis que Jacques VI était allé prendre possession de la couronne plus riche et plus puissante d’Angleterre, il s’était formé des partis opposés parmi les premiers seigneurs de l’Écosse, et ils exerçaient alternativement tous les pouvoirs de la souveraineté, suivant que par leurs intrigues à la cour de Saint-James ils parvenaient à se les faire déléguer. Les maux résultant de ce système de gouvernement ressemblaient à ceux qui affligent les cultivateurs en Irlande sur un domaine dont le propriétaire ne réside pas sur ses possessions et en abandonne le soin à un homme d’affaires intéressé. Il ne s’y trouvait point d’autorité générale, ayant de droit et de fait un intérêt commun avec la masse du peuple, et à qui celui qui était opprimé par une tyrannie subordonnée pouvait en appeler pour obtenir grâce ou justice. Quelque indolent, quelque égoïste, quelque disposé aux mesures arbitraires que puisse être un monarque, ses intérêts, dans un pays libre, sont si évidemment liés à ceux de ses sujets, les conséquences fâcheuses qui résulteraient de l’abus de son autorité sont si claires et si certaines que la politique la plus ordinaire et le plus simple bon sens se réunissent pour lui démontrer qu’une distribution égale de justice est le plus solide fondement de son trône. C’est pour cette raison que même les souverains qui se sont conduits en tyrans et qui ont usurpé tous les droits se sont en général montrés rigoureux dans l’administration de la justice, toutes les fois que leurs passions personnelles et leur puissance n’étaient pas intéressées.
Il n’en est pas de même quand les pouvoirs de la souveraineté sont délégués au chef d’une faction aristocratique qui voit, dans le chef de parti qui lui est opposé, un rival qui peut le devancer dans sa carrière d’ambition. Le temps de son gouvernement court et précaire doit être employé à récompenser ses partisans, à étendre son influence, à opprimer et à écraser ses ennemis. Abou Hassan lui-même, le plus intéressé de tous les vice-rois, n’oublia pas, pendant son califat d’un jour, d’envoyer à sa maison un présent de mille pièces d’or6, et ceux qui gouvernaient alors l’Écosse, devant leur puissance à la force de leur faction, ne manquèrent pas d’employer les mêmes moyens pour récompenser leurs partisans.
L’administration de la justice était surtout en proie à la partialité la plus dégoûtante. À peine se trouvait-il une affaire un peu importante dans laquelle les juges ne fussent influencés par quelque considération personnelle. Ils savaient si peu résister à la tentation de tirer parti de leurs places qu’il courait alors un proverbe aussi général que scandaleux : Dites-moi qui se plaint, et je vous citerai la loi. Un acte de corruption conduisait à un autre encore plus odieux. Le juge qui, dans une circonstance, prêtait son appui pour favoriser un ami ou pour nuire à un ennemi dont les décisions n’avaient pour base que ses principes politiques ou ses relations de famille et d’amitié, ne pouvait être supposé inaccessible aux motifs d’intérêt personnel ; et l’on croyait que la bourse du riche tombait souvent dans la balance de la justice pour l’emporter sur le pauvre qui n’avait pour lui que l’équité. Les ministres subordonnés de Thémis n’affectaient guère de scrupule pour se laisser gagner. Des sacs d’argent, quelques pièces d’argenterie étaient envoyés aux gens du roi pour obtenir d’eux des conclusions, sans même, dit un écrivain contemporain, qu’on eût la pudeur d’y mettre le moindre mystère.
Dans un temps semblable, ce n’était pas tout à fait manquer de charité que de présumer qu’un homme d’état, élevé dans les cours de justice, membre puissant d’une cabale triomphante, pût imaginer et mettre en usage des moyens de l’emporter sur un adversaire moins habile et moins en faveur. Si l’on avait supposé d’ailleurs que la conscience de sir William Ashton était trop timorée pour lui permettre de profiter de ces avantages, on se serait difficilement refusé à croire que son ambition et le désir qu’il avait d’augmenter sa fortune et son crédit trouvaient un puissant stimulant dans les exhortations de son épouse, comme jadis Macbeth trouva dans la sienne le conseiller de son attentat.
Lady Ashton était d’une famille plus distinguée que son époux, circonstance dont elle ne manquait pas de se prévaloir pour maintenir et augmenter l’influence de son mari sur les autres et la sienne sur lui-même. Telle était du moins l’opinion générale, et l’on croit qu’elle était bien fondée. Elle avait été belle, et son port était encore majestueux et plein de dignité. Douée par la nature de grands moyens et de passions violentes, l’expérience lui avait appris à se servir des uns et à cacher les autres, sinon à les modérer. Elle était sévère observatrice, au moins, des formes extérieures de la religion ; elle recevait avec une hospitalité splendide, même avec ostentation ; son ton et ses manières, conformément à la règle générale établie alors en Écosse, étaient graves, imposants et soumis aux règles les plus étroites de l’étiquette ; sa réputation avait toujours été à l’abri du souffle impur de la calomnie. Et cependant, malgré tant de qualités propres à inspirer le respect, rarement on parlait de lady Ashton avec affection. L’intérêt – celui de sa famille, si ce n’était le sien semblait trop évidemment le motif de toutes ses actions ; et quand cela arrive, le public malin juge ordinairement trop bien pour se laisser aisément imposer par l’extérieur. On reconnaissait que, dans tous ses compliments, dans toutes ses politesses les plus gracieuses, elle ne perdait pas plus son objet de vue que le faucon n’oublie sa proie, quand il décrit autour d’elle un cercle dans les airs. De là il résultait que ses égaux ne recevaient ses attentions qu’avec un sentiment qui tenait du doute et du soupçon, et ses inférieurs y ajoutaient un mouvement de crainte, impression utile sous un certain rapport à ses vues, car elle lui assurait une complaisance servile pour tous ses désirs et une obéissance implicite à tous ses ordres. Elle lui nuisait pourtant, parce qu’elle ne peut s’allier à l’amitié ni à l’estime.
Son mari même, dit-on, sur qui ses talents et son adresse avaient obtenu tant d’influence, la regardait avec une crainte respectueuse plutôt qu’avec un tendre attachement ; et l’on prétendait qu’il y avait des instants où il croyait avoir acheté bien cher l’honneur de cette alliance, au prix de son esclavage domestique. Tout cela n’était pourtant qu’un soupçon, et il aurait été difficile qu’il se changeât en certitude ; car lady Ashton était aussi jalouse de l’honneur de son mari que du sien, et elle savait combien il paraîtrait dégradé aux yeux du public si l’on voyait en lui l’esclave de sa femme. Dans tous les points, elle citait l’opinion de sir William comme infaillible ; elle en appelait à son jugement, et elle l’écoutait avec l’air de cette déférence qu’une femme soumise semblait devoir à un époux du rang et du caractère du lord garde des sceaux. Mais en cela il y avait quelque chose qui sonnait faux et creux ; et il était évident, pour ceux qui examinaient ce couple de près avec des yeux attentifs et peut-être malins, que lady Ashton, d’un caractère altier, fière de sa naissance et dévorée d’une soif insatiable d’agrandissement, regardait son mari avec un certain mépris, tandis que celui-ci avait pour elle moins d’amour et d’admiration que de crainte et de respect.
Cependant le but des désirs de sir William et de lady Ashton était le même ; et ils ne manquaient pas d’agir de concert, quoique sans cordialité, se témoignant à l’extérieur ces égards réciproques qu’ils jugeaient nécessaires pour s’assurer le respect du public.
Ils avaient eu un grand nombre d’enfants, mais il ne leur en restait que trois. L’aîné voyageait alors sur le continent ; le second était une fille qui venait d’atteindre sa dix-septième année ; le dernier était un garçon, plus jeune de trois ans, qui demeurait avec ses parents à Édimbourg pendant les sessions du parlement d’Écosse et du conseil privé, et le reste de l’année dans le château gothique de Ravenswood, auquel sir William avait ajouté de nouveaux bâtiments dans le style d’architecture du dix-septième siècle.
Allan, lord Ravenswood, ancien propriétaire de cet antique édifice et des domaines considérables qui en dépendaient, continua longtemps à faire une guerre inutile à son successeur, qu’il traduisit successivement devant tous les tribunaux d’Écosse pour y faire juger tous les points de contestation des relations d’affaires aussi longues qu’embrouillées qu’ils avaient eues ensemble, et qui furent tous décidés, suivant l’usage, en faveur du plaideur le plus riche et le plus en crédit. La mort seule mit fin aux procès en faisant comparaître lord Ravenswood devant le dernier tribunal. Le fil d’une vie longtemps agitée se rompit tout à coup dans un violent accès de fureur impuissante à laquelle il se livra en apprenant la perte d’un procès fondé peut-être sur l’équité plutôt que sur la disposition précise des lois, et qui était le dernier de tous ceux qu’il avait intentés à son puissant antagoniste. Son fils unique reçut ses derniers soupirs et entendit les malédictions qu’il prononça contre son adversaire comme si elles lui transmettaient un legs de vengeance dont la soif, passion qui était le vice dominant du caractère écossais, fût encore augmentée par d’autres circonstances.
Ce fut dans une matinée de novembre, tandis que les rochers suspendus sur l’Océan étaient couverts de vapeurs épaisses, que les portes d’une ancienne tour tombant en ruines, où lord Ravenswood avait passé les dernières années de sa vie, s’ouvrirent pour laisser passer ses dépouilles mortelles qu’on portait à une demeure encore plus triste et plus sombre. La pompe, à laquelle le défunt avait été étranger depuis bien des années, avait reparu un instant pour le livrer au sein de l’oubli.
Un grand nombre de bannières, portant les armes et les devises de cette ancienne famille et de celles auxquelles elle était alliée, étaient déployées et se suivaient en procession funèbre en passant sous la porte voûtée de la tour. Toute la noblesse du pays, alliée depuis des siècles aux Ravenswood, s’y était réunie pour rendre les derniers honneurs au défunt : tous étaient couverts de vêtements de deuil et formaient une longue cavalcade, marchant à pas lents, comme c’est l’usage dans une cérémonie si solennelle. Des trompettes, couvertes de crêpe noir, faisaient entendre leurs sons lents et lugubres pour régler la marche du cortège. Une foule immense d’habitants des environs, de tout âge et de tout sexe, formaient l’arrière-garde ; et les derniers sortaient à peine de la tour quand ceux qui étaient à la tête arrivèrent à la chapelle, lieu de sépulture ordinaire de cette famille.
Contre la coutume, et même contre la disposition textuelle de la loi, ils y furent reçus par un ministre de la religion anglicane, revêtu de son surplis et prêt à célébrer les obsèques du défunt suivant le rite de l’Église d’Angleterre. Lord Ravenswood en avait manifesté le désir dans ses derniers instants, et le parti des tories ou des Cavaliers, comme ils affectaient de se nommer, et dans lequel se trouvaient la plupart des alliés et des amis de cette famille, s’était fait un plaisir de s’y conformer pour braver la faction qui lui était opposée. Le clergé presbytérien, instruit que cette cérémonie devait avoir lieu et la regardant comme une insulte à son autorité, s’était adressé au lord garde des sceaux pour obtenir un ordre qui en empêchât l’exécution. Quand donc le ministre ouvrit son livre de liturgie, un officier de justice, suivi de quelques hommes armés, lui signifia la défense de procéder à la cérémonie.
Cette insulte enflamma d’indignation l’assemblée et surtout le fils du défunt, Edgar, jeune homme âgé d’environ vingt ans, qu’on appelait communément le Maître7 de Ravenswood. Il mit la main sur son épée, et disant au ministre de continuer le service, il avertit l’officier de justice de ne pas s’aviser d’interrompre une seconde fois la cérémonie. Celui-ci voulut insister sur l’exécution de ses ordres, mais cent glaives brillèrent à ses yeux et lui firent sentir la nécessité de se borner à une protestation contre l’acte de violence qui l’empêchait de faire son devoir ; il resta spectateur de la cérémonie funèbre qu’il était venu pour troubler, murmurant tout bas, comme s’il eût voulu dire : – Vous maudirez le jour où vous me traitez ainsi.
Cette scène aurait mérité d’être retracée par le pinceau d’un artiste. Sous les voûtes du palais de la mort, le ministre, effrayé du spectacle qu’il avait sous les yeux et tremblant pour sa propre sûreté, lisait à la hâte et à contrecœur les prières solennelles de l’Église. Autour de lui les parents du défunt, rangés en silence, montraient plus de courroux que de chagrin ; et leurs épées qu’ils brandissaient en l’air faisaient un contraste frappant avec les habits de deuil dont ils étaient couverts. Dans les traits du jeune homme seul le ressentiment parut un moment céder au profond chagrin avec lequel il voyait son père, et presque son unique ami, descendre dans le tombeau de ses ancêtres.
Un de ses parents le vit pâlir, lorsqu’à la fin de la cérémonie il s’agit de descendre le cercueil dans le caveau. C’était à lui, comme conduisant le deuil, d’y déposer le corps. Ce parent s’approcha de lui, offrit de le remplacer dans cette fonction pénible et douloureuse. Mais Edgar Ravenswood le remercia par un geste silencieux et remplit avec fermeté le dernier devoir que lui imposait le respect filial. Une pierre fut placée sur ce sépulcre : on ferma la porte du caveau, et la clef massive en fut remise au jeune homme.
Lorsqu’on sortait de la chapelle, il s’arrêta sur les degrés, et se tournant vers ses amis : – Messieurs, leur dit-il, vous venez de rendre les derniers devoirs au défunt d’une manière peu commune. Les honneurs funèbres, qui, dans d’autres pays, s’accordent au citoyen le plus obscur, auraient été refusés aujourd’hui à votre parent, qui n’est certainement pas issu d’une des dernières maisons d’Écosse, si votre courage ne les lui eût assurés. D’autres ensevelissent leurs morts dans les larmes, dans la douleur, dans un silence respectueux ; nous, nous avons vu nos rites funéraires interrompus par l’intervention des officiers de justice et de la force armée. La douleur que nous devions à la mémoire de celui que nous regrettons a fait place au sentiment d’une juste indignation. Mais je sais de quel carquois est parti le trait qui nous a blessés. Celui dont la main a creusé la tombe a pu seul vouloir troubler les obsèques ; et que le ciel me punisse si je ne me venge pas sur cet homme et sur sa maison des persécutions et des calamités qu’il a attirées sur la mienne !
La plus grande partie de l’assemblée applaudit à ce discours comme étant la vive expression d’un juste ressentiment ; mais ceux qui étaient d’un caractère plus froid et plus réfléchi regrettèrent que l’héritier de Ravenswood eût parlé ainsi. Il était trop faible pour pouvoir braver ouvertement sir William, et ils craignaient que ces paroles indiscrètes ne changeassent la haine secrète de celui-ci en une animosité déclarée. Les événements ne justifièrent pourtant pas leurs appréhensions, du moins dans leurs conséquences immédiates.
Le cortège retourna alors à la tour pour s’y abreuver largement en l’honneur du défunt, coutume qui n’a été abolie en Écosse que tout récemment. La maison de douleur devint le théâtre de la joie d’un festin et retentit des cris bruyants de l’ivresse ; et l’héritier de celui dont on célébrait les funérailles d’une manière si étrange dépensa en cette occasion près de deux années de son modique revenu. Mais tel était l’usage, et ne pas s’y conformer eût été montrer aussi peu de respect pour le défunt que d’attention pour les amis qui lui survivaient.
Le vin coulait à grands flots sur la table dressée dans la grande salle de la tour pour les parents et les amis du défunt ; les fermiers buvaient dans la cuisine, et la populace dans la cour. Les têtes ne tardèrent pas à s’échauffer, et le Maître de Ravenswood, titre qu’on s’obstinait à lui conserver malgré la forfaiture prononcée contre son père, fut le seul qui conserva son sang-froid. En passant à la ronde la coupe dans laquelle il ne faisait que tremper ses lèvres et que chacun vidait tour à tour, il entendit mille imprécations contre le lord garde des sceaux, et mille protestations de dévouement pour lui et pour sa maison. Il écouta en silence et d’un air sombre et pensif ces transports d’enthousiasme, et les regarda, avec raison, comme devant s’évanouir avec les bulles légères qui s’élèvent au bord du verre quand une liqueur spiritueuse vient d’y être versée, ou du moins comme ne devant pas durer plus longtemps que les vapeurs produites par le vin dans le cerveau des convives.
Quand le dernier flacon fut vide, ils firent leurs adieux au nouveau propriétaire de la tour, avec de vives protestations d’amitié qui devaient être oubliées le lendemain, à moins que ceux qui les avaient prodiguées ne trouvassent nécessaire à leur sûreté d’en faire une rétractation plus solennelle.
Recevant ces adieux avec un air de mépris qu’il pouvait à peine cacher, Ravenswood vit enfin sa vieille tour débarrassée de cette multitude d’hôtes, presque tous attirés par l’espoir d’un bon repas plutôt que par le désir de prouver leur respect pour le défunt, et il rentra dans la salle du festin, qui lui parut doublement déserte par le silence qui avait succédé au tumulte. Elle se remplit pourtant bientôt de fantômes conjurés par sa propre imagination. L’honneur de sa maison terni par la sentence de dégradation dont nous avons déjà parlé, sa fortune autrefois brillante et maintenant anéantie, ses espérances détruites, enfin le triomphe de la famille qui avait ruiné la sienne : tout cela offrait un vaste champ de méditations pour un esprit naturellement sérieux et réfléchi, et le jeune Ravenswood s’y abandonna d’autant plus aisément qu’il était sûr qu’elles ne seraient pas interrompues.
Le paysan qui montre les ruines de la tour couronnant le sommet du roc auquel les vagues font une guerre impuissante, et dont le cormoran et la mouette sont seuls habitants, affirme encore que, pendant cette fatale nuit, le Maître de Ravenswood, par les exclamations de son désespoir, évoqua quelque malin esprit dont l’influence pernicieuse présida aux événements de sa vie. Mais, hélas ! quel esprit est plus à craindre que nos propres passions, quand nous nous y abandonnons sans réserve ?
CHAPITRE III
Si d’atteindre le but sa flèche est si certaine,
Me préserve le ciel en ce cas, dit le roi,
De le voir, quelque jour, la lancer contre moi
WILLIAM BELL, Clim o’ the Cleugh.
Dans la matinée qui suivit les funérailles, l’officier de justice dont l’autorité avait été insuffisante pour mettre obstacle à leur célébration ne perdit pas de temps pour aller informer le lord garde des sceaux des causes qui l’avaient empêché d’exécuter sa mission.
L’homme d’État était assis dans une vaste bibliothèque, autrefois salle de banquet du château de Ravenswood. On y voyait encore les armoiries de cette antique maison sculptées sur le plafond en bois de châtaignier d’Espagne, et peintes sur les vitraux à travers lesquels le soleil dardait des rayons sur de longues rangées de tablettes, fléchissant sous le poids des recueils de jurisprudence et des commentaires sur les lois, joints à quelques histoires écrites par des moines, ce qui formait alors la partie la plus nombreuse et la plus estimée de la bibliothèque d’un historien écossais. Sur une grande table de chêne, placée au milieu de la salle, était un amas confus de lettres, de pétitions et de papiers d’affaires, dont l’examen faisait en même temps le charme et le tourment de la vie de sir William Ashton.
Il avait l’air grave et même noble. Son maintien était celui que devait avoir un homme qui occupait une place importante dans l’état ; et ce n’était qu’après une conversation longue et intime sur des objets d’un intérêt pressant et personnel qu’un étranger pouvait découvrir qu’il était indécis et vacillant dans ses idées, irrésolutions d’un caractère qui craignait toujours de manquer de prudence et de précaution, et dissimulé autant par orgueil que par politique, parce que, sachant lui-même combien il se laissait influencer par des motifs qui n’auraient dû avoir aucun poids sur un homme en place, il désirait que les autres ne pussent pas s’en apercevoir.
Il écouta avec l’apparence du plus grand sang-froid le récit exagéré du tumulte qui avait eu lieu lors des obsèques de lord Ravenswood, du mépris qu’on avait montré de son autorité et de celle de l’Église et de l’État ; il ne parut pas même ému du rapport assez fidèle qui lui fut fait des expressions injurieuses et menaçantes dont s’étaient servis contre lui-même le jeune Edgar et quelques-uns de ses amis ; enfin il écouta avec la même tranquillité ce que son agent avait pu recueillir des toasts portés pendant le repas qui avait suivi les funérailles, et des menaces qui l’avaient terminé. Il prit pourtant une note exacte de tout ce qu’il venait d’apprendre, et n’oublia pas d’inscrire les noms de tous ceux qu’il pourrait faire entendre comme témoins s’il jugeait à propos de donner suite à cette affaire. Il renvoya ensuite le délateur, bien sûr qu’il était alors le maître du reste de la fortune du jeune Ravenswood, et même de sa liberté personnelle.
Lorsque l’officier de justice se fut retiré, le lord garde des sceaux resta quelques instants plongé dans de profondes réflexions. Se levant alors tout à coup, il se mit à marcher à grands pas, comme un homme qui est sur le point de prendre quelque importante résolution. – Le jeune Ravenswood est à moi, dit-il enfin, il est à moi. Il s’est placé sous ma main, il faudra qu’il plie ou qu’il rompe. Je n’ai pas oublié l’opiniâtreté soutenue avec laquelle son père m’a disputé le terrain pied à pied devant toutes les cours de justice d’Écosse, la manière dont il a toujours rejeté toutes propositions d’arrangements, et les tentatives qu’il a faites pour nuire à ma réputation quand il a vu que mes droits étaient inattaquables. Cet enfant qu’il a laissé après lui, ce jeune Edgar, ce fou, cet écervelé, vient de faire naufrage avant d’être sorti du port. Il faut empêcher qu’il ne profite de quelque retour de marée qui pourrait le remettre en mer. Cette aventure, mise convenablement sous les yeux du conseil privé, ne peut être regardée que comme une révolte qui compromet les autorités civiles et ecclésiastiques. On peut prononcer contre lui une forte amende ; on peut ordonner sa détention dans la citadelle d’Édimbourg ou dans le château de Blackness. On pourrait même motiver, sur quelques-unes de ses expressions, une accusation de haute trahison… À Dieu ne plaise pourtant que je porte les choses si loin !… Non, je n’en ferai rien, je n’en veux point à sa vie, quand elle serait entre mes mains… Et cependant, s’il vit et que les circonstances viennent à changer, que ne pourrait-il pas en résulter ? Ne serais-je pas exposé à une restitution, peut-être à sa vengeance ? Je sais que le vieux Ravenswood avait obtenu la promesse de la protection du marquis d’Athol, et voilà maintenant son fils qui, seul et par sa méprisable influence, cherche à former une faction contre moi ! Ce serait un instrument tout prêt dans la main de ceux qui voudraient renverser l’administration.
Tandis que ces pensées agitaient l’esprit de l’astucieux homme d’état et qu’il cherchait à se persuader que son intérêt, que sa sûreté et celle de ses amis et de ses partisans exigeaient qu’il profitât, pour perdre le jeune Ravenswood, de l’occasion qu’il venait de lui fournir lui-même, il se mit à son bureau et commença à rédiger pour le conseil privé un rapport détaillé de tous les désordres qui avaient eu lieu aux obsèques de lord Ravenswood. Il savait que le fait en lui-même enflammerait d’indignation ses collègues, que d’ailleurs les noms des coupables leur étaient odieux ; et il espérait qu’ils se décideraient à faire un exemple du jeune Ravenswood, au moins in terrorem.
Il fallait cependant choisir ses expressions avec assez d’adresse pour rendre les accusés coupables à tous les yeux sans paraître porter une accusation formelle contre eux, ce qui, de la part de sir William Ashton, ancien antagoniste du père d’Edgar, aurait pu paraître suspect et odieux. Tandis qu’il était dans la chaleur de la composition, cherchant avec soin les termes les plus propres à représenter cette affaire sous le jour le plus défavorable pour Edgar, sans avoir l’air de l’accuser directement, sir William, en réfléchissant sur une phrase, porta les yeux par hasard sur les armoiries de la famille contre l’héritier de laquelle il cherchait en ce moment à aiguiser le fer de la loi, armoiries qui, comme nous l’avons dit, étaient sculptées en plusieurs endroits sur les lambris de cet appartement. C’était une tête de taureau noir, avec la devise : J’attends le moment. L’occasion qui les avait fait adopter à cette maison est assez singulière pour la rapporter, d’autant plus qu’elle avait un rapport assez direct avec l’objet des réflexions du lord garde des sceaux.