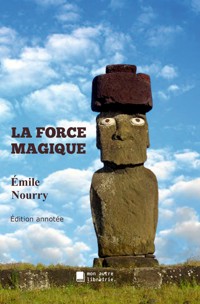
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mon Autre Librairie
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Étude approfondie et très documentée de cette force étrange que les sociétés traditionnelles appellent de différents noms, mais utilisent toutes de façon similaire et avec une efficacité qui nous étonne. L'auteur termine en ouvrant une audacieuse passerelle vers la science contemporaine, en particulier la physique, pour démontrer à quel point les chemins sont ouverts vers une unification des pratiques et des connaissances. (Édition annotée)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La force magique
Du mana des primitifs au dynamisme scientifique
Émile NOURRY
Édition annotée
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition de la Librairie Critique,
Paris, 1914.
Les notes entre crochets ont été ajoutées pour cette présente édition.
https://monautrelibrairie.com
__________
© Mon Autre Librairie, 2023
ISBN : 978-2-38371-045-5
Table des matières
En guise de préface
Chapitre I.
Définition de la magie
Chapitre II.
La force magique
Chapitre III.
La production et le culte de la force magique
Chapitre IV.
La genèse de la notion de force magique
Chapitre V.
L’hypothèse de la force magique et son équivalent occultiste
Chapitre VI.
L’hypothèse dynamique dans la science moderne
Conclusion
En guise de préface
En ne poursuivant qu’une idée, en ne voulant exposer que la notion de force magique, j’ai été conduit à en rechercher les racines dans la constitution même de l’esprit humain, j’ai dû malgré moi aborder, par incidence, bien des problèmes, esquisser des solutions que heurtent des théories imposantes ou des habitudes invétérées. Je l’ai fait en toute sincérité. Si j’ai dû prendre parti contre les thèses sociologiques de l’origine de la force magique, de l’origine du totem et des emblèmes totémiques, c’est sans aucun esprit agressif, car j’éprouve une profonde admiration pour l’effort de M. Durkheim et de ses collaborateurs. Si je me suis permis de suggérer une classification des sciences et de formuler des hypothèses propres à bouleverser certaines conceptions scientifiques, c’est que parmi les savants eux-mêmes on est persuadé de la nécessité d’un bouleversement. Je n’ai visé qu’un sujet, je me suis efforcé de m’y tenir ; malgré moi j’en ai touché vingt autres. Peut-être n’est-ce point tout à fait ma faute et peut-être le sujet le voulait-il. Les sujets généraux sont ainsi, on entend bien s’y borner, mais pour seulement les parcourir, il nous faut faire le tour du monde.
Chapitre I.
Définition de la magie
La magie est à la fois une connaissance, un art et un culte chez les primitifs, et bien qu’on la trouve souvent réduite ou à peu près à un art comme chez les sorciers guérisseurs de nos campagnes, elle n’a vraiment tout son épanouissement que lorsqu’elle réunit la théorie, l’art et le culte.1 Les occultistes contemporains ajoutent à l’art la théorie et ont tenté de restaurer l’initiation magique, mais malgré eux ils se sont trop frottés à la science expérimentale et leur sincérité n’est pas toujours assurée. C’est surtout chez les sauvages, Indiens de l’Amérique, Mélanésiens, Australiens, qu’elle peut être saisie dans sa réalité spontanée, son intégrité et sa sincérité. La magie, disons-nous, est l’ensemble des théories, des techniques et des sentiments mystiques par lesquels le primitif explique l’univers, capte et utilise ses forces invisibles et détermine son attitude intérieure vis-à-vis de toutes les puissances mystérieuses.
1° La connaissance magique
Tout d’abord la magie est une connaissance, un ensemble d’hypothèses, de théories et de représentations. On a même dit que c’était une science, j’estime que c’est une philosophie, mais une philosophie rudimentaire. Le magicien s’est longtemps confondu avec le physicien, le Physicus, l’homme qui étudie la nature (φυσις), le savant ès choses naturelles. Les philosophes ioniens sont appelés des physiciens et Archelaüs2 avait reçu en particulier le surnom de φύσικος. Au Moyen-âge, les hermétistes à la fois philosophes, astrologues, alchimistes et médecins étaient qualifiés, tel Arnauld de Villeneuve3 et tant d’autres, de physiciens. Le médecin s’est longtemps appelé fisico en italien et en espagnol ; il se nomme toujours physician en anglais. Dans les campagnes du centre de la France, le sorcier guérisseur est encore celui qui connaît la fusique et qui, grâce à elle, peut jeter ou lever des sorts, produire la pluie ou arrêter les épizooties. Pour l’Antiquité et le Moyen-âge, tout homme ayant des connaissances naturelles non communes était un magicien. Le pape Sylvestre II ne fut pas moins suspect à ses contemporains qu’Apulée, pontife d’Esculape, aux Africains de son temps. « Et à la vérité, dit Naudé, ce n’est point chose extraordinaire, si comme on a coutume de prendre pour magiciens ceux qui représentent des roses et des fleurs printanières à la plus forte saison de l’hiver : ainsi tous ces galands hommes qui ont paru comme des estoilles brillantes au milieu de cette nuict sombre et ténébreuse, et qui ont produit des effets admirables de leur doctrine en la saison la plus froide et la plus glacée des Lettres ».4 Au XVIe siècle ne voyons-nous pas Fernand de Cordoue,5 également savant dans les sciences et dans les arts, ayant emporté de haute lutte l’admiration des maîtres de l’Université de Paris, obligé de quitter la France parce que l’éclat de son savoir le fit soupçonner d’avoir fait un pacte avec le démon ?6
Mais les connaissances naturelles des magiciens ou de ceux qui passèrent pour tels aux yeux d’un public ignorant constituent un ensemble assez confus, tenant un peu de la science, mais surtout de la philosophie. L’évolution des connaissances naturelles peut se diviser en trois temps : magie, philosophie de la nature et science positive. Il n’y a pas si longtemps qu’un Lamarck ou un Linné qualifiaient leurs tentatives d’organisation de la zoologie et de la botanique de Philosophie botanique et de Philosophie zoologique. Toutes les sciences du Moyen-âge, Astrologie, Alchimie, Médecine, sciences des lapidaires, des plantaires et des bestiaires, science de l’homme et du monde, microcosme et macrocosme, constituaient un ensemble en quelque sorte indivisible bien connu sous le nom de philosophie hermétique. Et chez les Primitifs la magie nous apparaît comme une sagesse traditionnelle, comme le savoir séculaire des anciens, sagesse et savoir qui enveloppent et comprennent tout l’ensemble de leurs connaissances ; la magie est alors à la fois une cosmologie, une anthropologie et une pneumatologie, mais toutes dérivées ou imprégnées d’une même conception fondamentale, la conception de la force magique ; c’est une sorte de physique spirituelle construite sur de vastes et enfantines généralisations en vue de fins utilitaires.
La magie se distingue aisément de la science en ce que la science contrôle et critique par la raison, le calcul et surtout par l’expérience, les hypothèses et les théories au moyen desquelles on l’édifie ; tandis que toute la science du magicien repose sur les théories et les hypothèses qui ne sont justifiées que par la simplicité, l’ignorance, l’audace dans la généralisation qui est le propre des enfants. La science n’a qu’une maîtresse, et une maîtresse sévère : l’expérience. La magie n’a qu’une maîtresse également, mais une folle maîtresse, fille de la seule imagination : l’analogie.
La magie, avons-nous dit, est une sorte de philosophie naturelle embrassant à la fois le monde matériel, l’homme et les esprits, bons ou mauvais, et cependant ce n’est pas proprement une philosophie. Toute philosophie digne de ce nom part des données scientifiques de son temps pour viser à une connaissance de l’esprit, de sa portée et de sa valeur. C’est à la fois une critique de la connaissance et une théorie de la morale. En tant que critique de la connaissance, la philosophie diffère profondément de la magie, dont les principes n’ont été soumis à aucun examen. Comme législatrice de la conscience et règle idéale tendant à l’anoblissement de l’intelligence, à l’émancipation et à l’élévation de l’âme, la philosophie est une discipline spirituelle éminemment désintéressée ; la magie est une connaissance toute égoïste, utilitaire et positive.
2° L’art magique
La magie n’est pas seulement une théorie, c’est une application de cette théorie. Pour beaucoup même, la magie est presque exclusivement une technique, car c’est à peine s’ils attachent une importance à ses théories préscientifiques et à ses jugements de valeur. Nous avons vu que l’on ne saurait négliger l’aspect connaissance, nous verrons que l’on ne saurait davantage dédaigner son aspect cultuel. Mais si la magie est une technique, hâtons-nous d’ajouter que c’est une technique inspirée par une croyance et des sentiments mystiques. Le magicien qui veut guérir une maladie la considère soit comme le produit d’une force invisible, soit comme le fait d’un esprit, et ne se préoccupera que de lutter contre cette cause invisible par une technique appropriée ayant couleur de rites ou de cérémonies.
Toutes les techniques furent magiques à l’origine. La fabrication des outils et des armes nous apparaît encore comme un art religieux à l’origine de la civilisation grecque. Dactyles et Cabires7 sont de véritables prêtres artisans. La culture de la terre, la domestication des animaux, la chasse et la pêche sont tout d’abord des arts essentiellement mystiques comportant tout un cérémonial de renouvellement, de multiplication, de prémices, d’offrandes et de sacrifices. Les origines de la greffe et des engrais sont rituelles. Le chasseur et le pêcheur étaient des liturgistes soumis à toute une étiquette cérémonielle. La production du feu, l’entretien du foyer, la cuisson des aliments furent longtemps des fonctions sacrées dont plusieurs étaient le privilège du père de famille. Bâtir une habitation exigeait tout un ensemble de rites d’appropriation des matériaux et du terrain, de rites de construction proprement dits, et enfin de rites de protection, soit par l’installation de fétiches et de talismans, soit par l’ornementation. Les origines de la parure et des bijoux sont entièrement magiques. Les matières du vêtement étaient choisies pour des raisons mystiques et empruntées à des plantes ou des animaux sacrés ; sa confection exigeait des cérémonies qui le rendaient plus propre à éloigner les forces mauvaises et les mauvais esprits. Les hommes médecins chez les primitifs, les sorciers guérisseurs de nos campagnes sont essentiellement des magiciens, avant tout préoccupés des forces et des esprits invisibles.
Cependant tous ces arts nécessaires à la vie humaine se sont peu à peu émancipés des préoccupations mystiques, et dans la mesure même où ils y sont arrivés, constituent des techniques laïques indépendantes de la magie et des magiciens. Les artisans modernes, cultivateur ou tisserand, pêcheur ou médecin, demandent leurs inspirations non plus à la science du magicien, mais à la science véritable. C’est dire que, comme elle, les techniques modernes sont fondées sur l’expérience, uniquement préoccupées des causes positives qui tombent sous nos sens et dont on peut à volonté provoquer l’action et vérifier l’efficacité. L’artisan d’autrefois n’était pas sans observer, voire sans expérimenter ; mais son observation était constamment faussée par la préoccupation obsédante des esprits et des forces invisibles. Le trésor de la tradition où se conservent les pratiques utiles était à tel point encombré de superstitions et de vaines observances, qu’il ressemblait singulièrement à un tas de détritus où l’on eût égaré des paillettes d’or. Aujourd’hui l’artisan observe avec un esprit dégagé de préoccupations vaines, et contribue pour sa part à grossir le trésor des inventions efficaces Les moteurs admirables qui ont permis de réaliser l’automobile et l’aéroplane sont l’œuvre commune d’une collaboration incessante entre savants et ouvriers. L’ingénieur, qui doit réunir en lui à la fois la science et la pratique, est avant tout l’homme de l’expérience sensible ; le magicien était avant tout l’homme qui agit sur les êtres invisibles et les forces cachées. L’un prétend agir sur les phénomènes, l’autre déploie son activité dans le monde des noumènes.
3° Le culte magique.
La magie est, avons-nous dit, une connaissance, mais c’est une connaissance du mystère, de tout ce qui est secret et invisible ; il arrive même souvent que cette connaissance ne se transmette que par initiation : c’est alors une science secrète de choses secrètes ; c’est un art, mais un art secret réservé à des personnages souvent désignés par un tempérament de névropathe ou de visionnaire, mais qui presque toujours tiennent leur pouvoir et leur force de l’initiation. Cet art du magicien ou de l’initié requiert parfois la coopération de tout le groupe auquel il appartient, comme dans les danses pour la chasse, les cérémonies du renouveau, la réquisition ou la cessation de la pluie. C’est alors incontestablement un véritable culte où le magicien remplit une fonction sociale, où la magie inspire toute une société.
Connaissance des mystères, art secret, cérémonie publique, la magie implique un ensemble de sentiments où dominent le respect, la vénération, une sorte de craintive admiration ; le magicien et les dévots de la magie ont affaire à des forces puissantes à la fois bienfaisantes et redoutables dont le caractère bénéfique ou maléfique dépend de l’exécution minutieuse des rites et des observances, et ceci ne saurait être sans requérir une gravité, un sérieux qui rappelle le sérieux et la gravité des prêtres dans la célébration des mystères de la religion. Le magicien comme le prêtre doit pratiquer des ablutions, des jeûnes, se mortifier, se soumettre à un long et pénible entrainement s’il veut être assuré du succès de sa liturgie, s’il veut acquérir un pouvoir souverain sur la nature. Il y a une ascèse et une mystique magiques de même qu’il y a une ascèse et une mystique divines.
Est-ce à dire que la magie se confonde avec la religion ? ou que la magie soit la religion des primitifs ?
Pour les anciens et pour les peuples barbares la religion de l’étranger, et particulièrement la religion du vaincu, est une magie. Pline traite de magie la religion des Perses et des Gaulois. Cette distinction patriotique et nationaliste ne mérite pas de nous arrêter. Dans un même pays la religion de la minorité ou les pratiques propres à certains groupes isolés n’ont pas manqué d’être traitées de magie par les prêtres du culte dominant. Bien mieux, ils se sont efforcés de justifier cette distinction en déclarant que ces minorités s’adressaient non pas aux dieux, mais aux démons. Et cette distinction née du cléricalisme, inventée par l’esprit de dénigrement et l’appétit de domination des sacerdoces officiels, a été adoptée pendant longtemps comme une distinction véritable qui différencie réellement la magie de la religion.
Admettrons-nous cependant avec le christianisme que les derniers tenants du paganisme dénoncés par les prêtres chrétiens, poursuivis par les lois, étaient des magiciens et leur culte une pure magie ? Lorsqu’on nous dit que la magie tend à l’illicite et à l’interdit8 on fait involontairement écho à l’esprit de condamnation de tous les cléricaux qui rêvent la destruction de ceux qui ne s’inclinent pas devant leurs dieux. La magie a été traitée en pratique illicite ; mais par elle-même elle ne tend point à l’illicite, pas plus que l’orphisme ou les mystères d’Éleusis.
L’École sociologique a mis en avant une autre distinction : la magie serait d’origine sociale, mais dès qu’elle s’est différenciée de la religion elle serait devenue, nous dit-on, une pratique et un phénomène individuels.9 Ainsi, lorsque la magie et la religion coexistent, elles s’opposeraient comme s’opposent l’individuel et le social.
Les faits ne justifient pas cette distinction. Non seulement il faut admettre que les cultes magiques sont des phénomènes sociaux, mais que les cultes magiques ont survécu à l’instauration d’un culte proprement religieux. Le culte d’Hécate en face de la religion grecque, celui de Rudra-Shiva en face de l’orthodoxie hindoue témoignent de l’existence de cultesmagiques collectifs en pleine effervescence religieuse.
On a tenté d’autres distinctions. Pour différencier jadis la magie de la religion, l’une procède, disait-on, par voie de contrainte, l’autre par voie de propitiation ; l’une exige, l’autre supplie. Les enchantements et les sacrifices de la magie sont des rites impératifs, tandis que les invocations et les sacrifices de la religion sont des rites d’intercession.10
Malheureusement il est avéré que lorsque le magicien s’adresse aux esprits, il lui arrive aussi de supplier, et, d’autre part, les rites contraignants ne sont pas inconnus des religions. L’offrande et le sacrifice dans la religion israélite ou gréco-romaine ont souvent une force nécessitante.
Cependant, cette distinction semble déjà en amorcer une autre plus réelle et plus profonde. Les rites de contrainte sont en effet dépourvus de tout idéalisme et de toute estimation morale des dieux, tandis que les rites déprécatoires sont au contraire inspirés par une conception idéaliste de la divinité à laquelle on attribue avec une puissance surhumaine une supériorité spirituelle et morale. « Je suis profondément troublé de l’idée de penser, écrit Porphyre, que ceux que nous invoquons comme les plus puissants reçoivent des injonctions comme les plus faibles, et, qu’exigeant de leurs serviteurs qu’ils pratiquent la justice, ils se montrent cependant disposés à faire eux-mêmes des choses injustes lorsqu’ils en reçoivent le commandement, et tandis qu’ils n’exaucent pas les prières de ceux qui ne se seraient pas abstenus des plaisirs de Vénus, ils ne refusent pas de servir de guides à des hommes sans moralité, vers des voluptés illicites.11 »
En réalité, Porphyre pressentait la véritable distinction de la magie et de la religion. Le culte magique n’a aucune préoccupation de moralité ; le culte religieux est essentiellement établi en vue de fins idéales.12 Le culte magique est un culte naturaliste s’adressant aux forces mêmes et aux esprits de la nature pour des fins utilitaires et positives. Et lors même qu’il s’adresse à des esprits, c’est en tant qu’ils personnifient la nature et individualisent les forces qui la gouvernent. Il ne vise qu’à satisfaire des désirs et des besoins matériels, sans aucune préoccupation d’amélioration morale ou de progrès spirituel.
On voit de là que la religion diffère de la magie par son orientation idéaliste. Lorsque l’attitude sentimentale de l’homme fut capable d’être modifiée par l’idée de dignité personnelle et de moralité collective, ce ferment nouveau opéra une dissociation dans le culte magique primitif. Et comme la préoccupation morale est nécessairement une préoccupation sociale, bien que je n’entende pas dire que le social et le moral soient identiques, il en résulte que la distinction adoptée par l’école sociologique contient une part de vérité, mais ce n’en est qu’une part.
Certes, nombre de pratiques magiques survécurent dans le culte religieux mais on caractérise précisément la superstition par la recherche et l’exclusive préoccupation des intérêts individuels ou matériels. L’incubation de guérison dans les temples de l’antiquité, les cérémonies et processions des Quatre Temps de nos jours, ne passent point, direz-vous, pour des pratiques superstitieuses malgré leur couleur utilitaire. C’est exact, mais il était et il est entendu qu’elles ne sont en réalité que des rites piaculaires et qu’elles impliquent une adhésion morale humble et soumise au refus possible de la divinité. L’attitude sentimentale s’est alors imprégnée de sentiments moraux, le respect pour les dieux a pris une couleur d’idéalisme, la demande utilitaire elle-même s’est empreinte de dignité et celui même qui demande apparaît revêtu d’un reflet de la grandeur et de la noblesse de celui auquel il s’adresse.
De ce point de vue le rite magique se distingue du rite religieux non parce qu’il tend à l’illicite ou à l’individuel, puisqu’il peut viser une œuvre excellente tant au point de vue individuel qu’au point de vue social, la guérison d’une maladie ou l’abondance des récoltes, mais comme poursuivant une fin intéressée d’ordre matériel, tandis que le rite religieux tend à promouvoir l’idéal dans l’âme du suppliant. Nous avons indiqué du même coup comment le prêtre se distingue du sorcier.
On peut dire que dans un sens la magie est une calomniée : parce qu’indifférente au progrès spirituel et à la moralité, on l’a accusée de ne poursuivre que des fins criminelles. Lorsqu’Apulée s’efforçait de distinguer la bonne magie ou théurgie de la magie maudite ou goétie, on ne voulut point l’entendre, et cependant il est avéré que la magie agricole, la magie des métallurgistes, la magie médicale visent à de justes fins et travaillent souvent pour des intérêts éminemment sociaux.
La magie réunit à l’origine dans une confusion inévitable tout ce qui peut éveiller l’intérêt et les passions des hommes, la philosophie, les sciences, les techniques, le droit et la religion, mais tout cela informe et balbutiant. Puis sous l’action de ferments plus hautement rationnels, l’esprit critique et l’esprit d’équité, les techniques, les sciences se détachent peu à peu de l’indétermination primitive, perdent leur caractère magique et mystérieux pour devenir ce qu’elles sont aujourd’hui. Et tandis que l’expérience, ou mieux l’expérimentation, opérait cette dissociation dans la masse des pratiques et des connaissances magiques, l’idée d’équité et de moralité étroitement unies opérait une autre dissociation, d’où émergèrent la philosophie, le droit et la religion, ces trois formes de la sagesse ; tandis que cette germination, cette croissance, ces épanouissements venaient adoucir et embellir la vie, la magie, souche méprisée de ces floraisons humaines, la magie se mourait, semblable aux femmes douloureuses qui vivent juste assez pour donner au monde un enfant plein de force et de santé. À côté des fins aujourd’hui illicites de la magie, reconnaissons qu’elle eut d’autres fins nécessaires et précieuses. Ne soyons pas ingrats, ne la traitons pas d’antisociale, cette magie qui fut la connaissance, l’art et le culte de nos ancêtres, les balbutiements de leur sagesse barbare. Au contraire, louons pieusement ces premiers artisans inventeurs du soc et du levier qui ont su charmer les bêtes et capter le feu, pétrir le blé et fouler le raisin, magiques sacrifices d’où jaillirent pour l’humanité la force et la joie qui lui permirent de vivre jusqu’à nous.
Certes, la magie fut une humble chose, mais elle fut toute la rumeur de la pensée et de l’activité des premiers hommes, et de ce chef elle mérite l’hommage de notre piété et de notre justice.
Chapitre II.
La force magique
La magie, avons-nous dit, est une connaissance confuse participant à la fois de la science et de la philosophie, mais n’atteignant encore ni à l’une ni à l’autre. Néanmoins, cette connaissance n’est pas si balbutiante qu’elle n’implique des représentations, des signes, des classifications et des lois.
Les représentations magiques peuvent se ramener à deux types essentiels, d’une part les forces magiques et d’autre part les êtres spirituels : l’âme, les esprits, les démons et les dieux. Nous ne nous occuperons ici que des premières.
1° La force magique indifférente
Tous les primitifs ont expliqué ou tenté d’expliquer les activités de l’univers par un concept dynamique que l’on peut appeler la force magique. Cette force est assez difficile à définir, elle est de nature matérielle, bien qu’invisible et impalpable, et peut se comparer à une flamme obscure ou à un souffle insaisissable ; elle est en outre de nature intelligente et, sans être un esprit, participe de la nature spirituelle. On peut la définir une sorte de fluide matériel dépourvu d’intelligence personnelle, mais susceptible de recevoir, de s’incorporer et de répercuter l’impression de toutes les idées et de tous les esprits. On la retrouverait probablement chez tous les peuples primitifs si nous les connaissions mieux, il nous suffira de la reconnaître chez un certain nombre d’entre eux.
Cette notion est répandue chez les Mélanésiens sous le nom de mana. Le mana est présent dans toutes les activités de la nature et réside dans tous les êtres de l’univers, mais inégalement et avec des qualifications diverses.
Le sorcier ou le magicien est particulièrement doué de mana, c’est de lui qu’il tire sa force ; les noms des spécialistes en magie sont presque tous des composés de ce mot : peimana, gismana, mane hisu, etc.
Les êtres qui jouent un grand rôle dans la vie humaine sont tout particulièrement doués de mana : ce sont le soleil, la lune, certains astres, les animaux puissants et redoutables, les plantes vénéneuses et les plantes guérissantes, certaines pierres singulières par leur forme, leur éclat, leur rareté ou même une quelconque qualité. Ce sont aussi les éléments : la terre, l’eau, le feu, l’air ou le vent.
Comme la nature, les esprits de la nature eux aussi sont abondamment doués de mana ; il n’en est pas de même des âmes des morts qui le sont moins et très inégalement ; les âmes des chefs hardis et des sorciers puissants, seules, sont bien dotées.
Les phénomènes de la nature mettent en jeu du mana, de même l’activité de l’homme et celle des esprits ; mais il est des activités qui en sont tout particulièrement imprégnées, telles par exemple les tempêtes où circulent des troupes d’esprits et des flots de mana, telle l’activité rituelle du magicien et spécialement l’incantation et le sacrifice, telle encore l’invasion des esprits de la fièvre.





























