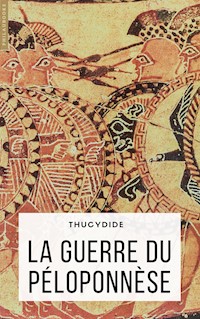
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Thucydide a écrit la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens, et est entré dans le détail de leurs exploits réciproques. Il a commencé son travail dès le temps des premières hostilités, persuadé que ce serait une guerre d’une grande importance, et même plus considérable que toutes celles qui avaient précédé. Sa conjecture n’était pas dépourvue de fondement : il voyait de part et d’autre les préparatifs répondre à l’état florissant auquel les deux peuples étaient parvenus, et le reste de la Grèce ou se déclarer dès lors pour l’un des deux partis, ou former du moins la résolution de s’y réunir. C’était le plus grand mouvement que la Grèce eût encore éprouvé, qui eût agité une partie des Barbares, et même qu’eût ressenti le monde entier.
La distance des temps ne permet pas de bien connaître les circonstances des événements qui ont immédiatement précédé cette guerre, et moins encore de ceux qui remontent à des époques plus reculées : mais, autant que je puis en juger, et portant mes regards jusque dans la plus haute antiquité, je crois qu’il n’y avait encore rien eu de grand ni dans la guerre ni dans tout le reste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
La guerre du Péloponnèse
Thucydide
Traduction parJean Alexandre Buchon Buchon.
philaubooks
Table des matières
Notice sur Thucydide
Livre 1
Livre 2
Livre 3
Livre 4
Livre 5
Livre 6
Livre 7
Livre 8
Notes
Notice sur Thucydide
Né vers l’an 471 avant J.-C. − Mort en 391.
Dans un article aussi savant que clair, inséré dans la Biographie universelle, M. Daunou a passé successivement en revue toutes les opinions émises par les anciens et les modernes sur la personne et les écrits de Thucydide, et les a mûrement et judicieusement discutées et pesées. J’ai puisé dans cet excellent travail les éléments de cette courte notice ; on ne craint pas de s’égarer en marchant à la suite de M. Daunou.
Suivant l’opinion la plus probable, Thucydide naquit en 471. Il appartenait à deux familles illustres, l’une en Thrace, l’autre dans l’Attique, et possédait dans un canton de la Thrace des mines d’or, qui le rendaient l’un des hommes les plus riches du continent. Olorus son père était, dit-on, descendant de cet Olorus, roi de Thrace, dont Miltiade épousa une des filles. À l’âge de quinze ans, Thucydide assista aux jeux Olympiques de l’année 456, et manifesta une vive émotion à la lecture qu’Hérodote y fit de son Histoire.
Depuis les jeux olympiques de 456 jusqu’à la prise d’Amphipolis par les Lacédémoniens en 424, on ne trouve rien de positif à dire sur lui. Il raconte, dans son Histoire, qu’il se trouvait à Thasos lorsqu’il reçut ordre de venir au secours d’Amphipolis ; qu’aussitôt il se mit en mer avec sept vaisseaux ; mais, qu’au moment où il arriva, sur le soir, les Lacédémoniens venaient de se rendre maîtres de la place. Malgré le service qu’il avait rendu en préservant au moins le port d’Éion, de manière à repousser toute tentative du général Lacédémonien, les Athéniens, irrités de la perte d’Amphipolis, condamnèrent Thucydide à l’exile. Il parle sans amertume de cette condamnation qui se prolongea pendant vingt ans, c’est-à-dire jusqu’à l’année 403, au moment où se terminait la guerre du Péloponnèse.
Pendant ces vingt années passées hors de sa patrie, il visita successivement les différentes nations belligérantes, et profita de ses loisirs pour recueillir les meilleurs renseignements sur les affaires du Péloponnèse. Déjà, dès l’ouverture de la guerre du Péloponnèse en 431, il avait entrepris d’en écrire l’histoire, et il avait alors quarante ans. Ce travail continua à l’occuper pendant son exil. Ainsi, ce serait entre les années 431 et 403 qu’aurait été composé ce bel ouvrage. À la fin de son troisième livre, il parle d’une éruption de l’Etna, dont M. Daunou fixe la date à l’année 395 : il a donc au moins vécu jusque-là ; mais il faut qu’il n’ait pas atteint au-delà des premiers mois de l’année 391, puisque ce fut vers la fin de cette année que ses héritiers communiquèrent ses écrits à Xénophon.
L’histoire de Thucydide, telle que nous la possédons, est divisée en huit livres ; cette division qui a quelquefois varié dans les temps anciens est universellement adoptée aujourd’hui.
Le livre premier est consacré à l’exposition : il contient un tableau rapide des plus anciens temps de la Grèce, tel qu’une critique sévère a pu lui en prouver la certitude, et le résumé des causes qui ont amené la guerre du Péloponnèse.
Avec le second livre, commence le récit de cette guerre. Il y comprend les trois premières années, d’avril 431 à juillet 428, en suivant toujours dans son récit l’ordre des temps par été et par hiver. L’été est, pour lui, les six mois renfermés entre l’équinoxe du printemps, où s’ouvrait la campagne militaire, à l’équinoxe d’automne, et l’hiver renfermait les six autres mois.
Les livres trois et quatre contiennent les six années suivantes jusqu’au printemps de 422.
Le cinquième livre s’étend de 422 à 416.
Le sixième livre s’ouvre au mois d’octobre 416, qui est principalement consacré aux événements de Sicile dont il retrace l’histoire ancienne.
Le septième ne correspond qu’à l’année écoulée depuis le milieu de 414 jusqu’à l’automne de 413. C’est celui où l’intérêt historique est porté au plus haut degré.
Le huitième est si inférieur aux sept précédents, que plusieurs critiques ont déclaré qu’il n’était pas de lui. « Le ton de l’auteur, dit M. Daunou, s’abaisse tout à coup, et s’affaiblit à tel point qu’on dirait qu’il ne prend plus le même intérêt à sa matière ; sa diction devient moins précise, plus monotone, moins élégante. Selon toute apparence, l’historien s’était promis de retoucher et de perfectionner cette section de son ouvrage, qui, d’ailleurs, ne devait pas être la dernière, car elle se termine en 412, vingt et unième année de la guerre du Péloponnèse, et il avait annoncé le projet d’étendre son travail jusqu’à la vingt-septième et dernière année. »
L’Histoire de Thucydide paraît avoir été assez peu connue de son vivant. Peut-être l’estime qu’il y professe pour les Lacédémoniens retarda-t-elle pendant quelques années l’expression de l’estime qui lui était due. Quelques écrivains anciens ont rapporté qu’en l’année 391 il n’en existait qu’un seul exemplaire dont Xénophon se fit l’éditeur. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’au temps de Démosthènes, elle était fort répandue et hautement appréciée par tous les bons esprits et qu’elle a pris, parmi les meilleures compositions anciennes et modernes, une prééminence qu’elle a toujours conservée depuis.
Les manuscrits les plus anciens que l’on en possède ne remontent pas au-delà du onzième siècle. La bibliothèque du roi en possède treize qui ont été décrits par M. Gail.
La première traduction de Thucydide a été faite en latin par Laurent Valla et imprimée à Venise en 1474 ; depuis cette époque il a été traduit dans toutes les langues et réimprimé dans tous les pays. La plus ancienne traduction française est celle de Claude Seyssel, imprimée pour la première fois à Paris en 1527, en un volume in-folio, pour l’usage de Louis XII. Seyssel, en suivant l’interprétation latine de Valla, avait toujours consulté Lascaris sur les passages douteux ; mais, malgré tous les efforts de Seyssel pour mettre son style français à la hauteur de l’original, malgré l’estime qu’avait pour lui Charles-Quint qui portait toujours cette traduction dans ses voyages, sa traduction est illisible aujourd’hui.
Une seconde traduction de Thucydide fut publiée en 1610, in-folio, à Genève, par Louis Jausaud d’Usez. Si Jausaud savait le grec, il savait peu le français, et ce n’est qu’à l’aide du texte que l’on peut comprendre sa traduction, qui, pour être littérale, n’est pas exempte de contre-sens.
Perrot d’Ablancourt, dont les traductions étaient appelées de belles infidèles, a donné aussi, en 1662, une traduction de Thucydide : elle n’est plus qu’infidèle sans être belle.
La plus consciencieuse et la meilleure est celle qui a été publiée par l’Évesque. C’était un homme savant qui comprenait bien son auteur, et dont le style assez facile se lit avec plaisir. Il voile encore les nobles traits de Thucydide, mais sans les cacher ; c’est la traduction que nous avons adoptée. Nous avons aussi conservé les notes les plus utiles de l’Évesque.
Voici la manière dont l’Évesque s’exprime lui-même sur sa traduction et sur son auteur :
« Que le lecteur ne s’attende point à reconnaître dans cette traduction la fière stature et la physionomie imposante de Thucydide : elle n’en offre que le squelette, qui pourra donner seulement une idée des fortes proportions de ce grand historien. Je n’ai jamais cru aux traductions faites d’après des auteurs qui ont eu du génie dans le style : j’y ai cru d’autant moins que la langue du traducteur avait moins d’abondance, d’harmonie, de liberté, de hardiesse que celle de l’auteur. On pourrait alors comparer l’interprète à un peintre qui voudrait copier le chef-d’œuvre d’un grand coloriste, et à qui manqueraient la plupart des couleurs dont le maître a composé ses teintes.
« Cent fois j’ai voulu détruire mon travail plus ou moins avancé ; je me faisais pitié en comparant ma sèche copie aux effrayantes beautés de l’original. J’ai continué cependant ; non pour offrir à mon pays ce qui rend Thucydide admirable, mais ce qui rend utile la lecture de son histoire. La traduction de cet historien manque à la France, car on ne peut donner le nom de traduction à l’infidèle abrégé de Perrot d’Ablancourt. Je craignais d’un côté qu’elle ne manquât longtemps encore, et que la difficulté de l’exécution ne continuât de rebuter ceux qui, par leurs études, seraient capables de s’y livrer. Je craignais de l’autre que dans la foule des imposteurs littéraires, il n’en vint un qui osât publier Thucydide mis en français d’après une traduction latine ou même anglaise. Par une telle copie de copie, on ne pourrait manquer de lui faire perdre ce que j’ai tâché du moins de lui conserver : une précision que l’original peut seul inspirer ; un caractère de fermeté qui s’affaiblit toujours dans une interprétation, mais qui se détruit entièrement quand un interprète ne parle que d’après un autre interprète1 ; les tours de phrase qui sont communs à la langue grecque et à la nôtre, et les expressions qui se correspondent dans les deux langues : car l’idiome des Français est rempli d’hellénismes ; avantage qu’il doit, peut-être, à l’antique colonie fondée à Marseille par les Phocéens2.
« J’ai fait les plus grands efforts pour rendre ma version aussi précise que le permettait notre langue. J’ai tâché de ne pas traduire seulement la pensée de mon auteur, mais de traduire encore sa phrase : c’est-à-dire de laisser, autant qu’il était possible, les différents membres de la phrase, et même les principales expressions, dans l’ordre où il les avait placés ; et j’ai reconnu que ma traduction perdait d’autant moins, que je pouvais atteindre de plus près à cette conservation du tour original. Plus d’une fois même, en relisant les morceaux que je croyais, avoir les moins malheureusement traduits, j’ai senti qu’ils pouvaient gagner encore, si j’exprimais une particule que j’avais omise, et qui se trouvait dans le texte. L’exactitude que j’ai recherchée rendra peut-être ma traduction plus utile que les traductions latines aux personnes qui, sans avoir fait de grands progrès dans la langue grecque, voudront étudier Thucydide dans sa langue3.
« Quoi que la noble émulation de lutter contre Hérodote ait fait entreprendre à Thucydide la composition de son Histoire, il ne s’est pas rendu l’humble imitateur du père de l’histoire. Hérodote a été comparé à Homère, et il a de grands rapports avec ce poète par l’abondance de son style et le charme de sa narration, toujours si libre et si facile, qu’il semble être venu aux jeux Olympiques, et y avoir raconté sans préparation ce qu’il avait recueilli dans ses voyages. C’est un fleuve majestueux qui coule paisiblement et sans obstacle, toujours plein, jamais bruyant, et conservant ses eaux pures et limpides. Tel qu’un vieillard qui aime à conter, et qui ne sacrifie pas volontiers ce que lui rappelle sa mémoire, il divague dans ses récits, et ne les rend que plus agréables en leur prêtant le charme de la variété. Il multiplie les épisodes, sait les fondre, avec un art admirable, avec les actions principales qu’ils semblent n’interrompre que pour fournir des repos au lecteur. Il ne rejette pas même les fables ; on voit qu’il les aime, et il n’en est que plus assuré de plaire. Dans son ouvrage, comme dans les poèmes d’Homère, on ne lit pas, on est spectateur ; on assiste aux entretiens des personnages, on est avec eux. L’auteur n’a pas besoin de tracer leurs portraits, puisqu’on les voit eux-mêmes, puisqu’on est témoin de leurs mœurs, de leurs discours, de leurs pensées. C’est surtout par ce caractère que l’ouvrage d’Hérodote tient le milieu entre l’histoire et le poème épique.
« Sérieux au contraire et taciturne, Thucydide avait reçu de la nature la physionomie de son caractère ; et il porte ce caractère dans ses écrits. Il pense, en quelque sorte, plus qu’il ne parle ; il s’efforce d’offrir à ses lecteurs plus de choses que de mots. Loin de vouloir briller et plaire par l’abondance du style, il ne songe qu’à le serrer ; quelquefois même il devient obscur, pour être trop avare de paroles. On est donc obligé de le lire comme il écrivait ; et de même qu’il pensait beaucoup en écrivant, il faut aussi penser beaucoup pour le lire, et travailler avec lui, au lieu de ne faire que s’amuser en l’écoutant. Il peut fatiguer les lecteurs peu réfléchis, et il impose même une attention soutenue à ceux qui ont l’habitude de la réflexion. Hérodote entraîne ; Thucydide attache : mais de la même manière qu’on s’attache à un travail intéressant, pour lequel on s’anime, et dont on s’obstine à vaincre la difficulté. Comme il épargne les paroles et que souvent il n’en dit pas assez pour exprimer tout ce qu’il pense, c’est au lecteur à trouver, par le peu qu’il a dit, tout ce qu’il a voulu dire, comme il faut pénétrer la pensée des hommes qui n’aiment point à parler.
« Thucydide offre donc surtout le mérite d’un penseur profond ; et, comme le même homme ne peut associer les qualités contraires, il n’a pas le mérite d’être ce qu’on appelle un narrateur agréable : car ce qui constitue l’agrément d’une narration, c’est de procurer à l’auditeur un plaisir toujours nouveau, sans lui donner jamais la moindre peine.
« Cependant il existe plusieurs genres de narrations, et elles supposent aussi des mérites différents. Il en est un que l’on trouve éminemment dans Thucydide : celui de décrire et de peindre. Il le développe dans le récit des sièges, des batailles, des combats maritimes, des désordres populaires, des malheurs qui frappent les nations ; il le fait briller de tout son éclat dans le récit de la fameuse peste d’Athènes : tableau poétique que le poète Lucrèce, si savant dans l’art de peindre, s’est contenté d’imiter ou plutôt de traduire, et qui est un des plus beaux morceaux de son poème.
« Cependant, comme si Thucydide avait eu plusieurs esprits qui l’inspiraient à sa volonté, supérieur à tous les historiens dans les descriptions voisines de la poésie, il laisse, quand il le veut, bien au-dessous de lui tous ses rivaux dans les narrations simples, élégantes et pures. C’est ce que les anciens ont remarqué sur plusieurs endroits de son ouvrage, et, entre autres, sur le récit de l’imprudente et malheureuse entreprise de Cylon. Ils disaient : « Ici le lion a ri ».
« Les modernes auraient une fausse idée de la manière des anciens si, d’après ce que je viens de dire, ils s’attendaient à trouver presque partout, dans Thucydide, cette force, cette fierté qui fait son caractère. À l’exemple d’Homère, il se fait du sommeil un besoin ou plutôt un devoir. Il raconte à ses lecteurs, ou leur indique les faits sur lesquels il ne juge pas nécessaire de fixer leur attention, avec une simplicité à laquelle nos plus modestes gazetiers refuseraient de descendre. C’est peut-être ce que les lecteurs français auront peine à lui pardonner ; ils veulent qu’un auteur soit beau partout : c’est vouloir qu’aucune de ses beautés n’éclate, et que chez lui rien ne brille, parce que tout éblouit.
« Hérodote avait fait entrer dans ses livres un assez grand nombre d’entretiens et de mots remarquables, prononcés par les personnages qu’il introduit sur la scène historique. Thucydide fut le premier qui sema l’histoire d’un grand nombre de longues harangues. Cette pratique a été blâmée par les modernes : elle l’a même été par quelques-uns des anciens ; mais seulement, je crois, depuis que les républiques de la Grèce furent soumises à la puissance de Rome. Chez les peuples soumis, un maître commande, et l’on obéit : dans les états libres, il n’est point de maîtres : celui qui veut conduire les autres doit commencer par les persuader. Les harangues étaient donc convenables à l’histoire du temps de Thucydide. C’était par des harangues que les conducteurs du peuple faisaient décider la guerre, la paix, les alliances ; par des harangues qu’on obtenait la punition ou l’absolution des accusés ; par des harangues que les généraux excitaient les soldats à bien servir la patrie. Elles étaient donc des parties intégrantes de l’histoire. Thucydide, il est vrai, n’a pas rapporté les discours précisément tels qu’ils avaient été prononcés ; mais il nous avertit qu’il s’en est procuré du moins le fond, quand il n’a pu les entendre lui-même4 : il n’a fait que les soumettre à son art.
« D’ailleurs, comme l’a très bien observé Perrot d’Ablancourt5, il avait une vue juste et profonde en faisant entrer, dans son Histoire, l’ornement au moins vraisemblable des harangues. Il sentait que le lecteur veut suivre un récit, et n’être pas interrompu par les réflexions longues et fréquentes de l’historien. Il conçut donc la pensée de tromper ses lecteurs en piquant leur curiosité. Ils étaient curieux de savoir ce qu’avaient dit, dans les occasions importantes, les principaux personnages de l’histoire : ce fut ces personnages qu’il supposa pénétrés des grandes vues politiques qui le distinguent entre tous les autres historiens.
« Quoique les harangues de Thucydide, considérées comme les accessoires d’un ouvrage historique, soient d’une assez longue étendue, il était obligé de les resserrer beaucoup plus qu’il ne l’aurait désiré, pour y faire entrer toutes les pensées qui lui étaient inspirées par le sujet : il en pressait le style, et la plus grande concision ne suffisait pas encore à renfermer l’abondance de ses conceptions. C’est aussi dans ses harangues qu’il est le plus riche de pensées et le plus avare de paroles : c’est là qu’il faut le deviner, et suppléer par la réflexion à toutes les idées qu’il insinue plutôt qu’il ne les exprime, et qui seraient nécessaires au développement de ce qu’il veut faire entendre ; c’est là, surtout, qu’on l’interprète quelquefois plutôt qu’on ne le comprend, et que Cicéron trouvait des pensées tellement obscures, qu’il était presque impossible de les saisir.
« Ce n’est pas seulement pour avoir épargné les mots que Thucydide est obscur ; il l’est encore par l’ordre dans lequel il les dispose, ou si l’on veut, par le désordre dans lequel il se plaît à les jeter. Il aime le fréquent usage de la figure que les grammairiens grecs nommaient hyperbate et qui consiste à troubler l’ordre des mots : figure employée fréquemment par les poètes lyriques, et qu’un historien devrait peut-être s’interdire, parce que son devoir est d’être clair. Il aime aussi à ressusciter des mots anciens, à en créer de nouveaux, à introduire dans la prose des expressions jusque-là réservées à la poésie : nouvelle source de difficultés pour les lecteurs. Pénétré de la sublimité de son sujet, il voulut en exprimer les principales parties dans le style sublime, et crut que le sublime d’expressions, consacré à la plus haute poésie, convenait à la grandeur de ce sujet, comme il s’accordait avec celle de son propre caractère, il veut plutôt être noble, grave, imposant et même terrible, que de se parer d’une aimable élégance. Loin de chercher un froid purisme, il affecte de s’approcher du solécisme6. Souvent il est âpre et dur dans son style, parce qu’il veut se hérisser de cette aspérité ; parce qu’il croit faire plus d’impression en frappant rudement l’oreille, que s’il la caressait de mots harmonieux : fait retentir sa phrase du cliquetis des armes, des cris aigus des combattants, du bruit des vaisseaux qui se heurtent et se brisent. Il étonne, et c’est ce qu’il se propose : sa prétention est de se faire admirer ; il dédaigne le soin d’être aimable. L’élégance ne convient point à sa force, et il affecte de montrer cette force dans tout ce qu’elle a d’effrayant7.
« Hérodote sera toujours préféré par les hommes qui, dans leurs lectures, ne cherchent que le plaisir : Thucydide, par ceux qui aiment une lecture qui les oblige à penser. Démosthènes le regardait comme un grand maître d’éloquence, et le copia, dit-on, tout entier huit fois de sa main. On ajoute même qu’une fois il l’écrivit tout entier de mémoire. Ce n’est pas, comme le remarque Cicéron, que l’éloquence de Thucydide convienne aux tribunaux ni à la place publique ; mais l’orateur y trouve tous les grands moyens que peut fournir le génie, et qu’il n’a plus qu’à développer suivant les règles de son art. »
Je terminerai cet article8 par un résumé qui reproduira de la manière la plus claire les divers événements de la vie de Thucydide. Ce tableau est fait d’après la chronologie de Dodwell.
1
I. Thucydide1 a écrit la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens, et est entré dans le détail de leurs exploits réciproques. Il a commencé son travail dès le temps des premières hostilités, persuadé que ce serait une guerre d’une grande importance, et même plus considérable que toutes celles qui avaient précédé. Sa conjecture n’était pas dépourvue de fondement : il voyait de part et d’autre les préparatifs répondre à l’état florissant auquel les deux peuples étaient parvenus, et le reste de la Grèce ou se déclarer dès lors pour l’un des deux partis, ou former du moins la résolution de s’y réunir. C’était le plus grand mouvement que la Grèce eût encore éprouvé, qui eût agité une partie des Barbares, et même qu’eût ressenti le monde entier. La distance des temps ne permet pas de bien connaître les circonstances des événements qui ont immédiatement précédé cette guerre, et moins encore de ceux qui remontent à des époques plus reculées : mais, autant que je puis en juger, et portant mes regards jusque dans la plus haute antiquité, je crois qu’il n’y avait encore rien eu de grand ni dans la guerre ni dans tout le reste.
II. On voit en effet que le pays qui porte aujourd’hui le nom de Grèce, n’était point encore habité d’une manière constante ; mais qu’il était sujet à de fréquentes émigrations, et que ceux qui s’arrêtaient dans une contrée, l’abandonnaient sans peine, repoussés par de nouveaux occupants qui se succédaient toujours en plus grand nombre. Comme il n’y avait point de commerce ; que les hommes ne pouvaient sans crainte communiquer entre eux, ni par terre ni par mer ; que chacun ne cultivait que ce qui suffisait à sa subsistance, sans connaître les richesses ; qu’ils ne faisaient point de plantations, parce que n’étant pas défendus par des murailles, ils ne savaient pas quand on viendrait leur enlever le fruit de leur labeur ; comme chacun enfin croyait pouvoir trouver partout sa subsistance journalière, il ne leur était pas difficile de changer de place. Avec ce genre de vie, ils n’étaient puissants, ni par la grandeur des villes, ni par aucun autre moyen de défense. Le pays le plus fertile était celui qui éprouvait les plus fréquentes émigrations : telles étaient la contrée qu’on nomme à présent Thessalie, la Béotie, la plus grande partie du Péloponnèse, dont il faut excepter l’Arcadie, et les autres enfin en proportion de leur fécondité : car dès que, par la bonté de la terre, quelques peuplades avaient augmenté leur force, cette force donnait lieu à des séditions qui en causaient la ruine, et elles se trouvaient d’ailleurs plus exposées aux entreprises du dehors. L’Attique, qui, par l’infertilité d’une grande partie de son sol, n’a point été sujette aux séditions, a toujours eu les mêmes habitants. Et ce qui n’est pas une faible preuve de l’opinion que j’établis, c’est qu’on ne voit pas que des émigrations aient contribué de même à l’accroissement des autres contrées. C’était Athènes que choisissaient pour refuge les hommes les plus puissants de toutes les autres parties de la Grèce, quand ils avaient le dessous à la guerre, ou dans des émeutes : ils n’en connaissaient point de plus sûr ; et devenus citoyens, on les vit, même à d’anciennes époques, augmenter la population de la République : on envoya même dans la suite des colonies en Ionie, parce que l’Attique ne suffisait plus à ses habitants.
III. Ce qui me prouve encore bien la faiblesse des anciens, c’est qu’on ne voit pas qu’avant la guerre de Troie, la Grèce n’ait rien fait en commun. Je crois même qu’elle ne portait pas encore tout entière le nom d’Hellade qu’on lui donne aujourd’hui, on plutôt qu’avant Hellen, fils de Deucalion, ce nom n’existait pas encore : les différentes peuplades donnaient leur nom à la contrée qu’elles occupaient. Mais Hellen et ses fils ayant acquis de la puissance dans la Phtiotide, et ayant été appelés dans d’autres villes par des peuples qui imploraient leur secours, le nom d’Hellènes, par une suite de ce commerce, fut celui qui servit le plus à désigner chacun de ces peuples. Il est vrai cependant que longtemps ce nom ne put l’emporter sur les autres au point de devenir commun à tous les Grecs : c’est ce que prouve surtout Homère. Quoique né fort longtemps après la guerre de Troie, il n’a pas compris sous une dénomination générique tous les alliés, pas même ceux qui étaient partis de la Phtiotide avec Achille, et qui furent cependant les premiers Hellènes ; mais il nomme distinctement dans ses vers les Danaëns, les Argiens et les Achéens. Il n’a pas employé non plus le mot de barbare2, par la raison, comme je le crois, que les Grecs ne s’étaient pas désignés eux-mêmes par un terme distinctif opposé à celui d’étrangers. Ainsi donc chaque société d’Hellènes en particulier, et les races qui s’entendaient mutuellement, quoique partagées en différentes villes, et qui furent comprises dans la suite sous un nom générique, faibles et sans commerce entre elles, ne firent rien d’un commun effort avant la guerre de Troie ; et même si elles se réunirent pour cette expédition, c’est que la plupart commençaient à pratiquer la mer.
IV. De tous les souverains dont nous ayons entendu parler, Minos est celui qui eut le plus anciennement une marine. Il était maître de la plus grande partie de la mer qu’on appelle maintenant Hellénique ; il dominait sur les Cyclades, et forma des établissements dans la plupart de ces îles, après en avoir chassé les Cariens : il en donna le gouvernement à ses fils, et les purgea sans doute, autant qu’il put, de brigands, pour s’en mieux assurer les revenus.
V. Anciennement ceux des Grecs ou des Barbares qui vivaient dans le continent au voisinage de la mer, ou qui occupaient des îles, n’eurent pas plus tôt acquis l’habileté de passer les uns chez les autres sur des vaisseaux, qu’ils se livrèrent à la piraterie. Les hommes les plus puissants de la nation se mettaient à leur tête ; ils avaient pour objet leur profit particulier, et le désir de procurer la subsistance à ceux qui n’avaient pas la force de partager leurs fatigues. Ils surprenaient des villes sans murailles3 dont les citoyens étaient séparés par espèces de bourgades, et ils les mettaient au pillage : c’était ainsi qu’ils se procuraient presque tout ce qui est nécessaire à la vie. Ce métier n’avait rien de honteux, ou plutôt il conduisait à la gloire. C’est ce dont nous offrent encore aujourd’hui la preuve certains peuples chez qui c’est un honneur de l’exercer avec adresse : c’est aussi ce que nous font connaître les plus anciens poètes. Partout, dans leurs ouvrages, ils font demander aux navigateurs s’ils ne sont pas des pirates ; c’est supposer que ceux qu’on interroge ne désavoueront pas cette profession, et que ceux qui leur font cette question ne prétendent pas les insulter. Les Grecs exerçaient aussi par terre le brigandage les uns contre les autres, et ce vieil usage dure encore dans une grande partie de la Grèce ; chez les Locriens-Ozoles, chez les Étoliens, chez les Acarnanes, et dans toute cette partie du continent. C’est du brigandage qu’est resté chez ces habitans de la terre ferme l’usage d’être toujours armés.
VI. Sans défense dans leurs demeures, sans sûreté dans leurs voyages, les Grecs ne quittaient point les armes ; ils s’acquittaient armés des fonctions de la vie commune, à la manière des Barbares. Les endroits de la Grèce où ces coutumes sont encore en vigueur prouvent qu’il fut un temps où des coutumes semblables y régnaient partout. Les Athéniens les premiers déposèrent les armes, prirent des mœurs plus douces, et passèrent à un genre de vie plus sensuel. Il n’y a pas encore longtemps que chez eux les vieillards de la classe des riches ont cessé de porter des tuniques de lin, et d’attacher des cigales d’or dans les nœuds de leur chevelure rassemblée sur le sommet de la tête. C’est de là que les vieillards d’Ionie, ayant en général la même origine, avaient aussi la même parure. Les Lacédémoniens furent les premiers à prendre des vêtements simples, tels qu’on les porte aujourd’hui ; et dans tout le reste, les plus riches se mirent chez eux à observer, dans leur manière de vivre, une grande égalité avec la multitude. Ils furent aussi les premiers qui, dans les exercices, se dépouillèrent de leurs habits, et se frottèrent d’huile en public. Autrefois, même dans les jeux olympiques, les athlètes, pour combattre, se couvraient d’une ceinture les parties honteuses, et il n’y a pas bien des années que cet usage a cessé. Encore à présent, chez quelques-uns des Barbares et surtout chez les Asiatiques, on propose des prix de la lutte et du pugilat, et ceux qui les disputent portent une ceinture. On pourrait donner bien d’autres preuves que les mœurs des Grecs furent celles que conservent encore aujourd’hui les Barbares.
VII. Les sociétés qui se sont rassemblées plus récemment et dans les temps où la mer fut devenue plus libre, ayant une plus grande abondance de richesses, se sont établies sur les rivages, et se sont entourées de murailles ; elles se sont emparées des isthmes pour l’avantage du commerce et pour se mieux fortifier contre leurs voisins. Mais comme la piraterie fut longtemps en vigueur, les anciennes villes, tant dans les îles que sur le continent, furent bâties loin de la mer ; car les habitants des côtes, même sans être marins, exerçaient le brigandage entre eux et contre les autres ; ces villes, construites loin des rivages, subsistent encore aujourd’hui.
VIII. Les insulaires n’étaient pas les moins adonnés à la piraterie. Tels étaient les Cariens et les Phéniciens ; ils occupaient la plupart des îles : on en a une preuve. Quand les Athéniens, dans la guerre actuelle, purifièrent Délos et qu’on enleva tous les tombeaux, on remarqua que plus de la moitié des morts étaient des Cariens. On les reconnaissait à la forme de leurs armes ensevelies avec eux, et à la manière dont ils enterrent encore aujourd’hui les morts. Mais quand Minos eut établi une marine, la navigation devint plus libre : il déporta les malfaiteurs qui occupaient les îles, et dans la plupart il envoya des colonies. Les habitants du voisinage de la mer, ayant acquis plus de richesses, se fixèrent davantage dans leurs demeures, et plusieurs s’entourèrent de murailles, devenus plus opulents qu’ils ne l’avaient été. L’inégalité s’établit ; car épris de l’amour du gain, les plus faibles supportèrent l’empire du plus fort ; et les plus puissants, qui jouissaient d’une grande fortune, se soumirent les villes inférieures. Telle était en général la situation des Grecs, quand ils s’armèrent contre les Troyens.
IX. Si Agamemnon parvint à rassembler une flotte, je crois que ce fut bien plutôt parce qu’il était le plus riche des Grecs de son temps, que parce que les amans d’Hélène, qu’il conduisait, s’étaient liés par un serment fait entre les mains de Tyndare4. Ceux qui, sur le rapport des anciens, ont le mieux connu les traditions dont les peuples du Péloponnèse conservent le souvenir, disent que Pélops s’établit une puissance sur des hommes pauvres, par les grandes richesses qu’il apporta de l’Asie ; que tout étranger qu’il était, il donna son nom au pays où il vint se fixer, et qu’une force plus grande encore s’accumula sur ses descendants, après que les Héraclides eurent tué dans l’Attique Eurysthée, dont Atrée était l’oncle maternel. Eurysthée, partant pour une expédition guerrière, lui confia, comme à son parent, la ville de Mycènes et sa domination. Il fuyait son père qui avait donné la mort à Chrysippe. Comme il ne revint pas, Atrée fut roi de Mycènes et de tout ce qui avait été soumis à Eurysthée ; il parvint à cette puissance de l’aveu même des Mycéniens, qui craignaient les Héraclides ; il paraissait d’ailleurs capable de régner, et il avait eu l’adresse de flatter le peuple. Dès lors les Pélopides furent plus puissants que les descendants de Persée. Agamemnon réunit sur sa tête tout cet héritage, et comme il l’emportait sur les autres par sa marine, il parvint moins par amour, je crois, que par crainte, à rassembler une armée et à s’en rendre le chef. On voit qu’en partant c’était lui qui avait le plus grand nombre de vaisseaux, et qu’il en fournit encore aux Arcadiens ; c’est ce que nous apprend Homère, si l’on en veut croire son témoignage. Ce même poète, en parlant du sceptre qui passa dans les mains d’Agamemnon, dit que ce prince régnait sur un grand nombre d’îles et sur tout Argos. Habitant du continent, s’il n’avait pas eu de marine, il n’aurait dominé que sur les îles voisines, qui ne pouvaient être en grand nombre. C’est par l’expédition de Troie qu’on peut se faire une idée de celles qui avaient précédé.
X. De ce que Mycènes avait peu d’étendue ou de ce que certaines villes de ce temps-là semblent aujourd’hui peu considérables, on aurait tort de conclure, comme d’une preuve assurée, que la flotte des Grecs n’ait pas été aussi considérable que l’ont dit les poètes et que le porte la tradition ; car si la ville de Lacédémone était dévastée, et qu’il ne restât que ses temples et les fondements des autres édifices, je crois qu’après un long temps, la postérité, comparant ces vestiges avec la gloire de cette république, ajouterait peu de foi à sa puissance. Et cependant sur cinq parties du Péloponnèse, elle en possède deux5 ; elle commande au reste et elle a au dehors un grand nombre d’alliés. Mais comme la ville n’est pas composée de bâtiments contigus, comme on n’y recherche la magnificence ni dans les temples ni dans les autres édifices, et que la population y est distribuée par bourgades, suivant l’ancien usage de la Grèce, elle paraît bien au-dessous de ce qu’elle est. Si de même il arrivait qu’Athènes fut dévastée, on se figurerait, à l’inspection de ses ruines, que sa puissance était double de ce qu’elle est en effet. Le doute est donc déplacé : c’est moins l’apparence des villes qu’il faut considérer que leur force ; et l’on peut croire que l’expédition des Grecs contre Troie fut plus considérable que celles qui avaient précédé, et plus faible que celles qui se font maintenant. S’il faut accorder ici quelque confiance au poème d’Homère, dans lequel sans doute, en sa qualité de poète, il a embelli les choses en les exagérant, on ne laissera pas de reconnaître que cette expédition le cédait à celles de nos jours. Il la suppose de douze cents vaisseaux ; il fait monter de cent vingt hommes ceux des Bœotiens, et de cinquante ceux de Philoctète ; et comme dans son énumération il ne parle point de la force des autres, je crois qu’il indique les plus grands et les plus petits. Il ne nous laisse pas ignorer que tous les hommes qui montaient le vaisseau de Philoctète étaient à la fois rameurs et guerriers ; car il fait des archers de tous ceux qui maniaient la rame. Il n’est pas vraisemblable qu’il y eût sur les bâtiments beaucoup d’hommes étrangers à la manœuvre, si l’on excepte les rois et ceux qui étaient dans les plus hautes dignités, surtout lorsqu’on devait faire la traversée avec tous les équipages de guerre ; d’ailleurs les vaisseaux n’étaient pas pontés, ils étaient conformes à l’ancienne construction et ressemblaient à ceux de nos pirates. En prenant donc un milieu entre les plus forts bâtiments et les plus faibles, on voit que le total de ceux qui les montaient ne formait pas un grand nombre de troupes, eu égard à une entreprise que la Grèce entière partageait.
XI. C’est ce qu’il faut moins attribuer à la faiblesse de la population qu’à celle des richesses. Faute de subsistances, on ne leva qu’une armée assez peu considérable, dans l’espérance que la guerre elle-même pourrait la nourrir en pays ennemi. Arrivés dans la campagne de Troie, les Grecs gagnèrent une bataille, c’est un fait certain ; car sans cela ils n’auraient pu se construire un camp fermé de murailles. On voit que même ils n’y rassemblèrent pas toutes leurs forces, et que, par disette de vivres, ils se mirent à cultiver la Chersonèse, et à faire le brigandage. C’est à quoi il faut surtout attribuer la résistance des Troyens pendant dix ans ; comme les Grecs étaient dispersés, leurs ennemis se trouvaient toujours en force égale contre ceux qui restaient. Mais s’ils étaient arrivés avec des munitions abondantes, restés ensemble, ils auraient fait continuellement la guerre sans se distraire par le brigandage et l’agriculture ; et supérieurs dans les combats, ils auraient pris aisément la place. Ils furent même en état, sans être réunis, de résister avec la portion de troupes qui était toujours prête au combat ; attachés constamment au siège, ils se seraient rendus maîtres de Troie en moins de temps et avec moins de peine. Ainsi, faute de richesses, les entreprises antérieures avaient été faibles, et celle-là même, bien plus célèbre que les précédentes, fut au-dessous en effet de la renommée et des récits accrédités aujourd’hui sur la foi des poètes.
XII. Et même encore après la guerre de Troie, la Grèce, toujours sujette aux déplacements et aux émigrations, ne put prendre d’accroissement, parce qu’elle ne connaissait pas de repos. Le retour tardif des Grecs occasionna bien des révolutions ; il y eut des soulèvements dans la plupart des villes, et les vaincus allèrent fonder de nouveaux états. La soixantième année après la prise d’Ilion, les Bœotiens d’aujourd’hui, chassés d’Arné par les Thessaliens, s’établirent dans la contrée appelée maintenant Bœotie ; elle se nommait auparavant Cadméide. Il s’y trouvait dès longtemps une portion de ce peuple, et elle avait envoyé des troupes devant Ilion. Ce fut dans la quatre-vingtième année après la prise de cette ville, que les Doriens occupèrent le Péloponnèse avec les Héraclides.
Après une longue période de temps, la Grèce, parvenue enfin avec peine à un repos solide et n’éprouvant plus de séditions, envoya hors de son sein des colonies : les Athéniens en fondèrent dans l’Ionie et dans la plupart des îles ; les Péloponnésiens dans l’Italie, dans la plus grande partie de la Sicile et dans quelques endroits du reste de la Grèce. Tous ces établissements sont postérieurs au siège de Troie.
XIII. Quand la Grèce fut devenue plus riche et plus puissante, des tyrannies6 s’établirent dans la plupart des villes, à mesure que les revenus y augmentaient. Auparavant la dignité royale était héréditaire7, et les prérogatives en étaient déterminées. Les Grecs alors construisirent des flottes et se livrèrent davantage à la navigation. On dit que les Corinthiens changèrent les premiers la forme des vaisseaux, qu’ils les construisirent sur un modèle à peu près semblable à celui d’aujourd’hui, et que ce fut à Corinthe que furent mises sur le chantier les premières trirèmes grecques. On sait que le constructeur Aminoclès, de Corinthe, fit aussi quatre vaisseaux pour les Samiens. Il s’est écoulé tout au plus trois cents ans jusqu’à la fin de la guerre dont j’écris l’histoire, depuis qu’Aminoclès vint à Samos. Le plus ancien combat naval dont nous ayons connaissance est celui des Corinthiens contre les Corcyréens ; il ne remonte pas à plus de deux cent soixante ans au-dessus de la même époque.
Corinthe, par sa situation sur l’isthme, fut presque toujours une place de commerce, parce qu’autrefois les Grecs, tant ceux de l’intérieur du Péloponnèse que ceux du dehors, faisant bien plus le négoce par terre que par mer, traversaient pour communiquer entre eux, l’intérieur de cette ville. Les Corinthiens étaient donc puissants en richesses, comme le témoignent les anciens poètes ; car ils donnent à Corinthe le surnom de riche. Quand les Grecs eurent acquis plus de pratique de la mer, ils firent usage de leurs vaisseaux pour la purger de pirates, et les Corinthiens, leur offrant alors un marché pour le commerce de terre et le commerce maritime, eurent une ville puissante par ses revenus.
La marine des Ioniens se forma beaucoup plus tard sous le règne de Cyrus, premier roi des Perses, et sous celui de Cambyse, son fils. Ils firent la guerre à Cyrus, et furent quelque temps les maîtres de la mer qui baigne leurs côtes. Polycrate, tyran de Samos, pendant le règne de Cambyse, fut puissant sur mer et soumit à sa domination plusieurs îles, entre autres celle de Rhénie ; il consacra cette dernière à Apollon de Délos. Les Phocéens, fondateurs de Marseille, vainquirent par mer les Carthaginois8.
XIV. Voilà quelles étaient les plus puissantes marines. On voit qu’elles ne se formèrent que plusieurs générations après le siège de Troie ; elles employaient peu de trirèmes, et comme au temps de ce siècle, elles étaient encore composées de pentécontores9 et de vaisseaux longs.
Peu après la guerre médique et la mort de Darius, qui succéda sur le trône de Perse à Cambyse, les tyrans de la Sicile et les Corcyréens eurent un grand nombre de trirèmes. Ce furent dans la Grèce les seules flottes considérables avant la guerre de Xerxès : car les Éginètes, les Athéniens, et peut-être quelques autres, n’en avaient que de faibles, et qui n’étaient guère composées que de pentécontores ; ce fut même assez tard et seulement quand Thémistocle, qui s’attendait à l’invasion des Barbares, eut persuadé aux Athéniens, alors en guerre avec les Éginètes, de construire des vaisseaux sur lesquels ils combattirent ; tous n’étaient pas même encore pontés.
XV. Telles furent les forces maritimes que possédèrent les Grecs dans les temps anciens et même dans ceux qui sont les moins éloignés de nous. Les villes qui avaient des flottes supérieures se procurèrent une puissance respectable par leurs revenus pécuniaires et par leur domination sur les autres, car, avec leurs vaisseaux, elles se soumirent les îles. C’est ce qui arriva surtout aux peuples dont le territoire ne suffisait pas à leurs besoins.
D’ailleurs il ne se faisait par terre aucune expédition capable d’augmenter la puissance d’un état ; toutes les guerres qui s’élevaient n’étaient que contre des voisins, et les Grecs n’envoyaient pas des armées au dehors faire des conquêtes loin de leurs frontières. On ne voyait pas de villes s’associer à celles qui avaient plus de force, et se soumettre à leur commandement ; des républiques égales entre elles n’apportaient pas en commun des contributions pour lever des armées, seulement les voisins se faisaient en particulier la guerre les uns aux autres. Ce fut, surtout dans celle que se firent autrefois les peuples de Chalcis et d’Érétrie, que le reste de la Grèce se partagea pour donner des secours aux uns ou aux autres.
XVI. Il survint à certaines républiques différents obstacles qui ne leur permirent pas de s’agrandir. Ainsi les Ioniens voyaient s’élever très haut leur fortune, quand Cyrus, avec les forces du royaume de Perse, abattit Crœsus, conquit tout ce qui se trouve au-delà du fleuve Halys jusqu’à la mer, et réduisit en servitude les villes du continent. Darius vainquit ensuite les Phéniciens sur la mer, et se rendit maître des îles.
XVII. Ce qu’il y avait de tyrans dans les différents états de la Grèce, occupés seulement de pourvoir à leurs intérêts, de défendre leur personne et d’agrandir leur maison, se tenaient surtout dans l’enceinte des villes, pour y vivre autant qu’il était possible, en sûreté. Si l’on excepte ceux de Sicile, qui s’élevèrent à une grande puissance, ils ne firent rien de considérable, seulement chacun d’eux put exercer quelques hostilités contre ses voisins. Ainsi de toutes parts et pendant longtemps, la Grèce fut hors d’état de faire en commun rien d’éclatant, et chacune de ses villes était incapable de rien oser.
XVIII. Après que les derniers tyrans d’Athènes et du reste de la Grèce, car presque tout entière elle avait été soumise à la tyrannie, eurent été la plupart chassés par les Lacédémoniens, excepté ceux de Sicile, ce peuple devint puissant par cet exploit, et ce fut lui qui régla les intérêts des autres républiques. Il est bien vrai que Lacédémone, fondée par les Doriens qui l’habitent, fut plus longtemps qu’aucune autre ville dont nous ayons connaissance, agitée de séditions ; mais elle eut, dès l’antiquité la plus reculée, de bonnes lois et ne fut jamais soumise au pouvoir tyrannique. Il s’est écoulé quatre cents ans et même un peu plus, jusqu’à la fin de la guerre que nous écrivons, depuis que les Lacédémoniens vivent sous le même régime.
Peu d’années après l’extinction de la tyrannie dans la Grèce se donna la bataille de Marathon entre les Mèdes et les Athéniens ; et dix ans après, les Barbares, avec une puissante armée, se jetèrent sur la Grèce pour l’asservir. Pendant que ce grand danger était suspendu sur les têtes, les Lacédémoniens, supérieurs en puissance, commandèrent les Grecs armés pour la défense commune. Les Athéniens, ayant pris la résolution d’abandonner leur ville, montèrent sur leurs vaisseaux et devinrent hommes de mer. Les Grecs, peu après avoir d’un commun effort repoussé les Barbares, se partagèrent entre les Athéniens et les Lacédémoniens, tant ceux qui avaient secoué le joug du roi10 que ceux qui avaient porté les armes avec lui. C’était alors les deux républiques qui montrassent le plus de puissance, l’une par terre, l’autre par mer. Leur union fut de courte durée : elles finirent par se brouiller et se firent la guerre avec les secours des peuples qu’elles avaient dans leur alliance. C’était à elles que les autres Grecs avaient recours quand il leur survenait quelques différends. Enfin, dans tout le temps qui s’est écoulé depuis la guerre des Mèdes jusqu’à celle-ci, ces deux peuples, tantôt se jurant entre eux la paix, tantôt se faisant la guerre l’un à l’autre ou combattant ceux de leurs alliés qui les abandonnaient, eurent un appareil de guerre formidable ; et comme ils s’exerçaient avec ardeur au milieu des dangers, ils acquirent beaucoup d’expérience.
XIX. Les Lacédémoniens commandaient leurs alliés sans exiger d’eux aucun tribut : ils les ménageaient pour les tenir attachés au gouvernement d’un petit nombre, le seul qui convînt à la politique de Lacédémone. Mais les Athéniens, ayant pris avec le temps les vaisseaux des villes alliées, excepté ceux de Chio et de Lesbos, leur imposèrent à toutes des tribus pécuniaires11, et dans la guerre que nous écrivons, leur appareil militaire fut plus grand qu’il ne l’avait jamais été, lorsqu’ils florissaient le plus par les secours complets de tous leurs alliés.
XX. Tel j’ai trouvé l’ancien état de la Grèce, et il est difficile d’en démontrer l’exactitude par une suite de preuves liées entre elles ; car les hommes reçoivent indifféremment les uns des autres, sans examen, ce qu’ils entendent dire sur les choses passées, même lorsqu’elles appartiennent à leur pays. Ainsi l’on croit généralement à Athènes qu’Hipparque était en possession de la tyrannie, lorsqu’il fut tué par Harmodius et Aristogiton. On ignore qu’Hippias était l’aîné des fils de Pisistrate, qu’il tenait les rênes du gouvernement, et qu’Hipparque et Thessalus étaient ses frères. Harmodius et Aristogiton, au jour et à l’instant même qu’ils allaient exécuter leur projet, soupçonnèrent qu’Hippias en avait reçu quelques indices de la part des conjurés : ils l’épargnèrent dans l’idée qu’il était instruit d’avance, mais ils voulurent essayer du moins de faire quelque chose avant d’être arrêtés, et ayant rencontré près du temple nommé Léocorion, Hipparque occupé à disposer la pompe des Panathénées, ils lui donnèrent la mort.
Il est bien d’autres choses qui existent encore de nos jours et qui ne sont pas du nombre de celles que le temps a effacées de la mémoire, dont on n’a cependant que de fausses idées dans le reste de la Grèce. Ainsi on croit que les rois de Lacédémone donnent chacun deux suffrages au lieu d’un, et que les Lacédémoniens ont un corps de troupes nommé Pitanale, qui n’a jamais existé ; tant la plupart des hommes sont indolents à rechercher la vérité et aiment à se tourner vers la première opinion qui se présente.
XXI. D’après les preuves que j’ai données, on ne se trompera pas sur les faits que j’ai parcourus, en m’accordant de la confiance, au lieu d’admettre ce que les poètes ont chanté, jaloux de tout embellir ; ou ce que racontent les historiens, qui, plus amoureux de chatouiller l’oreille que d’être vrais, rassemblent des faits qui, dénués de preuves, généralement altérés par le temps et dépourvus de vraisemblance, méritent d’être placés entre les fables12. On peut croire que dans mes recherches je me suis appuyé sur les témoignages les plus certains, autant du moins que des faits anciens peuvent être prouvés.
Quoique l’on regarde toujours comme la plus importante de toutes les guerres, celle dans laquelle on porte les armes, et que rendu au repos, on admire davantage les exploits des temps passés, on n’a qu’à considérer par les faits celle que je vais écrire, et l’on ne doutera pas qu’elle ne l’ait emporté sur les anciennes guerres.
XXII. Rendre de mémoire, dans des termes précis, les discours qui furent tenus lorsqu’on se préparait à la guerre ou pendant sa durée, c’est ce qui était difficile pour moi-même quand je les avais entendus, et pour ceux qui m’en rendaient compte, de quelque part qu’ils les eussent appris. Je les ai rapportés comme il m’a semblé que les orateurs devaient surtout avoir parlé dans les circonstances où ils se trouvaient, me tenant toujours, pour le fond des pensées, le plus près qu’il était possible de ce qui avait été dit en effet.
Quant aux événements, je ne me suis pas contenté de les écrire sur la foi du premier qui m’en faisait le récit ni comme il me semblait qu’ils s’étaient passés ; mais j’ai pris des informations aussi exactes qu’il m’a été possible, même sur ceux auxquels j’avais été présent. Ces recherches étaient pénibles, car les témoins d’un événement ne disent pas tous les mêmes choses sur les mêmes faits ; ils les rapportent au gré de leur mémoire ou de leur partialité. Comme j’ai rejeté ce qu’ils disaient de fabuleux, je serai peut-être écouté avec moins de plaisir, mais il me suffira que mon travail soit regardé comme utile par ceux qui voudront connaître la vérité de ce qui s’est passé, et en tirer des conséquences pour les événements semblables ou peu différents qui, par la nature des choses humaines, se renouvelleront un jour. C’est une propriété que je laisse pour toujours aux siècles à venir, et non un jeu d’esprit fait pour flatter un instant l’oreille13.
XXIII. La plus considérable des guerres précédentes fut celle contre les Perses ; et cependant cette querelle fut bientôt jugée par deux actions navales et deux combats de terre. Mais la guerre que j’écris a été de bien plus longue durée, et a produit des maux tels que jamais la Grèce n’en avait éprouvés dans un même espace de temps. Jamais tant de villes n’avaient été dévastées soit par les Barbares, soit par leurs hostilités réciproques ; quelques-unes même perdirent leurs habitants pour en recevoir de nouveaux ; jamais tant d’hommes n’avaient éprouvé les rigueurs de l’exil ; jamais tant n’avaient perdu la vie dans les combats ou par les séditions. Des événements autrefois connus par tradition, et rarement confirmés par les effets, ont cessé d’être incroyables : tremblements de terre ébranlant à la fois une grande partie du globe, et les plus violents dont on eût encore entendu parler ; éclipses de Soleil plus fréquentes que dans aucun temps dont on ait conservé le souvenir ; en certains pays, de grandes sécheresses, et par elles, la famine ; un fléau plus cruel encore, et qui a détruit une partie des Grecs, la peste ; maux affreux, et tous réunis à ceux de cette guerre.
Les Athéniens et les Péloponnésiens la commencèrent en rompant la trêve de trente ans qu’ils avaient conclue après la soumission de l’Eubée14. J’ai commencé par écrire les causes de cette rupture et les différends des deux peuples, pour qu’on n’ait pas la peine de chercher un jour d’où s’éleva, parmi les Grecs, une si terrible querelle. La cause la plus vraie, celle sur laquelle on gardait le plus profond silence, et qui la rendit cependant inévitable, fut, je crois, la grandeur à laquelle les Athéniens étaient parvenus et la terreur qu’ils inspiraient aux Lacédémoniens. Mais voici les raisons qu’on mettait en avant de part et d’autre, et qui firent rompre la trêve et commencer les hostilités.
XXIV. Épidamne est une ville qu’on trouve à droite en entrant dans le golfe d’Ionie : elle est voisine des Talautiens, Barbares de nation illyrique. C’est une colonie des Corcyréens ; Phalius, fils d’Ératoclide, Corinthien de race, et descendant d’Hercule, en fut le fondateur ; il fut mandé de la métropole, suivant l’antique usage, pour exercer cette fonction15. Des Corinthiens et d’autres gens d’origine dorique se joignirent à ceux qui allaient établir la colonie : ce fut, avec le temps, une cité considérable, et elle parvint à une grande population ; mais, comme on le raconte, les habitants, après s’être livrés pendant plusieurs années à des dissensions intestines, périrent en grand nombre dans une guerre qu’ils eurent avec les Barbares leurs voisins, et perdirent une grande partie de leur puissance. Enfin, avant la guerre que nous écrivons, le peuple chassa les riches ; ceux-ci se retirèrent chez les Barbares, et avec eux, ils exercèrent par terre et par mer le brigandage contre leur patrie. Les citoyens qui étaient restés dans la ville, ainsi tourmentés, envoyèrent une députation à Corcyre comme à leur métropole. Ils demandaient qu’on daignât ne les pas abandonner dans leur ruine, qu’on voulût bien les réconcilier avec les exilés et mettre fin à la guerre des Barbares. Ils firent cette demande assis, en qualité de suppliants, dans le temple de Junon16 : mais les Corcyréens ne reçurent pas leurs prières, et les renvoyèrent sans leur rien accorder.
XXV. Les Épidamniens, voyant qu’ils n’avaient aucun secours à espérer de Corcyre, ne surent quel parti prendre dans leur malheur. Ils envoyèrent à Delphes consulter le dieu, pour savoir s’ils remettraient leur ville aux Corinthiens, comme à leurs fondateurs, et s’ils essaieraient d’en obtenir quelque assistance. Le dieu leur répondit de donner leur ville aux Corinthiens, et de se mettre sous leur commandement. Les Épidamniens allèrent à Corinthe, et conformément à l’oracle, ils remirent aux Corinthiens la colonie. Ils leur firent connaître qu’elle avait eu pour fondateur un citoyen de Corinthe ; et leur communiquant la réponse du dieu, ils les prièrent de ne pas les abandonner dans leur désastre, et de leur accorder des secours. Les Corinthiens étaient persuadés que cette colonie ne leur appartenait pas moins qu’aux Corcyréens ; ils prirent ces infortunés sous leur protection, touchés de la justice de leur cause, et en même temps par haine pour les citoyens de Corcyre, qui les négligeaient, quoiqu’ils fussent une colonie sortie de leur sein. Ils ne leur rendaient pas les honneurs accoutumés dans les solennités publiques, et ne choisissaient pas, comme les autres colonies, un pontife de Corinthe, pour présider à leurs sacrifices17. Égaux par leurs richesses aux états les plus opulents de la Grèce, et plus puissants encore par leur appareil militaire, ils dédaignaient leur métropole. Ils ne manquaient pas aussi, dans l’occasion, de vanter avec orgueil leur grande supériorité dans la marine, parce qu’autrefois les Phéaciens avaient habité Corcyre, et avaient dû leur gloire à la puissance de leurs flottes : aussi les voyait-on s’appliquer surtout à la navigation, et leur marine était formidable ; ils avaient cent vingt trirèmes quand ils commencèrent la guerre.
XXVI. Les Corinthiens, qui avaient contre cette république tant de sujets de plainte, envoyèrent avec joie des secours à Épidamne. Ils engagèrent ceux qui le voudraient à y aller former des établissements, et y firent passer une garnison composée de Corinthiens, d’Ampraciotes et de Leucadiens : elle prit sa route par terre du côté d’Apollonie, colonie de Corinthe, dans la crainte que les Corcyréens ne leur fermassent le passage de la mer. Ceux-ci, informés qu’il allait à Épidamne une garnison et de nouveaux habitants, et que la colonie s’était donnée aux Corinthiens, éprouvèrent un vif ressentiment. Ils mirent aussitôt en mer vingt-cinq vaisseaux qui furent bientôt suivis d’une autre flotte, et ordonnèrent, avec une hauteur insultante, aux Épidamniens de recevoir les exilés, et de chasser la garnison et les habitants qui leur étaient envoyés de Corinthe : c’est que les exilés d’Épidamne étaient venus à Corcyre ; ils montraient les tombeaux de leurs ancêtres, faisaient valoir l’origine commune qui les unissait aux Corcyréens, et demandaient à être rétablis dans leur patrie. Les Épidamniens refusèrent de rien entendre, et ceux de Corcyre les allèrent attaquer avec quarante vaisseaux ; ils menaient avec eux les exilés, dans le dessein de les rétablir, et ils avaient pris un renfort d’Illyriens. Prêts à former le siège, ils déclarèrent qu’il ne serait fait aucun mal ni aux étrangers, ni même à ceux des Épidamniens qui voudraient se retirer ; mais que ceux qui s’obstineraient à faire résistance seraient traités en ennemis. Personne n’eut égard à cette proclamation, et lesCorcyréens assiégèrent la place qui est située sur un isthme.
XXVII. Dès qu’on reçut à Corinthe la nouvelle du siège, on fit des dispositions de guerre. Il fut en même temps publié que ceux qui voudraient aller s’établir à Épidamne y jouiraient de tous les droits de citoyens ; et que ceux qui, sans partir sur-le-champ, voudraient participer aux avantages de la colonie, auraient la permission de rester, en déposant cinquante drachmes, monnaie de Corinthe. Bien du monde partit, beaucoup d’autres apportèrent de l’argent ; on engagea les Mégariens à fournir des vaisseaux d’escorte, dans la crainte d’être inquiété dans la navigation par les Corcyréens. Les Mégariens se disposèrent à les accompagner avec huit vaisseaux, et les Paliens, qui logent dans l’île de Céphalénie, avec quatre. On demanda aussi des secours aux Épidauriens, qui fournirent cinq vaisseaux ; les Hermioniens en donnèrent un, les Trézéniens deux, les Leucadiens dix, les Ampraciotes huit. On demanda aux Thébains de l’argent, de même qu’aux Phliasiens. On n’exigea des Éléens que des vaisseaux vides et de l’argent. Les Corinthiens eux-mêmes équipèrent trente vaisseaux et mirent sur pied trois mille hoplites18.
XXVIII. Les Corcyréens, sur l’avis de ces préparatifs, vinrent à Corinthe, accompagnés de députés de Lacédémone et de Sicyone qu’ils avaient pris avec eux. Ils demandèrent que les Corinthiens, comme n’ayant rien à prétendre sur Épidamne, en retirassent la garnison et les hommes qu’ils y avaient envoyés ; que s’ils avaient à faire quelque réclamation, on s’en remettrait à l’arbitrage des villes du Péloponnèse dont les deux partis conviendraient, et que celui des deux peuples dont elles reconnaîtraient les droits sur la colonie, en resterait le maître. Ils offraient aussi de s’en rapporter à l’oracle de Delphes ; enfin ils ne voulaient pas la guerre ; mais si leurs demandes étaient rejetées, ils se verraient forcés de se procurer des secours et de se faire, chez quelques-unes des principales puissances de la Grèce, des amis, que d’ailleurs ils répugneraient à choisir. Les Corinthiens répondirent qu’ils n’avaient qu’à retirer de devant Épidamne leurs vaisseaux et les troupes de Barbares, et qu’alors on mettrait leurs demandes en délibération ; mais qu’en attendant il ne serait pas juste que les Corcyréens fussent assiégés, et eux-mêmes mis en jugement. Ceux de Corcyre répliquèrent qu’ils consentaient à cette proposition, si les Corinthiens rappelaient les gens qu’ils avaient dans Épidamne, ou que même, si les deux partis convenaient de rester tranquilles où ils se trouvaient, ils étaient prêts à faire une trêve jusqu’au jugement des arbitres.
XXIX. Les Corinthiens n’écoutèrent aucune de ces propositions. Dès que leur flotte fut appareillée, et qu’ils eurent reçu les troupes auxiliaires, ils envoyèrent un héraut déclarer la guerre à Corcyre, sortirent du port avec soixante-quinze vaisseaux et deux mille hoplites, et cinglèrent vers Épidamne. Les commandants de la flotte étaient Aristée, fils de Pellicus ; Callicrate, fils de Callias, et Timanor, fils de Timanthe : les généraux de terre, Archétime, fils d’Eurytime, et Isarchidas, fils d’Isarchus. Ils étaient devant Actium, dans les campagnes d’Anactorium, où est le temple d’Apollon, quand ils virent arriver sur un vaisseau de transport un héraut qui venait de la part des Corcyréens leur défendre de s’avancer contre eux. Ceux qui l’envoyaient appareillaient en même temps leur flotte, garnissaient de leurs agrès le plus grand nombre des vaisseaux pour les mettre en mer et radoubaient les autres. Comme le héraut ne leur rapporta, de la part des Corinthiens, aucune parole de paix, et que les navires, au nombre de quatre-vingts, étaient équipés (ils en avaient quarante au siège d’Épidamne), ils partirent à la rencontre des ennemis, mirent la flotte en bataille et engagèrent le combat. Leur victoire fut complète ; ils détruisirent quinze vaisseaux de Corinthe, et le même jour, ceux qui faisaient le siège d’Épidamne forcèrent la place à capituler. La capitulation portait que les étrangers seraient mis en vente, et les Corinthiens dans les fers, jusqu’à ce qu’on eût décidé de leur sort.





























