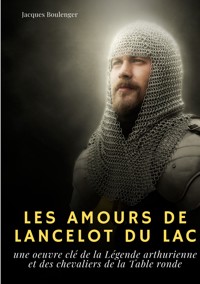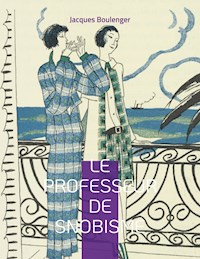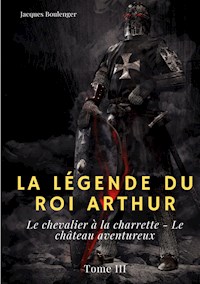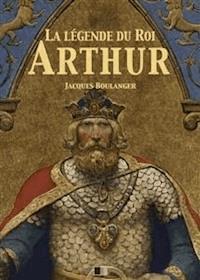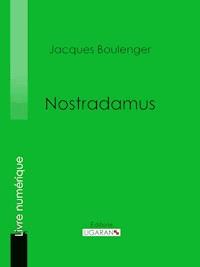Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Lancelot quitte la Dame du Lac pour rejoindre la cour du roi Arthur à Camaaloth, afin d'y être fait chevalier. Là, il va rencontrer la reine Guenièvre, celle qui allait devenir le centre de son univers, celle pour qui il allait combattre dragons, magiciens et chevaliers félons, celle qui inspirera les hauts faits qui feront de lui le plus célèbre des chevaliers de la Table ronde. Mais il devient également l'inséparable ami de Galehaut, le fils de la belle géante et le sire des Îles Lointaines. Lancelot et Galehaut vont vivre d'innombrables aventures où ils rivaliseront de prouesses et de courtoisie pour l'honneur de leurs dames et la gloire du royaume de Bretagne, jusqu'à ce que le Destin en décide autrement...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Légende du Roi Arthur - Tome 2
La Légende du Roi Arthur - Tome 2LES AMOURS DE LANCELOTI. Au royaume de Logres.II. Le Blanc cortège.III. Les adieux.IV. Le beau damoisel.V. Le jour de la Saint-Jean.VI. “Adieu, beau doux ami !”VII. La dame de Nohant et le chevalier à la blanche robe.VIII. Délivrance de Nohant.IX. Le gué de la reine. Les demoiselles-oiseaux.X. Les trois écus de Saraide la pucelle.XI. Prise de la Douloureuse Garde.XII. La tombe de Lancelot.XIII. “Fin coeur ne peut mentir”.XIV. Lancelot en extase. Départ de la Douloureuse Garde.XV. Keu déçu.XVI. Le chevalier à la litière.XVII. Retour à la Douloureuse Garde.XVIII. Les clés des enchantements. La Joyeuse Garde.XIX. Le chevalier pensif et Daguenet le couard.XX. Le Chèvrefeuille.XXI. Lancelot au Puy de Malehaut.XXII. Le fils de la belle géante. La semonce au roi.XXIII. La dame de Malehaut : Lancelot en gêole.XXIV. Le tournoi de Galore : le chevalier vermeil.XXV. La dame de Malehaut : le baiser.XXVI. Délivrance de Lancelot.XXVII. Le tournoi de Galore : le noir chevalier.XXVIII. La promesse de Galehaut.XXIX. La soumission de Galehaut.XXX. L'entremise de Galehaut.XXXI. Le pré des arbrisseaux. Quel giorno più non vi leggemmo avante.XXXII. “Bonne est la compagnie de quatre !”.XXXIII. Galehaut et la dame de Malehaut.LE ROMAN DE GALEHAUTI. La vie belle.II. Rêverie du roi. Quête de Lancelot.III. La demoiselle de Norgalles.IV. Sagremor fait amie nouvelle.V. Heureuse rencontre. Chansons.VI. Le chevalier qui pleure et rit.VII. Ségurade, le chevalier Fée.VIII. La dame de Roestoc.IX. La nièce du nain Groadain.X. L'écu fendu.XI. L'Étroite Marche.XII. Marganor. Délivrance de l'Étroite Marche.XIII. Florée.XIV. En Sorelois.XV. Lionel et les larrons.XVI. Le chevalier et l'écuyer. Lionel et Gauvain.XVII. Le pont norgallois. Lancelot trouvé.XVIII. Siège de la Roches aux Saines.XIX. L'écu soudé. Les prisonniers de Camille l'enchanteresse.XX. Le forcené.XXI. Prise de la Roche aux Saines.XXII. Le songe de Galehaut et l'Orgueilleuse Emprise.XXIII. Les deux Guenièvres.XXIV. L'amitié de Galehaut.XXV. La signifiance du songe.XXVI. La terre en baillie.XXVII. Le royaume de Gorre. Méléagant l'orgueilleux.XXVIII. Félonie de Méléagant. La bonne blessure.XXIX. La vaine chasse.XXX. La fausse Guenièvre.XXXI. La reine en jugement.XXXII. Le jugement faussé.XXXIII. Le combat de justice.XXXIV. Mort de la fausse Guenièvre et de Bertolai le vieux.XXXV. Retour de la reine. Le roi pardonné.XXXVI. Enlèvement de Gauvain.XXXVII. La demoiselle aux tresses coupées.XXXVIII. Les escrimeurs de Pintadol.XXXIX. Escalon le Ténébreux.XL. Le Val Sans Retour.XLI. La Tour Douloureuse.XLII. Lionel au cœur sans frein.XLIII. Dépit de la reine. Adoubement de Lionel.XLIV. Escalón l'Aisé.XLV. Le Val des Faux Amants.XLVI. L'anneau de Morgane.XLVII. Les amants sous l'eau.XLVIII. Keu d'Estraux.XLIX. Mort de Karadoc le grand et conquête de la Tour Douloureuse.L. Morgane la Déloyale : la laide pucelle.LI. Morgane la Déloyale. Frénésie de Lancelot.LII. La mort de Galehaut.Page de copyrightLa Légende du Roi Arthur - Tome 2
Jacques Boulenger
LES AMOURS DE LANCELOT
À Madame Marie-Louise Pailleron
I. Au royaume de Logres.
Le conte dit qu’il y avait anciennement, parmi les forêts du royaume de Logres, une foule de grottes où les chevaliers errants trouvaient toujours le vivre et le couvert : car, lorsque l’un d’eux avait besoin de boire et de manger, il n’avait qu’à se rendre à la plus prochaine, et aussitôt une demoiselle de féerie en sortait, on ne peut plus belle, qui portait une coupe de fin or à la main, avec des pâtés très bien lardés, et du pain ; et elle était suivie d’une autre pucelle, qui tenait une blanche serviette merveilleusement ouvrée et une écuelle d’or et d’argent où se trouvait justement le mets que le chevalier désirait ; et encore, si le plat ne lui plaisait point, on lui en apportait d’autres à sa volonté.
Mais il advint qu’un chevalier mauvais et plein de vilenie força l’une de ces pucelles au bord de sa grotte, et ensuite lui prit la vaisselle d’or où elle l’avait servi. D’autres agirent comme lui : de façon qu’elles ne voulurent plus se montrer, pour prière qu’on leur en fit.
Lorsque le roi Arthur eut fondé la Table ronde par le conseil de Merlin, les chevaliers de sa maison convinrent qu’ils protégeraient toutes les demoiselles. Si une pucelle était conduite par un chevalier et que celui-ci fut outré et vaincu, alors elle appartiendrait au vainqueur. Mais celle qui était seule n’avait rien à redouter, sinon des félons, dont il n’y avait guère en ce temps, et elle pouvait aller aussi sûrement par le royaume que si elle eût été gardée. Néanmoins, on n’eut plus jamais aucune nouvelles des pucelles des grottes.
Ce fut le commencement des Temps Aventureux.
Alors la Bretagne bleue fut pleine de merveilles et les chevaliers se mirent à errer. Partout, il y avait des pas difficiles et des coutumes singulières qu’on ne pouvait franchir ou redresser qu’à grande prouesse : grâce à quoi les chevaliers, et surtout ceux de la Table ronde, faisaient tant d’armes que leur renom en est demeuré jusqu’à présent. Ils chevauchaient par monts et par vaux sur leurs grands destriers, abattant les mauvais usages, défiants les félons, ramenant les méchants à raison, détruisant les larrons qui volaient sur les routes ; et des demoiselles qu’on ne saurait demander plus avenantes cheminaient sur leurs palefrois ; et, pendant ce temps, la cour du roi Arthur resplendissait sur le pays de Logres, ornée de la reine Guenièvre et de ses dames, brillante d’or, d’argent, de riches draps de soie, de fêtes, de gerfauts, d’éperviers, de faucons, d’émerillons. Là vivaient les compagnons de la Table ronde, et jamais on ne vit si bons chevaliers, si preux, si fiers, si vigoureux et hardis ; mais on estimait alors la prouesse a beaucoup plus haut prix qu’aujourd’hui.
Cinq fois l’an, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte, à la Toussaint et à la Noël, le roi Arthur tenait cour renforcée et portait couronne. En ce temps-là, nul ne passait pour vraiment preux, qui n’eût demeuré quelque temps en sa maison : aussi les barons venaient-ils en foule à ces cours. Et celle de la Pentecôte était la plus enjouée et la plus gaie, parce que c’est ce jour-là que Notre Sire, monté au ciel, envoya le Saint-Esprit parmi ses fidèles, qui étaient aussi déconfortés que des brebis qui ont perdu leur pasteur. Mais celle de Pâques était la plus haute et la plus honorée, en mémoire du Sauveur qui ressuscita et nous racheta des éternelles douleurs. D’ailleurs, à maintes autres époques, comme la Chandeleur et la mi-août, ou bien le jour de la fête de la ville dans laquelle il se trouvait, et encore quand il voulait faire honneur à quelques gens, le roi tenait sa cour ; mais cela ne s’appelait point cour renforcée. Et, à toutes ces cours, il avait coutume de ne se mettre à son haut manger que lorsqu’une aventure s’était présentée à ses chevaliers.
II. Le Blanc cortège.
Or, le vendredi avant la Saint-Jean, le roi chassa tout le jour dans la forêt de Camaaloth ; vers le soir, comme il regagnait la ville avec ses gens, il vit venir à lui une belle compagnie.
En tête, deux garçons à pied menaient deux sommiers blancs, dont l’un portait un léger pavillon de campement, le plus riche qu’on eût jamais fait, et l’autre deux beaux coffres pleins de robes de chevaliers. Puis avançaient, deux par deux, quatre écuyers montés sur des roussins et tenant qui un écu à boucle d’argent, qui un heaume argenté, qui une lance, qui une grande épée, claire, tranchante et légère à merveille ; et après eux d’autres écuyers et sergents ; puis trois pucelles ; enfin une dame accompagnée d’un damoisel beau comme le jour et de deux gentils valets avec lesquels elle causait. Et les robes, les armes, les écus, les chevaux, tout le cortège était couleur de neige.
Le roi s’arrêta, émerveillé. Cependant la dame, l’ayant aperçu, pressait son palefroi et, dépassant son escorte, s’avança vers lui en compagnie du beau damoisel. Et sachez encore qu’elle était vêtue d’une cotte et d’un manteau de samit blanc, fourré d’hermine, et qu’elle chevauchait un petit palefroi ambiant, si bien taillé qu’on n’en vit jamais de plus beau, dont la housse de soie traînait jusqu’à terre ; son frein et son poitrail étaient subtilement gravés d’images où l’on voyait des dames et des chevaliers. Dès que la dame arriva devant le roi, elle écarta son voile et, après lui avoir rendu le salut qu’il se hâta de lui faire le premier, en gentilhomme courtois et bien appris qu’il était, elle lui dit :
– Sire, Dieu vous bénisse comme le meilleur des rois de ce monde ! Je viens de bien loin pour vous demander un don que vous ne me refuserez point, car il ne peut vous causer nul mal et ne coûtera rien.
– Demoiselle, répondit le roi, dût-il m’en coûter beaucoup, pourvu qu’il ne me soit honte et qu’il ne cause dommage à mes amis, je vous l’octroierai, quel qu’il soit.
– Sire, grand merci ! Je vous requiers donc de faire chevalier ce mien écuyer, lorsqu’il vous le demandera.
– Belle amie, grâces vous soient rendues de m’avoir amené ce beau jouvenceau. Je lui donnerai ce qui est de moi : ses armes et la colée ; Dieu ajoutera le surplus : c’est la prouesse.
La Dame remercia le roi et lui apprit qu’on l’appelait la Dame du Lac ; après quoi, quelque prière qu’il lui fit de demeurer, elle prit congé, le laissant fort étonné, car il n’avait jamais entendu prononcer ce nom.
III. Les adieux.
Le damoisel, qui semblait au désespoir de la quitter, voulut la convoyer quelque temps. Quand ils eurent cheminé côte à côte, tristement, la distance d’un trait d’arc, elle rompit le silence et lui dit :
– Fils de Roi, il faut donc nous séparer. Mais, auparavant, je veux que vous sachiez, vous que j’ai élevé, que je ne suis pas votre mère et que vous n’êtes pas mon fils. Votre lignée est des meilleures du monde ; et vous apprendrez un jour le nom de vos parents. Songez à vous rendre aussi parfait de cœur que vous l’êtes de corps, car ce serait grand dommage si en vous la prouesse ne valait pas la beauté. Demain soir, vous prierez le roi Arthur de vous faire chevalier, et ce jour même, avant la nuit vous quitterez son hôtel et vous irez errant par tout le pays cherchant aventure : car c’est ainsi que vous gagnerez louanges et valeur. Ne vous arrêtez en aucun lieu, ou le moins possible ; mais gardez d’y laisser quelque exploit à faire à ceux qui viendront après vous. Et si l’on vous demande qui vous êtes, répondez que vous ignorez votre propre nom.
Elle tira de son doigt un anneau qu’elle passa à celui du damoisel. Puis elle le recommanda à Dieu, en le baisant bien doucement, et elle lui dit encore :
– Beau Fils de Roi, écoutez ceci : vous mènerez à bien les plus périlleuses aventures, et celui qui achèvera celles que vous aurez laissées, il n’est pas encore de ce monde… Je vous en dirais davantage, mais mon cœur se serre et la parole me faut… Allez, allez à Dieu, le bon, le beau, le noble, le gracieux, le désiré, le mieux aimé !
Elle lui baisa encore la bouche, le visage et les deux yeux tendrement ; puis elle partit si triste qu’elle n’eût su prononcer un mot de plus. Et le damoisel pleura en la voyant s’éloigner. Il courut accoler un à un les valets, les pucelles et les garçons ; après quoi il demeura avec les sommiers que la Dame du Lac lui avait laissés. Alors il se mit en devoir de rejoindre le roi.
IV. Le beau damoisel.
Dès le samedi matin, il vint trouver monseigneur Yvain le grand, qui l’avait hébergé en son logis, et il le pria de requérir le roi Arthur de l’armer le lendemain.
– Comment, beau doux ami, lui dit son hôte, ne vous convient-il pas d’attendre encore un peu et d’apprendre le métier des armes ? Il tombe à terre l’oiselet qui s’élance avant de savoir voler.
Mais le valet répliqua qu’il lui tardait de ne plus être écuyer, et messire Yvain s’en fut dire son désir au roi.
– Parlez-vous de damoisel à la blanche robe ? répondit celui-ci. Que dites-vous, Gauvain, de notre valet d’hier soir qui veut déjà être chevalier ?
– Je pense que la chevalerie lui siéra bien, car il est beau et semble de bonne race.
– Quel est ce valet ? fit la reine Guenièvre.
– Allez le quérir, Yvain, dit le roi, et faites qu’il s’habille du mieux qu’il pourra ; j’ai idée qu’il a assez de ce qu’il faut pour cela.
Dans la cité, la nouvelle s’était répandue du damoisel qui était venu en équipage de chevalier, de sorte que les rues se trouvèrent pleines de monde, lorsqu’il traversa la ville en croupe sur le cheval de monseigneur Yvain. Au palais même, les chevaliers, les dames et les demoiselles étaient descendus dans la cour pour le voir, et le roi et la reine se penchaient à la fenêtre.
Le blanc damoisel mit pied à terre, ainsi que messire Yvain, qui le prit par la main et le mena dans la salle où le roi et la reine firent asseoir entre eux leur parent, tandis que le jouvenceau se plaçait vis-à-vis, sur l’herbe verte dont le sol était jonché. Il était avenant de visage et fait à merveille ; ses bottes étaient si justes qu’on aurait cru qu’il était né chaussé, et ses éperons luisaient à s’y mirer. Déjà, la reine Guenièvre le regardait avec douceur et priait Dieu de faire prud’homme celui à qui il avait donné une si belle apparence. Et quant au valet à la blanche robe, toutes les fois qu’il pouvait jeter à la dérobée les yeux sur elle, il s’émerveillait de sa beauté, à laquelle celle de la Dame du Lac ni d’aucune autre ne lui semblait comparable ; en quoi certes il n’avait point tort, car la reine Guenièvre était la dame des dames et la fontaine de vaillance.
– Comment a nom ce beau valet ? demanda-t-elle.
– Dame, je ne sais, répondit Yvain. Je pense qu’il est du pays de Gaule, car il en a le parler.
Alors la reine prit le beau damoisel par la main et lui demanda où il était né. Mais lui, au toucher de cette douce main, il tressaille comme un homme qui s’éveille, et ne réplique mot.
– D’où êtes-vous ? reprend la reine.
Il la regarde et lui dit en soupirant qu’il ne sait d’où. Elle lui demande comme il a nom, et il répond qu’il ne sait comme. À cela, elle vit bien qu’il était tout ébahi et hors de lui-même ; et certes elle n’osait imaginer que ce fût à cause d’elle ; pourtant elle avait quelque soupçon. Alors, pour ne pas le troubler davantage, et de crainte aussi que nul n’en pensât mal, elle se leva.
– Ce valet ne semble pas de grand sens, dit-elle, et, sage ou fol, il a été assez mal enseigné.
– Qui sait, dame, dit messire Yvain, s’il ne lui est pas défendu de révéler son nom et son pays ?
– Cela peut bien être, répondit-elle, mais si bas que la damoisel ne l’entendit pas.
Puis elle se retira dans ses chambres.
V. Le jour de la Saint-Jean.
La nuit venue, messire Yvain conduisit le beau valet dans une église où il le fit veiller jusqu’à l’aube ; après quoi, il le ramena en son logis pour dormir un peu. Au matin, ceux qui devaient être adoubés le jour de la Saint-Jean reçurent du roi la colée ; puis tout le monde fut entendre la messe et, en revenant, le roi commença de ceindre l’épée aux nouveaux chevaliers.
Mais comme il ne lui restait plus à armer que le blanc damoisel, une pucelle entra dans la salle, la plus belle qui ait jamais été. Ses tresses semblaient des gemmes et elle était si bien proportionnée qu’on ne voyait rien en elle à reprendre ; que vous dirai-je de plus ? Elle avançait en soulevant légèrement sa robe par devant ; arrivée devant le roi, elle la laissa aller sur l’herbe puis elle salua. Les chevaliers et les dames qui étaient dans la salle s’étaient approchés pour mieux voir une telle beauté, et l’on aurait pu leur couper l’aumônière sans qu’ils s’en aperçussent, tant ils béaient à la considérer ; bref, tous la louaient, petits et grands. Mais elle dit sans s’ébahir, en riant un peu de ce qu’ils la regardaient ainsi :
– Roi Arthur, Dieu te sauve ! Je te salue, toi, ta compagnie et tous ceux que tu aimes de par la dame de Nohant et de par moi-même.
– Belle douce amie, répondit le roi qui était bien disert et savait se jouer en paroles, vous avez grande part en ce salut, puisque tous ceux que j’aime y sont compris.
– Sire, je m’aime donc mieux d’y être avec vous. La dame de Nohant vous demande secours comme à son seigneur lige, car le roi de Northumberland a envahi et gâté sa terre. Tous deux ont convenu que ma dame pourra faire défendre son droit par un chevalier contre un, ou par deux contre deux, ou par trois contre trois, ou par autant qu’elle en pourra avoir. Et elle vous requiert de lui envoyer tel champion qu’il vous plaira.
– Belle amie, répondit le roi, je la secourrai volontiers, car elle tient de moi sa terre. Mais, ne me fût-elle de rien, je ne lui aiderais pas moins, car elle est très vaillante dame, débonnaire et de haute lignée, et pour l’amour de vous.
Le damoisel entendit ces mots ; tandis qu’on menait la pucelle au corps gent dans les chambres de la reine, il vint s’agenouiller devant le roi et lui demanda d’être envoyé au secours de la dame de Nohant.
– Sire, ajouta-t-il en le voyant hésiter, vous ne devez pas me refuser le premier don que je requiers de vous après mon adoubement. Je serais peu prisé et, moi-même, je m’estimerais moins, si vous ne vouliez me donner à accomplir ce que peut faire un chevalier.
Là-dessus, messire Gauvain et messire Yvain intervinrent pour représenter au roi qu’il ne pouvait l’éconduire honorablement. Si bien qu’à la fin celui-ci octroya le don, quoiqu’il craignît qu’un tel jouvenceau ne fût pas encore d’âge à porter un si lourd faix de chevalerie.
– Sire, grand merci, dit le damoisel.
Et quand il eut pris congé du roi et des barons, il fut à son logis pour se faire armer.
VI. “Adieu, beau doux ami !”
Or, messire Yvain, qui l’avait accompagné, le vit soudain pâlir et lui demanda ce qu’il avait.
– Ha ! sire, je n’ai pris congé de madame !
– Vous avez dit que sage.
Tous deux revinrent au palais et montèrent aux chambres de la reine. Là, le damoisel s’agenouilla sans mot dire, les yeux baissés.
– Dame, dit messire Yvain, voici le valet d’hier soir, que le roi a fait chevalier ce matin ; il vient prendre congé de vous.
– Quoi ! s’en va-t-il déjà ?
– Oui, dame. Il va de par monseigneur porter secours à la dame de Nohant. Il l’a demandé en don.
– Mais comment messire le roi le lui a-t-il octroyé ? Il est si jeune !… Levez-vous, beau doux sire. Je ne sais qui vous êtes, peut-être meilleur gentilhomme que l’on ne suppose, et je vous souffre à genoux devant moi ! Je ne suis guère courtoise !
– Ha ! dame, dit le damoisel en soupirant, pardonnez-moi la folie que j’ai faite !
– Et quelle folie ?
– J’ai pensé sortir de céans sans avoir congé de vous.
– Beau doux ami, vous êtes assez jeune homme pour qu’on vous pardonne un si grave méfait !
– Dame, merci.
Et, après avoir hésité un instant, il dit encore :
– Dame, si vous vouliez, je me tiendrais toujours pour votre chevalier.
– Je le veux bien. Adieu, beau doux ami.
Elle le fit lever en lui donnant la main ; certes il fut bien aise quand il sentit cette main toucher la sienne, toute nue. Il salua les dames et les demoiselles qui avaient ouï parler de sa bonne grâce et de son excellence beauté et qui avaient toutes l’œil sur lui, durant qu’il s’entretenait avec la reine, s’émerveillant que Nature l’eût si bien pourvu de ce qu’elles désiraient le plus ; puis il revint à son logis pour se faire armer. Et là, messire Yvain s’aperçut qu’il n’avait pas d’épée.
– Par mon chef, vous n’êtes point chevalier, puisque le roi ne vous a pas ceint l’épée !
– Sire, répondit le damoisel, je n’en voudrais pas d’autre que la mienne, que mes écuyers ont emportée. Je les rattraperai aisément et je reviendrai aussi vite que mon cheval pourra courir.
Là-dessus, il sauta sur son cheval et partit toute bride ; mais il ne revint pas, car il espérait bien qu’il serait chevalier d’une autre main que celle du roi. Et messire Yvain, après l’avoir vainement attendu, s’en fut conter au palais comment le valet l’avait trompé. Messire Gauvain dit que c’était peut-être un très haut homme et qui s’était dépité parce que le roi ne lui avait pas ceint l’épée avant les autres, ce que la reine et beaucoup de chevaliers crurent possible.
Mais le conte retourne maintenant au blanc damoisel qui chemine avec ses gens.
VII. La dame de Nohant et le chevalier à la blanche robe.
Ses écuyers portaient sa lance et son heaume, et l’un menait en laisse son destrier, tandis que l’autre chassait devant lui les deux sommiers. Le damoisel chevauchait à leur suite, tout pensif, et ainsi allèrent-ils jusqu’à ce qu’ils parvinssent à la cité de Nohant.
Alentour le pays était ravagé et les maisons incendiées ; mais le roi de Northumberland et ses hommes étaient alors occupés à piller à quelque distance, si bien que le portier les laissa passer, quand il vit qu’ils n’étaient que trois. Les vilains des environs étaient venus se réfugier dans la ville, et elle était si pleine de gens que le blanc damoisel erra longtemps avant de trouver à se loger ; enfin, dans une petite rue, il aperçut un boucher qui lui sembla prud’homme, assis sur les marches de sa maison. L’un des écuyers vint requérir ce vilain de les héberger ; il répondit qu’il n’avait point de place. Pourtant, quand sa femme, qui était bonne à Dieu et au siècle, l’en eut prié, il consentit à recevoir les étrangers dans une grange qu’il avait. Là, les écuyers désarmèrent leur seigneur, puis ils firent nettoyer tout et joncher le sol de paille fraîche, dressèrent un riche lit, firent des sièges, allumèrent un beau feu de bûches sèches et de charbon, mirent les chevaux à l’écurie, les pansèrent, leur donnèrent d’avoine ; enfin ils tirèrent des coffres de belles robes de chevaliers et de valets, blanches comme fleur en avril, dont le damoisel et eux-mêmes se vêtirent ; et, après avoir pris soin d’enfermer les chevaux à l’étable et les malles dans une chambre dont ils ôtèrent la clef, ils s’en furent doucement tous les trois vers le château, non sans regarder curieusement dans la ville. Lorsqu’ils arrivèrent dans la salle, la dame de Nohant causait dans l’embrasure d’une fenêtre avec son sénéchal, et elle se demandait comment elle pourrait défendre sa terre, car beaucoup de ses chevaliers avaient été durement blessés dans les dernières rencontres. Le blanc damoisel vint à elle et, après avoir salué, il lui dit que le roi Arthur l’envoyait pour soutenir son droit.
– Beau sire, Dieu donne bonne aventure au roi Arthur, et soyez le bienvenu ! Mais dites-moi votre nom si cela vous agrée.
– Dame, je suis nouveau chevalier, qui n’a point encore combattu.
À ces mots, la dame baissa tristement la tête. Néanmoins, elle pria le blanc damoisel d’aller se reposer auprès de ses chevaliers, mais elle se retira dans ses chambres, toute dolente et déconfortée.
Or, lorsqu’il fut l’heure de souper et que l’eau fut cornée et les tables mises, les chevaliers de la dame de Nohant vinrent s’asseoir, chacun à sa place ordinaire, et se mirent à manger sans mot dire au blanc damoiselle ni s’occuper de lui le moins du monde. Il était resté dans l’embrasure d’une fenêtre, s’entretenant avec ses écuyers et disant que jamais il n’avait rencontré de gens si peu courtois.
– Allez à notre logis, commanda-t-il aux deux valets, préparez à manger en quantité et faites crier par la ville que tous les pauvres et les ménestrels et les faiseurs de tours sont invités à souper.
– Sire, volontiers, mais venez avec nous ; nous ne voulons vous laisser seul parmi cette canaille.
Ils sortirent de la salle tous trois sans prendre congé de personne, et, pendant que ses gens achetaient ce qui convenait, le damoisel s’étendit sur son lit. Comme son hôtesse était venue lui tenir compagnie dans ses plus beaux habits, il lui fit donner pour la remercier un surcot et un manteau d’écarlate, fourrés de vair et tout neufs, dont elle fut si ravie qu’elle s’en vêtit aussitôt et appela son mari pour qu’il la vit ainsi faite. Et, quand la nuit fut venue, on alluma tant de luminaires qu’on eût cru que la grange flambait ; puis le damoisel fit asseoir les jongleurs, les danseuses, les bouffons d’un côté de la table et la menue gent de l’autre ; et, vers la fin du repas, les ménestrels commencèrent de chanter, de jouer de leurs violes et les acrobates de faire des tours, en sorte que le bruit et la gaieté se répandirent par la ville. Tous les chevaliers du château vinrent regarder à la porte ; mais le blanc damoisel feignit de ne pas seulement les apercevoir.
La dame de Nohant eut nouvelles de cette fête et, quand elle sut que le champion envoyé par le roi Arthur soupait si joyeusement en son logis, elle s’informa et apprit qu’on ne lui avait offert chez elle ni à boire ni à manger et que nul ne l’avait seulement regardé. Alors elle se repentit de ne lui avoir pas fait plus belle chère.
– En nom Dieu, lui dit son sénéchal, ce n’est pas en pleurant qu’on retient les chevaliers étrangers, mais par de belles paroles, des joyaux, des cadeaux ! Fût-il le pire homme du monde, vous deviez l’accueillir à grande joie et le prier de manger à votre table, puisqu’il était envoyé par monseigneur le roi.
– Je vois bien que j’ai fait une folie. Mais je croyais qu’il avait mangé avec mes chevaliers.
– Vous croyiez ? Peut-être est-il de meilleur lignage que vous. Vous n’eussiez rien risqué de le faire asseoir à votre côté.
Alors la dame se mit à pleurer et à gémir comme font les femmes. Mais son sénéchal dit encore :
– Maintenant, rien ne sert de pleurer. Allons, et nous lui parlerons.
Sitôt qu’ils entrèrent au logis du chevalier, les jeux s’arrêtèrent, et la menue gent se leva devant eux. Le damoisel fit semblant de ne rien voir ni entendre, mais il regarda ses écuyers en souriant. Alors son hôte, le boucher, à qui il venait de donner une très belle coupe, le tira par sa robe : de manière qu’il se retourna et, feignant de reconnaître seulement la dame de Nohant, lui souhaita la bienvenue, puis la prit par la main et la fit asseoir à côté de lui, ainsi que le sénéchal. Son hôte, qui était serf, voulait se retirer, mais il l’en empêcha, disant que nul ne lui avait fait un aussi bon accueil depuis son arrivée à Nohant, et que, s’il était encore dans le pays de Logres, il eût demandé au roi Arthur de l’affranchir.
– Sire chevalier, dit la dame de Nohant, je l’affranchis pour l’amour de vous. Et je vous prie, en nom Dieu, de ne pas me tenir rancune et de me pardonner la mauvaise chère que je vous ai faite.
– Dame, je suis venu pour l’amour de monseigneur le roi et non pour aucune autre raison. Je ferai ce que je pourrai en son honneur, et je n’ai point de rancune, n’ayant rien à demander à personne, car nul ne me doit rien.
– Sire, dit le sénéchal, madame voudrait que vous vinssiez vous héberger en son hôtel, et elle vous en prie et requiert.
– Sire, merci à vous et à elle, mais je suis bien ici, répondit le blanc damoisel.
Ainsi causaient-ils tous les trois, en écoutant les ménestrels et regardant les danseuses ; puis la dame le recommanda à Dieu et revint avec le sénéchal à son palais, où le blanc damoisel consentit à s’héberger le lendemain, car il avait le cœur franc et ne gardait point aisément rancune aux dames et à ceux qui amendaient leurs offenses sans félonie.
VIII. Délivrance de Nohant.
Or, la dame de Nohant qui, d’abord, qu’elle l’avait vu, l’avait peu estimé, s’était prise pour lui d’amour lorsqu’il l’avait ainsi traitée ; et elle était très belle ; pourtant il n’en fut point touché, car il ne mettait pas toutes les beautés dans son cœur. Le lendemain, au matin, elle l’envoya chercher à grand honneur ; mais, comme il arrivait au palais, voici venir Keu le sénéchal.
– Dame, messire le roi m’a chargé de soutenir votre droit. Il l’eût fait dès le premier jour, si un nouveau chevalier ne l’eût prié de lui en accorder le don.
– Sire Keu, dit le damoisel, c’est à moi de combattre, puisque je suis arrivé ici le premier.
– Ce ne peut être, dit Keu, puisque je suis venu.
– Nous jouterons donc : le vainqueur fera la bataille.
La dame était embarrassée : elle désirait de confier son droit au blanc damoisel, mais elle savait que le sénéchal était fort aimé du roi, et elle avait grand besoin de son seigneur lige.
– En nom Dieu, s’écria-t-elle, puisque je puis avoir deux champions, vous combattrez tous les deux.
Après manger, le blanc damoisel se leva et vint au mur de la salle où se trouvaient appuyées une quantité de lances. Il en choisit une, la plus grosse et la plus forte qu’il put trouver, en éprouva le fer et le bois, et rogna la hampe de deux grands pieds en présence de tous ceux qui étaient là. Ensuite il alla examiner ses armes avec ses écuyers, regardant bien si rien n’y manquait : ni courroie, ni poignée à son écu, ni maille à son harnois, ni lacet à son heaume. Et tous l’en prisèrent davantage.
Le lendemain, dès que l’aube parut et que le guetteur corna sur le mur, il se leva et la dame le trouva à genoux devant le crucifix ; cela lui plut fort. Pourtant, quand les deux champions se furent mis en selle, à l’heure dite, dans la lande choisie pour la bataille, et qu’elle vit que le damoisel n’avait pris d’autres armes que l’écu et sa lance, elle en fut bien alarmée. Mais il lui déclara qu’il ne pourrait ceindre l’épée qu’après en avoir reçut le commandement de quelqu’un.
– Au moins, souffrez que j’en fasse pendre une à votre arçon, dit-elle. Vous avez à faire à un dangereux homme.
Ainsi fut fait ; puis les quatre champions prirent du champ et, quand le cor sonna, ils chargèrent deux contre deux, aussi vite que leurs chevaux purent aller.
Keu et celui qui s’adressait à lui s’entre-choquèrent si rudement que la tête et le cœur leur tournèrent ; tous deux lâchèrent leurs rênes, et les poignées de leurs écus, perdirent leurs étriers et roulèrent à terre, où ils demeurèrent étourdis le temps de parcourir un arpent au galop. Cependant le damoisel frappait l’écu de l’autre, et d’une telle force qu’il le lui serra au bras et le bras au corps, et qu’il le fit voler par-dessus la croupe de son destrier, ses rênes rompues à la main. Et sitôt qu’il eut passé, il revint au sénéchal qui se relevait.
– Prenez mon homme, sire Keu, et me laissez le vôtre !
Mais le sénéchal ne daigna répondre.