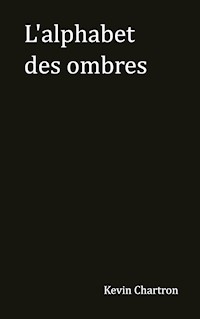Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Lorsque le Gouvernement Central décide de prendre Arisco, dénoncé dans tout le pays comme le plus dangereux des criminels, il confie cette mission au Général Petrus Mascarado, personnage aussi glorieux et craint qu'énigmatique. Toute une armée, alors, se lance à la poursuite, en pleine forêt amazonienne, d'un homme seul. Mais dans un pays proie d'invasions et luttant pour sa survie, dans un pays au gouvernement omniprésent, dans un pays où la population redoute autant qu'elle respecte ceux qui la protègent, que signifie de lancer une troupe entière, en pleine nature, après un homme seul ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Salazar
Qu’il faut lirecar l’orateur sera retrouvé plus tard
Petrus Mascarado
Arisco
Le rappel
Où chacun pourra se faire une opinion des paroles et des actes de l’un et de l’autre
Quelqu’un entend quelque chose
Amaïa
Petrus Mascarado contre lui-même
Un doute peut en valoir un autre
La rue
La colonne infernale
Quelqu’un d’autre entend quelque chose d’autre
La vérité sur l’Affaire Petrus Mascarado
Le pot-aux-roses
De Charybde en Scylla
La vérité sur l’Affaire Arisco
I - Salazar
Aux ides de chaque mois, le Gouvernement Central missionnait un de ses hommes, du reste choisi parmi des volontaires, qu’il chargeait de se rendre, seul, dans le Territoire National du Recuerdo, situé dans le comté d’Alma, dans la province de Conocimiento. Là se trouvait le mausolée de Salazar. Le Gouvernement Central avait instauré, à l’époque de son édification, le Territoire Unique. Administré directement par le Gouvernement Central, ne dépendant d’aucune province (pas même celle dans laquelle il se trouvait) ni d’aucun gouverneur (pas même celui du comté), le Territoire National du Recuerdo devait, selon les termes mêmes de la loi qui l’instituait, rester inchangé et inviolé. Aucune construction n’y était permise, pas plus qu’une exploitation des sols et des sous-sols, qu’un barrage ou une ponction sur un cours d’eau, que l’abattage ou l’élagage d’un arbre. Les manœuvres militaires, les transports de marchandises, le survol même étaient prohibés. Seul le délégué du Gouvernement Central recevait, une fois par mois, la permission d’entrer dans le Territoire National du Recuerdo, de le parcourir et de se rendre auprès du mausolée du Territoire Unique.
La tâche de ce délégué consistait à maintenir le mausolée dans un état parfait de présentation en le débarrassant et en le nettoyant des herbes et mousses, en chassant les bêtes y élisant refuge et en maintenant, par la coupe des feuilles, branches et arbustes, un périmètre propre et régulier. A ce titre, le délégué du Gouvernement Central était le seul citoyen autorisé à toucher au paysage du Territoire National du Recuerdo et du Territoire Unique.
Cette mission constituait un grand honneur, parmi les honneurs les plus remarquables auxquels le Gouvernement Central pouvait élever un de ses citoyens. Cela expliquait que chaque mois des volontaires fissent en masse acte de candidature. Le Gouvernement Central, par ailleurs, allouait au soldat retenu pour cette mission une solde ponctuelle nettement supérieure à celle des plus hauts gradés. Ce soldat était, en outre, décoré au cours d’une cérémonie publique. Rien n’interdisait de se représenter après avoir accompli une mission, un délai d’itération d’un an minimum devant être respecté. Ce principe permit à certains soldats d’être désignés à plusieurs reprises, de jouir d’un prestige considérable au sein de la population et de vivre – richement parfois – des primes.
Le privilège d’être choisi résidait également dans le fait que le mausolée, le Territoire Unique et le Territoire National du Recuerdo étaient interdits à la population, sans aucune distinction ni exception. Si bien que seul le soldat choisi par le Gouvernement Central pouvait voir la tombe de Salazar. Les plus hauts personnages de l’Etat parfois en ignoraient jusqu’à l’aspect. Il n’existait aucune représentation du mausolée, et personne ne savait au juste, les années passant, à quoi il ressemblait. D’où l’extrême application, sévérité et solennité avec lesquelles le Gouvernement Central arrêtait, chaque mois, son choix. Du reste, le trajet était périlleux. Il fallait accomplir plusieurs jours de marche, accompagné d’un âne bâté portant les vivres et le matériel, et parcourir la forêt en échappant aux animaux, aux maladies et à la folie. Cela explique pourquoi le Gouvernement Central ne retenait que les candidatures de soldats aguerris, bien notés par leurs supérieurs et connus pour leurs actes de bravoure et de dévouement. Au cours des périodes prolongées de paix, les actes de bravoure n’entraient pas en considération dans le choix du soldat, cela va sans dire. Deux précautions valant mieux qu’une, en sus de n’envoyer que les meilleurs hommes de la troupe, le Gouvernement Central se prémunissait contre toute expédition frauduleuse et contre tout acte d’escroquerie. Il eût été aisé, et nous ne le précisons qu’à des fins historiques et anthropologiques, pour un homme désigné pour cette mission de se retirer des regards quelques jours puis de reparaître en affirmant avoir traversé le Territoire National du Recuerdo, avoir atteint le mausolée de Salazar, l’avoir nettoyé et être revenu, à seules fins d’être socialement considéré et de toucher l’importante prime. Ce genre de manigances se retrouve dans toutes les sociétés que le genre humain a pu fonder. Afin d’éviter toute mascarade et toute honte pareilles, le Gouvernement Central confiait au soldat désigné un objet enveloppé dans du papier provenant de l’Imprimerie Nationale et scellé à la marque de l’Etat. Cet objet devait être déposé au pied du mausolée, dans une niche close. Tout soldat accomplissant la mission devait, avant de laisser le sien, récupérer l’objet prouvant que son prédécesseur n’avait pas floué la société.
Le Gouvernement Central décidait également au début de chaque année quel mois verrait une expédition sans prime. Le soldat volontaire et désigné ce mois-ci devait accomplir la même mission que ses onze camarades de l’année, courir les mêmes dangers et risquer tout autant sa vie, mais aucune somme d’argent ne lui était remise en récompense. Il se payait en prestige, attendu qu’une telle dévotion devait nécessairement engendrer des honneurs plus mémorables. Quoi qu’il en soit, il n’est pas douteux que si le Gouvernement Central vouait là un culte sincère à la mémoire du plus grand personnage de l’histoire de la Nation, il maintenait l’intérêt de la population pour l’incorporation militaire par la promesse d’une prime garantissant la subsistance aisée d’une famille pendant plusieurs mois, ce qui pour nombre de fils et de pères était loin d’être négligeable. Les épopées mensuelles prenaient également forme d’exemples pour la jeunesse du pays. Du reste, le mois sans prime vint à briller d’un tel prestige qu’on rencontrait des soldats ne se portant volontaires que pour celui-ci.
Chaque mois, au retour de la mission, le Gouvernement Central organisait une cérémonie pendant laquelle le héros se voyait remettre ses décorations. On inscrivait ses nom et prénom et ceux de ses père et mère sur le monument central de la cour du palais du Gouvernement Central, sur celui de la place d’armes et de la grand-place de la capitale et sur celui de la place de sa ville ou de son village de naissance. On en érigeait un s’il n’y en avait pas encore. Quelques jours plus tard, une délégation du Gouvernement Central se présentait chez les parents du héros pour leur remettre la prime.
Le Territoire Unique présentait cette particularité d’être le plus important et le plus sacré du pays tout en étant le plus petit. De forme circulaire, il s’étendait sur une surface de quelques mètres carrés en tout et pour tout. Las, l’architecte commit une erreur de calcul. Cela arrive même aux meilleurs et, présentement, l’architecte n’était même pas de ceux-là. De ce fait, le périmètre du Territoire Unique ne peut être donné sous son résultat exact, la formule idoine pour le calculer à l’aide de pi conduisant à un chiffre décimal dont on ne voit pas la fin. Nous nous bornerons donc, c’est le cas de le dire, à apporter un arrondi : le Territoire Unique établissait sa circonférence à trente-et-un mètres.
En pleine nature, dans la partie la plus reculée de la forêt, dans la partie la plus éloignée de toute vie et activité humaines, le Gouvernement Central fit donc déboiser un cercle d’environ trente-et-un mètres de circonférence. On installa au centre de ce cercle le corps de Salazar, la tête dirigée vers l’ouest, une main sur la poitrine, l’autre le long du corps, dans un sarcophage de pierre creusé recouvert d’une dalle de marbre scellée. On déposa le sarcophage sur une estrade. On ne grava rien sur la table de marbre ni sur le sarcophage de pierre. Le tombeau fut placé au centre d’un cercle d’un mètre de rayon dont on recouvrit le sol de petites pierres blanches. On recouvrit le reste du Territoire Unique, de la bordure de ce cercle blanc jusqu’à la forêt qui ceignait l’espace sacré, de petites pierres noires. Le soldat qui se présentait chaque mois devait éliminer toute forme de végétation apparue sur le Territoire. Il devait tout aussi bien replacer chaque pierre blanche mélangée aux noires, et inversement, par le vent, la pluie ou les bêtes. Les animaux ne témoignent pas pour les lieux sacrés des mêmes prévenances que les sociétés humaines et le Gouvernement Central refusa toujours la construction d’une palissade autour du Territoire Unique. Au reste, cela empêche-t-il le sautillement et l’ébrouement des oiseaux ? Le soldat emportait avec lui, porté par l’âne, outre des vivres, des outils de coupe et de nettoyage, une petite quantité de pierres blanches et noires lui servant à remplacer celles que les intempéries, la saleté ou l’usure marquaient.
On trouvait également sur le Territoire Unique trois panneaux de marbre, solidement ancrés dans le sol et formant une manière de retable. On plaça le premier devant le tombeau, à la tête de Salazar ; les deux autres se tenaient sur les côtés du sarcophage. On eût pu tracer un arc de cercle allant de l’extrémité de celui de gauche à l’extrémité de celui de droite et passant par le centre de celui du milieu. Les trois panneaux avaient deux mètres de haut et un mètre de large. Sur celui du milieu, on pouvait lire :
Nul ne sait quand il naquit. Nul n’ignore quand il mourut. Nul ne sait s’il eut père et mère. Nul n’ignore qu’il est père de tous.Nul n’a jamais vu son portrait. Nul n’ignore sa figure. Nul ne sait son prénom. Nul n’ignore son nom. SALAZAR
On racontait d’ailleurs qu’il n’était pas un enfant de trois ans qui fût incapable de citer le nom de Salazar et qu’aucun n’ignorait ses exploits. Cela relève au mieux de la supposition car jamais personne ne demandait à un enfant de trois ans s’il connaissait Salazar. Mais il s’agit là d’une façon de parler pour évoquer le fait que Salazar resplendissait depuis sa tombe d’une gloire immarcescible et qu’une gloire à ce point immense ne pouvait qu’être connue de tous.
Sur le panneau de gauche, on pouvait lire :
JUSTICE
Quand il faisait la conquête de ces terres, on rapporta un jour un crime à Salazar. On lui dit que deux Indiens, avec la complicité d’un Espagnol, avaient volé. Abandonnant sur l’heure ses projets et ses plans, mettant de côté l’entreprise de conquête commandée par la Couronne, il rassembla des hommes et se mit sur le champ à la poursuite des criminels. La traque dura trois jours et trois nuits. Salazar perdit trois hommes, emportés par les créatures de la forêt ou des rivières. Après deux jours, il fut sans aucun doute sur la trace des criminels lorsqu’on lui signala, dans un dispensaire, le passage la veille de trois hommes dont un souffrait d’une blessure à une jambe. Au soir du troisième jour, Salazar consentit à une halte pour reposer ses soldats et ses chevaux. Pendant qu’une partie des hommes défrichaient pour installer le campement, d’autres furent chargés de longues rondes et patrouilles dans les alentours, à la recherche d’indices, de traces et de pistes à suivre. Vers minuit, on amena au camp un homme, trouvé rampant dans la jungle. Deux soldats le soutenaient pour marcher car il semblait à bout de forces et une jambe blessée le faisait boiter. On présenta l’homme à Salazar, dans la lueur sombre et ondulante des torches nocturnes. C’était l’Espagnol complice des deux Indiens criminels. Dans sa fuite, il avait été touché par la balle d’un soldat. Les deux Indiens, poursuivis par les cavaliers de Salazar, parvinrent à le mener jusqu’au dispensaire. On y refusa d’abord de le soigner. Puis, devant ses souffrances et l’état morbide de sa plaie, on appliqua les soins qu’on pouvait. Les trois hommes repartirent quelques heures plus tard. Mais le bandage se défit et tomba au sol. C’est cela qui donna à Salazar, lorsqu’un de ses hommes découvrit le pansement, la certitude d’aller dans la bonne direction. Comme ils essayaient de traverser une rivière, les deux Indiens, frappés par une poussée du courant, ne purent retenir l’Espagnol qui leur échappa. Après avoir atteint les rives, ils le cherchèrent des yeux, le crurent noyé et s’enfoncèrent dans la forêt. En aval du cours d’eau, l’Espagnol réussit à agripper une branche allongée au-dessus du courant et gagna la rive. Là, apercevant les deux Indiens qui fuyaient, il appela, mais la fatigue et l’émotion de la noyade évitée lui avaient coupé la voix. Ayant heurté avec sa jambe blessée un rocher contre lequel le courant l’avait jeté, il fut incapable de se mettre debout et commença de ramper derrière les deux Indiens, déjà loin, pour tenter en vain de les suivre. Il rampa ainsi toute une journée, sans aucune chance d’arriver où que ce soit.
Quand tous les soldats furent rassemblés, Salazar lui-même commença d’interroger l’homme.
– D’où viens-tu ? demanda-t-il.
L’homme, toujours soutenu par deux soldats, regardait Salazar dans les yeux, le visage couvert de terre et de salissures, les vêtements foncés et alourdis par l’humidité. Mais il ne répondit rien.
– Où allais-tu ? demanda Salazar.
L’homme ne répondit toujours pas.
Un souffle de vent éteignit alors une des torches. Salazar demanda à un des soldats de s’approcher et il lui dit tout bas :
– Passez votre torche devant cet homme, des pieds à la tête, que je le voie mieux.
Le soldat exécuta l’ordre et l’on put voir le captif déchaussé, sa jambe vilainement blessée, ses vêtements sales et pesants, sa poitrine tout en sueur traversée de griffures et d’écorchures, son visage fatigué et marqué. Salazar dit alors :
– Cet homme est blessé et épuisé. Qu’on lui apporte un siège !
Quelques secondes plus tard, assis à quelques mètres de lui, l’homme regardait Salazar qui demeurait immobile et fixait dans l’air un point invisible.
– As-tu bu aujourd’hui ? demanda-t-il.
– Non, répondit l’homme.
– Cet homme a soif. Qu’on apporte de l’eau !
Alors, Salazar pencha la tête et regarda l’homme boire. Il but lentement, par petites gorgées. L’eau était claire et encore fraîche. L’homme frissonna quand elle parcourut son corps en glaçant sa poitrine, ses entrailles et son échine.
– Qu’as-tu mangé aujourd’hui ? demanda Salazar.
– Rien, répondit l’homme.
– Cet homme a faim. Qu’on apporte de la nourriture !
Deux des soldats qui transportaient les vivres donnèrent à l’homme des fruits et de la viande séchée, avec laquelle il manqua de peu s’étouffer. Quand l’homme eut mangé sous les regards de tous les soldats, on vit sa mine changée. Il reprenait des couleurs, sa respiration se faisait plus régulière, il se redressait même sur son siège. Salazar le considéra un moment, tandis qu’on remettait dans des sacs ce qui n’avait pas été avalé. Puis il lui demanda :
– Dans quelle direction sont partis les deux Indiens que tu as assistés dans leur crime, qui t’accompagnaient et que tu as perdus ?
Sans tressaillir, l’homme répondit calmement :
– Je n’ai commis aucun crime. Aucun Indien ne m’accompagnait. J’étais seul et je me suis perdu.
– Cet homme ment, dit alors Salazar. Qu’on l’exécute !
Et justice passa.
Sur le panneau de droite, on pouvait lire :
LOYAUTÉ
La dernière campagne militaire menée par Salazar, éprouvante et pénible, donna à chacun la preuve de sa loyauté envers la Nation et de sa fidélité au Peuple, au Gouvernement Central et au devoir.
Depuis plusieurs mois, nos terres subissaient les attaques et incursions de troupes ennemies venues de l’ouest et du nord. Celles-ci s’étaient entendues dans une alliance contre notre Nation. Le Gouvernement Central réagit judicieusement en envoyant quatre armées de vétérans et de troupes d’élite. Deux colonnes se dirigèrent vers l’ouest, deux se dirigèrent vers le nord. Salazar commandait une de celles allant vers le nord.
Quelques semaines après le départ des quatre armées, un messager se présenta au palais du Gouvernement Central. Il allait à pied, entouré d’une escouade d’infanterie. Il remit au premier personnage du Gouvernement Central un petit pli dans lequel on lisait ceci :
« Je porte à la connaissance du Gouvernement Central les faits très graves qui suivent.
Nous faisions route vers le nord, à un jour de marche en arrière des troupes du Général Embustero. Un messager est arrivé. Il était envoyé par le Général Cazado. La lettre qu’il portait disait que les deux armées de l’ouest venaient d’être attaquées. Celle du Général Varado a été presque entièrement anéantie. Une poignée d’hommes a pu se replier, sauvant quelques chevaux et une partie des munitions. Tous les vivres sont aux mains de nos ennemis. L’armée du Général Cazado s’est portée au secours du Général Varado dès que la nouvelle de l’attaque fut connue. Elle a, à son tour, subi d’importantes pertes, moins graves à ce qu’il semble. D’après le messager nous ayant rejoints, le Général Cazado dispose encore de la moitié de ses hommes. Par conséquent, j’ai fait dire au Général Embustero que je faisais marcher mes troupes en renforts de celles du Général Cazado et du Général Varado afin de contenir, sinon repousser, la progression des troupes ennemies. J’ai laissé un détachement auprès du Général Embustero afin qu’on m’avertisse au plus vite des événements se déroulant au nord. Ces hommes font une navette continuelle entre mes troupes et celles du Général Embustero. Sachez donc que la frontière ouest est enfoncée et que la débandade de nos troupes y est complète. Si l’on considère de tels propos comme défaitistes, que l’on me traduise en cour martiale. Sachez donc également que la frontière nord est dégarnie et que le Général Embustero devra très certainement faire face seul à une attaque.
Avec toute la dévotion que vous me connaissez et toute l’estime que je vous porte,
Général Salazar. »
En fin d’après-midi, alors que le Gouvernement Central parait au plus pressé et donnait les derniers ordres aux renforts qui allaient partir vers la frontière nord tandis qu’on envoyait des vivres à la frontière ouest, un autre messager se présenta au palais. Celui-ci arrivait à cheval, entouré d’une escouade de cavalerie. Il remit au premier personnage du Gouvernement Central la lettre que voici :
« Je porte à la connaissance du Gouvernement Central les faits très importants qui suivent.
Nous faisions route en direction de l’ouest depuis plusieurs jours. Quelques hommes du détachement laissé au nord avec le Général Embustero nous ont rejoints. Ils nous ont appris que, quelques jours après avoir été laissé seul pour défendre la frontière nord, le Général Embustero a fait sécession. D’après nos hommes, il aurait rallié la cause ennemie. Plusieurs soldats du détachement ont été tués en tentant de fuir pour nous rejoindre. Plusieurs hommes du Général Embustero ont violemment rejeté cet acte de trahison de leur chef. Tous ont été passés par les armes après des combats. Nous ignorons combien ils étaient et combien d’hommes le Général Embustero a perdu lors des affrontements.
Par conséquent, nous nous sommes repliés sur une position nous permettant de contrer l’avancée éventuelle des troupes ennemies étrangères comme l’avancée des troupes du Général Embustero en provenance du nord. Cette position vous sera communiquée de vive voix par mon messager. Un détachement a poursuivi sa route en direction de l’ouest avec pour consigne d’ordonner au Général Cazado et au Général Varado de se replier également et de nous rejoindre. Je tiens donc à vous confirmer que j’ai pris sur moi d’ordonner un repli général de toutes nos troupes. A l’instant où j’écris cette lettre, je ne sais si le Général Cazado et le Général Varado ont reçu cet ordre et s’ils y ont obéi. Sachez que si tel est le cas, je suis seul à pouvoir être tenu pour responsable. J’accepterai toute mise en accusation par le Gouvernement Central si mon comportement relevait à ses yeux de faits de trahison. J’affirme que si les hommes m’ont suivi dans ce repli, ce n’est aucunement par couardise ou compromission. Mon prestige seul les a convaincus de l’excellence de cette manœuvre. Aucune accusation à leur endroit ne saurait donc se justifier.
Sur les quatre armées, une seule demeure intacte. La mienne. J’espère voir nous rejoindre ce qui reste de celles du Général Cazado et du Général Varado. Tout porte à croire que nos ennemis lanceront très bientôt une offensive depuis l’ouest et une autre depuis le nord, laquelle sera appuyée par les troupes félonnes du Général Embustero. Le spectacle de notre débâcle et de notre repli les y incitent obligatoirement. Que l’on me fasse comparaître devant une cour martiale si l’on estime mes propos et mes actes défaitistes. Je ne fais que porter à la connaissance du Gouvernement Central la réalité des faits afin qu’il y réponde comme il se doit. Notre repli était nécessaire pour préparer nos défenses et ne pas être encerclés.
Si le Gouvernement Central peut nous faire parvenir des renforts, je les prendrai sous mon commandement. S’il ne le peut pas, nous vaincrons sans eux.
Avec toute l’estime que je vous porte et toute la dévotion que vous me connaissez,
Général Salazar.
P.S. : Fuir n’est pas toujours un acte commis par des lâches. Les soldats qui ont fui les troupes du Général Embustero pour nous avertir de sa trahison en ont donné la preuve et ont fait par là-même montre de leur courage et de leur loyauté. Je porte à votre connaissance les noms de ces soldats pour les recommander à vos décorations les plus honorifiques :
Soldat Buenaventura Sinresplendar – de toutes mes campagnes.
Soldat Cesar Corriente – de toutes mes campagnes.
Soldat Honorato Francisco Fiel y Leal y Ciego.
Soldat Liberato Del Monton – de toutes mes campagnes. »
Le gouvernement envoya tous les renforts qu’il put. Tous les hommes dont on disposait encore partirent sur le champ. Ils arrivèrent trop tard. Ce qui ne serait que tragique s’ils n’étaient pas arrivés au mauvais endroit. En effet, si le Général Salazar avait pris soin de ne pas écrire dans sa lettre la position de sa zone de repli, il espérait éviter ainsi que le document, tombé aux mains d’ennemis, se retournât contre lui au lieu de le secourir. Il n’imaginait pas que le messager à cheval et l’escouade de cavalerie le trahiraient et indiqueraient, de vive voix, au Gouvernement Central une mauvaise position, avant de vouloir avertir le Général Embustero que la capitale se trouvait sans la moindre défense. Si bien que quand le Gouvernement Central comprit qu’on le manipulait et que les renforts furent enfin, après contre-ordre, envoyés au bon endroit, il était trop tard : le Général Salazar avait déjà remporté une éclatante victoire. Il retenait prisonnier le Général Embustero et remit au Gouvernement Central deux coffres remplis de pièces d’or et de bijoux en argent. C’étaient ceux que le Général Embustero avait reçus pour trahir. Il les avait offerts tels quels au Général Salazar pour qu’il prît son exemple et se tirât de cette position à ces yeux désespérée. En réponse, le Général Salazar éclata dans un rire sonore et fit donner la troupe.
Le Territoire Unique n’était pas un lieu de recueillement, ni un lieu de célébration. C’était un lieu sacré, un lieu de mémoire sans visiteur. Nul n’ignorait son existence ; personne ne l’avait jamais vu. Les trois panneaux de marbre gravés ne pouvaient être lus que par le soldat envoyé chaque mois par le Gouvernement Central. Personne pourtant n’en ignorait le texte. Il est des choses qui se savent.
Il vint un jour à l’esprit d’un député l’idée de demander l’abandon du Territoire Unique. Il avançait qu’une chose sue par tous sans que personne ne la vît jamais ne portait plus en elle la moindre raison d’être. Puisque tout le monde vénérait Salazar, entretenir physiquement et matériellement son souvenir devenait inutile. Puisque qu’on glorifiait Salazar sans jamais voir son mausolée ni lire ses exploits, à quoi bon entretenir son tombeau ? Le sacré existait de lui-même et l’espace du sacré n’avait plus lieu d’être. Il avançait également que l’entretien du mausolée, la gravure des noms du soldat et de ses parents dans la capitale et son village de naissance, les généreuses primes versées onze mois sur douze et les fonctionnaires de l’Etat occupés à la question grevaient les finances de la Nation, laquelle était, qui plus est, endettée. On pouvait donc économiser le symbole matériel sans ternir le symbole moral et d’une pierre deux coups économiser son coût.
On ne tint nul compte de cette remarque.
II - Qu’il faut lire car l’orateur sera retrouvé plus tard
A ceux qui pensent, ici, parmi nous, que nous n’accomplissons là qu’une œuvre injuste, je réponds qu’ils se trompent. Leur conscience n’est pas au rendez-vous de leur devoir. Nous ne traquons pas un homme, nous poursuivons un criminel. Rien, ici, ne peut être qualifié d’excès de zèle, de vengeance personnelle, d’acharnement. C’est la lutte obstinée et déterminée de la justice et du droit contre le crime, la corruption et l’impureté. Je ne suis rien d’autre que l’expression de la société saine et bien portante voulant se guérir d’un corps malade. Vous êtes les soldats de cette guérison.
Le fléau viral qui s’abat sur nos terres, ce n’est pas le bras armé de la rigueur, de la morale et des lendemains sûrs, c’est le bras armé du crime. C’est ce crime qui corrompt les esprits et détourne les âmes. C’est ce crime qui vole, qui violente, qui tue, qui s’en prend aux femmes et aux enfants, qui, depuis les bas-fonds où il germe fétidement, répand sur l’horizon son voile et sa tâche noirs. Car le crime vient d’en bas, sachez-le bien ; il ne vient jamais d’en haut. Quand la cime de la société ploie, c’est que la base est pourrie. Votre présence ici, devant moi, en demeure à jamais l’ultime et décisive preuve. Qui que vous soyez, quelle que soit votre condition, vous quittâtes un jour votre existence, hideuse ou splendide, pauvre ou riche, pour rejoindre cette armée dont la mission éternelle est d’extirper le crime des basses couches de la société. Vous n’êtes pas au sommet, pas plus que moi, mais nous sommes le dernier rempart protégeant la cime de cette nation. Nous regardons vers le bas, pour voir où la terreur se loge et pour l’annihiler, en pensant aux nôtres mais en ne les épargnant pas. Nous regardons vers le bas avec bienveillance, mais sans la moindre pitié. Où la loi doit agir, elle agit ; où son bras doit frapper, il frappe ; où ses armes doivent tuer, elles tuent. Vous êtes ces bras et ces armes. Rien ne se mettra jamais en travers de notre avancée vers la justice et l’ordre. Celui qui s’oppose à nous, celui qui nous fait barrage est contre nous. Il est contre l’idéal lumineux sur lequel est bâtie notre société. Il doit être éliminé et il le sera. Poursuivi par nous tous ou par le dernier d’entre nous qui survivra, il répondra de sa faute et de son crime.
Rappelons-nous les exploits de Salazar, et comment ils nous disent, aujourd’hui encore, ce que nous devons faire. Rappelons-nous son attitude exemplaire face à l’Espagnol, complice de deux Indiens, qui lui mentait. Ce haut fait est gravé en toutes lettres au mausolée du Territoire Unique. Pour le crime qu’il avait commis, cet homme méritait d’être puni. Pour s’être rendu complice d’un crime, il méritait d’être puni. Pour son mensonge, peut-être sa faute la plus grande, il méritait encore d’être puni. Il méritait plus encore : il méritait d’être châtié. Salazar n’a pas été inhumain avec lui. Il le traita en homme, lui offrit le réconfort, de quoi étancher sa soif, de quoi éteindre sa faim, de quoi soulager sa blessure et reposer ses membres. Qu’obtint-il en retour ? Le mensonge ! Qui fut inhumain ? Qui décida de ne pas considérer l’autre comme son égal en droits et en intelligence ? A Salazar qui lui tendait la main, cet homme a menti. A Salazar qui le poursuivait pour son crime, cet homme osa répondre que le crime n’existait pas. Il regarda la loi en face et lui dit : « Vous rêvez, vous voyez des choses qui n’existent pas, vous inventez des crimes et des coupables, vous n’avez pas toute votre tête ». Voilà la grande insulte à la dignité humaine, et à la masse passée, présente et future des hommes qui bâtissent nos sociétés d’ordre et de justice. Voilà l’injure suprême.
Mesurez la bonté et la grandeur d’âme. Salazar aurait pu, tout à sa satisfaction d’avoir pris un des coupables et à sa hâte de prendre les deux autres, interroger cet homme sur le champ, chercher la vérité et trouver à sa place le mensonge à la minute même où ses soldats lui avaient présenté l’Espagnol. Mais cela aurait-il été juste ? Qui devant l’assoiffé ne tend pas sa gourde ? Qui devant l’affamé n’ouvre pas son havresac ? Qui devant le blessé ou le mutilé ne prête pas son épaule ou ne donne pas une béquille ou une canne ? Le plus misérable des hommes partagerait son quignon de pain avec le chien errant qui passe. Qui ne le ferait pas pour son semblable ?
Mais il ne s’agit ici ni de pitié, ni de chantage. Il s’agit d’un accord, d’un consentement mutuel. Je ne nie pas ce droit fondamental accordé au criminel qui est de fuir. Personne ne peut contester ce droit. Il est le plus sacré, avec celui pour le prisonnier de s’évader. Personne ne veut passer une minute de son existence dans un cachot, et personne ne veut être pris en sachant qu’on l’enverra y croupir ou qu’il terminera sous une potence. Et fuir après un crime, c’est déjà savoir que c’est un crime. Le criminel qui fuit n’est pas à blâmer ; il est à reconnaître en tant qu’homme et il est dans son droit ; il sait mieux que personne ce qu’il en coûterait d’être pris. Blâmer le criminel pour son crime, cela s’entend. Nous en tombons tous d’accord, et c’est ce qui justifie notre présence ici. Mais blâmer l’homme qui refuse de ne plus être libre de ses mouvements, voilà un autre crime, voilà une insulte à la conscience humaine. Cet homme fuit, et nous le poursuivons. Mais n’oubliez jamais que ce n’est pas sa fuite qui le rend coupable, c’est son crime. On voit des innocents fuir ; mais on n’a jamais vu un innocent coupable. Et à ceux qui rétorqueront que le criminel n’a qu’à rester honnête pour ne rien risquer, je réponds que cela est hors de propos. On ne sait jamais, avant de commettre un crime, qu’on le commettra. L’intention n’a jamais été un savoir ou une connaissance. Elle n’est même pas un fait. Les Grecs racontaient l’histoire d’un homme devant se rendre aux bains pour y retrouver un ami. En chemin, tandis qu’il rêve au ciel ou aux étoiles, des soldats croisèrent sa route et l’arrêtèrent.
– Où te rends-tu comme cela ? demanda le chef.
– Je ne sais pas, répondit l’homme.
Croyant à une moquerie – ce qui revient pour lui à une injure – le soldat fit arrêter et jeter l’homme en prison. Ce faisant, il lui donna doublement raison. Car, entendez bien cela : avoir l’intention d’aller quelque part ne signifie pas qu’on soit en train de s’y rendre et signifie encore moins qu’on sache où l’on va arriver. Cela ne signifie même pas qu’on fasse ce qu’il faut pour y arriver. Du reste, ce brave homme grec ne pouvait qu’ignorer qu’il finirait sa journée en prison. Si bien que, marchant avec l’intention de se rendre aux bains, il était plus que quiconque fondé à dire qu’il ne savait pas où il allait. Comment savoir ce qui adviendra entre l’intention et sa réalisation ?
Je répète donc qu’il est hors de propos de dire qu’un innocent qui ne commet pas la folie de devenir coupable n’a aucune raison de fuir et qu’il suffit de rester honnête pour ne pas craindre d’être poursuivi. Car la pensée n’est pas criminelle. Et l’homme qui commet un crime n’est coupable de rien tant qu’il s’en tient au désir du crime, à la volonté du crime, à la pensée du crime. Et même, dirai-je, tant qu’il s’en tient à la préméditation. Retenez bien ceci, et ne l’oubliez jamais : si le crime ne peut pas être constaté, si la victime n’existe pas, alors le crime n’existe pas et aucun coupable n’est à rechercher. Car le projet n’est rien. Supposez qu’un homme nourrisse le projet d’un livre, le qualifieriez-vous pour autant d’écrivain ? Diriez-vous que le roman existe ? Vous ne le pourriez pas, car quiconque vous dirait : « Ce roman, montrez-le-moi » prendrait à défaut votre certitude et votre affirmation. Pas plus qu’il n’y a d’écrivain sans roman, il n’y a de coupable sans crime. L’intention n’est donc rien. Même l’intention la plus poussée ne peut tenir lieu de crime. Celui qui s’apprête à fusiller un homme n’est coupable de rien tant qu’il n’a pas appuyé sur la détente. Et une fois qu’il a tiré, une fois qu’il a fait une victime, alors il est coupable et son crime est terrible. Il est coupable, mais savait-il seulement qu’il oserait ne pas renoncer ?
Revenons maintenant à cet homme que Salazar fit exécuter. Je dis qu’il ne doit être l’objet d’aucune indulgence, d’aucune compassion. Pas un seul de nos sentiments de bonté ou de commisération ne doit être dirigé vers sa mémoire et vers son âme. Son crime faisait de lui un coupable, et il méritait qu’on le punisse pour cela. Sa fuite était légitime. Elle était même saine. Qui sait les pensées qui le tourmentèrent durant toutes ces heures d’errance ? Mais à l’instant même de sa capture, dès l’instant où la force de la loi et de la justice se saisissaient de lui, il n’était plus un homme en fuite face à l’insondable mépris des geôles, il était le coupable devant répondre de son crime. Alors son destin changeait. Il n’était plus l’homme qui échappait à la loi, il était l’homme qui lui faisait face. Je ne saurais dire laquelle des deux positions est la plus courageuse. Fuir, c’est aussi affronter son crime, et la conscience est un poids autrement plus lourd que les fers. La prison est une nécessité, je n’en douterai jamais. Mais elle ne se résume pas à la cœrcition. Elle extrait le criminel de la société qu’il trouble et met un double verrou sur l’oubli où elle le plonge, mais jamais elle ne prendra la noirceur du remords, jamais elle ne se fera plus accusatrice que la honte, jamais elle n’aura l’œil plus tourmenteur que la conscience. Or, ces ténèbres se trouvent dans l’âme humaine et nul ne sait où elles dorment, nul ne sait ce qui les fait germer. Et nul ne sait quel homme les connaîtra un jour.
A l’instant de la capture, disais-je, tout changea. Car c’est à l’instant précis de la capture que le soldat poursuivant le criminel cesse d’être son chasseur pour devenir son protecteur. C’est à lui désormais de garantir sa santé et ses droits. Mais c’est aussi à cet instant qu’un accord muet et invisible est conclu entre le criminel devenu captif et le chasseur devenu gardien. La fuite et la cavale ne sont pas des fautes. Elles sont l’expression désespérée du refus humain de l’enfermement physique. J’insiste sur ce point, et vous en soupirez peut-être, mais cela ne doit jamais quitter votre esprit. Que votre détermination et votre colère ne soient en rien accrues par la fuite ; seul le crime compte. Ne blâmez jamais celui qui tente de vous échapper ; il se craint davantage qu’il ne craint le châtiment. Et la peur est le sentiment le moins méprisable et le moins risible qu’on puisse éprouver. Ayons toujours pour l’homme qui a peur la plus grande prévenance et les meilleurs sentiments. Quoi qu’il en soit, une fois le criminel pris, son premier devoir est de ne pas contredire la justice. La possibilité qui était la sienne de s’y soustraire disparue, il commet la grande faute morale et le grand acte de trahison en refusant le jugement de son crime. En le niant, en le dissimulant, en empêchant que la vérité pure et parfaite soit dite, en empêchant que le coupable soit reconnu et désigné comme tel, il obscurcit la société, il jette sur elle un brouillard propice au désordre. Il dit haut et fort : « J’ai fui, mais cela ne suffit plus. Maintenant je me cache. La vérité, qui est le premier droit de chacun, je vous en prive, car tout m’est égal et la société m’importe peu, car vos existences me sont indifférentes, votre bonheur compte moins que mon mensonge ». Cela n’est ni correct ni recevable. L’homme pris, l’homme tenu, l’homme dont la seule issue est morale et dont le seul et dernier espoir est la reconnaissance du monde qui naîtra de ses aveux, de sa résipiscence et du juste éclaircissement qu’ils enfanteront, cet homme-là, la fuite est son droit, la vérité est son devoir ; fuir n’avoue rien, mentir dissimule tout. L’obligation de la vérité s’impose à lui par l’échec flagrant de sa fuite. Car, pourquoi fuyait-il ? Il fuyait pour éviter la confrontation terrible de son crime et de la justice, de sa grande faiblesse et de l’impassible force de la société. La société qui l’observe sans ciller, la justice qui lui répond sans fléchir. Il craignait la cellule et le cachot et tentait d’y échapper. Nous lui accordons et nous lui reconnaissons ce droit. Mais il voulait aussi ne pas être sous l’œil éternel de la société et de la justice, il ne voulait pas savoir son visage scruté par des juges, ses moindres paroles entendues comme des tressaillements de l’âme ou des manifestations de son cœur troublé. Il ne voulait pas qu’on regardât ses mains trembler, devenir moites, se poser avec assurance sur une table, rester au fond de ses poches, se tordre sans fin, se fermer en poings serrés, car il ne voulait pas qu’on dît : « Voilà une preuve de plus », « Voilà un outrage supplémentaire ». Il ne voulait pas que, le voyant protester, on dît : « Un innocent ne perdrait pas son calme ! », et il ne voulait pas que, le voyant garder son sang-froid, on dît : « Un innocent n’irait pas placidement à la potence ». Car il n’est pas douteux que la place de l’accusé est une place terrible, et vouloir y échapper n’a rien d’incompréhensible. Aussi, la fuite de cet homme n’a rien qui doive nous surprendre. Je dis très honnêtement que ma réaction, dans une situation semblable, serait la sienne. Mais fuir, c’est se savoir recherché, c’est craindre d’être pris, c’est redouter qu’une chaîne retienne tout à coup son pas. Aussi, plus la fuite se prolonge, plus l’espace autour du fugitif rétrécit et réduit. En même temps que rétrécit son espace de vie, c’est son espace de pensée qui rétrécit et se referme sur lui-même. Il arrive alors un stade paroxystique au cours duquel le fuyard devient incapable de penser à autre chose qu’aux conditions actuelles et futures de sa fuite. Son existence se réduit à cette réalité : pour ne pas être enfermé, il se retrouve prisonnier de sa fuite. Pour ne pas subir cette épreuve insupportable qu’est la contrainte subie, il enclot son esprit et ne lui laisse plus comme seule vision que la marche en avant sans fin, sans but, sans alternative. Pour échapper, il s’enferme. Pour respirer librement, il respire petitement. Pour marcher sans entraves, il marche sans choix. Pour dormir sans être surveillé, il dort les yeux ouverts. L’existence en cavale est une existence réduite et contredite. C’est la vie dehors avec la noirceur de la vie dedans. C’est la liberté prise dans un étau. Quand la nuit est pour l’homme libre le grand moment de répit, c’est pour l’homme en fuite le grand moment de peur. On craint toujours plus de voir surgir un ennemi du noir qu’en pleine lumière. Et fuir c’est voir la nuit prendre toujours plus d’importance sur le jour. Jusqu’à l’instant décisif de la capture. J’ai dit que le fuyard craignait cette capture, qu’il tentait tout pour s’y soustraire. Pourquoi ? Parce qu’il sait ce qu’elle implique pour sa liberté physique, d’accord. Mais parce qu’il sait aussi l’obligation morale qui lui incombe s’il est pris. Cette obligation, c’est l’aveu, c’est la fin du silence sur le crime, c’est la reconnaissance pleine et entière de ses actes et de sa faute qui fait de lui un coupable et non plus un accusé.
Je vois parmi vous des mouvements de tête, je sens comme une rumeur. Vous vous interrogez et vous avez raison de le faire. Vous vous dites : « Et les innocents ? » Je parle de criminels, de coupables, d’aveux, mais que dire des innocents ? Des erreurs sont commises, et l’on pourchasse parfois des hommes auxquels on ne peut rien reprocher. Car la fuite ne prouve rien ; je l’ai déjà dit, et je le répète. Si les seuls coupables fuyaient, la justice mettrait moins de temps à examiner les affaires. Mais à l’éventualité de la fuite d’un innocent, je répondrais deux choses. La première est que s’il est vrai qu’un innocent peut fuir alors que rien ne peut lui être reproché, il n’est pas moins vrai que parfois la culpabilité du fuyard est certaine. Le flagrant délit ou l’impossibilité matérielle, physique, chronologique d’une autre solution ne laisse pas le moindre doute. La seconde chose est que dans l’éventualité où serait poursuivi puis arrêté un homme innocent, il est évident que cet homme mettrait toute son énergie certes à clamer cette innocence mais également à la démontrer pour se disculper parfaitement aux yeux de tous. Et il mettrait sa bienveillance et toute l’empathie que lui inspire la consolidation de la société et le bonheur des victimes à concourir à l’établissement de la vérité.
Maintenant, souvenons-nous de l’Espagnol poursuivi et arrêté par les hommes de Salazar. Etait-il coupable ? Oui. Nous le savions. Les témoignages, les preuves, les indices démontraient tous, sans aucun doute possible, la culpabilité de cet homme. Qu’en est-il de son interrogatoire ? A-t-il respecté le contrat entre le fugitif capturé et l’émanation de l’ordre et de la loi qui le poursuivait personnifiée en un homme dont j’ai déjà sûrement parlé au moins pour dire qu’il s’appelait Salazar ? Non. A-t-il participé à l’établissement de la vérité ? Non. Qu’a-t-il fait ? Il a menti et nié sa culpabilité. Et nier est la forme de moquerie la plus méprisable. Car elle vise, en présentant un mensonge comme la vérité, à dissimuler les propres turpitudes de celui qui l’emploie. Les innocents ne rechignent pas à dire ce qu’ils savent. Et certains coupables en font leur spécialité. Ils veulent uniquement sauver leur peau, pourrait-on m’objecter, et c’est pourquoi je précède cette objection. Ils disent tout ce qu’ils savent, et parfois plus. Parfois même, ils inventent plus qu’ils ne mentent. Ils croient résoudre et débrouiller leur culpabilité par des flots de paroles, comme une trouée de nuages sur l’océan sombre. Ils pensent contenter celui qui les tient en le noyant sous tant d’informations, tant d’indices, tant de dénonciations. Ils espèrent aussi s’attirer le nécessaire de sympathie et de reconnaissance qui rendra la peine moins lourde et qui éloignera peut-être la mort.
C’est en cela – permettez-moi cette parenthèse qui ne sera pas longue – c’est en cela, dis-je, que la torture constitue le procédé le plus abject, le plus injuste et le plus inhumain qui soit. Car, une fois qu’a été résolue la difficulté de trouver une personne suffisamment étrange pour accepter d’infliger des sévices à un semblable, sévices dont la seule vue, dont la seule évocation fait souffrir le commun des mortels et lui donne la nausée, la torture constitue cette forme insensée de justice dans laquelle l’innocent a plus à craindre que le coupable. Car, de deux choses l’une, ou l’innocent se tait et endure le martyre jusqu’à la mort ou aussi longtemps que son tortionnaire le juge nécessaire, ou il s’accuse de crimes qu’il n’a pas commis, voire en accuse d’autres que lui, pour abréger ses souffrances. Et qui ne dirait pas que celui qui se tait sous la torture est innocent ? Car qui ne parlerait pas pour le répit, même bref, du corps ? La torture se propose donc d’être l’instrument permettant au coupable de se sauver. Aussi, croyez-moi : torturer, c’est prendre le risque que la justice regarde dans la mauvaise direction.
L’homme qui ment devant la justice est un misérable, et il aggrave encore son crime en créant l’idée que ce crime n’existe pas ou en créant le soupçon et le doute qu’un autre l’ait commis. Mais l’homme qui avoue parce qu’il sent que cela attirera sur lui l’œil bienveillant et clément des juges, une forme de reconnaissance de la société, en plus clair qui voit dans l’aveu un mal nécessaire pour éviter la potence ou le bagne, cet homme ne travaille pas à la victoire de la justice ni à son triomphe. Cet homme travaille pour lui seul. Cet homme est égoïste, irresponsable et, osons le mot, intéressé. De la même manière que le témoignage et la protestation sincère d’un innocent éclairent la justice, le contrat moral et éthique existant entre le coupable qui est pris et la justice l’engage à ne pas trahir en paroles la chance et le droit physique de fuite qui étaient les siens. La justice qui ne prend pas le coupable doit se passer de la vérité ; le coupable qui est pris doit se passer du mensonge. Voilà la grande loi des sociétés humaines. Voilà le grand contrat social. Aussi rappelez-vous ce criminel espagnol pris dans la forêt par une patrouille, qu’on interrogea et qu’on abattit. Ne le blâmez pas d’avoir fui après son crime, mais ne pleurez pas son dernier sort. Si cet homme n’avait pas l’intention de dire la vérité, il aurait dû refuser l’eau et la nourriture qu’on lui donnait, lui qui fut pris assoiffé et affamé. Et quitte à mentir, il aurait dû mentir debout, lui qui fut pris blessé et rampant et qu’on porta pour l’asseoir. C’est une malhonnêteté morale qu’il paya. Et la morale, il n’y a que ça. Je dirais même qu’il n’y a rien d’autre.
Nous sommes ici nombreux et c’est heureux. Le rassemblement qui s’étale devant moi me remplit de joie. Il reste encore dans notre société des gens de bonne volonté. Et je vois parmi vos mines volontaires, parmi vos regards opiniâtres et décidés, je vois même à l’intérieur de vos cœurs nobles et fiers, au-delà de votre ardent et farouche désir d’accomplir votre devoir, chez certains, l’étincelle du doute et de la morale, l’ombre du remords, le questionnement vivace de la justice. Je sais parfaitement ce que certains d’entre vous pensent ou se disent. Vous regardez vos armes et leur nombre multiplié par le nombre multiplié de vos camarades, et vous vous demandez s’il est juste et humain de lancer tant d’hommes contre un seul, de lancer une armée à la poursuite d’un seul criminel. Je sais – j’insiste sur ce verbe – je sais que cela ébranle votre foi dans notre société. Nos manœuvres vous semblent un indice de nos mensonges, de notre corruption et du dévoiement de nos idéaux. Pour être exact, vous comprenez notre troupe comme la horde de la terreur. Aussi, il me semble nécessaire, et pour tout dire salutaire, de vous interroger à mon tour. Si vous étiez le chef de cette armée, si vous étiez l’homme que je suis, si vous étiez un supérieur, un ministre, organiseriez-vous une telle levée de troupes si vous ne la jugiez pas utile et nécessaire ? Je ne dis pas que le sort de notre société en dépend, mais je dis que laisser de côté un principe, c’est prendre le risque qu’ils soient peu à peu tous écartés. Oui, nous sommes armés et nombreux et cet homme que nous poursuivons est seul et fuit dans une forêt terrible où les bêtes sauvages peuvent vous dévorer, où la nuit vous ensevelit, où le jour vous rend au désert dense, impénétrable et infini des lianes, des hautes herbes et des eaux profondes ; oui, vous pouvez ainsi errer des jours durant sans voir le ciel que clôt la canopée. Oui, cela est vrai. Mais vous qui doutez et vous interrogez, croyez-vous être les seules intelligences de cette société à ne pas être malades ? Croyez-vous avoir raison contre ceux qui ne doutent pas, contre ceux qui décident, contre tout le monde ? Voici la véritable question : qui a raison ? Ceux qui savent, ou ceux qui doutent ? Certains parmi vous croient que cet homme est dangereux, d’autres croient qu’il ne l’est pas. Moi, je sais qu’il est dangereux, et je n’ai pas besoin d’y croire. Qui suivre, en esprit comme en actes ? Celui qui sait, ou celui qui croit ?
Aussi me permettrai-je ici une digression sur la question morale et philosophique du doute. L’homme qui doute est par essence l’homme qui croit et qui fait donc religion de ce dont il n’est pas certain. Voilà par conséquent sa situation paradoxale : il croit en ce dont il n’est pas certain et en en doutant remet en cause sa propre croyance. Pour autant, le doute ne doit pas être un absolu car si tel était le cas, il scléroserait l’être en le privant de toute possibilité de décision et d’initiative. Que ferait le citoyen au moment de décider de son vote face au doute altérant ses convictions ? C’est à ce point vrai que l’être doutant trop de lui-même ne fait plus rien, ou mal, par peur de l’échec ou, nouveau paradoxe, par certitude de n’y avoir aucun intérêt. Sa conduite ou sa pensée provoquent ou suscitent chez lui un tel questionnement qu’elle ne lui autorise plus rien.
Imaginons un individu qui, cheminant, arrive à une fourche. On l’en a prévenu et on lui a dit que le chemin partant vers la droite était plus court et plus sûr que celui partant vers la gauche. Seulement, il hésite. Il hésite parce qu’il doute. Croyant s’être décidé, il commence à se diriger vers la gauche, puis, doutant derechef, s’arrête et ne bouge plus. Son doute lui vient peut-être d’un défaut de mémoire : il ne se rappelle plus si on lui a conseillé de prendre à droite ou à gauche. Il lui vient peut-être d’une suspicion envers celui qui l’a conseillé : il ne fait pas confiance à son ami, ou bien ne fait pas confiance à l’inconnu à qui il a demandé son chemin. Son doute lui vient peut-être des circonstances, de ses impressions et de sa sensibilité. Supposons qu’on l’ait enjoint à prendre le chemin de droite et que, arrivant à la fourche, il voie un chemin de droite sombre, bordé de ronces, boueux d’aspect, et un chemin de gauche clair, propre, longé par de bucoliques parterres. Personne ne doute que ses sens lui imposeront d’aller sur sa gauche ; les sens étant pour bien des choses les pires témoins du monde. Doutant de ce qu’on lui a dit, et croyant dur comme fer en son doute, il emprunte le chemin de gauche sans se douter qu’il y rencontrera des bêtes féroces, qu’il sera cerné de précipices, qu’il finira par se perdre ou que quelque brigand le détroussera. S’il avait su que le chemin de droite était le bon, il ne se serait pas risqué à prendre celui de gauche. Car le doute n’assaille pas celui qui sait. Sachant ce qu’il sait, et n’y croyant pas, il ne doute pas de ce qu’il sait puisqu’il tient ce qu’il sait pour la vérité. Celui qui sait que le soleil se lève à l’est ne doute pas chaque matin des points cardinaux. L’ignorant non plus ne craint pas le doute dans l’exacte mesure où son ignorance le conduit à ignorer qu’il est ignorant, donc à être persuadé qu’il sait et que rien n’échappe à son savoir, ce qui le préserve du doute. Le doute, en somme, est la maladie des croyants qui ne font pas confiance aux paroles qu’on leur tient. Car il est commode de voir dans le doute la géniale intuition de la vérité ou l’exercice de la raison individuelle capable de débrouiller les mensonges, les incertitudes ou les faux-semblants de la parole admise ou collective. Caché derrière le vraisemblable : le vrai, en somme. Mais il ne suffit pas de penser seul pour penser vrai. Il ne suffit pas non plus de contredire pour avoir, a posteriori, une raison de le faire. En l’espèce, celui qui doute de ce que je dis et des raisons qui nous rassemblent ici doute de mon supérieur le plus proche et, en remontant la chaîne hiérarchique, doute finalement du sommet de la société. En doutant d’un seul homme – moi – il contredit tout le monde. Or, qui doute de la politique de la société telle que la société la conduit doute de la société elle-même. Et celui qui doute du tout en étant la partie et l’instrument remet en cause le tout sans remettre en cause la partie. Voilà une attitude et une position lâches et déloyales. Qui peut croire qu’une mission telle que celle dont nous sommes chargés peut aboutir à un succès total et rapide si ceux qui sont chargés de l’accomplir n’y croient pas, n’ont pas confiance en leur chef, doutent de l’utilité et du bienfondé de ce qu’ils font ? Certes, cela n’exclut nullement la réussite, mais elle sera certainement plus tardive et plus relative. Je dirais, pour conclure cette digression, que le doute demeure aux yeux des gens de bien et des honnêtes gens la position intellectuelle la plus confortable et la plus versatile qui soit, et c’est la raison pour laquelle ils ne l’acceptent pas. Celui qui n’affirme rien reste à la lisière des choses. L’histoire ne lui donne jamais tort, et rien ne le taraude jamais. Ni sa conscience, ni le jugement des autres. C’est une manière aisée de rester au chaud pendant que d’autres risquent leur réputation et leur postérité. Le doute est l’artifice de la pensée qui attend que les événements pensent pour elle. Où est le courage ? Chez celui qui affirme en prenant le risque de se tromper et de compromettre sa pensée en la confrontant à la réalité des événements, des choses et du monde ? Ou chez celui qui ne dit rien et à qui cela ne coûtera jamais rien ? Suis-je lâche de prendre la tête de ce combat en me tenant prêt à en répondre devant n’importe qui ? Etes-vous lâches de me suivre, en quittant les vôtres et en risquant votre vie, pour la justice, l’ordre et la prospérité ? Cela n’a aucun sens ; n’en doutez pas.
Mais sachez bien que ce que nous allons accomplir tuera certains d’entre nous. Je marcherai à votre tête et je sais qu’à l’instant où je poserai le pied sur le sol de cette forêt ma vie n’aura guère plus de consistance ni de certitude que la flamme d’une chandelle. Jamais les flambeaux que nous allumerons pour guider notre marche n’auront aussi bien porté la figure de nos existences. Nous marcherons derrière la lueur fragile et palpitante de torches sans repère dont l’éclat transparent ne fait que mieux souligner la nuit. Le bruit du pas de nos chevaux nous fera mieux sentir encore le silence nous serrant dans sa sourdine sombre. Les bruits invisibles de la nature frapperont nos imaginations et trembleront dans les tréfonds de nos effrois. Rien dans les senteurs mordantes ne rappellera l’homme que nous sommes et nous avancerons désorientés, pris dans les effluves monstrueux et les exhalaisons délirantes. La nuit succédera au jour comme la grêle succède à l’orage. Le jour succédera à la nuit comme l’aveuglement succède à l’éclipse. Regardez bien. La branche mord, la rivière engloutit, la forêt aspire, l’horizon n’existe plus et le ciel devient un mythe. Le sol crépite du grouillement des insectes et des scolopendres ; le feuillage hurle dans vos crânes enfiévrés et son tintement résonne comme le chant de cloches désaccordées. Vos pas craquent sur les branches mortes et les squelettes noircis. Certaines nuits, on croit voir fuir dans le sombre des bêtes que l’imagination elle-même n’admet pas, cette maîtresse de tous les esprits humains. Comme si dans l’obscurité demeurait la lueur intacte et noire de la peur, faisant danser derrière elle des ombres ténébreuses. Les bêtes qui peuplent ces bois en les hantant de leur légende n’ont pas plus d’âme qu’elles n’ont d’espoir. Elles survivent. Elles arrachent au sol, aux arbres, aux eaux, aux terriers, aux nids, aux tanières, aux herbes les plus hautes, aux marécages les plus profonds, aux cimes les plus inaccessibles ce qui nourrit leurs existences éternelles. Ne croyez pas qu’on trouve derrière ce rideau des jaguars. Non ! On ne trouve que le jaguar qui rôde depuis des milliers d’années et qu’aucune de ses tâches ne trahit. Ne croyez pas qu’on trouve des anacondas, ne croyez pas qu’on trouve des pumas, ne croyez pas qu’on trouve des caïmans, ne croyez pas qu’on trouve des vautours, ne croyez pas qu’on trouve des araignées terribles. Non ! On trouve l’anaconda, on trouve le puma, on trouve le caïman, on trouve le vautour, on trouve l’araignée. Comme sur cette terre on trouve l’homme qui la peuple, on trouve dans cette forêt l’animal qui la hante. Et ici, le monde tel que vous pouvez le concevoir et l’imaginer n’existe pas. Ce monde échappe à la pensée, il échappe à la conscience, il échappe à la méchanceté et à l’orgueil. Si vous l’oubliez, vous ne lui échapperez pas. C’est dans l’obscurité virginale des nuits innocentes que ce monde fait descendre et résonner en l’homme étranger les craintes et les peurs les plus noires et les plus aiguisées. Vous n’échapperez pas, même au milieu de vos compagnons, au désespoir de vous sentir abandonnés et laissés à votre trouble dans un monde où l’horizon n’est plus qu’un mur. Vous regarderez autour de vous. Vous ne saurez jamais si vous ne posez pas le pied sur la queue d’un serpent ou si l’œil d’un fauve ne vous suit pas. Vous craindrez que la ronde des vautours et des oiseaux de proie ne trace dans les cieux votre course. Vous craindrez que le geste lent du paresseux n’accompagne votre épuisement. Les bruits mystérieux de la nature parleront dans vos veines à votre sang glacé par l’invisible. Vous croirez voir ce qui n’est pas et halluciner ce qui est ; l’eau vous sera suspecte, la couleur des fruits vous mentira ; le plus petit, le plus minuscule, le plus insignifiant des êtres vivants vous inspirera la crainte. C’est un monde que l’homme ne connaît pas et où il n’a rien à faire. Les tribus qui habitent ces forêts sont des peuples bien supérieurs au nôtre. Nous qui ne savons ni vivre ici ni ne pas y vivre.
Oui, certains d’entre nous mourront. Dévorés et déchiquetés, emportés dans les limbes d’un fleuve, avalés par la végétation impénétrable, perdus et sans compagnon, perclus de parasites, rendus fous par la maladie, étouffés par la chaleur, ébouillantés par la soif, empoissonnés par la faim, asservis par la fatigue. Mais ceux qui mourront, et je serai peut-être de ceux-là, mourront avec l’honneur au front d’avoir accompli pour les autres la grand-œuvre de justice et de morale. Ils mourront en gardant dans l’œil la plus fine lueur de la splendeur de Salazar.
Ainsi parla Petrus Mascarado.
III - Petrus Mascarado
Quelques jours après s’être mise en route, la troupe entra dans la ville fluviale de Crecimienta. Petrus Mascarado ordonna là une halte jusqu’au lendemain matin. Les hommes s’embrassèrent presque à cette annonce de repos. Les heures de marche avaient déjà été longues et pénibles, chargées de matériel et de vivres, passées dans la lourde chaleur humide de la forêt, et entrecoupées de haltes et de sommeils brefs qui brisaient davantage les forces qu’ils ne les reconstituaient. Une fin d’après-midi et une nuit entière, c’étaient presque du luxe. Cela laissait le temps de dormir pour de bon, de manger à son aise sans que rien ne presse, de bavarder avec tel compagnon, ou simplement de rêver, en songeant sous la lune.