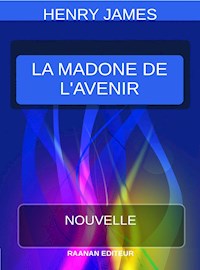
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La Madone de l’avenir est une nouvelle de l’écrivain américain Henry James publiée en 1873.
Extrait
| I
L’histoire que je vais raconter me rappelle ma jeunesse et mon séjour en Italie, — deux beaux souvenirs. J’étais arrivé à Florence assez tard dans la soirée, et en achevant de souper, je me dis qu’un Américain qui débarque dans une pareille ville ne doit pas l’insulter en se mettant vulgairement au lit sous prétexte de fatigue. Je me levai donc, et je suivis une rue étroite qui s’ouvrait non loin de mon hôtel. Dix minutes après, je débouchai sur une grande piazza déserte qu’éclairaient les pâles rayons d’une lune d’automne. En face de moi se dressait le Palazzo-Vecchio, avec sa grande tourelle qui s’élance comme un pin au sommet d’une colline escarpée. Au bas de l’édifice se dessinaient vaguement des sculptures, et je m’approchai afin de les examiner. Une des figures que j’avais entrevues, placée à gauche de la porte du palais, était un magnifique colosse qui semblait lancer un défi aux passants. Je reconnus bien vite le David de Michel-Ange. Éclairée comme elle l’était, cette image de la force prenait un aspect sinistre, et ce fut avec une sorte de soulagement que je détournai les yeux pour contempler une statue de bronze posée sous la loggia, dont les élégantes arcades forment un si charmant contraste avec l’ensemble massif du palais. Rien de plus vivant, de plus gracieux que cette statue ; le personnage conserve un certain air de douceur, bien que le bras nerveux qu’il allonge tienne une tête de Gorgone. Ce personnage a nom Persée, et vous trouverez son histoire, non pas dans la mythologie grecque, mais dans les mémoires de Benvenuto Cellini.
Tandis que mon regard allait de l’une à l’autre de ces belles œuvres, je témoignai sans doute mon admiration par quelques paroles involontaires, car un individu que l’obscurité m’avait empêché d’apercevoir se leva sur les marches de la loggia et s’adressa à moi en très bon anglais. C’était un petit homme maigre, vêtu d’une sorte de tunique de velours noir (autant que je pus en juger) et coiffé d’une barrette moyen âge, d’où s’échappait une masse de cheveux rouges. Il me pria d’un ton insinuant de lui communiquer « mes impressions. » Je lui trouvai un air à la fois bizarre et pittoresque. On aurait été tenté de le prendre pour le génie de l’hospitalité esthétique, si en général ce génie-là n’accueillait les voyageurs sous la forme d’un guide dont la mise et l’allure sont celles d’un pauvre honteux. Cependant la brillante tirade que me valut mon silence embarrassé rendait l’hypothèse assez plausible...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SOMMMAIRE
I
II
III
HENRY JAMES
LA MADONE DE L'AVENIR
NOUVELLE
Revue des Deux Mondes, 3e période,
tome 14, 1876 (pp. 590-617).
Raanan Éditeur
Livre 281| édition2
I
L’histoire que je vais raconter me rappelle ma jeunesse et mon séjour en Italie, — deux beaux souvenirs. J’étais arrivé à Florence assez tard dans la soirée, et en achevant de souper, je me dis qu’un Américain qui débarque dans une pareille ville ne doit pas l’insulter en se mettant vulgairement au lit sous prétexte de fatigue. Je me levai donc, et je suivis une rue étroite qui s’ouvrait non loin de mon hôtel. Dix minutes après, je débouchai sur une grande piazza déserte qu’éclairaient les pâles rayons d’une lune d’automne. En face de moi se dressait le Palazzo-Vecchio, avec sa grande tourelle qui s’élance comme un pin au sommet d’une colline escarpée. Au bas de l’édifice se dessinaient vaguement des sculptures, et je m’approchai afin de les examiner. Une des figures que j’avais entrevues, placée à gauche de la porte du palais, était un magnifique colosse qui semblait lancer un défi aux passants. Je reconnus bien vite le David de Michel-Ange. Éclairée comme elle l’était, cette image de la force prenait un aspect sinistre, et ce fut avec une sorte de soulagement que je détournai les yeux pour contempler une statue de bronze posée sous la loggia, dont les élégantes arcades forment un si charmant contraste avec l’ensemble massif du palais. Rien de plus vivant, de plus gracieux que cette statue ; le personnage conserve un certain air de douceur, bien que le bras nerveux qu’il allonge tienne une tête de Gorgone. Ce personnage a nom Persée, et vous trouverez son histoire, non pas dans la mythologie grecque, mais dans les mémoires de Benvenuto Cellini.
Tandis que mon regard allait de l’une à l’autre de ces belles œuvres, je témoignai sans doute mon admiration par quelques paroles involontaires, car un individu que l’obscurité m’avait empêché d’apercevoir se leva sur les marches de la loggia et s’adressa à moi en très bon anglais. C’était un petit homme maigre, vêtu d’une sorte de tunique de velours noir (autant que je pus en juger) et coiffé d’une barrette moyen âge, d’où s’échappait une masse de cheveux rouges. Il me pria d’un ton insinuant de lui communiquer « mes impressions. » Je lui trouvai un air à la fois bizarre et pittoresque. On aurait été tenté de le prendre pour le génie de l’hospitalité esthétique, si en général ce génie-là n’accueillait les voyageurs sous la forme d’un guide dont la mise et l’allure sont celles d’un pauvre honteux. Cependant la brillante tirade que me valut mon silence embarrassé rendait l’hypothèse assez plausible.
— Je connais Florence depuis bien longtemps, monsieur, me dit mon interpellateur ; mais jamais je ne l’ai vue plus belle, plus vivante que ce soir. C’est que pour moi les fantômes des morts illustres viennent animer les rues désertes. Le présent est endormi ; le passé seul plane sur nous comme un rêve rendu visible. Figurezvous les vieux Florentins arrivant en couples pour juger la dernière œuvre de Michel-Ange ou de Benvenuto ! Quelle précieuse leçon, si l’on pouvait entendre leurs paroles ! Le plus modeste bourgeois d’entre eux, avec son bonnet de velours et sa longue robe, avait du goût. L’art régnait alors, monsieur. Le soleil brillait de tout son éclat, et ses larges rayons dissipaient les ténèbres ; nous, nous ne voyons qu’une supériorité dont le poids nous écrase. Le soleil a cessé de resplendir ; mais je m’imagine,… vous allez rire de moi…, je m’imagine que la clarté perdue nous illumine ce soir. Non, jamais le David ne m’a semblé plus grandiose, le Persée plus beau ! Cette atmosphère argentée par les rayons de la lune m’arrive imprégnée des secrets des maîtres, promettant de les révéler à quiconque se prosternera ici dans une pieuse contemplation ! — Mon intéressant rapsode remarqua sans doute mon air intrigué. Il rougit et se tut ; mais il ajouta bientôt avec un sourire attristé : — Vous auriez tort de me prendre pour un charlatan ou pour un fou ; il n’est pas dans mes habitudes de m’embusquer sur la piazza afin de saisir au passage les innocents touristes. Ce soir, je l’avoue, je suis sous le charme, et d’ailleurs, je ne sais trop pourquoi, j’ai cru avoir affaire à un artiste.
— Je n’ose revendiquer ce titre dans le sens que vous donnez au mot, répliquai-je, et je le regrette. Vous n’avez pourtant aucune excuse à m’adresser, car moi aussi je suis sous le charme, et vos éloquentes réflexions sont loin de l’avoir rompu.
— Si vous n’êtes pas artiste, vous méritez de l’être, répondit-il en s’inclinant. Un jeune homme qui arrive à Florence au milieu de la nuit, — je vous ai vu débarquer, — et qui s’empresse de quitter son hôtel pour rendre hommage au beau, a des droits à ma sympathie.
L’accent avec lequel il débita cette jolie phrase acheva de me révéler un compatriote. Il n’y a que les Américains pour s’enthousiasmer ainsi. — J’aime à croire, lui répondis-je, que, si ce jeune homme est un vil trafiquant newyorkais, vous ne le trouverez pas moins digne de votre estime.
— Les Newyorkais, répliqua-t-il avec une gravité qui semblait me reprocher mon badinage peu patriotique, sont de nobles protecteurs des beaux-arts.
La tournure que prenait cet entretien nocturne ne me rassurait pas. Mon compagnon était-il un Yankee entreprenant, un peintre sans ouvrage, désireux d’extorquer une commande ? Par bonheur, je n’eus pas à défendre ma bourse. L’horloge de la tour qui se dressait en face de nous sonna le premier coup de minuit. Ma nouvelle connaissance tressaillit, s’excusa de m’avoir retenu et se disposa à s’éloigner ; mais comme ma curiosité se trouvait éveillée, je lui proposai de faire route ensemble. Il y consentit volontiers. Traversant la piazza, nous longeâmes l’arcade ornée de statues du musée des Offices et nous gagnâmes l’Arno. Quel chemin suivis-je ? Il ne m’en souvient guère. Je me rappelle seulement que, tandis que je me promenais à l’aventure, je fus initié à des théories esthétiques qui ne manquaient pas d’une certaine originalité. J’écoutai cette conférence en plein air avec une sorte de fascination, ne sachant trop que penser du singulier professeur. Il avoua, en secouant tristement la tête, son origine américaine.
— Chez nous, s’écria-t-il, le sens artiste n’a pour s’exercer qu’un champ aussi stérile que laid ! Malheureux déshérités de l’art, nous sommes exclus du cercle magique, condamnés à rester toujours superficiels ! Jamais nous n’atteindrons la perfection. Un peintre américain, s’il veut exceller, a dix fois plus à apprendre qu’un Européen ; nous n’avons ni goût, ni tact, ni force. Comment en aurions-nous ? Notre rude climat, notre passé silencieux, notre présent tapageur, la banalité dont l’étreinte nous comprime par tous les côtés sont aussi vides de ce qui peut inspirer un artiste, que mon cœur est vide d’amertume en avouant cette vérité. Nous n’avons d’autre ressource que de vivre dans un perpétuel exil !
— Franchement, répondis-je en souriant, vous me paraissez être chez vous dans l’exil, et Florence me semble une assez jolie Sibérie. Voulez-vous que je vous dise ma pensée ? Rien ne me paraît plus oiseux que de gémir sur notre manque d’un sol propice à l’inspiration. Le vrai rôle de l’artiste est d’essayer de produire quelque chose de bon. Inventez, créez ! Il n’existe dans notre glorieuse constitution aucun article qui s’y oppose. Quand il vous faudrait travailler cinquante fois plus qu’un autre, peu importe ! Pourquoi êtes-vous artiste, si ce n’est pour vaincre les obstacles ? Soyez notre Moïse, ajoutai-je en lui posant la main sur l’épaule, et guidez-nous vers la terre promise.
— Vous parlez d’or, jeune homme ! répondit mon compagnon. Inventer, oui, c’est là notre tâche, je le sais fort bien. Je travaille, je travaille nuit et jour. Je crée une œuvre ! Je ne me donne pas pour un Moïse ; je ne suis qu’un pauvre peintre doué de patience ; mais quel triomphe, si je parvenais à répandre sur notre pays un rayon de cette gloire qui lui fait défaut ! À minuit, lorsque le vent du sud caresse Florence endormie, il semble évoquer l’âme des belles œuvres cachées dans les églises et les galeries, il pénètre dans mon petit atelier avec le clair de lune et fait battre mon cœur au point de m’empêcher de songer au repos. J’en profite pour ajouter sans cesse une nouvelle idée à ma conception.
Mon bizarre compagnon connaissait à fond l’histoire et les traditions locales de la ville, et il m’apprit qu’il ne voulait plus quitter Florence. — Je lui dois tout, me dit-il. C’est ici que j’ai commencé à vivre, du moins de la vie intellectuelle. Une à une, les aspirations profanes, les ambitions mondaines ont disparu de mon horizon, ne me laissant que ma croyance, mon calepin et le culte des vrais maîtres.
— Et avez-vous beaucoup produit pendant votre long séjour ? lui demandai-je.
Il garda un moment le silence.
— Je n’ai pas beaucoup produit, si vous interprétez littéralement le mot, répliqua-t-il enfin. Il me répugne de me manifester par des essais imparfaits. Ce qu’il y avait de bon dans chacun de mes efforts, je l’ai réabsorbé au profit de la force génératrice de conceptions futures ; ce qu’il y avait de mauvais, — hélas ! le mauvais abondera toujours, — je l’ai détruit sans hésiter. Je puis affirmer, non sans orgueil, que mon pinceau n’a pas contribué à accroître le nombre des platitudes qui encombrent le monde. Je suis un pauvre peintre patient, j’étudie et j’attends.





























