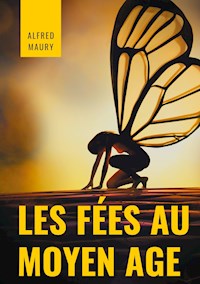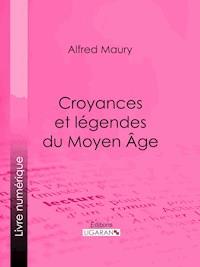Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "La magie des peuples sauvages, des sociétés encore livrées à la barbarie primitive, reflète par ses formes ridicules, la grossièreté des notions que se fait de l'univers l'esprit humain, quand il est plongé dans l'ignorance la plus absolue. La religion de l'homme sauvage ou très barbare est un naturalisme superstitieux, un fétichisme incohérent dans lequel tous les phénomènes de la nature, tous les êtres de la création, deviennent des objets d'adoration."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les sciences physiques n’étaient à l’origine qu’un amas de superstitions et de procédés empiriques qui constituaient ce que nous appelons la magie. L’homme avait si bien conscience de l’empire qu’il était appelé à exercer sur les forces de la nature que, dès qu’il se mit en rapport avec elles, ce fut pour essayer de les assujettir à sa volonté. Mais au lieu d’étudier les phénomènes, afin d’en saisir les lois et de les appliquer à ses besoins, il s’imagina pouvoir, à l’aide de pratiques particulières et de formules sacramentelles, contraindre les agents physiques d’obéir à ses désirs et à ses projets. Tel est le caractère fondamental de la magie. Cette science avait pour but d’enchaîner à l’homme les forces de la nature et de mettre en notre pouvoir l’œuvre de Dieu. Une pareille prétention tenait à la notion que l’antiquité s’était faite des phénomènes de l’univers. Elle ne se les représentait pas comme la conséquence de lois immuables et nécessaires, toujours actives et toujours calculables ; elle les faisait dépendre de la volonté arbitraire et mobile d’esprits ou de divinités dont elle substituait l’action à celle des agents mêmes. Dès lors, pour soumettre la nature, il fallait arriver à contraindre ces divinités ou ces esprits à l’accomplissement de ses vœux. Ce que la religion croyait pouvoir obtenir par des supplications et des prières, la magie tentait de le faire par des charmes, des formules et des conjurations. Le dieu tombait sous l’empire du magicien ; il devenait son esclave, et, maître de ses secrets, l’enchanteur pouvait à son gré bouleverser l’univers et en contrarier les lois. À mesure que les sciences se dégagèrent des langes de la superstition et de la chimère, la magie vit son domaine se resserrer de plus en plus. Elle avait d’abord envahi toutes les sciences, ou, pour mieux dire, elle en tenait complètement lieu : astronomie, physique, médecine, chimie, écriture même et poésie, tout, dans le principe, était placé sous sa tyrannie. La connaissance des lois naturelles, révélée par l’observation, montra tout ce qu’il y avait de stérile et d’absurde dans les pratiques auxquelles elle recourait. Chassée d’abord de la science des phénomènes célestes, elle se réfugia dans celle des actions physiques. Puis, expulsée de nouveau, par l’expérience, du monde matériel et terrestre, elle se retira dans les actions physiologiques et psychologiques, dont les lois plus obscures se laissaient moins facilement pénétrer ; elle s’y fortifia, et continue d’y résister encore.
Il n’y avait pas toutefois que mensonge et délire dans les procédés magiques ; il suffit de contempler quelque temps la nature pour en découvrir certaines lois. Les enchanteurs arrivèrent ainsi de bonne heure à la notion de plusieurs phénomènes dont ils ne savaient pas percer la cause, mais dont ils suivaient avec attention tous les accidents. Ces notions furent associées aux pratiques ridicules dans lesquelles s’égarait l’ignorance, et l’on sut en tirer parti pour produire des effets capables de frapper les imaginations. De la magie sont ainsi sorties quelques sciences qui restèrent longtemps infectées des doctrines chimériques au sein desquelles elles avaient pris naissance. La thérapeutique, l’astronomie, la chimie, ont passé par une période de superstition que représentent la connaissance des simples, la préparation des philtres, l’astrologie, l’alchimie, produits immédiats de la magie des premiers âges. Et le succès qu’assurait aux enchantements l’emploi de procédés fondés sur des propriétés réelles et des observations physiques contribua puissamment à accréditer dans l’esprit du vulgaire la croyance à leur efficacité. Cependant l’illusion se dissipa peu à peu, et toutes les merveilles que les magiciens prétendaient accomplir s’évanouirent dès qu’on tenta d’en vérifier la réalité. Il ne fut pas difficile de reconnaître qu’en dépit des charmes, des conjurations et des formules, la nature demeurait toujours la même ; que ses lois n’étaient ni troublées, ni interverties : alors on s’aperçut qu’il n’y a dans tous ces prestiges qu’une illusion de l’esprit. Le magicien n’apparut plus comme un homme qui tient sous sa dépendance les phénomènes et les agents naturels, mais comme un artisan de mensonge, en possession de certains secrets pour leurrer notre imagination et évoquer devant elle des images décevantes. Ce fut comme le dernier âge de la magie. On avait cessé de croire aux prodiges qu’elle prétendait accomplir, mais on croyait encore à la réalité de la science des magiciens. On se les représentait comme des complices des esprits malfaisants, des suppôts de l’enfer, qui peuvent abuser nos sens, s’emparer de notre volonté, bouleverser notre intelligence ; et la puissance qu’on leur déniait sur le monde physique, on la leur accordait encore sur l’homme. Tel a été le point de vue auquel la plupart des chrétiens se sont placés. Trop éclairés pour prêter à la magie un pouvoir qu’ils fortifiaient dans les mains de Dieu, ils ne l’étaient pas encore assez pour reconnaître l’inanité des pratiques magiques et le ridicule des enchantements. Mais ici, comme tout à l’heure, un mélange de vérités et d’erreurs entretenait les esprits dans une opinion superstitieuse. Les enchanteurs, les sorciers avaient effectivement découvert les moyens d’exalter ou d’assoupir nos sens par l’emploi de certains narcotiques, de provoquer en nous des hallucinations par un trouble introduit dans le cerveau et le système nerveux ; et ces illusions, qui constituaient tout leur art, semblaient aux chrétiens l’œuvre du diable, la preuve de l’intervention des démons dans les sortilèges et les conjurations.
La démonologie, qui servit de support à la magie expirante, est désormais condamnée par tous les esprits sérieux et critiques. Débris du naturalisme antique, dont le christianisme à son insu avait subi l’influence, elle fait encore de temps à autre des apparitions ; et dans des moments d’abattement, de délire ou de terreur, elle tente de reprendre sur la raison une partie du terrain qu’elle a perdu. Vains efforts : la constance des lois physiques éclate plus que jamais dans les merveilles de la science appliquée. L’étude des phénomènes éteint en nous la foi au merveilleux, et c’est par ses progrès que seront expulsés les derniers restes de la superstition.
Présenter en aperçu l’histoire de ce grand mouvement de l’esprit humain qui nous éleva graduellement des ténèbres de la magie et de l’astrologie aux lumineuses régions de la science moderne, tel est le but de ce petit ouvrage. On a écrit déjà plusieurs fois l’histoire de la magie. Les uns ont cherché dans l’ensemble de ces croyances chimériques des preuves à l’appui de leur solidité ; les autres n’ont voulu que nous inspirer un profond dédain pour tant de folies et d’absurdités ; nul n’a songé à tirer de la comparaison des faits un enseignement réellement philosophique, et à marquer les différentes phases par lesquelles a passé une science qui, toute chimérique qu’elle est, a été cependant le début nécessaire des grandes découvertes qui devaient en ruiner les fondements. Je tenterai de le faire. J’aurais pu accumuler bien des témoignages et grossir ce volume d’une foule de détails intéressants ; mais j’ai voulu me borner à indiquer la voie qu’a suivie l’esprit humain, et je n’ai demandé à mes lectures que les citations indispensables à la démonstration de la vérité.
La magie des peuples sauvages, des sociétés encore livrées à la barbarie primitive, reflète par ses formes ridicules la grossièreté des notions que se fait de l’univers l’esprit humain, quand il est plongé dans l’ignorance la plus absolue. La religion de l’homme sauvage ou très barbare est un naturalisme superstitieux, un fétichisme incohérent dans lequel tous les phénomènes de la nature, tous les êtres de la création, deviennent des objets d’adoration. L’homme place en tout lieu des esprits personnels conçus à son image, tour à tour confondus avec les objets mêmes ou séparés de ces objets. Telle est la religion de tous les peuples noirs, des tribus altaïques, des peuplades de la Malaisie, et des restes de populations primitives de l’Hindoustan, des Peaux rouges de l’Amérique et des insulaires de la Polynésie ; telle fut à l’origine celle des Aryas, des Mongols, des Chinois, des Celtes, des Germains et des Slaves. Tel paraît avoir été le caractère des croyances qui servirent de fondement au polythéisme des Grecs et des Latins. Seulement, suivant le génie propre de chaque nation et de chaque race, suivant la contrée qu’elle habite, le genre de vie qu’elle mène, c’est vers tel ou tel ordre d’agents ou de phénomènes que se tourne de préférence sa vénération. Mais un fétichisme démonologique demeure toujours au fond de ces religions grossières, qui cherchent la divinité dans les produits de la création. Les fables qu’on raconte sur les dieux, les mythes par lesquels on explique les phénomènes de l’univers, les cérémonies et les rites dont se compose le culte, gardent des traces presque ineffaçables des idées enfantines et superstitieuses qui furent la première expression du sentiment religieux. Le Brahmanisme chez les Hindous, le Bouddhisme chez les Tartares, l’Islamisme des Arabes, des Persans et des peuples africains, le Judaïsme même chez les descendants dispersés des anciens Hébreux, et le Christianisme d’une foule de populations récemment converties à l’Évangile, sont remplis de croyances et de pratiques qui remontent au naturalisme que ces religions ont remplacé.
La magie eut surtout pour objet de conjurer les esprits dont les peuples sauvages redoutent encore plus l’action malfaisante qu’ils n’en attendent de bienfaits. La crainte des dieux, qui a été la mère de la religion, car l’amour n’en fut que la fille tardive, domina dès le principe l’humaine imagination, et souvent plus une peuplade, une tribu possède de vertus guerrières, plus elle déploie de résolution et de courage dans les combats, plus elle se montre pusillanime à l’égard des puissances mystérieuses dont elle suppose l’univers peuplé. Tous les voyageurs ont signalé l’influence exercée sur les sociétés sauvages et ignorantes par ces superstitions, et l’importance de la magie est presque toujours en raison du développement du système démonologique. Un écrivain anglais, M. Joseph Roberts, nous a dépeint le déplorable état de crédulité où sont arrivés à ce sujet les Hindous. « Ce peuple, écrit-il, a affaire à tant de démons, de dieux et de demi-dieux, qu’il vit dans une crainte perpétuelle de leur pouvoir. Il n’y a pas un hameau qui n’ait un arbre ou quelque place secrète regardée comme la demeure des mauvais esprits. La nuit, la terreur de l’Hindou redouble, et ce n’est que par la plus pressante nécessité qu’il peut se résoudre, après le coucher du soleil, à sortir de sa demeure. A-t-il été contraint de le faire, il ne s’avance qu’avec la plus extrême circonspection et l’oreille au guet. Il répète des incantations, il touche des amulettes, il marmotte à tout instant des prières et porte à la main un tison pour écarter ses invisibles ennemis. A-t-il entendu le moindre bruit, l’agitation d’une feuille, le grognement de quelque animal, il se croit perdu ; il s’imagine qu’un démon le poursuit et dans le but de surmonter son effroi, il se met à chanter, à parler à haute voix ; il se hâte et ne respire librement qu’après qu’il a gagné quelque lieu de sûreté. »
Chez les nègres, cette superstition est portée à son comble. Nul individu n’ose se mettre en route que chargé d’amulettes, ou, comme on les appelle, de grigris ; il en est parfois littéralement tapissé . Pour le nègre tout objet peut devenir un talisman après une consécration mystérieuse. Les grigris ne sont pas seulement à ses yeux un palladium pour sa personne, ce sont encore des objets divins visités par les esprits, et voilà pourquoi il leur rend un culte. Le rôle considérable que jouent les amulettes et les objets consacrés dans la religion des noirs africains a fait donner à cette religion le nom de fétichisme, étendu ensuite aux religions analogues. Le mot fétiche est dérivé du portugais fetisso, qui signifie chose enchantée, chose fée, comme l’on disait en vieux français, mot qui vient lui-même du latin fatum, destin. Winterbottom prétend que l’expression de fétiche est une altération de faticaria, puissance magique. Je ne le pense pas ; mais si cependant cette étymologie est fondée, elle ne fait que rattacher par un autre dérivé le mot en question à la racine latine fatum.
Les grigris sont de toutes formes et varient depuis la simple coquille ou la corne d’un animal jusqu’à l’objet le plus compliqué dans sa fabrication, depuis le plus sale chiffon jusqu’au morceau de maroquin préparé avec le plus de soin. « De petites maisons, dit le voyageur Gordon Laing, contenant des coquilles, des crânes, des images, sont toujours placées à peu près à douze cents pieds des différentes entrées des villes ; on les regarde comme la demeure des grigris, qui en prennent soin. Cette pratique est commune chez toutes les nations païennes que j’ai visitées. Nulle part néanmoins elle n’est portée au même degré que dans le Timanni, où il n’y a presque pas de maison qui n’ait ses esprits protecteurs. »
Non seulement le nègre met dans ses amulettes toute sa confiance, mais elles sont de fait ses véritables dieux. Dans les occasions solennelles, les Bambaras adorent sous le nom de canari un énorme vase de terre rempli de grigris de toutes sortes, qu’ils ne manquent pas de consulter avant d’entreprendre quelque chose d’important.
Le culte se trouvant à peu près réduit chez les peuples sauvages à la conjuration des esprits et à la vénération des amulettes, les prêtres ne sont que des sorciers ayant pour mission d’entrer en rapport avec les démons tant redoutés. Autrement dit, le culte se réduit à peu près à la magie. Tel est encore aujourd’hui le caractère du sacerdoce chez une foule de nations barbares et de peuplades abruties. Les nègres de la Sénegambie ont leurs guieultabés , les Gallas ont leurs kalichas, les Caraïbes ont leurs mariris ou piaches, les Indiens des bords de l’Amazone ont leurs pagès, et ceux du Chili leurs machis, les Malgaches ont leurs ombiaches et les Malais leurs poyangs ; les insulaires des Marianne savaient leurs makahnas ; les Polynésiens donnaient à leurs sorciers différents noms ; les tribus de races altaïque et finnoise ont leurs chamans ; les Mongols, quoique bouddhistes, reconnaissent des sorciers du même genre qu’on appelle Abysses ; en un mot les prêtres magiciens sont de tous les pays où le fétichisme tient encore lieu de religion.
Ces prêtres cumulent les fonctions de devin, de prophète, d’exorciste, de thaumaturge, de médecin, de fabricant d’idoles et d’amulettes. Ils n’enseignent ni la morale ni les bonnes œuvres ; ils ne sont pas attachés à la pratique d’un culte régulier, au service d’un temple ou d’un autel. On ne les appelle qu’en cas de nécessité ; mais ils n’en exercent pas moins un empire considérable sur les populations auxquelles ils tiennent lieu de ministres sacrés. On redoute leur puissance et surtout leur ressentiment ; on a une foi aveugle en leur science. Ces enchanteurs ont d’ordinaire dans le regard, dans l’attitude, je ne sais quoi qui inspire la crainte et qui agit sur l’imagination. Cela tient sans doute parfois au soin qu’ils prennent d’imprimer à leur physionomie quelque chose d’imposant ou de farouche, mais cette expression particulière est plus souvent l’effet de l’état de surexcitation, entretenu par les procédés auxquels ils recourent ; ils emploient en effet divers excitants pour exalter leurs facultés, se donner une force musculaire factice et provoquer en eux des hallucinations, des convulsions ou des rêves qu’ils regardent comme un enthousiasme divin ; car ils sont dupes de leur propre délire ; mais lors même qu’ils s’aperçoivent de l’impuissance de leurs prédictions, ils n’en tiennent pas moins à être crus. En cela, ils sont généralement bien servis ; les sauvages rapportent sur leur compte des histoires absurdes qui témoignent de leur crédulité, et ces fables sont répétées avec tant d’assurance qu’on rencontre souvent des Européens ayant résidé parmi eux qui finissent par y ajouter foi. C’est grâce à ce mélange d’astuce et de folie que les sorciers réussissent à devenir chez certaines tribus des personnages considérables et à s’en faire les magistrats ou les chefs.
Les femmes même exercent parfois ce sacerdoce magique. Leur organisation nerveuse, plus facilement excitable, les rend plus propres au métier de devin et d’enchanteur. Elles entrent avec plus de facilité dans ce délire fatidique poussé quelquefois jusqu’à la fureur et qu’on tient pour le plus haut degré de l’inspiration. Les Germains et les Celtes avaient de semblables prophétesses, qu’entourait la vénération publique et dont les avis étaient écoutés même des guerriers les plus expérimentés ; les hommes du Nord les appellent Aliunar ou Aliorumnes, Volur ou Spakonur. Elles se retrouvent aussi chez les premiers Arabes, dans l’histoire desquels elles ont plusieurs fois joué un rôle.
Mais quelque grand qu’ait été l’ascendant pris par les prêtres magiciens sur l’imagination des peuples enfants, cette confiance excessive n’en a pas moins ses retours. Si les conjurations n’ont pas eu d’effet, si la science magique est en défaut, le dépit des sauvages contre les sorciers ou les chamans va souvent jusqu’à la colère et met la vie de ceux-ci en danger. Habitués à ces mécomptes, les magiciens supportent avec sang-froid ou résignation les outrages qui leur sont faits, sachant que le premier moment d’irritation passé, la superstition ramènera forcément à eux. Le Kalmouk frappe, brise ou foule aux pieds l’idole qui n’a point exaucé ses vœux, mais le lendemain c’est elle encore qu’il implore dans la crainte ou l’espérance.
Tel est le tableau que nous tracent les voyageurs du sacerdoce des peuples sauvages ; il peut nous faire juger de ce qu’étaient jadis les ministres divins, là où, depuis, une religion plus éclairée a remplacé de naïves superstitions.
Ce n’est pas seulement par les traits généraux, mais jusque par les moindres détails, que la magie de tous les peuples barbares se ressemble.
Chez tous se retrouvent des pratiques analogues. C’est d’abord l’emploi des plantes médicinales ou de drogues naturelles destinées à provoquer les hallucinations et les rêves dans lesquels l’imagination croit voir les esprits et les êtres fantastiques dont la crainte l’obsède ; car, ainsi que le remarquait Pline, il y a déjà dix-huit siècles, la médecine populaire a été le point de départ de la magie. Les Iniangas des Cafres amazoulous exercent surtout la médecine magique. Les Pagès de l’Amazone passent pour avoir un grand pouvoir dans l’emploi des incantations contre les maladies et les douleurs de toute sorte. Les sorciers des tribus indiennes de l’Amérique du Nord se faisaient remarquer par une connaissance assez approfondie de la vertu des médicaments ; ils les administraient non seulement afin de produire un délire factice, mais encore pour opérer la guérison de maladies ou de blessures. Ces cures étaient attribuées à l’influence des manitous. L’Indien n’allait jamais en guerre sans porter avec lui les charmes et les compositions, œuvre des sorciers, dans un sac que nos premiers colons appelaient le sac de médecine. Le Tartare transporte de même avec lui, ou suspend à l’entrée de sa tente, ses fétiches et ses idoles, comme la Bible nous montre que le faisait Laban.
Si les magiciens mettent à profit la connaissance des simples pour guérir les maladies, ils y recourent aussi en vue de composer des philtres et des poisons qu’ils administrent à ceux qui se sont attiré leur ressentiment ; les victimes se croient poursuivies par le courroux céleste. Ces charlatans ont aussi quelques notions de météorologie, de ces notions que l’homme acquiert bien vite, dès qu’il vit à l’air libre et qu’il interroge quotidiennement la nature ; ils savent prédire certains changements atmosphériques ; de là leur prétention de produire la pluie, de conjurer les vents.
Observateurs attentifs de l’homme et de toutes ses faiblesses, habiles à démêler dans ses traits les sentiments qui l’agitent, à pénétrer du regard au fond de sa conscience étonnée, les sorciers des sauvages prétendent découvrir les fautes et les crimes cachés, les pensées secrètes, et recourent au besoin aux épreuves et aux ordalies dont l’emploi s’est retrouvé chez la plupart des peuples barbares.
Au naturalisme tel qu’il apparaît dans les premiers âges est presque constamment associé le culte des morts, fondé sur la crainte qu’on a des âmes de ceux qui ne sont plus. Il se retrouve en tous lieux ; il tient aux racines mêmes de la superstition ; et, modifiées et épurées, ces croyances se sont transmises jusqu’à nous. Les magiciens ont la prétention d’évoquer les morts du fond de leur demeure souterraine ou des lieux dans lesquels ils errent sous mille formes diverses. Confondues avec les esprits, les âmes des trépassés se montrent comme eux dans les visions provoquées par des narcotiques ; et l’imagination, en se retraçant les traits de ceux qui ne sont plus, se persuade qu’ils vivent encore. Aussi les rêves jouent-ils un rôle considérable dans la religion des peuples sauvages, et c’étaient eux qui entretenaient le plus les tribus indiennes dans leur croyance à la magie. Ce délire dans lequel l’homme crédule s’imagine voir les démons et les génies, se répand épidémiquement ; il est en quelque sorte contagieux. Il existe chez les nègres comme chez une foule de peuplades de l’Amérique, des cérémonies nocturnes, des danses mystérieuses ayant pour but de produire un enthousiasme frénétique, et, dans l’opinion de ces sauvages, d’établir entre eux et les esprits un commerce plus intime et plus fréquent. On s’y exalte au bruit d’une musique retentissante et lugubre, comme le font les chamans au son de leur tambour ou boubna. Les noirs ont transporté ces rites diaboliques jusque dans les Antilles, où ils sont connus sous le nom de vaudou. Ils constituent de véritables initiations dans lesquelles la vocation de sorcier se manifeste. Celui qui est en proie à l’exaltation la plus forte et dont le système nerveux finit par contracter une altération chronique s’y croit appelé ; car ces magiciens, non plus que les chamans, ne forment généralement pas de caste proprement dite. Leur mission est tout individuelle, et une fois regardés comme inspirés, ils deviennent l’objet de la considération publique. Afin de se livrer plus librement au commerce avec les esprits, et aussi pour ne point laisser percer les artifices auxquels ils recourent en vue d’accroître leur influence ; ils vivent séparés du reste de la tribu, n’entretiennent guère de rapports avec elle, et ne se montrent que dans les grandes occasions ; voilà pourquoi règnent sur leur compte presque partout les mêmes fables. On assure qu’ils peuvent à leur gré se rendre invisibles ou se métamorphoser en animaux, qu’ils sont invulnérables et que leur regard possède une vertu magique et presque toujours malfaisante. Ces contes se débitent en Amérique comme chez les Musulmans ; la Chine en est remplie, et ils forment toute l’histoire populaire des Chamans. Mais le besoin de s’entraider et de se défendre, de s’initier aux secrets de leur art et de recruter des disciples zélés et intelligents, conduit peu à peu les prêtres-sorciers à se grouper en véritables associations. Parfois, ils ont constitué des castes, l’art magique et divinatoire étant devenu héréditaire chez quelques familles ; et pour assurer leur influence ils ont monopolisé l’exercice du culte et la direction des consciences ; en un mot, ils ont constitué le premier noyau des familles sacerdotales, ainsi que cela se voit pour la Grèce et chez les anciens Aryas ; et dès ce moment, la magie a commencé à se dépouiller des formes grossières dont je viens de présenter l’aperçu.
Les traditions historiques d’accord avec les monuments nous présentent la contrée qu’arrosent le Tigre et l’Euphrate comme un des points du globe où la civilisation a le plus anciennement fleuri. Les empires de Ninive et de Babylone étaient déjà arrivés à un haut degré de puissance et de prospérité, que plus des trois quarts de l’univers demeuraient plongés dans la barbarie primitive. La religion se dégagea donc plus tôt, chez les Assyriens, du grossier fétichisme qui en avait été la première enveloppe, pour revêtir une forme plus rationnelle et plus systématique ; elle s’associa à des opinions cosmologiques et donna ainsi naissance à une véritable théologie. En Asie, la sérénité du firmament et la majesté des phénomènes célestes attirèrent de bonne heure l’observation et frappèrent l’imagination. Les Assyriens virent dans les astres autant de divinités auxquelles ils prêtèrent des influences bienfaisantes ou malfaisantes, influences qu’ils avaient réellement pu constater pour le soleil et la lune. L’adoration des corps célestes était aussi la religion des populations pastorales descendues des montagnes du Kurdistan dans les plaines de Babylone. Ces Kasdim ou Chaldéens finirent par constituer une caste sacerdotale et savante qui se consacra à l’observation du ciel, en vue de pénétrer davantage dans la connaissance des dieux. Ils s’astreignirent à une contemplation journalière du firmament et découvrirent ainsi quelques-unes des lois qui le régissent. De la sorte, les temples devinrent de véritables observatoires : telle était la célèbre tour de Babylone, monument consacré aux sept planètes, et dont le souvenir a été perpétué par une des plus anciennes traditions que nous ait conservées la Genèse.
Une longue suite d’observations mirent les Chaldéens en possession d’une astronomie théologique, reposant sur une théorie plus ou moins chimérique de l’influence des corps célestes appliquée aux évènements et aux individus. Cette science, appelée par les Grecs astrologie ou apotélesmatique, fut dans l’antiquité le titre de gloire des Chaldéens.
Je n’ai pas l’intention d’entrer dans les détails d’une doctrine à tout jamais abandonnée. L’esprit ne se résoudrait pas aisément à étudier des règles compliquées dont la vanité lui est aujourd’hui démontrée. D’ailleurs nous ne connaissons qu’imparfaitement cette astrologie chaldéenne, qui subit avec le temps bien des modifications, et dont on ne saurait plus saisir que des lambeaux.
Toute la science des hommes et des choses se trouvant ramenée, par les idées chimériques dont étaient infatués les Assyriens, à la connaissance des phénomènes célestes, la théologie ne fut plus qu’une branche de l’astrologie, et la magie elle-même qui l’avait nécessairement précédée, à l’âge où les Assyriens ne reconnaissaient encore qu’un simple naturalisme, tomba forcément dans sa dépendance. Cependant les mêmes hommes ne cultivaient pas simultanément, à ce qu’il semble, ces diverses branches de la science divine. On comptait à Babylone, si l’on en croit un livre, il est vrai, apocryphe, divers ordres de prêtres ou interprètes sacrés, les hakamim ou savants, peut-être les médecins ; les khartumim, ou magiciens, les asaphim, ou théologiens ; et enfin les Kasdim et les Gazrim, c’est-à-dire les Chaldéens, les astrologues proprement dits. Ainsi Babylone renfermait des magiciens et des sorciers aussi bien que des devins et des astrologues. Quels moyens ces magiciens mettaient-ils en pratique ? Nous ne saurions le dire d’une manière précise ; mais la grande réputation qu’ils s’étaient acquise dans l’art d’opérer des prodiges ne permet pas de douter que leur science ne fût en partie fondée sur des notions positives de météorologie, de physique, de chimie et de médecine. Et le rôle important que jouait à Babylone l’interprétation des songes fait croire que, comme les peuples sauvages, les Assyriens voyaient dans les hallucinations et les rêves des révélations de la Divinité. Il est donc naturel de supposer que les prêtres recouraient aussi à l’emploi des préparations ayant pour but de les faire naître.
Nous devons à l’historien Diodore de Sicile, qui écrivait vers le commencement de notre ère, les détails les plus circonstanciés qui nous soient parvenus sur les prêtres chaldéens, ou, comme l’on disait simplement, sur les Chaldéens, cette épithète ayant fini par s’appliquer exclusivement à la caste issue de la population de ce nom. L’auteur grec nous donne un abrégé de leur doctrine cosmologique, doctrine entièrement fondée sur la divinisation des planètes et des étoiles.
À la tête des dieux, les Assyriens plaçaient le soleil et la lune, dont ils avaient noté le cours et les positions journalières respectives par rapport aux constellations du zodiaque. Ce zodiaque lui-même paraît avoir été une de leurs inventions ; c’était à leurs yeux l’ensemble des douze demeures dans lesquelles l’astre du jour entrait successivement pendant l’année. Les douze signes étaient régis par autant de dieux qui se trouvaient avoir de la sorte les mois correspondants sous leur influence. Chacun de ces mois se subdivisait en trois parties ; ce qui faisait en tout trente-six subdivisions auxquelles présidaient autant d’étoiles nommées dieux conseillers et ce qui répond aux décans de l’astrologie égyptienne. De ces trente dieux décadaires, une moitié avait sous son inspection les choses qui se passent au-dessus de la terre et l’autre celles qui se passent au-dessous. Le soleil, la lune et les cinq planètes occupaient le rang le plus élevé dans la hiérarchie divine et portaient le nom de dieux interprètes, parce que, nous dit Diodore, leur cour régulière indiquait la marche des choses et la succession des évènements. Entre ces planètes, Saturne, ou, comme les Assyriens paraissent l’avoir appelé, Bel l’ancien, regardé comme l’astre le plus élevé parce qu’il est la planète la plus distante de nous, était entouré de la plus grande vénération ; c’était l’interprète par excellence, le révélateur. Chacune des autres planètes avait son nom particulier. Les unes, telles que Bel (Jupiter), Merodach (Mars), Nebo (Mercure), étaient regardées comme mâles ; les autres, telles que Sin (la lune) et Mylitta ou Baalthis (Vénus), comme femelles ; et de leur position relative, par rapport aux constellations zodiacales, appelées aussi seigneurs ou maîtres des dieux , les Chaldéens tiraient sur la destinée des hommes, nés sous telle ou telle conjonction céleste, des prédictions que les Grecs nommaient horoscopes. Pour cela, ils établissaient, en vertu de règles particulières, l’état astronomique du ciel au moment de la naissance d’un individu, ou, comme disaient les Grecs, dressaient son thème généthliaque et ils en concluaient sa destinée.
Les Chaldéens supposaient qu’il existe en outre une relation étroite entre chacune des planètes et les phénomènes météorologiques, opinion en partie fondée sur des coïncidences fortuites ou fréquentes qu’ils avaient pu observer. De là, la croyance que ces astres exerçaient une influence tour à tour bienfaisante ou malfaisante. Et de là aussi, les prophéties qu’ils débitaient sur les évènements futurs. Au temps d’Alexandre, leur crédit était encore considérable, et le roi de Macédoine, par superstition ou par politique, les voulut consulter.
Il est probable que les prêtres de Babylone, qui rapportaient aux influences sidérales toutes les propriétés naturelles, imaginaient entre les planètes et les métaux dont l’éclat respectif avait avec la teinte de leur lumière une certaine analogie, des relations mystérieuses. Car cette doctrine se retrouve chez les Sabiens, héritiers de leurs traditions. L’or correspond au soleil, l’argent à la lune, le plomb à Saturne, le fer à Mars, l’étain à Jupiter. De là devait découler une alchimie analogue à celle que nous signalerons plus loin en Égypte.
Les Chaldéens ou plutôt les enchanteurs babyloniens prédisaient aussi par l’inspection des sacrifices, l’observation des augures, l’interprétation des prodiges ; ils faisaient usage d’incantations ou de charmes ; en un mot, l’on retrouvait chez eux toutes les pratiques superstitieuses qui avaient précédé l’invention de la divination régulière et savante dont on leur rapportait l’honneur.
Les prêtres de la Babylonie formaient de véritables collèges sacerdotaux ; ils se transmettaient leurs secrets et leur science oralement, de génération en génération, en sorte que la théologie astrologique formait en Assyrie le patrimoine de certaines familles.
Lorsque les conquêtes de Cyrus eurent mis fin au grand empire de Babylone, la religion des Perses pénétra sur les bords de l’Euphrate et jusqu’en Cappadoce. Les prêtres du mazdéisme héritèrent en partie de l’influence qu’avaient d’abord exclusivement exercée les Chaldéens. Ces prêtres, désignés par les Grecs sous le nom de mages, μάγοι, altération du zend mog, mogbed ou mobed, qu’ils portaient dans leur patrie, étaient aussi en possession d’une science sacrée. Ils passaient pour d’habiles thaumaturges et quoique leur religion ne fût pas comme celle des Chaldéens, entièrement fondée sur l’observation des astres, ils connaissaient cependant les phénomènes célestes associés dans leur doctrine à l’adoration des esprits.
L’étude des Védas, ces livres sacrés de l’Inde, qui forment encore le code religieux des Brahmanes, a fait voir que la religion perse était sortie du naturalisme, dont ces hymnes antiques et ces formules sacrées nous ont gardé la naïve et primitive expression. Le chantre Arya personnifie dans son langage poétique et adore dans l’élan de son sentiment religieux, le soleil sous tous ses aspects, et les météores lumineux, les eaux, la terre et les arbres.
Ce naturalisme revêtit dans l’Iran une forme plus spiritualiste et plus systématique. La notion d’esprits célestes, d’êtres intelligents et cachés se substitua à l’adoration pure et simple des forces et des objets de la nature. Le soleil, les astres, la terre, les eaux et les plantes ne furent plus adorés que comme des manifestations sensibles de puissances intelligentes et immatérielles. L’idée de Dieu se dégagea de la conception encore vague qu’on retrouve dans le Rig-Véda, et au-dessus de l’univers le Perse plaça un dieu qui en est le créateur et le maître. Ce fut Ormuzd, ou, pour l’appeler par son véritable nom zend, Ahoura-Mazda. Mais le mal existant dans l’univers, le Perse se refusait à y voir l’œuvre d’un dieu sage et bon ; il en fit remonter la cause à une divinité mauvaise, Ahriman ou mieux Angramanyou, c’est-à-dire le malententionné. Ahriman fut donc conçu comme l’adversaire perpétuel d’Ormuzd. Partout où celui-ci a établi le bien, son ennemi répand le mal. Autour de ces deux divinités, les Perses en plaçaient d’autres qui en formaient comme le cortège. Les assesseurs d’Ormuzd étaient les Amschaspands, personnifications idéalisées des formes solaires adorées comme autant de dieux dans les Védas, les Izeds, protecteurs ou personnification des phénomènes naturels, et les Férouers, génies qui représentaient les forces vivantes de la nature, sortes d’hypostases de tout ce qui a intelligence et vie et dont l’origine doit être cherchée dans l’adoration des âmes. On donnait pour serviteurs à Ahriman les Dews, esprits pervers qui aidaient ce dieu mauvais dans son œuvre impure, et avaient créé avec lui les animaux malfaisants.
Ainsi le mazdéisme offrait sans cesse la lutte du bien et du mal, de la destruction et de la vie, l’opposition de la lumière et des ténèbres. Tandis qu’Ormuzd et ses anges veillaient sur la nature et y répandaient les bienfaits, Ahriman, dieu de la mort, de la misère et de la nuit, soutenait contre eux une guerre acharnée. Les Perses révéraient dans le soleil la manifestation la plus éclatante d’Ormuzd, qui avait ainsi pris chez eux la place de l’Indra védique.
Ce dualisme n’était pas toutefois radical. La victoire finale était assurée au dieu du bien, après des combats séculaires ; et quoique les deux divinités eussent apparu dès le principe, Ormuzd devait finalement l’emporter.
Avec de pareilles croyances, le Perse se montrait naturellement préoccupé de s’assurer la protection des génies lumineux et de conjurer l’influence des dews. De là, une série de prières et de pratiques, de rites et de cérémonies, ayant pour objet d’appeler certains esprits et d’en éloigner d’autres. La liturgie perse dont les mages étaient les ministres, la magie, μαγεία, comme l’appelaient les Grecs, ne s’offrit conséquemment aux yeux de ceux-ci que comme une science d’enchantements et d’évocations ; dès lors les mages prirent en Occident le caractère de magiciens et de sorciers.
Les Perses honoraient comme leur grand prophète Zoroastre, Zarathoustra ou Zerduscht, dont le nom diversement altéré se trouve consigné chez un grand nombre d’auteurs de l’antiquité. Quoi qu’il en soit de ce personnage mythique ou réel, réformateur plutôt qu’instituteur de la religion mazdéenne, on doit voir en lui le législateur religieux de la Perse. On lui attribuait la composition des livres sacrés dont les Parsis ne nous ont conservé dans l’Avesta que quelques fragments. Zoroastre devint donc naturellement pour la Grèce et pour Rome l’inventeur de la magie, le patron des mages persans confondus avec les Chaldéens de Babylone ; on fit des uns et des autres les disciples de Zoroastre, auquel les Grecs, par une confusion facile à comprendre, donnaient Ormuzd, ou, comme ils disaient, Oromaze, pour père.
Les Mèdes et les Perses furent en Occident comme les types des enchanteurs et des magiciens ; et tout ce qui tenait à leur culte fut mis sur le compte de la magie, c’est-à-dire de la science des enchantements.
Ce qui contribua beaucoup à accréditer cette idée, c’est le rôle considérable que jouait dans la liturgie mazdéenne le hom ou haoma, plante sacrée et dès lors tenue par les Grecs pour magique. Les Aryas employaient de préférence dans leurs libations le jus du sarcostemma viminalis, qu’ils appelaient soma. Ils attribuaient à cette plante des vertus mystérieuses, un caractère de sainteté particulier. Transporté dans la religion perse, le soma ou hom devint le symbole de la nourriture céleste. D’après l’Avesta, il éloigne la mort ; il donne la santé, la vie, la beauté ; il assure de longues années et une nombreuse progéniture ; il est un talisman contre les esprits mauvais, un garant pour obtenir le ciel. Personnifié en une véritable divinité, le Hom, de même que le Soma des Aryas, s’offrait à l’imagination comme le génie de la victoire et de la santé, comme un médiateur, ou une divinité qui, sous une apparence sensible et matérielle, se laissait boire et manger de ses adorateurs, et entretenait dans leur cœur la pureté et la vertu.
Le sacrifice du Hom avait donc un caractère tout particulier, et, bien que sous des formes assurément plus spiritualistes, il n’était qu’une transformation de ces préparations magiques auxquelles recourent les prêtres de tous les peuples sauvages.
Ainsi, par l’ensemble de ses caractères, la magie perse s’imposait aux imaginations avec un degré de puissance et de vertu qu’on ne retrouvait pas dans les enchantements plus grossiers des autres religions.
La civilisation égyptienne remontait à une époque non moins reculée que celle de Babylone. La religion avait pris sur les bords du Nil une physionomie un peu différente de celle qui lui appartenait en Assyrie, quoiqu’elle reposât sur les mêmes fondements. Le naturalisme était associé chez les Égyptiens à l’adoration des animaux : ceux-ci étaient regardés comme les symboles ou les incarnations d’autant de divinités. Le soleil, sous ses différents aspects et aux diverses places où il apparaît dans le ciel, la lune, les constellations recevaient un culte et étaient personnifiés en une foule de dieux dont l’histoire mythique représentait allégoriquement les phénomènes de la nature. La magie et l’astrologie se trouvèrent rattachées au culte par les mêmes motifs qui existaient à Babylone. Les prêtres égyptiens, organisés en une caste puissante et respectée, possédaient, comme les Chaldéens, des secrets pour opérer des prodiges et étonner l’imagination du peuple par des effets réputés miraculeux. Observateurs non moins soigneux que les astrologues babyloniens, des météores et des révolutions atmosphériques, ils savaient prédire certains phénomènes et se donnaient pour les avoir produits. La lutte entre Moïse et les devins, les magiciens de la cour de Pharaon, mentionnée dans l’Exode, nous en est une preuve frappante. Ces prêtres réussirent à reproduire les prodiges opérés par le législateur hébreu ; et dans ces prodiges, il est aujourd’hui facile de reconnaître des phénomènes naturels à l’Égypte et dont la magie savait prévoir à certains signes la prochaine apparition. D’autres de ces prétendus prodiges ne sont en réalité que des prestiges tout semblables à ceux qu’opèrent aujourd’hui les Harvis, car l’Égypte continue d’être comme par le passé la terre classique des enchanteurs. À cet égard, la magie égyptienne ne se distinguait guère de la magie des autres peuples. Mais ce qui lui assigne un caractère particulier, c’est l’empire qu’elle prétendait exercer sur les divinités, et par ce côté la religion des Égyptiens se rattachait davantage au fétichisme des nègres, caractérisé comme elle par la zoolâtrie. J’ai dit que les prêtres-sorciers font consister tout le culte dans la conjuration et l’évocation des esprits. Chez les Perses, au contraire, l’art magique ne s’exerçait guère que contre les mauvais génies, tandis qu’Ormuzd et ses anges n’étaient invoqués que par des prières et des supplications. Les Égyptiens ne distinguaient pas à cet égard entre les dieux ; ils s’imaginaient à l’aide de leurs évocations, par l’emploi de certaines formules sacramentelles, contraindre la divinité d’obéir à leurs désirs et de se manifester à leurs yeux. Appelé par son nom véritable, le dieu ne pouvait résister à l’effet de l’évocation. Cette opinion tout égyptienne persista jusqu’aux derniers temps de la religion pharaonique. Elle se trouve consignée dans les écrits de l’hiérogrammate Chérémon, qui avait composé, à l’époque alexandrine, un traité sur la science sacrée des Égyptiens. Non seulement on appelait le dieu par son nom, mais s’il refusait d’apparaître, on le menaçait. Ces formules de contrainte à l’égard des dieux ont été appelées par les Grecs Θεὼν ἀνάγxαι. Porphyre, dans sa Lettre à Anébon, s’indigne d’une pareille prétention chez les magiciens égyptiens, d’une foi si aveugle dans la vertu des mots. « Je suis profondément troublé de l’idée de penser, écrit le philosophe, que ceux que nous invoquons comme les plus puissants reçoivent des injonctions comme les plus faibles, et, qu’exigeant de leurs serviteurs qu’ils pratiquent la justice, ils se montrent cependant disposés à faire eux-mêmes des choses injustes, lorsqu’ils en reçoivent le commandement, et tandis qu’ils n’exaucent pas les prières de ceux qui ne se seraient pas abstenus des plaisirs de Vénus, ils ne refusent pas de servir de guides à des hommes sans moralité, au premier venu, vers des voluptés illicites. »
On comprend qu’avec une telle idée, l’emploi des mots eût pris dans la magie égyptienne une importance toute particulière. On regarda dès lors comme indispensable, lors même que le magicien ne comprenait pas la langue à laquelle le nom du dieu était emprunté, de conserver ce nom sous sa forme primitive ; car un autre mot n’eût pas eu la même vertu. L’auteur du traité des Mystères des Égyptiens, attribué à Jamblique, prétend que les noms barbares, les noms tirés de l’idiome des Assyriens et des Égyptiens, ont une vertu mystique et ineffable qui tient à la haute antiquité de ces langues, à l’origine divine et révélée de la théologie de ces peuples.
Au reste, il est possible que la même opinion sur l’efficacité des mots employés dans les formules fût commune à tout l’Orient, car elle est un des fondements de la croyance aux incantations. Les esséniens s’obligeaient par serment à ne pas révéler le nom des anges, parce qu’ils prêtaient à l’invocation de ces noms une vertu magique, et nous trouvons chez les Juifs, déjà avant notre ère, la croyance aux charmes et aux évocations.
La connaissance des phénomènes célestes faisait en Égypte, comme en Chaldée, partie intégrante de la théologie. Les Égyptiens avaient des collèges de prêtres spécialement attachés à l’étude des astres, et où Pythagore, Platon, Eudoxe, avaient été s’instruire. Hérodote fait déjà mention des connaissances astronomiques des Égyptiens. Geminus nous assure qu’ils observaient constamment les solstices, dont l’exacte notion leur était nécessaire pour trouver dans leur année vague la date du commencement de la crue du Nil.
La religion était d’ailleurs en Égypte toute remplie de symboles se rapportant au soleil et à la lune. Chaque mois, chaque décade, chaque jour était consacré à un dieu particulier. Les fêtes étaient marquées par le retour périodique de certains phénomènes astronomiques, et les levers héliaques auxquels se rattachaient certaines idées mythologiques étaient notés avec une grande attention. La sérénité des cieux rendait facile en Égypte comme en Babylonie l’étude du firmament, et l’on pouvait à l’œil nu constater bien des phénomènes qui, dans nos climats, demandent pour être aperçus l’emploi d’instruments. On trouve encore aujourd’hui la preuve de cette vieille science sacerdotale dans les zodiaques sculptés au plafond de quelques temples, et dans des inscriptions hiéroglyphiques mentionnant des phénomènes célestes.
L’astrologie était donc en Égypte cultivée avec autant d’éclat que dans la Babylonie, et ces deux pays se disputaient l’honneur de l’avoir découverte. Les uns prétendaient que les Chaldéens avaient emprunté leurs idées à l’Égypte, les autres que les Égyptiens avaient tiré leur science de la Chaldée. Ce qui est certain, c’est que les principes sur lesquels reposaient les astrologies babylonienne et égyptienne avaient beaucoup d’analogie. Ces principes étaient consignés dans des livres sacrés dont on faisait remonter la rédaction au dieu Thoth ou Tat, regardé comme l’inventeur de l’écriture, et identifié plus tard par les Grecs à leur Hermès. Ces livres de l’Hermès égyptien, surnommé Trismégiste, c’est-à-dire très grand, comprenaient des traités de toutes les sciences dont l’étude était réservée à la caste sacerdotale. Les égyptologues en ont retrouvé des fragments écrits sur papyrus, en caractères hiératiques. À l’époque alexandrine, on les traduisit en grec, en y introduisant sans doute de nombreuses interpolations et leur faisant subir un remaniement sous l’influence des idées platoniciennes.
D’après les Égyptiens, auxquels n’avait pas plus échappé qu’aux Grecs l’influence des changements atmosphériques sur nos organes, les différents astres ont une action spéciale sur chaque partie du corps. Dans les rituels funéraires que l’on déposait au fond des cercueils, il est fait constamment allusion à cette doctrine. Chaque membre du mort est placé sous la protection d’un dieu particulier. Les divinités se partagent pour ainsi dire la dépouille du défunt. La tête appartient au dieu Ra ou soleil, le nez et les lèvres à Anubis, les yeux à la déesse Hathor, les dents à la déesse Selk, la chevelure à Moou, le Nil céleste, les genoux à la déesse Neith, les pieds à Phtha, etc. Ces dieux étant en rapport avec les astres, il s’agissait, pour établir le thème généthliaque de quelqu’un, de combiner la théorie de ces influences avec l’état du ciel au moment de sa naissance. Il semble même que dans la doctrine égyptienne, une étoile particulière indiquât la venue au monde de chaque homme, opinion qui était aussi celle des mages, et à laquelle il est fait allusion dans l’Évangile de saint Matthieu. Telle partie du corps était-elle affectée d’une maladie, on invoquait pour sa guérison la divinité à laquelle en était confiée la garde.
En Égypte comme en Assyrie, les propriétés chimiques des corps paraissent avoir été aussi rapportées aux influences divines et sidérales. Les bords du Nil étaient la terre classique de la chimie ou plutôt de l’alchimie, et ce nom lui-même a été emprunté à celui de l’Égypte, Kem, Kémi (Κημι, Χημι), qui se lit plusieurs fois sur les monuments hiéroglyphiques, et signifie proprement la terre noire.
Les alchimistes égyptiens, qui découvrirent par la pratique bon nombre des procédés de la technologie et de la métallurgie modernes, avaient composé des traités qui faisaient aussi partie de la science sacrée. On a retrouvé des fragments de quelques-uns de ces écrits ; mais de bonne heure, ils ont dû devenir très rares, car, nous dit Suidas, Dioclétien, pour punir les Égyptiens de s’être révoltés contre les lois de Rome, fit brûler tous les livres qu’avaient composés leurs ancêtres sur la chimie. Nous ne pouvons avoir une idée de leur contenu que par des contrefaçons grecques postérieures qui en ont singulièrement altéré les principes. Ils suffisent toutefois pour nous faire voir que la science des combinaisons et des décompositions chimiques y était étroitement liée aux spéculations sur les astres et les dieux. Julius Firmicus parlant des influences sidérales sur les dispositions intellectuelles de l’homme, dit : « Si c’est Mercure sous l’influence duquel il est né, il s’adonnera à l’astronomie, si c’est Mars, il embrassera le métier des armes, si c’est Saturne, il se livrera à la science de l’alchimie. » Le nom même des planètes appliqué aux métaux et aux substances métalliques chez les alchimistes du Moyen Âge, héritiers des doctrines de l’art sacré égyptien, nous prouve le rapport permanent que l’on prétendait établir entre ces corps et les étoiles. La chimère de la pierre philosophale ou du grand œuvre paraît originaire de l’Égypte, puisque Dioclétien, en faisant brûler les livres d’alchimie des Égyptiens, se proposait de les priver ainsi d’une grande source de richesses. L’or était personnifié en Égypte par une déesse, Noub. Enfin toutes les théories alchimiques du Moyen Âge sont constamment associées à l’idée de l’intervention des esprits élémentaires et des démons, qui s’offre comme un dernier vestige de l’antique astrologie égyptienne.
Ainsi en Égypte, comme en Perse et en Chaldée, la science de la nature était une doctrine sacrée dont la magie et l’astrologie ne constituaient que des branches, et où les phénomènes de l’univers se trouvaient rattachés par un lien étroit aux divinités et aux génies dont on le croyait rempli.
La religion fut de tout temps associée chez les Grecs à l’exercice des pratiques superstitieuses qui découlent de la magie des premiers âges. Le culte en était pénétré. La divination était exercée soit dans des établissements spéciaux, des sanctuaires fatidiques appelés manteions, soit par des devins de profession, qui colportaient de ville en ville leur mensongère industrie. Le sacrifice était presque toujours accompagné de rites ayant pour objet de consulter la volonté des dieux, ou même de véritables incantations. La confiance en certaines formules magiques, en certains charmes, dans la vertu de certains gestes, était excessive ; on y recourait contre la fascination, pour évoquer les dieux, guérir des maladies, cicatriser des plaies et détourner l’influence malfaisante attribuée à différents actes. Les purifications, qui jouaient un si grand rôle dans la liturgie, étaient toujours accompagnées de paroles et de pratiques fort analogues aux enchantements ; et ce sont ces purifications qui paraissent avoir été le point de départ des mystères. On attribuait à Orphée, leur prétendu fondateur, la composition de plusieurs charmes. Les devins, qui formèrent quelquefois de véritables castes, s’attribuaient une certaine puissance sur la nature ; ils charmaient les serpents, comme les psylles des environs de Parium et de la Libye ; ils conjuraient les vents et pouvaient même métamorphoser les hommes en animaux. La Croyance à la lycanthropie était de date fort ancienne en Grèce ; elle s’y est perpétuée jusqu’à nos jours.
Cette puissance attribuée aux devins apparaît dans les plus vieilles traditions mythologiques de la Grèce, dans les fables de Médée et de Circé. Les femmes de la Thessalie avaient surtout une grande réputation dans l’art des enchantements ; elles étaient habiles à composer des poisons, et pouvaient, assurait-on, par leurs chants magiques, faire descendre la lune des cieux. Ménandre, dans sa comédie intitulée la Thessalienne, représentait les cérémonies mystérieuses à l’aide desquelles ces sorcières forçaient la lune à abandonner le ciel, prodige qui devint même si bien le type par excellence de tout enchantement, que Nonnus nous le donne comme opéré par les brachmanes.