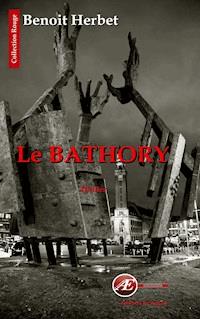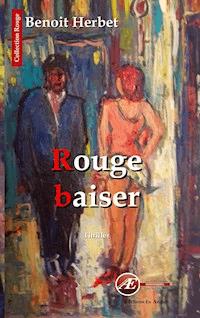Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Je m’appelle Caroline. J’ai quarante-cinq ans, je suis médecin, j’exerce à Charleroi. Jusqu’à présent, ma vie n’a pas été un long fleuve tranquille. Enfant, j’ai été abandonnée par ma mère. J’ai eu une petite fille, mais elle est morte. Accessoirement, ma vie sentimentale est un désastre.
Aujourd’hui, j’emménage dans un appartement situé au troisième étage de la maison Stassen, une somptueuse demeure de style Art Nouveau. Je veux être une belle personne, j’aspire à un peu de quiétude, j’ose croire au bonheur.
Malheureusement, nuit après nuit, quelque chose de monstrueux parcourt les couloirs de mon immeuble et ruine mes espérances. Je n’ai aucune idée du destin horrible qui me tend les bras.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Avec ce récit de maison hantée, qu’il explore de manière originale, Benoit Herbet dépeint la palette de nos peurs les plus viscérales et livre un incroyable roman d’épouvante, dans la lignée des textes de Richard Matheson, Shirley Jackson et Jean Ray.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benoit Herbet
La Maison Stassen
Thriller
ISBN : 9789-10-388-0534-7
Collection : Rouge
ISSN :2108-6273
Dépôt légal : janvier 2023
© couverture Ex Æquo
© 2023 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite
Éditions Ex Æquo
6 rue des Sybilles
88370 Plombières Les Bains
www.editions-exaequo.com
Fais une petite marche jusqu’à la limite de la ville
Et traverse les rails de chemin de fer
Là où le viaduc se profile
I
De la sérénité…
C’est l’expression dominante que dégage le visage de cette femme ! Je lui concède une parfaite quiétude. J’observe son teint clair, ses yeux grand ouverts et la commissure délicate de ses lèvres, qui s’épanouissent, larges, radieuses et sensuelles, au-dessus de son menton volontaire.
Je tente de m’imprégner de cette image.
Je la détaille obstinément, m’égare le long de ses tempes et m’attarde lorsque j’examine les premières mèches qui naissent à l’orée de ses oreilles en un subtil camaïeu d’or, de châtain et de bronze.
De longues minutes s’écoulent.
Je la regarde comme si je la voyais pour la première fois. Progressivement, la discrète beauté des traits de cette paisible quadragénaire m’apparaît tel un masque tranquille que je ne pourrai jamais oublier. Je me hasarde à détailler le reste de sa personne.
Elle est nue.
Son assassin l’a d’abord tuée. En témoignent trois vilaines plaies sur son corps menu. Trois stigmates indélébiles infligés au moyen d’une lame crantée. Le premier coup l’a atteinte à hauteur de son sein droit, cette petite mamelle jadis arrogante que l’acier a crevée, et qui pendouille désormais sur le côté, paresseuse, affalée, comme un ballon dégonflé duquel se sont écoulés de copieux filets de sang qui coagulent déjà. Le deuxième coup a creusé une vilaine blessure, profonde et meurtrière, à hauteur de l’abdomen, dont un agglomérat de boyaux rougeoyants semble prêt à s’échapper. Le troisième a carrément tracé un sillon impie dans les chairs déchirées de son bas-ventre.
Je ne prête aucune attention à mon environnement.
La pièce baigne sous la sépulcrale clarté de la lune. Une lumière de circonstance. C’est l’heure des promesses et des menaces, et, dans le cas de cette femme, d’un aller sans retour. Autour de moi, pas une pendule ne frémit, pas un chat ne ronronne, pas une boiserie ne craque. Je poursuis mon examen dans un silence absolu. Elle est allongée sur un tapis dont les longs poils gris forment le linceul monochrome dans lequel son cadavre sera bientôt emporté.
Cette femme monopolise mon attention.
Après avoir traîné son corps ici, son meurtrier l’a mutilée. J’en veux pour preuve qu’au bout de son bras droit, sectionné à hauteur du poignet, un moignon baigne dans une flaque noirâtre. Sa main a disparu. Dans l’esprit déviant de l’homme qui lui a pris la vie, ce crime méritait un trophée. Une récompense sanguinolente conquise d’un coup de hachoir.
C’en est trop.
Je détourne mon regard avant que l’horreur de la scène ne me submerge. Je m’arrime une dernière fois aux yeux écarquillés de la victime tragique de cet acte de barbarie dont le caractère le plus atroce est peut-être son côté ordinaire. Je me retiens de songer au nombre de femmes anonymes qui finissent dans un état similaire à celui de cette pauvre dépouille.
Ainsi que je le devinais, dès le début de mon examen, et contre toute attente, par-delà la souffrance, la surprise ou peut-être le dépit, le visage de cette malheureuse est demeuré intact. De ses yeux qui n’en finissent pas de mourir émanent les vestiges délicats d’une parfaite douceur.
Confrontée à une pareille horreur, face à l’inanité d’une existence meurtrie et brisée, je tente en vain de m’arrimer à cette précaire consolation : le visage de la morte est demeuré serein.
La vie l’a simplement désertée.
II
Deux jours plus tôt, j’emménageais au troisième étage de la maison Stassen.
Rares sont les demeures qui conservent, au mépris du temps et des modes architecturales, le nom de l’homme qui leur a donné la vie. Uniques sont ces lieux dont la structure et les ornements se confondent en une singulière démonstration du génie humain.
À bien y réfléchir, la maison Stassen m’a accompagnée, depuis mon enfance, et il y avait quelque chose de logique, comme un accomplissement, ou une fatalité, à l’idée que je finisse par m’y installer.
La maison Stassen est située sur le boulevard de l’Yser. À Charleroi. Ma ville. Elle se tient et se maintient depuis plus d’un siècle. Proche de la rue de la Montagne. À deux pas de la Maison du Peuple. Elle a été bâtie en 1905. À l’apogée de l’Art Nouveau. Du courant artistique qui a fleuri aux quatre coins du globe au début du siècle dernier, elle possède une profusion de traits fantaisistes et souples, incongrus et harmonieux, féminins et floraux, qui en font une des plus belles réalisations du genre.
Quand j’étais petite fille, que je ne connaissais rien à l’art et encore moins à l’architecture, que je passais devant, ma main lovée dans celle de ma mère, et que mon nez ne portait pas plus haut que sa majestueuse porte d’entrée en fer forgé, je la comparais innocemment à la maison en pain d’épices, dans Hansel et Gretel. Mon imagination débordante d’enfant sage voyait dans les carrelages en céramique du rez-de-chaussée des sucreries prodigieuses et dans les boiseries ondulantes qui formaient les châssis de ses fenêtres le probable nid où essaimaient des fées bienveillantes, par ailleurs plutôt rares au Pays Noir. Je devais avoir cinq ou six ans, à l’époque, puisque j’avais encore ma mère, mais je me rappelle qu’elle m’expliquait qu’au début de la Première Guerre mondiale, les Allemands étaient entrés à Charleroi par le Viaduc et qu’ils avaient traversé ma ville d’ouest en est, ne laissant qu’un amas de ruines calcinées dans leur sillage. Même les magasins Raphaël, tout proches, à l’angle de la rue de la Montagne, étaient partis en cendres. Toutes les constructions avaient flambé, toutes sauf une : la maison Stassen ! Elle était restée, fière et droite, parmi un chaos de poutres fumantes et de gravats émiettés. Cette précision historique, que maman tenait probablement de sa propre mère, m’avait émerveillée. Je voyais en ma future demeure un rempart, un château fort imprenable, un havre de quiétude au milieu de l’Armageddon.
Adolescente, j’étais à la fois solaire et lunaire, et j’étais courtisée par un garçon charmant, différent des autres garçons. Une bouture d’homme, imaginatif et attentionné, que je considère avec du recul et un peu de désillusions comme mon premier, mon vrai, mon seul Grand Amour. Mon Grand Amour. Quand je pense à lui, je l’évoque en ces termes, plutôt que par son prénom. Mon Grand Amour s’intéressait à tout, mais il nourrissait en particulier une curieuse passion pour l’Art Nouveau. Il en connaissait toutes les réalisations notables qu’on pouvait trouver dans notre ville, que nous parcourions dans tous les sens, avant ou après le collège. Me tenant par la main, il me promenait de la maison Dorée à la maison des Médecins, et il s’émerveillait également devant les frontons ornés de figures féminines de la rue du Collège ou devant certains châssis merveilleux de la rue de Marcinelle. Selon lui, Charleroi abritait tant de trésors qu’il aurait été criminel de les oublier ou de ne simplement pas les honorer comme ils le méritaient. De toutes ces pépites, ostentatoires ou cachées, sa préférée était, de loin, la maison Stassen. Nous pouvions nous y arrêter et la contempler plusieurs fois par semaine. Petit à petit, j’en discernais les détails, j’apprenais de la bouche de mon amoureux des termes fabuleux, tout en me demandant secrètement où il les avait appris tant il m’impressionnait, et je m’inventais un lien invisible avec cette bâtisse, que j’assimilais, consciemment ou inconsciemment, au souvenir de ma mère, alors disparue depuis une dizaine d’années.
Devenue adulte, après des études de Médecine à Liège et Bruxelles, je suis revenue à Charleroi, j’y ai ouvert mon cabinet, où j’exerce en tant que généraliste. Une de mes patientes, Madame Papic, habite au deuxième étage de la Maison Stassen. C’est à la faveur d’une consultation à son domicile que je suis entrée pour la première fois dans cette demeure énigmatique et flamboyante, comme en un royaume vierge et mystérieux, régi par ses règles inconnues et sublimé par une profusion d’éléments fantasmagoriques sur lesquels je reviendrai plus tard. À l’époque, j’étais une femme mariée. Je suis depuis divorcée. J’étais mère. Aujourd’hui, je ne le suis plus. Je ne sais d’ailleurs plus vraiment ce que je suis, ni ce que je possède, et encore moins ce que je vaux. Je crains de n’être plus rien. Mais peut-être est-il plus sage de ne pas étaler dès à présent mon spleen coutumier. Disons que j’aspire simplement à une vie meilleure.
Il y a deux jours, donc, j’emménageais, débordant de courage et d’espérances, au troisième étage de la maison Stassen.
Comme tous les passants, promeneurs, parents, enfants, vieillards, amants, ouvriers, employés, célèbres ou anonymes, amoureux de l’art en général ou de la ville en particulier, qui, depuis plus d’un siècle, en allant à l’école ou en rentrant du travail, sous le soleil de midi ou à la faveur d’une lune pleine à craquer, sont un jour passés, sur un trottoir ou l’autre du boulevard, en marchant vers l’est ou vers l’ouest, devant l’inexorable maison Stassen, j’ignorais évidemment qu’elle est hantée.
III
Après mes consultations, le jour de mon emménagement, je me suis garée sur une place miraculeuse sur l’îlot central du boulevard, située juste devant la Maison. Confiant la plus grosse partie de cette ignoble corvée à une équipe de déménageurs rustauds, j’avais chargé ma voiture du strict nécessaire : j’avais emmené mes plantes, et Mimine, ma petite chatte tigrée adorée. J’ai d’abord déchargé les deux pots, que j’ai déposés devant la lourde porte de l’immeuble, puis j’ai extrait précautionneusement mon félin chéri, qui me demandait de ses grands yeux verts incrédules dans quelle nouvelle aventure inconsciente je l’embarquais.
Sur le seuil, j’ai examiné les plaques de cuivre qui jouxtaient les sonnettes, en m’efforçant de mémoriser le nom de mes nouveaux voisins.
Au rez-de-chaussée, à gauche, Pierre Payen, dont j’avais déjà fait la connaissance, mais qui, sur la plaque de cuivre, est sobrement résumé, en caractères d’imprimerie, à la fonction désuète qu’il incarne avec une discrétion et une abnégation stupéfiantes : CONCIERGE. À droite, la boutique abandonnée d’une entreprise de Pompes Funèbres au nom prédestiné, et que j’aurais trouvé amusant si j’étais pourvue d’un tant soit peu d’humour noir : TOUSSAINT.
Au premier étage, à gauche, un autre nom que je connaissais déjà, et que j’assimilais à l’aide que cet homme m’avait parfois prodiguée au cours des derniers mois : PAOLI. Et à droite, un solennel, mais inconnu VAN CAUWELAERT-AVOCAT.
Au deuxième, ma gentille patiente, à gauche. PAPIC. Et un espace vide à droite, encadré de quatre trous qui permettraient de fixer le nom du prochain occupant qui habiterait cet appartement vacant.
Au troisième, un inconnu à gauche, qui n’en demeurait pas moins mon voisin direct. MICHIELS. Et à droite, sur une plaque rutilante, mes initiales, dites du bonheur. CC. Précaution dérisoire, en vue de préserver mon anonymat, pour ne pas que Crétin, passant par-là, voie mon nom. Pour ne pas que ce crétin de Crétin me retrouve.
Et au quatrième, un seul nom, à droite : GOLDENBERG. L’emplacement de gauche semblait non seulement libre, mais également vierge, comme s’il n’y avait qu’un seul appartement à ce niveau. À moins que le logement des Goldenberg n’occupe tout l’étage.
Avec une maladresse et une naïveté qui n’appartiennent qu’à moi, j’ai cru que je serais capable de ramasser mes plantes, à raison d’une dans chaque bras, d’agripper la caisse de Mimine par la poignée, et d’ouvrir la gigantesque porte d’un discret coup de ma frêle épaule. Il est heureux que le ridicule ne tue pas.
Mon sauveur est venu à moi à cet instant précis. Il a surgi. Grand. Fort. Noir. D’une voix délicate, il a demandé…
— Puis-je vous aider, Madame ?
La réponse semblait évidente. Il m’a débarrassée de mes deux plantes, qu’il a enlacées dans ses bras musclés qu’un t-shirt rikiki moulait avantageusement, au mépris de la fraîcheur automnale. De sa main libre, il a attrapé une clé dans sa poche, et a ouvert la porte d’une pichenette, comme si elle était en carton-pâte.
— Je vous en prie, Madame.
Sa politesse, son allure et sa douceur m’ont ravie. Je lui ai souri. Mon nouveau voisin était de toute évidence un homme charmant.
Je suis entrée, portant précautionneusement Mimine, qui ne m’aurait pardonné aucun cahot intempestif. J’ai été avalée par les trois marches du vestibule, happée par la pléthore de couleurs diffuses et variées qui imprégnaient l’endroit, comme si je les remarquais pour la première fois. Et j’ai senti le froid. Un froid indicible, soudain, incompréhensible. Une invisible chape de glace qui s’est abattue sur moi, alors qu’aucun courant d’air ne l’expliquait.
J’ai frissonné.
La caisse, au bout de mon bras, a vibré de spasmes soudains. Je l’ai levée à hauteur de mon regard. Le dos de Mimine semblait s’être brisé en deux, jusqu’à former, tel l’accent circonflexe qui pourvoit la grêle de ses flèches destructrices, une crête poilue de minou furibard, suivie d’une queue dressée dont les poils avaient doublé, sinon triplé de volume.
Je n’ai pas compris. J’ai avancé en direction de l’ascenseur.
À ma droite, la porte condamnée qui menait à l’ancienne boutique des Pompes Funèbres Toussaint. À ma gauche, la loge du concierge, dont le comptoir vitré était ouvert. J’ai aperçu Monsieur Payen, impassible, à qui j’ai adressé un discret salut, qu’il m’a rendu d’un imperceptible hochement.
Toujours suivie de mon providentiel porteur, je suis parvenue au cœur de la demeure : une impressionnante cage d’escaliers, d’une splendeur à couper le souffle, et s’enlaçant autour de l’antique ascenseur qui traverse les quatre étages, cinq si je compte la cave. Là, je me suis sentie écrasée par l’élément le plus extraordinaire de la maison Stassen : l’étrange colonne de marbre qui prend discrètement naissance au rez-de-chaussée : relativement sobre à sa base, simplement striée de quelques motifs délicats, elle s’épanouit ensuite à trois cent soixante degrés en une arcade massive, taillée en autant de circonvolutions complexes et tordues qui figurent le squelette d’un animal prodigieux dont la colonne vertébrale difforme embrasse et dévore ensuite le plafond, comme si elle soutenait la totalité de la Maison. Il m’aurait été impossible de la détailler davantage sans ressentir durablement les effets pernicieux d’un angoissant vertige.
Accroché au mur opposé à la colonne, comme dissimulé sous l’arche tentaculaire qui tend de curieuses griffes de pierre polie vers son cadre de bois noble et recouvert de feuilles d’or, un imposant portrait me toisait avec une insistance qui confinait à l’intimidation. Immortalisés sur la toile, deux dandys prétentieux posaient sur moi leurs yeux de corbeaux rusés, avec pour arrière-plan une nébuleuse rougeâtre amalgamant le carmin le plus vif à la lie de vin la plus ténébreuse.
Instinctivement, j’ai détourné mon regard de ce tableau, non sans me demander qui avait pu avoir l’idée d’accrocher une horreur pareille dans un lieu de vie. Mon doigt a pressé sur le bouton noir, usé par un siècle d’usages incessants, et la cabine, bourdonnant au sous-sol, s’est mise en branle paresseusement, se hissant courageusement à ma hauteur en un amalgame de cliquetis minutieux. J’ai ouvert la porte, tiré la grille, et suis entrée dans l’habitacle aux parois luxueuses, ornées d’éléments de marqueterie, séparées par les vitres qui permettent d’admirer la rampe de l’escalier qui naît à cet endroit : l’impressionnante tête de départ, dans laquelle sont sculptés des motifs en spirale, dessine une onde formidable qui se propage à travers les épais balustres, jusqu’au sommet, quatre étages plus haut.
Chargé de mes plantes, mon voisin m’a suivie. Il a refermé la grille, et m’a posé la question dont il connaissait déjà la réponse :
— Vous êtes la dame du troisième, n’est-ce pas ?
Sans même attendre que je réagisse, il a appuyé sur le pressoir correspondant. Le plancher a légèrement tressauté. Nous avons gravi un univers féerique, constellé de fresques murales dont les milliers de carreaux représentent des scènes bucoliques où se pavanent nymphes, muses et déesses, lovées dans les replis d’un jardin d’Éden foisonnant.
Je manquais à la plus élémentaire des politesses. J’ai tendu la main vers mon sauveur, en tentant vainement de lui montrer à quel point j’étais sûre de moi.
— Caroline, enchantée.
Il a pris ma main minuscule dans la sienne. Mes doigts menus et pâles se sont logés dans sa paume noire comme l’ébène, et somme toute rassurante. Il m’a souri, de ses dents gigantesques et carnassières.
— Irène, enchantée.
Je n’ai d’abord pas compris. Ma tête arrivait à la hauteur de sa poitrine, partiellement masquée par le feuillage de mes plantes. Mais j’ai parfaitement vu ses seins gigantesques et même discerné les tétons dressés que compressait outrageusement son t-shirt. Je me suis tue, le temps d’assimiler l’information. Je ne souhaitais pas qu’il ou elle croie que je le jugeais, je ne voulais pas qu’il lise dans mon regard une once de réprobation, de haine, ou de racisme, mais je devais digérer ma surprise. Iel a précisé.
— Lady Irène. Mais comme tu as l’air d’une petite nana sympa, tu peux m’appeler Irène.
Elle m’a tutoyée comme s’il s’agissait d’une évidence, mais cela me convenait, cela me faisait du bien.
La cabine évoluait à travers les étages, et j’étais définitivement tenaillée par cette impression aiguë de poser un regard neuf sur cet environnement que j’étais pourtant censée connaître ; je discernais avec une certaine sidération les éléments subtils qui imprègnent les parties communes d’une atmosphère unique, en perpétuelle évolution. Je découvrais par exemple de quelle manière, sur chaque demi-palier, à l’arrière de la Maison, les larges baies vitrées, garnies de vitraux aux tons disparates, diffusent un chapelet de lumières colorées d’intensité variable, de jour comme de nuit.
Nous sommes parvenues au troisième étage. Irène a déposé les plantes devant ma porte, m’a adressé un autre de ses sourires radieux, puis est descendue par les escaliers. En remuant du cul.
Je n’ai eu d’autre choix que de saisir mon trousseau de clés et d’entrer, prise d’un sentiment étrange. Comme si je n’en avais pas réellement envie. Pourtant, je l’avais voulu, cet appartement. J’avais même cassé mon plan d’épargne retraite pour me l’offrir, j’étais ravie de venir habiter dans ce lieu qui faisait, comme je l’ai déjà évoqué, partie intégrante de ma vie, situé à une centaine de mètres seulement de chez mon père, et, last but not least, de recouvrer ma liberté, loin des griffes manipulatrices de Crétin. Pourtant, seule sur le seuil, je me suis trouvée soumise à une aberrante appréhension.
Je n’étais pas la bienvenue.
J’ai ouvert la porte sans difficulté. La lumière du jour était teintée d’un étonnant voile de pénombre diffuse. De ma main libre, j’ai cherché l’interrupteur. Une lumière crue a éclairé l’entrée et le séjour. Les déménageurs avaient laissé un indescriptible capharnaüm de meubles placés n’importe comment, de cadres empilés, de babioles éparpillées et de cartons rassemblés en une précaire ziggourat constituée de mes modestes possessions.
J’ai failli pleurer en prenant la mesure du chantier qui m’attendait.
J’ai posé la caisse. J’ai libéré Mimine, qui a détalé, ventre à terre, comme si elle était pourchassée par une horde baveuse de bouledogues déchaînés.
Je suis restée là, bras ballants, âme en friche, cœur en vrac ; j’ai pris conscience de ma solitude, de mon manque de courage et de la tristesse toujours prompte à se rappeler à mon bon souvenir. J’ai cherché une excuse, un alibi, n’importe quoi qui puisse me distraire de cette tâche ingrate. Je me suis accrochée au souvenir du ballotin de pralines que j’avais acheté à Rive Gauche quelques heures plus tôt. J’y ai vu une occasion inespérée de fuir, par le même chemin que venait de prendre Lady Irène.
J’ai dévalé les marches. Je me suis arrêtée au premier étage. J’ai frappé à la porte. J’ai regardé ma montre. Monsieur Paoli devait avoir terminé ses consultations. J’ai réalisé que je le dérangeais peut-être. Il était trop tard pour faire demi-tour. Quelques interminables secondes se sont écoulées. J’ai attendu, silencieuse, sur le palier silencieux de notre demeure silencieuse. Ugo Paoli m’a ouvert :
— Oh, Caroline…
— Bonsoir, Monsieur Paoli.
— Tu es installée ?
J’ai esquissé un sourire en vue de sauvegarder ma dignité.
— Disons que je le serai lorsque j’aurai vidé tous mes cartons.
— Courage, Caroline !
J’ai tendu la boîte de Léonidas à ce moment-là.
— C’est pour moi ?
— Oui, c’est grâce à vous que j’ai trouvé mon appartement.
— Merci, Caroline, il ne fallait pas.
Ugo Paoli a pris les pralines, il m’a encore remerciée et il a délicatement fermé sa porte, me rendant par ce simple geste à la singulière quiétude des lieux. Je me suis rendu compte que j’avais oublié de lui dire que je souhaitais prendre rendez-vous en vue d’une autre séance. Je n’ai pas osé le déranger à nouveau. Je me suis retournée, face à la porte de l’avocat van Cauwelaert. Je ne discernais aucun bruit sur le palier, ni derrière les portes, ni au rez-de-chaussée, ni dans les étages supérieurs. La cabine de l’ascenseur avait disparu Dieu sait où. J’ai subitement eu l’impression d’être seule dans la maison, petite Caroline précaire dans un lieu aux apparences enchanteresses, mais qui m’impressionnait au-delà de ce que mon vocabulaire peut exprimer.
J’étais à deux doigts de ressentir de la peur. Sans raison. Sans cause. Une peur nouvelle, qui se superposait à toutes celles que j’avais expérimentées au cours de ma vie.
Je suis remontée en empruntant les escaliers. J’ai pressé le pas. Parvenue au deuxième étage, j’ai dépassé l’appartement vide ainsi que celui de Madame Papic, et j’ai gravi deux par deux les marches qui me séparaient du troisième.
Mon appartement m’attendait là où je l’avais laissé.
La porte située en face de la mienne était entrouverte. Je me suis arrêtée. J’ai regardé. Je me suis rappelé le nom sur l’interphone. Michiels.
Monsieur Michiels m’est apparu à cet instant. Il sortait de chez lui.
J’ai bredouillé.
— Bonjour.
Il s’est arrêté et m’a regardée, visiblement intrigué, comme s’il craignait que je fasse du porte-à-porte dans l’espoir de lui vendre une assurance.
— Bonjour, vous cherchez quelqu’un ?
— Non… En fait, j’habite ici. Je suis…
— Vous êtes ?
J’ai pris une inspiration.
— Votre nouvelle voisine.
— Enchanté, nouvelle voisine, moi, c’est Mickaël.
— Caroline.
Il s’est avancé vers moi. J’ai cru qu’il allait me serrer la main, ou m’embrasser. Il a juste pressé sur le bouton de l’ascenseur. Quelle quiche je puis être ! Comment pouvais-je imaginer des choses pareilles ?
Je suis rentrée dans l’appartement. Je devrais m’habituer à dire « chez moi. »
IV
Ma première soirée a été gâchée par une succession de moments de découragement auxquels je n’étais pas préparée. Confrontée à l’arrogance des falaises de cartons, à la terreur féline de Mimine et à la fatigue harassante qui me saisit après chaque journée de travail, je me suis affalée dans le canapé.
J’ai exhumé de mon sac un roman d’Anna Gavalda, intitulé Billie, et j’ai tenté de le reprendre à la page 17, où je l’avais abandonné trois semaines plus tôt.
J’ai glandouillé sur mon smartphone, me suis fendue d’un message laconique à papa pour lui dire que j’étais bien installée et j’ai également changé une entrée de mon répertoire, en virant le prénom de Crétin pour le remplacer par le surnom qui lui va si bien.
Crétin ! Tant de promesses au départ, pour tant de malveillance à l’arrivée… Tant de médiocrité, de tentatives mesquines pour prendre le contrôle de ma vie, et de constats caustiques pour me dénigrer sans relâche... Je ne sais pas comment justifier le malaise qu’il m’inspire ni l’angoisse qui m’étreint lorsque je songe à lui. J’ignore sous quelle forme son insidieuse présence pourrait se manifester à nouveau. Chercherait-il ma nouvelle adresse ? M’appellerait-il ? Passerait-il au cabinet, au prétexte qu’il est mon patient ? Me suivrait-il ? Quel motif impérieux, quelle tristesse feinte, quelle stature de victime afficherait-il pour justifier sans aucune gêne qu’il revenait frapper à ma porte ?
Ma porte. À plusieurs reprises, ce premier soir, je me suis assurée qu’elle était fermée. Et verrouillée. Je n’ai pas pu résister à l’envie de regarder par le judas. J’ai scruté l’univers difforme constitué d’un palier silencieux, d’une cage d’ascenseur disproportionnée, et de la porte close de l’appartement en face. Mais point de Crétin. Et c’était tant mieux ! Allais-je devenir folle ? Je l’ignorais. Toujours est-il que je n’ai pas résisté à la tentation d’éteindre la lumière au salon, et de regarder par la fenêtre, au-delà de mon balcon, au cas où il m’aurait déjà retrouvée, ou aurait reconnu ma voiture, ou attendrait sur le trottoir en face, devant Notre-Dame des Remparts. J’ai cherché son faciès stupide, redouté sa silhouette grotesque, avant de me rendre à l’évidence, sans toutefois aller jusqu’à en être soulagée : Crétin ne m’avait pas retrouvée. Pas encore, du moins.
J’ai tenté une dernière fois de convaincre Mimine de quitter sa cachette, sous mon lit, et de me rejoindre sur le canapé, mais je n’ai récolté qu’un inhabituel feulement, accompagné de la promesse implicite de me lacérer le bras si je m’avisais de l’extirper de son refuge.
Je me suis couchée. J’ai introduit des écouteurs dans mes oreilles. J’ai écouté Gisèle Pape, convaincue qu’elle m’emmènerait sur la plaine, et qu’à sa suite, j’entendrais le chant des pistes, préambule vertueux à une nuit de sommeil réparateur.
Apaisée et confiante, j’ai posé mon téléphone et les pastilles sur ma table de nuit.
J’ai éteint.
Je me suis calfeutrée sous ma couette.
J’ai découvert les ombres inédites et la pénombre galopante de ma nouvelle chambre. J’ai parcouru les boiseries, mesuré la hauteur du plafond et fixé les murs nus, que je m’étais promis de garnir. Ensuite, j’ai fermé les yeux.
C’est cet instant précis que la maison, jusque-là silencieuse, a choisi pour se réveiller. Mes voisins du dessus n’étaient pas couchés. J’ai entendu des pas. Des petits pas. Des petits pas d’enfants qui couraient, pieds nus, et dont les talons martelaient le parquet. Leur course invisible naissait au-dessus de ma tête, puis s’éloignait, et revenait invariablement à ma hauteur.
J’avais l’impression de pouvoir les suivre dans leur grand appartement, comme si je devinais la boucle qu’ils dessinaient à travers les pièces spacieuses aux boiseries séculaires.
Ils partaient, trottaient, puis s’arrêtaient, et je me réjouissais de pouvoir enfin m’endormir. Je glissais alors lentement vers le paradis onirique auquel je prétendais, mais les habitants du quatrième ruinaient invariablement mes espérances et reprenaient leur course.
Le même processus s’est répété une fois, deux fois, trois fois. Excédée, je me suis retournée dans mon lit, j’ai collé mon oreiller sur ma tête, j’ai pesté intérieurement, j’ai prié pour que ça s’arrête. Mais le petit cortège répétait inlassablement sa farandole, jouant cruellement avec mes nerfs.
J’ai tenté de me souvenir du nom qui figurait sur l’unique sonnette du quatrième. Gold quelque chose. Goldstein, peut-être. Je me représentais une tribu de petits garnements tout puissants. Je fustigeais intérieurement les parents de ces enfants rois qu’ils laissaient courir dans l’appartement. J’ai songé à me lever, à monter et leur demander de se calmer. Puis, j’ai réalisé que j’étais vêtue en tout et pour tout d’une unique nuisette, et que je n’avais pas trop le courage de me rhabiller. Je me suis retournée lourdement. J’ai aussi pris conscience que je ne voulais pas passer pour l’emmerdeuse de service, la petite quadra divorcée et aigrie qui ne supporte pas les enfants des autres. À défaut d’avoir bâti une famille ou d’être entourée d’amis, je voulais a minima réussir mes relations de voisinage.
Nouveau silence. Nouvel espoir. Nouveau roulement de pas saccadés. Nouvelle désillusion.
Colère.
Si je laissais passer cela le premier soir, cela les inciterait à récidiver, nuit après nuit. Dès le départ du prochain cycle, je me lèverais, me rhabillerais et leur montrerais de quel bois je me chauffe.
Les pas sont revenus au-dessus de moi. J’étais décidée. Prête à mener l’assaut dès qu’ils repartiraient.
Mais ils n’ont pas recommencé. Le silence s’est fait. J’ai attendu. J’ai compté les secondes. J’ai cru que j’allais enfin pouvoir dormir.
J’ai entendu un claquement. Davantage qu’un craquement. Quelque part dans la maison. Suivi d’un autre. Des pas. Différents de ceux qui avaient gâché mon sommeil. D’autres pas. Dans l’escalier. Qui montaient. Qui approchaient. Des pas. D’une seule personne. Qui martelaient les marches. Le bois, si noble, si impeccablement ciré, semblait ployer, couiner, crier sous leur assaut saccadé qui scandait les rimes assassines d’une menace explicite.
Des pas. Méthodiques. Déterminés. Implacables.
Je me suis cramponnée à ma couette. J’ai eu l’impression qu’on venait me chercher. C’est idiot. Mais c’est ainsi. Des pas. Qui sont parvenus jusqu’à mon palier. Je me suis recroquevillée. Si j’avais pu, j’aurais rejoint Mimine sous le lit. Des pas. Qui me glaçaient. J’ignorais pourquoi j’avais peur. Si peur. Rien ne justifiait mon effroi subit. Des pas au-dehors. La peur au-dedans. Inexplicable. Mais irréfutable. Des pas. Qui ont continué leur chemin. Qui ont continué en direction du quatrième étage. Des pas. Sur le palier au-dessus du mien. Et quatre coups, formidables, résolus, terrifiants.
Soudain, le silence.
Un silence insupportable. Pernicieux. J’aurais subitement voulu que les trottinements reprennent au-dessus de ma tête, mais il régnait désormais un calme assourdissant, interminable, m’abandonnant, seule, à ma peur, et ressuscitant accessoirement toutes les frayeurs accumulées depuis mon enfance, à commencer par celle que m’inspirait le couloir du premier étage, chez mes parents.
Je me suis levée. Précaire Caroline que je suis. Virginale dans ma nuisette, enfantine dans cet incompatible amalgame entre curiosité et terreur. Je craignais un intrus, un voleur, ou pire encore, une visite inopportune de Crétin. J’ai traversé le couloir, sur la pointe des pieds. Le parquet était tiède, mais j’étais glacée. Je redoutais les ombres des cartons, les portes des placards et les lents mouvements des arbres qui tanguaient à hauteur des fenêtres du salon. Tout était silence et menace. Je me suis approchée de la porte. J’ai fixé la poignée et mes clés. J’avais envie de m’assurer que je l’avais bien fermée, mais je craignais que le moindre cliquetis du trousseau trahisse ma présence. Je me suis contentée d’approcher du Judas. J’étais terrorisée. Des régiments de craintes diverses assaillaient mes jambes, escaladaient mes doigts et contractaient ma poitrine. Je me demandais comment je réagirais si je voyais Crétin, collé de l’autre côté du battant. Ou un voleur. Ou un intrus. Ou bien pire encore. Mon imagination décuplait ma terreur, qui n’en demandait pas tant, et qui, en retour, ouvrait généreusement les volets de mes perceptions les plus anxiogènes.
J’ai collé mon œil à la lorgnette.
Vide. Le palier était vide. Tout ça pour rien.
Les pas ont ressuscité au quatrième étage. J’ai sursauté. Ils ont dévalé les marches. J’ai reculé. Je suis tombée en arrière. En quelques secondes, quoi que ce fût, c’était arrivé sur mon seuil. Ça s’est arrêté devant ma porte, ou peut-être ai-je cru que ça s’était arrêté devant ma porte.
C’est redescendu par là où c’était monté.
J’ai attendu, pétrifiée. Ce n’est pas revenu.
J’ai rampé jusqu’à mon lit. Je me suis couchée.
L’aube n’allait plus tarder à pointer à l’horizon lorsque je suis enfin parvenue à trouver le sommeil.
V
Hier, sans surprise, je me suis réveillée dans un état pitoyable. Je manquais évidemment de sommeil, et je me demandais ce que j’avais imaginé, rêvé ou redouté. J’ai essayé de délimiter la frontière entre mes peurs rationnelles et celles dictées par mon imagination foisonnante ou mes angoisses récurrentes, avant de mettre ces vicissitudes sur le coup du stress lié au déménagement.
Mon appartement était le projet d’une vie, j’allais y être heureuse.
Mon appartement était le projet d’une vie, j’allais y être heureuse.
Mon appartement était le projet d’une vie, j’allais y être heureuse.
J’ai répété maintes fois ce mantra en me douchant, en prenant mon café, et en garnissant de viande hachée la gamelle de Mimine, qui demeurait invisible.
Je suis sortie.
De mon appartement, d’abord : les parties communes baignaient à nouveau dans un silence absolu et, sur les demi-niveaux, les vitraux diffusaient leur kaléidoscope de couleurs enchanteresses.
De la maison, ensuite : la matinée était ensoleillée, le boulevard était couvert d’un tapis de feuilles jaunes et de rares voitures passaient à une allure raisonnable. J’ai choisi de me rendre à mon cabinet à pied.
La rue de la Montagne est devenue d’une tristesse consternante. Depuis des années, ruinée et désertée, elle n’arbore que des grillages baissés et des vitrines crasseuses partiellement couvertes d’affiches. Toutes ses boutiques ont été siphonnées par des décennies de crises, de misère contagieuse ou par la proximité de centres commerciaux déshumanisés. On n’y croise plus guère que des passants qui semblent s’y être égarés ou quelques SDF qui errent, bouteille de Despé à la main.
Consciemment ou inconsciemment, j’ai pressé le pas dans ce décor de désolation. Parvenue à la Ville Basse, j’ai traversé le piétonnier de la rue de Dampremy, heureuse de voir que certains commerces y font encore illusion, me suis engouffrée dans le passage Langrand et me suis faufilée jusqu’à la rue de Marchienne, où se trouve mon cabinet.
J’ai entamé mes consultations sans courage ni envie, mais la matinée est passée plutôt rapidement.
J’ai déjeuné d’un sandwich, et j’ai courageusement délesté ma salle d’attente des patients qui s’y entassaient. Quelques syndromes grippaux, des rhumes saisonniers, et une crise de sciatique. Rien de bien passionnant.
J’ai reçu la visite de la petite Charlotte, accompagnée de sa maman. Charlotte, huit ans, a une petite frimousse adorable, mais quelque peu gâchée, en ce moment, par une myriade de boutons qui la défigurent. Elle nous fait une bonne varicelle. J’ai consacré plus de temps que d’ordinaire à cette consultation. J’ai pris le temps de demander à cette enfant charmante si elle aimait l’école, si elle était bien sage, et à quoi elle aimait jouer sur sa tablette, dont elle peinait à détacher son regard innocent.
Quand Charlotte et sa mère sont sorties, je suis restée seule, quelques minutes durant. J’ai réprimé les larmes qui s’efforçaient de percer à l’extrémité de mes yeux. Chaque fois que je vois Charlotte, c’est pareil. Elle me rappelle Anaïs. Et quand je me souviens d’Anaïs, je chavire.
Vie de merde.
Je me suis arrêtée suffisamment tôt, car j’avais une visite à effectuer. Il était dix-sept heures lorsque je suis sortie du cabinet. J’ai regardé autour de moi. Je redoutais de tomber nez à nez avec Crétin, ou d’apercevoir sa voiture. La rue de Marchienne était tranquille. À ma gauche, la façade désolée du Coliseum rêvait de son passé glorieux ainsi que de jours meilleurs. À ma droite, en face, le Bathory, un club sur le déclin, se remettait des soirées du week-end dernier et se préparait à accueillir ses clients à venir.
En rentrant, je suis passée devant le passage de la Bourse, qui semblait hiberner, lui aussi. J’ai néanmoins été le témoin d’une scène étrange.
J’ai entendu des pas. Cela devient une habitude, chez moi. Les pas précipités de quelqu’un qui détalait. Spontanément, j’ai tourné la tête. Et c’est alors que j’ai vu un monsieur d’un certain âge, qui se précipitait vers moi. Plus précisément, ses foulées le portaient dans ma direction, mais sa tête, tournée vers l’arrière, dessinait un angle étrange, comme s’il fixait quelque chose, plus loin, dans les ténèbres du passage. Comme s’il fuyait ce quelque chose.
En une fraction de seconde, j’ai saisi son effroi, j’ai mesuré toute l’énergie qu’il mettait à échapper à son destin. Il a failli manquer une marche qui marquait l’extrémité de la galerie. J’ai alors discerné son visage. Ses traits étaient figés en un pantomime d’une épouvante sans nom, ses yeux exorbités, mais hagards semblaient fous, et ses cheveux avaient été rendus au blanc le plus élémentaire, comme vidés de toute couleur dans l’instant de cette terreur létale.
L’homme a accompli une ultime enjambée, et il s’est effondré.
Mort.
Je me suis approchée. Je me suis penchée. J’ai cherché son pouls. J’ai tenté de le ranimer. J’ai appelé des secours. Mais rien n’y fit.
Mort !
De peur. Sous mes yeux. Je me tenais agenouillée sur sa dépouille délivrée de son tourment, et j’ai réalisé que j’avais été rejointe par quelques riverains curieux de voir, de savoir ou de comprendre. Mon champ de vision portait vers les marches du passage de la Bourse. Je n’ai osé lever le regard, de crainte de voir ce que ce vieil homme avait vu, et d’être à mon tour poursuivie par ce qui l’avait banni de toute vie terrestre.
Les urgentistes n’ont pu que constater le décès, hisser la dépouille sur une civière, et la recouvrir d’un drap. Avant que son visage, pourtant gravé dans mon esprit, ne disparaisse à tout jamais, je l’ai détaillé une dernière fois. Il semblait paralysé, prêt à emporter dans la tombe une épouvante inqualifiable.
J’en ai frissonné.
J’ai emprunté le chemin inverse de celui par lequel j’étais passée le matin. Et je suis revenue à la maison Stassen. Je me suis approchée des interphones. J’ai retrouvé le nom de mes voisins du quatrième, auxquels j’avais deux mots à dire. Les Goldenberg. J’ai appuyé sur la sonnette de Madame Papic. Bien que je fusse désormais sa voisine, je préférais m’annoncer. C’était plus sérieux.
D’une voix faible, elle m’a répondu instantanément, comme si elle attendait impatiemment ma venue :
— Je vous ouvre, Caroline.
Une secousse a électrocuté la porte. Je suis entrée.
À nouveau, j’ai été frappée par l’atmosphère glaciale de l’entrée, puis aspirée par les marches, en direction du vestibule, et j’ai aperçu, derrière sa loge, la silhouette malingre de M. Payen, le concierge. Je l’ai salué, il a hoché la tête. Je n’avais jamais remarqué qu’il était aussi âgé. Il travaillait encore, infatigable, mais néanmoins usé, alors qu’il avait dépassé les septante ans. Ses cheveux étaient toujours noirs, et soigneusement peignés, mais ils dessinaient de rares lignes précaires sur son crâne menu, par-dessus son front que plissaient une myriade d’inquiétudes inconnues.
Deux mètres plus loin, je me suis trouvée comprimée par la déferlante de fers forgés vaniteux et de pierres taillées par des dizaines de petites mains oubliées qui semblaient m’accueillir en leur sein telle une mendiante crasseuse offerte à une cour de notables décadents, personnifiés par les deux austères bourgeois qui me dominaient du haut de leur toile incandescente.
L’ascenseur a émergé des ténèbres du sous-sol. Irène en est sortie. Il portait une robe en lamé. Dorée, moulante, spectaculaire. Fendue jusqu’en haut de ses cuisses musclées et épilées, elle épousait son bassin, qui chaloupait à chacun de ses pas, et compressait sa poitrine féerique.
— Mais ma parole, voici Caroline. Tu es ravissante.
Il n’en était rien. Je me sentais au mieux normale et insignifiante, et au pire, invisible. Mais cela est très agréable à entendre. Je pense qu’il a réussi à me faire rougir.
Irène a tenu la porte et refermé derrière moi les grilles de la cabine. J’ai pressé sur le bouton du deuxième. J’ai traversé la fantasmagorie de la maison Stassen, en tournant sur moi-même dans l’espace exigu qui m’incarcérait. À cet instant, tous les ornements qui me cernaient se sont unis dans le seul but de m’impressionner et m’ont offert trois cent soixante degrés de détails inédits. Le rachis de l’arcade a révélé de nouveaux ossements de marbre à l’anatomie impossible, les balustres ont plié selon des règles bravant les limites de la géométrie euclidienne, les muses des carrelages ont pris d’autres postures, parfois lubriques, et les vitraux ont dessiné sur le bois des escaliers de nouvelles constellations de comètes chatoyantes. J’évoluais en plein songe, il me suffisait de soutenir la vision de la Maison que j’habitais depuis moins de vingt-quatre heures pour douter instantanément de ma raison.