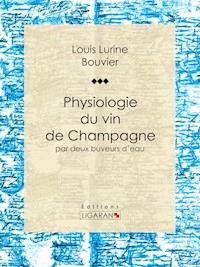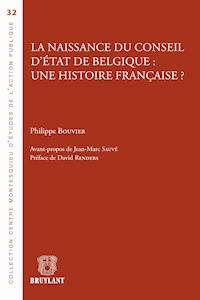
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bruylant
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Centre Montesquieu d'études de l'action publique
- Sprache: Französisch
La genèse du Conseil d’État de Belgique débute en 1832 et s’achève en 1948. Au fil des ans, le Conseil d’État français apparaît comme « repoussoir ou modèle, mais référence constante », selon les termes du professeur Michel Leroy. Sur les pas de nos prédécesseurs, l’on entend illustrer la pertinence du propos. À travers le temps qui va, l’ombre du « système français » ne cesse en effet de planer sur la route, longue et sinueuse, qui conduit au Conseil d’État de Belgique. Faut-il s’en étonner lorsqu’on sait que le comte Duval de Beaulieu, auteur en 1834 d’une proposition de loi visant à créer un Conseil d’État en Belgique, fut lui-même auditeur au Conseil d’État sous le Premier Empire ! Un florilège de citations, souvent savoureuses, s’efforce de rendre l’atmosphère des périodes traversées. Au bout du compte, l’on ne peut s’empêcher d’observer que le Conseil d’État de Belgique aurait parfaitement pu ne pas être. Le voilà à présent devenu largement sexagénaire et détenteur d’un honorable indice de satisfaction. À n’en pas douter, le plus grand nombre s’accordera à reconnaître les inappréciables services qu’il rend dans ses fonctions consultative et contentieuse. Pénétrer dans son histoire, c’est aussi se donner les moyens de réfléchir à son avenir en pleine connaissance de cause.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Groupe De Boeck s.a., 2012
EAN 978-2-8027-3935-7
ISSN 2294-6039
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe De Boeck. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web :www.bruylant.be
Éditions Bruylant Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
COLLECTION CENTRE MONTESQUIEU D’ÉTUDES DE L’ACTION PUBLIQUE
DÉJÀ PARUS
La Cour d’arbitrage. Actualité et perspectives
Avec la collaboration de R. Andersen, Fr. Delpérée, B. Jadot, Y. Lejeune, A. Rasson-Roland, M.-Fr. Rigaux, H. Simonart, Fr. Tulkens et J. van Compernolle, 1988.
La Région de Bruxelles-Capitale
Avec la collaboration de R. Andersen, G. Brouhns, Fr. Delpérée, Fr. Jongen, M.-Fr. Rigaux, H. Simonart et M. Verdussen, 1989.
Les compétences implicites et leur application en droit belge
Geneviève Cerexhe, 1989.
Recueil d’études sur la Cour d’arbitrage : 1980-1990
Francis Delpérée et Anne Rasson-Roland, 1990.
La dérogation en droit public
Françoise Leurquin-De Visscher, 1990.s
Médias et service public
Sous la direction de François Jongen, 1992.
La Constitution fédérale du 5 mai 1993
Avec la collaboration de R. Andersen, G. Craenen, X. Delgrange, Fr. Delpérée, R. Ergec, Fr. Haumont, J. Le Brun, P. Nihoul, Ph. Quertainmont, M.-Fr. Rigaux, K. Rimanque, H. Simonart, J.-Cl. Scholsem, Fr. Tulkens, M. Uyttendaele, P. Van Orshoven et M. Verdussen, 1993.
La Belgique fédérale
Sous la direction de Francis Delpérée, 1994.
Regards croisés sur la Cour d’arbitrage : 10 ans de jurisprudence constitutionnelle
Sous la direction de Francis Delpérée, Anne Rasson-Roland et Marc Verdussen, 1995.
Le Médiateur
Avec la collaboration de R. Andersen, Fr. Delpérée, G. de Kerchove, D. Déom, S. Depré, Fr. Glansdorff, P. Lewalle, D. Nagant de Deuxchaisnes, Th. Stiévenard, M. Uyttendaele, J. van Compernolle et M. Verdussen, 1995.
La responsabilité pénale des ministres fédéraux, communautaires et régionaux
Sous la direction de Francis Delpérée et Marc Verdussen, 1997.
La justice constitutionnelle en Europe centrale
Sous la direction de Marc Verdussen, 1997.
La saisine du juge constitutionnel : aspects de droit comparé
Sous la direction de Francis Delpérée et Pierre Foucher, 1998.
Le nouveau Conseil supérieur de l’audiovisuel
Sous la direction de François Jongen, 1998.
Les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal
Elisabeth Willemart, 1999.
Le Conseil supérieur de la justice
Sous la direction de Marc Verdussen, 1999.
Justice constitutionnelle et subsidiarité
Sous la direction de Francis Delpérée, 2000.
Droit administratif et subsidiarité
Sous la direction de Robert Andersen et Diane Déom, 2000.
L’Europe de la subsidiarité
Sous la direction de Marc Verdussen, 2000.
Les questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage : aspects théoriques et pratiques
Christine Horevoets et Pascal Boucquey, 2011.
Dossier sur l’élection du bourgmestre
Sous la direction de Francis Delpérée et Marc Joassart, 2002.
Quelles réformes pour le Sénat? Propositions de 16 constitutionnalistes
André Alen, Patricia Popelier, Marc Uyttendaele et al., 2002.
Welke hervormingen voor de Senaat? Voorstellen van 16 grondwetsspecialisten
André Alen, Patricia Popelier, Marc Uyttendaele et al., 2002.
Les lois spéciales et ordinaire du 13 juillet 2001 : la réforme de la Saint-Polycarpe
Sous la direction de Francis Delpérée, 2002.
L’unité et la diversité de l’Europe : les droits des minorités. Les exemples belge et hongrois
Sous la direction de Francis Delpérée et László Trócsányi, 2003.
La procédure de révision de la Constitution
Sous la direction de Francis Delpérée, 2003.
La Cour d’arbitrage, vingt après. Analyse des dernières réformes
Sous la direction de Anne Rasson-Roland, David Renders et Marc Verdussen, 2004.
Le sport dopé par l’Etat. Vers un droit public du sport ?
Sous la direction de Sébastien Depré, 2006.
Les sanctions administratives
Sous la direction de Robert Andersen, Diane Déom et David Renders, 2007.
L’accès aux documents administratifs
Sous la direction de David Renders, 2008.
L’arbitrage en droit public
Sous la direction de David Renders, Pierre Delvolvé et Thierry Tanquerel, 2010.
Les subventions
Sous la direction de David Renders, 2011.
L’objectif du Centre Montesquieu d’études de l’action publique de l’Université catholique de Louvain est de procéder à l’analyse de l’action, de l’organisation et du contrôle des pouvoirs publics en Belgique, en Europe et dans le monde.
En vue d’atteindre cet objectif, le Centre groupe tout à la fois des spécialistes des sciences politiques et administratives et des spécialistes des sciences juridiques et contentieuses.
La collection du Centre Montesquieu d’études de l’action publique accueille les publications du Centre, qu’il s’agisse de monographies, d’actes de colloques ou de travaux de recherches doctorales entrepris par ses membres.
Sous la direction de :
David Renders, Professeur à l’Université catholique de Louvain où il enseigne notamment le droit et le contentieux administratifs, avocat au barreau de Bruxelles.
La genèse du Conseil d’État de Belgique débute en 1832 et s’achève en 1948. Au fil des ans, le Conseil d’État français apparaît comme « repoussoir ou modèle, mais référence constante », selon les termes du professeur Michel Leroy. Sur les pas de nos prédécesseurs, l’on entend illustrer la pertinence du propos. À travers le temps qui va, l’ombre du « système français » ne cesse en effet de planer sur la route, longue et sinueuse, qui conduit au Conseil d’État de Belgique. Faut-il s’en étonner lorsqu’on sait que le comteDuval de Beaulieu, auteur en 1834 d’une proposition de loi visant à créer un Conseil d’État en Belgique, fut lui-même auditeur au Conseil d’État sous le Premier Empire ! Un florilège de citations, souvent savoureuses, s’efforce de rendre l’atmosphère des périodes traversées. Au bout du compte, l’on ne peut s’empêcher d’observer que le Conseil d’État de Belgique aurait parfaitement pu ne pas être. Le voilà à présent devenu largement sexagénaire et détenteur d’un honorable indice de satisfaction. À n’en pas douter, le plus grand nombre s’accordera à reconnaître les inappréciables services qu’il rend dans ses fonctions consultative et contentieuse. Pénétrer dans son histoire, c’est aussi se donner les moyens de réfléchir à son avenir en pleine connaissance de cause…
Philippe BOUVIERAuditeur général au Conseil d’État de BelgiqueMaître de conférences invitéà l’Université catholique de Louvain
À mes proches, résolument.
Remerciements
Puisse chacun de ceux qui, peu ou prou, ont participé à cette « aventure », trouver ici l’expression de ma profonde gratitude.
Avant-propos
La naissance du Conseil d’État de Belgique qui est l’objet de l’ouvrage aujourd’hui publié a donné lieu à une conférence remarquée, prononcée le 25 novembre 2011 au Conseil d’État de France dans le cadre du Comité d’histoire du Conseil d’État et de la juridiction administrative. J’avais alors eu grand plaisir à accueillir et écouter mon collègue Philippe Bouvier, Auditeur général au Conseil d’État de Belgique, homme pétri de culture, dont l’érudition historique et la connaissance approfondie des institutions publiques de la Belgique, mais aussi de nombreux pays européens, notamment la France, ont fait l’admiration de ses auditeurs. Il est heureux que soit aujourd’hui publié le texte intégral qui est le fruit des recherches et de la réflexion de M. Bouvier et qui a servi de trame à cette conférence. J’en avais ce jour-là formulé le vœu : il est exaucé.
La lecture de la seule table des matières pourrait laisser penser que l’examen chronologique des différents projets d’établissement d’un Conseil d’État en Belgique, qui a donné lieu à un travail approfondi de l’auteur, constitue un exercice austère, plus inspiré d’une aride exégèse de travaux parlementaires et de débats juridiques qu’empreint du souffle des mutations de l’histoire. Il faut inviter le lecteur à se déprendre de cette impression, à aller plus avant et à se plonger dans les premières pages de l’ouvrage. Une fois qu’il les aura lues, nul doute qu’il continue.
La première chose dont il se rendra compte, c’est que le récit est captivant, le style alerte, les anecdotes légion : M. Bouvier a exhumé des archives les bonnes formules, les mots choisis, souvent fleuris même, qui ont émaillé les débats relatifs à la création du Conseil d’État de Belgique. L’ouvrage se lit d’une traite, comme un roman, alors même que le dénouement de l’histoire nous est connu. Il s’agit là certes d’une remarque de forme, mais elle revêt une grande importance pour soutenir le propos de l’auteur, qui est nécessairement technique. Le lecteur sera ensuite impressionné par la richesse des développements, l’ampleur du travail de recherche réalisé et la profusion des sources qui ont été dépouillées par M. Philippe Bouvier. Il prendra enfin un grand plaisir à suivre les péripéties d’une idée, celle de la création d’un Conseil d’État en Belgique qui, marquée par les souvenirs encore vivaces du Conseil d’État napoléonien, instrument de rationalisation d’un pouvoir autoritaire, fut d’abord rejetée, avant qu’elle ne se concrétise, plus d’un siècle plus tard, pour former l’institution que nous connaissons peu ou prou aujourd’hui. Le travail de l’auteur nous permet de mieux mesurer à quel point l’étude et la compréhension de l’histoire et, notamment, de celle des institutions peuvent nous aider à déchiffrer et construire le présent et à préparer l’avenir.
Le pari de M. Philippe Bouvier était audacieux, raisonné et risqué. Audacieux, car il se proposait de lire l’histoire de la naissance du Conseil d’État de Belgique au travers d’un prisme particulier qui est celui du modèle français. Raisonné, tant la référence française a été constamment présente dans le débat belge. Risqué, car la ligne de crête est étroite qui sépare, d’un côté, la thèse selon laquelle le Conseil d’État français a servi aussi bien de modèle que de repoussoir à la création d’une institution homologue en Belgique et, d’un autre côté, l’altération ou la dénaturation de l’histoire qui ferait du second une copie, un simple décalque du premier. En d’autres termes, l’auteur courait le risque de donner l’impression à son lecteur qu’Alexis de Tocqueville avait raison lorsqu’il professait, dans L’Ancien régime et la Révolution, que « l’histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d’originaux et beaucoup de copies ».
M. Philippe Bouvier a remporté son pari. Il contribue en effet à éclairer l’origine d’une institution à la lumière d’une autre, dont il montre le caractère à la fois attractif et encombrant. On croise ainsi en cours de lecture à la fois de grandes pages de la littérature juridique française, telles que celles écrites par Léon Duguit ou Gaston Jèze, et les critiques les plus acerbes adressées au Conseil d’État napoléonien et à ses réincarnations successives au cours du XIXe et du XXe siècle, qui en ont fait une institution apparemment conforme, mais en réalité profondément infidèle à ses origines, n’eût été la constance de son attachement à l’intérêt général. La thèse d’un Conseil d’État français à la fois modèle et repoussoir en sort renforcée.
Les influences, sur une période aussi longue et un sujet aussi sensible, sont toutefois nécessairement multiples et ne résident pas uniquement dans l’exemple français qui, s’il a certes joué un rôle important, n’a pas été exclusif. En outre, dans la famille commune des juridictions administratives suprêmes, chacune d’entre elles présente des singularités, chacune connaît une histoire propre qui interdit de penser qu’une institution pourrait n’être que la reproduction d’un modèle existant. En d’autres termes, il n’y a en la matière que des idiosyncrasies nationales. L’idéal type de la juridiction administrative suprême, si tant est qu’il existe, est nécessairement tributaire de circonstances et de particularités nationales et il est modelé par le génie propre de chaque peuple. Les travaux de M. Philippe Bouvier vont nettement dans ce sens. Ce n’est pas le moindre des mérites de l’auteur que de faire ressortir cette idée de manière très fine, par un jeu de miroirs. Le Parlement de Belgique et, en particulier, le Sénat sous l’influence de Louis Wodon ont ainsi été en mesure, après de multiples tentatives, retours en arrière et contradictions, de dépasser l’antagonisme entre des écoles de pensée juridique et des courants politiques opposés pour forger une institution répondant, au-delà des mérites et des vices prêtés au modèle français, aux besoins de la Belgique en matière de conseil législatif et de contrôle juridictionnel de l’administration. En refermant ce livre, on ne peut s’empêcher de penser, à la suite de l’auteur, que bien plus qu’une histoire française, la naissance du Conseil d’État de Belgique est, au sens propre du terme, une histoire belge. Au-delà de la prégnance des modèles extérieurs, c’est bien chaque État, chaque Nation qui construit sa propre histoire.
Jean-Marc SAUVÉ
Vice-président du Conseil d’État de France
Préface
1. S’il est un mot pour résumer l’histoire du Conseil d’État de Belgique, c’est bien celui de contretemps.
En 1831, la Belgique, qui vient d’acquérir son indépendance sur le Royaume des Pays-bas, se dote d’une Constitution qui, en termes de contrôle juridictionnel, n’a d’yeux que pour les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.
Ce sont les cours et tribunaux qui héritent, en exclusivité, de la résolution des litiges portant sur un droit subjectif de caractère civil. Eux également qui se voient confier, sauf exception, le traitement des différends mettant en cause un droit subjectif de caractère politique. Eux encore qui, pour vider les causes qui leur sont déférées, se voient reconnaître l’important pouvoir d’écarter l’application des règlements et arrêtés généraux, provinciaux et locaux contraires à la loi.
En ces temps d’indépendance, le contentieux administratif est comme happé dans le tourbillon du contentieux de droit commun dont il ne se distingue guère. L’architecture ainsi conçue n’est pas difficile à expliquer. La jeune Belgique entend tourner le dos à l’histoire, celle de France, puis des Pays-Bas. Le Conseil d’État, qui en fait partie, est à inscrire au passé.
2. À peine le jeune État s’est-il envolé vers son destin que des voix s’élèvent. Elles entendent dénoncer une carence dans l’élaboration de l’œuvre normative dont ne saurait se passer la nouvelle puissance étatique. En jetant le Conseil d’État aux oubliettes de l’histoire, la Belgique a omis de s’adjoindre les services d’un corps capable d’éclairer les institutions chargées des fonctions de légiférer et de réglementer. N’est-il pas imprudent de se passer de conseils avisés dans la construction de l’ordre juridique qui doit, peu à peu, élever la Belgique ?
Dès 1832, il en est pour crier gare ! Trop peu, cependant, pour revenir en arrière. La liberté – celle qui souffle en ces temps d’indépendance – rechigne – le mot est faible – à s’entourer de conseils dont elle craint les freins, davantage qu’elle n’aperçoit le mur.
À coups de boutoir, la Belgique finira – quatre-vingt ans plus tard – par s’adjoindre les services d’un Conseil de législation, près le Ministère de la Justice. L’œuvre n’est pas parfaite, mais se révèle indispensable : une première prémisse vient de paraître.
3. Si, à l’indépendance, le Constituant avait volontairement omis de consacrer l’existence d’un Conseil d’État, l’intention de ses artisans n’était pas, tant s’en faut, d’abandonner le Pays à l’arbitraire de la puissance publique. Au contraire, le Conseil d’État apparaissait précisément comme l’une des figures de ce à quoi les Pères de la Nation nouvelle entendaient s’arracher.
Las, les cours et tribunaux étaient de leur temps…Ils peinaient à comprendre que leur office comprenait la mission de condamner l’État, puissance publique, à réparer le dommage causé du fait de la faute commise par l’un de ses organes. Tout au plus consentaient-ils à condamner l’État à indemniser la victime d’un dommage commis, par sa faute, dans les relations de droit privé.
D’injustice en injustice, des hommes d’État et de science allaient progressivement s’indigner d’un tel état du droit, dans le jeune État de droit. L’idée d’une cour de contentieux administratif devait naître et faire son chemin… jusqu’à ce que le boulet rouge qu’elle constituait pour les cours et tribunaux – alors seuls détenteurs du pouvoir juridictionnel et, à ce titre, menacés par l’idée en germe – soit arrêté par une volée de bois vert…
À Bruges, un arbre sis sur le domaine public de la ville se couche, sans prévenir, sur les installations d’une société horticole, causant à celle-ci quelque dégât. Saisie au gré des circonstances, la Cour de cassation profite de l’occasion pour opérer un revirement de jurisprudence aussi spectaculaire qu’hostile à la création d’une juridiction administrative qui – quatre-vingt-dix ans après l’indépendance – en vient à compter un nombre inquiétant de partisans.
Sans doute, la Cour de cassation réussit, par l’arrêt qu’elle rend, à ne pas se rendre. Mais la conscience collective n’en est plus là : le pouvoir d’annuler l’acte administratif unilatéral contraire à la loi doit désormais être consacré.
4. Au bénéfice de la seconde prémisse qui se dessine ainsi, l’heure de naissance du Conseil d’État de Belgique n’est pourtant pas encore près de sonner.
L’on est à se demander si les fonctions de conseil en législation et de juge en administration doivent être attribuées à une même institution. Si cette institution doit s’appeler « Conseil d’État ». Si un pouvoir, d’avis ou de juridiction, doit lui être reconnu en vue d’allouer, s’il échet, une indemnité. Si la Cour de cassation, à laquelle d’aucuns songent pour exercer le pouvoir d’annulation des actes administratifs unilatéraux, doit être – au cas où ce pouvoir lui échapperait – l’arbitre des conflits d’attribution entre l’ordre judiciaire, dont elle est la tête, et l’ordre administratif, dont elle ne veut voir la tête.
La solution, teintée de pragmatisme politique – notamment envers la Cour de cassation –, met quelque vingt-six années à émerger. Au final, il y aura un Conseil d’État de Belgique qui officiera en qualité de conseil et de juge. En revanche, la nouvelle institution devra se contenter d’un pouvoir d’avis en termes indemnitaires et sera placée sous le contrôle de la Cour de cassation en termes de conflits d’attribution.
5. En relatant l’histoire qui a conduit à la naissance du Conseil d’État de Belgique, Philippe Bouvier entre assurément dans l’histoire de la doctrine du droit administratif belge. Prenant appui sur une documentation imposante, il est le premier à opérer une mise en perspective des idées et des faits qui, depuis l’origine de l’État belge, vont conduire à la naissance de l’institution. Au bénéfice d’une recherche méticuleuse, le lecteur est plongé, en un peu plus de cent pages, dans les méandres de la vie à la fois politique et juridictionnelle d’un Pays, plus d’un siècle durant.
Littéralement passionné, l’auteur, dans un style clair et choisi, communique à merveille son état d’esprit et de cœur. Il se délecte des grandes et des petites phrases qu’il a glanées au fur et à mesure de ses découvertes à Bruxelles, mais aussi – pour son plus grand bonheur – à Paris.
Le propos est conçu telle une pièce de théâtre à rebondissements. L’intrigue est captivante, les mots ciselés, les chassés-croisés nombreux, les personnalités – pour ne pas écrire les personnages – étonnants dans la trajectoire qu’ils épousent et dont, parfois, ils divorcent.
À travers des mots qui font revivre le passé et cerner le présent, Philippe Bouvier cherche ainsi à comprendre une institution qu’il sert, sans compter, depuis vingt-cinq ans, et qu’il contribue à diriger, avec un brio salué de tous, en qualité d’Auditeur général adjoint, puis d’Auditeur général, depuis dix ans déjà.
6. Devenu, en 2009, maître de conférences invité à l’Université catholique de Louvain, pour le plus grand bonheur de ses étudiants et de l’Université dont il est par ailleurs diplômé, Philippe Bouvier révèle, par ce qu’il rapporte, à quel point le Conseil d’État de Belgique est à contretemps de l’histoire.
Entre 1831 et 1912, l’on croit pouvoir se passer du Conseil d’État : l’institution n’existe pas, alors qu’elle devrait naître. Entre 1912 et 1946, l’on trouve à pouvoir se passer du Conseil d’État : c’est le moment choisi pour faire éclore l’institution. Entre 1946 et 1993, le Conseil d’État accomplit son œuvre sans embûche, bien qu’il ne soit reconnu que par la loi. Depuis 1993, la Constitution reconnaît l’existence du Conseil d’État, mais, à compter de cette époque, la défédéralisation progressive du Royaume conduit ses composantes – en particulier au Nord du Pays –, sinon à envisager la suppression de l’institution, tout au moins à en siphonner les compétences à coup de recours aux pouvoirs implicites.
Un État sans Conseil, puis un Conseil sans État ? Le trait est sans nul doute exagéré, mais le jeu de bascule non moins saisissant.
7. Dans la dernière partie de l’ouvrage, Philippe Bouvier, qui rappelle les différentes évolutions qu’a connues le Conseil d’État depuis sa création, tâche de saisir l’avenir qui, l’histoire ne cessant de se répéter, repasse les questions qui se posaient aux acteurs de la vie politique, juridictionnelle et universitaire de l’avant 1946.
8. L’une de ces questions touche à l’articulation des pouvoirs juridictionnels reconnus aux cours et tribunaux, d’une part, au Conseil d’État, de l’autre.
L’on sait ce qui a permis de donner cohérence à la coexistence de deux ordres de juges chargés du contrôle de la régularité de l’action administrative unilatérale : la théorie de l’objet véritable et direct du recours.
Cette théorie est artificielle, dès lors qu’en tout litige mettant aux prises une telle action, l’on peut vouloir combattre l’existence même de celle-ci ou solliciter la protection juridictionnelle du droit subjectif qu’elle met en cause.
Pour autant, la coexistence de deux ordres juridictionnels capables d’assurer différemment la protection des droits ou intérêts du citoyen n’est pas à négliger. Il suffit de penser à ces situations qui, sans requérir la mise à néant de la décision administrative, n’en exigent pas moins la réparation du dommage occasionné par elle. Il s’impose, au-delà, de rappeler que la démocratie se meurt sans contre-pouvoirs et que la coexistence de deux ordres chargés d’appréhender, sous des angles complémentaires, des mêmes situations, est un bienfait pour la société qui a la force d’instituer un tel dispositif.
9. Philippe Bouvier livre une autre question récurrente : celle de savoir s’il faut maintenir, dans les mains de la Cour de cassation, le pouvoir de trancher les conflits d’attribution.
Il n’est pas besoin d’exposer le conflit d’intérêt dans lequel la Constitution a placé la juridiction judiciaire suprême, en lui attribuant une telle charge. La circonstance qu’elle soit à la fois juge et partie s’explique, à défaut de se justifier, par l’histoire que conte le présent ouvrage : il s’agit là, ni plus ni moins, que d’un compromis.
Le temps a passé. N’est-il pas, aujourd’hui, utile de reconsidérer les choses ? Au bout de soixante-dix années d’existence, le Conseil d’État a su montrer que sa mission n’oblitérait en rien le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires sur l’administration. N’est-il pas temps, dans ces conditions, de désigner un nouvel arbitre des conflits d’attribution ?
Au détour d’une contribution livrée dans le cadre du Liber amicorum offert à notre estimé confrère Michel Mahieu, l’on plaidait, il y a quatre ans, avec Jean-François van Drooghenbroeck, pour la mise sur pied d’un organe réunissant les deux présidents de la Cour constitutionnelle, les premier président et président de la Cour de cassation et les premier président et président du Conseil d’État. L’organe ainsi créé pourrait à la fois être le dépositaire de toutes les sensibilités et convenir de solutions durables, car équilibrées.
10. Une autre question encore ne saurait être tue : celle de savoir dans quelle mesure le Conseil d’État devrait pouvoir allouer une indemnité à celui qui la lui demande.
L’on sait que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 juin 1971, le pouvoir d’avis reconnu au Conseil d’État en termes indemnitaires pour cause de dommage exceptionnel, s’est mué en un pouvoir de décision.
À l’origine, l’on a admis que la juridiction administrative pouvait se voir confier une telle mission, par cela qu’il s’agissait de mettre fin à une rupture d’égalité entre citoyens devant les charges publiques, donc d’un droit politique dont la Constitution permet de confier la protection à une juridiction extrajudiciaire.
L’heure est à se demander si le Conseil d’État ne pourrait pas aller un pont plus loin et allouer des dommages et intérêts au requérant à qui il vient de donner gain de cause, par l’annulation de l’acte administratif unilatéral qu’il achève de prononcer.
L’on sait que la déclaration de révision de la Constitution, adoptée en 2010, ouvre la voie à cette éventuelle réforme qui, selon nous, aurait un immense mérite : celui d’une économie de procédure pour le justiciable. En termes d’organisation devant le Conseil d’État, cependant, la mise en œuvre d’une telle réforme devra être mûrement réfléchie, car elle n’est pas sans entraîner des conséquences pour les parties, l’Auditorat et le Conseil, dans l’instruction des dossiers.
11. Une ultime question vient à être mise sur la table par l’auteur, qui touche à la problématique de la réfection de l’acte jugé irrégulier par le Conseil d’État. Devrait-on, comme aux Pays-Bas, permettre à l’autorité, avant annulation, de corriger l’irrégularité que le Conseil d’État sanctionnera, si l’administration ne fait rien de l’avertissement qui lui est ainsi lancé ?
Il y a, nous semble-t-il, dans la théorie du retrait d’acte, tout ce que la « boucle administrative » néerlandaise présente d’avantages. Une critique doit cependant être formulée à l’encontre de ce mécanisme, que la théorie du retrait n’a pas à essuyer ; toute irrégularité, même de forme, touche au fond de la décision ; l’auteur d’un acte n’est pas l’autre ; une formalité est faite pour éclairer l’auteur ; seule une motivation formelle adéquate peut valablement conduire au dispositif d’une décision, etc.
En permettant à l’administration de corriger, au dernier moment, une irrégularité tenant à la légalité externe de l’acte, l’on fait fi de l’interaction qui existe entre la forme d’une décision et le fond de celle-ci, qui fait de la compétence de l’auteur de l’acte, des formes et des formalités, non du formalisme, mais une composante essentielle du fondement de l’action administrative.
12. S’il est un mot pour résumer l’histoire du Conseil d’État de Belgique, c’est bien celui de contretemps. S’il est un mot pour résumer l’intérêt de l’ouvrage que l’on tient dans les mains, c’est qu’il arrive à temps : le temps d’un rendez-vous. Un rendez-vous que l’État et son Conseil doivent se donner. Un rendez-vous que l’État et son Conseil ne peuvent plus manquer.
David RENDERSrofesseur à l’Université catholique de LouvainAvocat au barreau de Bruxelles
Liste des abréviations
Sommaire
Remerciements
Avant-propos
Préface
Liste des abréviations
Introduction
Première partie. La période « parlementaire » : 1832- 1857
Chapitre 1er. La proposition De Gorge Le Grand
Chapitre 2. L’initiative de Charles Rogier
Chapitre 3. La proposition Duval de Beaulieu
Chapitre 4. Charles Rogier, le retour
Chapitre 5. La proposition d’Anethan
Deuxième partie. La période « doctrinale » : 1858- 1914
Chapitre 1er. Le Conseil d’État législatif
Chapitre 2. L’émergence d’une cour de contentieux administratif
Troisième partie. L’épisode de la révision constitutionnelle : 1919- 1921
Chapitre 1er. La déclaration de révision constitutionnelle
Chapitre 2. Deux événements majeurs
Chapitre 3. Les travaux du Constituant
Quatrième partie. La dernière ligne droite : 1928- 1948
Chapitre 1er. La montée en puissance d’Henri Velge
Chapitre 2. Les propositions Carton de Wiart
Chapitre 3. Le projet van Zeeland
Chapitre 4. Les derniers pas
Cinquième partie. Le Conseil d’État conjugué au passé, au présent et au futur
Chapitre 1er. De 1948 à nos jours
Chapitre 2. Perspectives
En guise de conclusion
Table onomastique
Table des matières
J’ay seulement faict icy un amas de fleurs estrangeres, n’y ayant fourny du mien, que le filet à les lier.
Introduction
1. En sa séance du 5 mai 1834, le jeune Sénat de Belgique adopte le projet de loi relatif à la création d’un Conseil d’État. Transmis à la Chambre des représentants, ce projet restera toutefois sans lendemain. Il faudra d’ailleurs encore attendre plus de 112 ans pour qu’un Conseil d’État puisse voir le jour en Belgique : ce fut effectivement chose faite par la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’État. Et son installation solennelle prendra place le 9 octobre 1948. C’est dire si la période de gestation fut de longue durée.
En 1834, les débats se sont déroulés en séance publique du Sénat entre le 23 avril et le 5 mai, sous la présidence du baron Goswin de Stassart. La proposition de loi pour la création d’un Conseil d’État avait été déposée par le comte Dieudonné Duval de Beaulieu et l’un des plus farouches opposants à celle-ci fut le comte François de Robiano. Qu’ont donc en commun ces trois sénateurs ?
Goswin de Stassart et Dieudonné Duval de Beaulieu furent auditeurs au Conseil d’État sous le Premier Empire. Le comte Louis de Robiano, frère de François, connut le même état. D’autres jeunes gens issus de l’aristocratie belge en furent également, certains à leur demande, d’autres d’office1. À la vérité, le Conseil d’État napoléonien aura d’ailleurs « hébergé » pas moins de 29 Belges, ainsi que 4 Hollandais, 7 Allemands et 22 Italiens2.
Nommé auditeur en 1804, Goswin de Stassart fut même promu au grade de maître des requêtes pendant la période des Cent-Jours. Il partagea d’ailleurs cet honneur avec un autre Belge, le comte Philippe de Visscher de Celles, à ceci près que ce dernier, entré au Conseil d’État en qualité d’auditeur en 1806, devint maître des requêtes au bout de quelques mois à peine. Il se trouve que les deux hommes ne s’appréciaient guère3. Tous deux furent également préfets sous l’Empire, puis membres du Congrès national lors de l’indépendance de la Belgique ; leurs chemins se séparèrent par la suite4.
Dieudonné Duval de Beaulieu fut également auditeur dès 1806. Promu ultérieurement auditeur de première classe, il a eu l’occasion d’assister aux séances du Conseil présidées par Napoléon5. Quant à Louis de Robiano, auditeur de 1811 à 1814 et affecté à l’administration de la Loterie, il ne paraît pas avoir marqué d’une grande empreinte son passage au Conseil d’État napoléonien6.
Chose étrange, les travaux parlementaires de 1834 ne laissent apparaître aucune trace du glorieux passé des sénateurs Stassart et Duval de Beaulieu, ni d’ailleurs des autres jeunes aristocrates belges qui ont servi le Conseil d’État à l’époque napoléonienne. Les convenances parlementaires y auraient-elles fait obstacle ? Était-il désobligeant, voire malhabile, de se prévaloir de son parcours avant l’indépendance ? L’on ne sait. Ce n’est pas à dire que les allusions demeurèrent totalement absentes ; elles ne furent toutefois faites qu’à fleurets mouchetés et provinrent surtout des opposants au texte examiné.
Ainsi le sénateur Jean-Baptiste Thorn a-t-il entendu faire valoir sa crainte que « la gloire dont, du temps de l’empire, nous avons vu briller une institution du même nom, ne soit pour beaucoup entrée dans les calculs des honorables membres et ait fortement contribué à faire naître leur illusion »7. De même, souligne le sénateur comte Jean-Baptiste d’