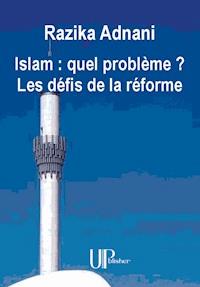Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
2e édition octobre 2017
Réflexion sur le fléau de la violence
La nécessaire réconciliation est une réflexion sur le fléau de la
violence. À l'heure où la violence touche toutes les sociétés, cet ouvrage présente une autre analyse des causes qui permettent à la violence de se généraliser, à travers un nouveau concept celui de « la moralisation de la violence ».
Razika Adnani prend l'Algérie comme exemple pour construire sa pensée. Elle aborde la question de la légitimité de la guerre de libération et réexamine le principe de « la violence justifiée ». La question capitale est de savoir comment faire pour que la justification de la violence ne puisse jamais entraîner sa moralisation.
Mais la guerre suffit-elle, à elle seule, à expliquer le phénomène de la violence ? Razika Adnani croise causes historiques et sociologiques. Elle met en avant le rôle fondamental de l'éducation et pose la question de la modernité confrontée à la tradition, avec des exemples concrets tels que la justification du « voile » ou la pratique de « l'œil indiscret ». Enfin elle voit l'expression d'une souffrance, elle-même source de violence, dans le poids d'une histoire non assumée. Ainsi, elle nous entraîne au cœur des habitudes comportementales pour nous aider à comprendre comment certaines d'entre elles peuvent devenir le terreau de la violence. L'Algérie partage une culture et une vision de l'avenir avec les autres pays du Maghreb et les pays arabes et arabophones. Voilà qui permet de saisir des aspects importants du phénomène de violence sociale non seulement en Algérie mais aussi dans l'ensemble de ces pays.
Razika Adnani construit sa réflexion dans la perspective de savoir si une meilleure relation avec l'autre et un meilleur partage de l'espace sont possibles. Elle s'interroge sur la relation qui existe entre l'image que nous avons de nous-mêmes et la violence faite à autrui.
Cet ouvrage est un outil indispensable de lecture du monde et un formidable message d’espoir.
EXTRAIT
En ce matin du mois de mai 2012, la lumière si particulière d'Alger envahissait ma cuisine. Je prenais mon thé face à la fenêtre. J'étais heureuse de retrouver ma ville. Le journal posé sur la table à côté de moi, j'en survolais rapidement les titres quand l'un d'eux attira mon attention : « Il ne faut pas délégitimer la guerre d'Algérie ». Par cette phrase, « il ne faut pas », le titre se présentait sous la forme d'une injonction ou d'une leçon de morale que la journaliste attribuait à l'une des figures de la guerre de libération. Les leçons de morale attirent toujours mon attention, car elles instillent toujours un doute. Quand on dit à quelqu'un : « il ne faut pas voler », c'est soit parce qu'il vole déjà et qu'on veut le persuader d'arrêter, soit parce que, simplement, on craint qu'il ne le fasse. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de le dire à une personne intègre. Quelques questions me vinrent à l'esprit. Pourquoi cette injonction alors que l'Algérie s'apprêtait à fêter le cinquantième anniversaire de son indépendance ? Sous-entendait-on la possible existence d'une opinion qui délégitimerait la guerre de libération ? Qui pouvait en être l'auteur ? J'ai soudain ressenti un besoin fort et irrésistible de m'exprimer, d'écrire comme si, d'un seul coup, j'avais beaucoup de choses à dire.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Essai brillant. Bravo pour cette analyse claire, documentée et sans concession. Razika Adnani est une essayiste et une analyste du monde arabe à suivre sans aucun doute! -
client, Amazon
Je recommande la lecture de ce livre qui analyse de façon originale le phénomène du développement de la violence dans la société en s'appuyant sur l'expérience de l'Algérie et qui aborde finement la plupart des questions de société actuelles -
JOLY, Amazon
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Razika Adnani La nécessaire réconciliation
2e édition
« Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personnede tout autre, toujours en même temps commeune fin et jamais simplement comme un moyen »
Emmanuel Kant (1724-1804)
Première partie DE LA MORALISATION
Une leçon de morale
En ce matin du mois de mai 2012, la lumière si particulière d’Alger envahissait ma cuisine. Je prenais mon thé face à la fenêtre. J’étais heureuse de retrouver ma ville. Le journal posé sur la table à côté de moi, j’en survolais rapidement les titres quand l’un d’eux attira mon attention : « Il ne faut pas délégitimer la guerre d’Algérie ». Par cette phrase, « il ne faut pas », le titre se présentait sous la forme d’une injonction ou d’une leçon de morale que la journaliste attribuait à l’une des figures de la guerre de libération. Les leçons de morale attirent toujours mon attention, car elles instillent toujours un doute.
Quand on dit à quelqu’un : « il ne faut pas voler », c’est soit parce qu’il vole déjà et qu’on veut le persuader d’arrêter, soit parce que, simplement, on craint qu’il ne le fasse. Il ne nous viendrait pas à l’esprit de le dire à une personne intègre. Quelques questions me vinrent à l’esprit. Pourquoi cette injonction alors que l’Algérie s’apprêtait à fêter le cinquantième anniversaire de son indépendance ? Sous-entendait-on la possible existence d’une opinion qui délégitimerait la guerre de libération ? Qui pouvait en être l’auteur ? J’ai soudain ressenti un besoin fort et irrésistible de m’exprimer, d’écrire comme si, d’un seul coup, j’avais beaucoup de choses à dire.
Il m’est difficile, étant donné la conjoncture, de savoir à qui ce discours s’adressait réellement. Ces paroles lancées comme une leçon de morale ont été prononcées lors d’une conférence qui s’est déroulée en Algérie face à un public algérien, par définition le plus concerné par cette guerre. Je ne peux pas non plus exclure la possibilité qu’elle s’adressait aux Français, si je prends en considération le contexte dans lequel cette injonction a été formulée : cette conférence faisait suite à un séminaire sur « l’Algérie 50 ans après » qui s’était déroulé à Marseille en 2012. De ce fait, je n’ai pu exclure aucune des deux possibilités.
Adresser une telle injonction aux Algériens revient à les sous-estimer, notamment les jeunes générations, et à mettre en doute leur capacité à comprendre la légitimité du combat de leurs aînés. Certes, depuis le 5 juillet 1962 le temps a passé, mais cela ne justifie pas un tel doute. Les Algériens aujourd’hui encore, et plus que jamais, sont convaincus de la légitimité de la guerre de libération de leur pays, car ils sont persuadés que tout être humain, homme ou femme, a le droit de se soustraire à l’infériorité dans laquelle on veut le contraindre au nom d’une philosophie et d’un pouvoir qui font de certaines personnes des êtres supérieurs et d’autres des êtres inférieurs ; le droit à la liberté, à la dignité et à la justice est intrinsèque à la personne humaine ; toute spoliation de ce droit donne à la personne ou au peuple concerné le droit de le réclamer. Aujourd’hui encore, plus qu’hier, ils sont conscients que refuser le mépris et l’humiliation est tout simplement un droit indiscutable ; de ce fait, la guerre que leurs grands-parents ou leurs parents ont menée est pour eux l’expression de ce refus et ne pouvait être que légitime. Ils sont persuadés que, grâce à elle, ils ont gagné le droit d’être des citoyens dignes et celui de connaître enfin le goût d’une liberté et d’un honneur longtemps confisqués.
La guerre de libération nationale était une guerre contre un colonialisme accapareur de terres, déniant de surcroît leur humanité aux habitants. Si même il n’y avait qu’une seule possibilité que la guerre d’Algérie ait été illégitime, cela laisserait entendre que le colonialisme aurait été légitime. Or légitimer le colonialisme, c’est retourner à l’âge de la barbarie, de l’esclavage, de l’injustice et de l’horreur humaine. C’est aussi faire triompher la déraison sur la raison. Défendre le colonialisme, c’est renoncer à l’humanité au profit de l’animalité qui est en nous ; c’est abandonner la modernité.
Certes, il y a une autre manière de réclamer ses droits : la revendication pacifique, et nul ne doute que ce soit la manière la plus « civilisée » de le faire. Cependant, les massacres de mai 1945 ont prouvé que le colonialisme n’entendait pas ce discours : le peuple algérien l’a compris. L’être humain, quand il est aveuglé par la préservation de ses intérêts personnels, ne comprend pas le langage de la raison. Même la Charte des Nations Unies et « la Déclaration des droits de l’homme », « la conscience universelle » selon l’expression de Malek Bennabi, étaient sourdes aux cris des peuples colonisés. Il écrit : « la bonne conscience universelle sagement muette, quand il le faut, ne trouve rien à dire à propos de certaines “affaires intérieures” bien qu’elle se mêle de certaines autres. Un pays colonisé, c’est donc une “affaire intérieure” c’est un postulat. Tout le reste en découle »[1].
Ainsi, soumis contre leur gré à cet état d’infériorité et ne pouvant le tolérer, les Algériens n’avaient d’autres moyens que de faire la guerre pour s’y soustraire. Elle est alors devenue une solution incontournable.
C’est cette histoire qui fait que les Algériens sont convaincus de la légitimité de la guerre de libération de leur pays. S’il y a une seule question qu’ils n’auront jamais à se poser, c’est sa légitimité. C’est elle qui leur a permis, après des siècles d’occupation turque puis française, d’être enfin souverains sur leur terre et ils en sont fiers.
Aujourd’hui, je me rappelle encore la fierté de mes parents et de mes enseignants, quand, alors que nous étions enfants, ils nous racontaient la guerre, notre Guerre, et comment ils avaient arraché leur pays aux mains des colons. Je me rappelle les chants nationalistes algériens : Min Djibalina, ya chahid el watan…[2] et la vive émotion qu’ils suscitaient. Nous sommes la génération de l’indépendance[3]. Nous n’avons connu ni la période coloniale ni la guerre, mais nous portons en nous les souffrances de la première et la fierté de la seconde. Nous adresser une telle injonction est donc dénué de sens.
Nous ne pouvons pas non plus adresser cette injonction à tous les Français, car cela reviendrait à nier le soutien apporté à la guerre de libération par tous ceux qui, imprégnés des principes de la révolution française de 1789 et « des droits de l’homme », se sont dressés contre le colonialisme. Rappelons que certains l’ont payé de leur vie. De même, cela nierait l’action de tous les intellectuels, penseurs, philosophes et historiens dont les travaux apportent, aujourd’hui comme hier, plus de lumière et de vérité sur l’inhumanité du colonialisme et ses pratiques injustes. Pouvons-nous oublier Maurice Audin, jeune mathématicien étranglé sur une table de torture, Germaine Tillion et son combat pour alléger la souffrance des Algériens détenus et les nombreux avocats qui se sont engagés aux côtés des Algériens pour les défendre alors que la guerre faisait rage ? Devons-nous rappeler la « Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie », dite « Manifeste des 121 », publiée le 6 septembre 1960 ? Dans ce texte, les signataires déclaraient que « la cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres ». Dans son livre Guerre d’Algérie, droit et non droit, Arlette Heymann-Doat dénonce le Droit en Algérie, rédigé au seul profit du colonisateur et au détriment du colonisé. Il « a été conçu pour le contraire de ce que son image peut représenter : il a été porteur d’injustice, de barbarie et d’impunité. Il a fait des colons des citoyens et des indigènes des sujets »[4], écrit-elle.
Il y a certainement encore des nostalgiques de l’Algérie française. Cependant, peuvent-ils nier que la guerre des Algériens avait pour cause l’indignation d’un peuple tout entier ? À la base, ne retrouve-t-on pas les mêmes motifs qui animaient la résistance française ? Ces nostalgiques ne peuvent que reconnaître la légitimité d’une guerre dont la cause était la liberté et la fin du colonialisme. Ils ont, certes, poussé des parlementaires français à voter une loi reconnaissant son bien-fondé[5], mais ce texte a été très vite retiré, car au fond personne ne peut le justifier : par principe, nul n’a le droit d’occuper la terre d’un autre. Une chose importante reste à préciser : l’expression « guerre d’Algérie » n’a pas le même sens selon que l’on se place du côté algérien ou du côté français. Du côté algérien, la guerre d’Algérie est une guerre menée contre la France dans le but de libérer le pays du joug des colons : c’est une guerre de libération nationale.
Du côté français, c’est une guerre menée contre des insurgés algériens pour sauver sa colonie et protéger les Français d’Algérie. Supposer que cette phrase : « il ne faut pas délégitimer la guerre d’Algérie » s’adresserait aux Français, reviendrait à leur dire que la guerre qu’ils ont menée contre les Algériens était juste. Venant d’une des figures de la guerre, ce discours serait absurde non seulement pour les Algériens, mais aussi pour tous les Français qui dénoncent le colonialisme sous tous ses aspects. Une telle leçon de morale ne peut donc logiquement s’adresser qu’aux Algériens.
Si en réalité personne ne doute de la légitimité de la guerre de libération, pourquoi alors cette leçon de morale alors que l’Algérie fête le 50e anniversaire de son indépendance ? Que se cache-t-il derrière ce discours ? Comment expliquer que ce qui n’était pas même imaginable les premières années de l’indépendance nous leur soit brutalement infligé aujourd’hui par une des figures de cette guerre ?
Certes, les premières années de l’Algérie indépendante ne furent pas faciles. Tout était à construire, mais nos parents avaient de grands espoirs : ils étaient sûrs que leur avenir, tout comme celui de leurs enfants, ne pouvait être que meilleur. Ils avaient l’espoir que l’Algérie, pour laquelle ils s’étaient battus, n’allait pas les décevoir. Leurs espérances faisaient la grandeur de leur guerre.
Quelques années plus tard, les difficultés ont commencé à surgir ; les objectifs sont devenus de plus en plus incertains et les espoirs de moins en moins certains. Cependant, ni nos parents ni nous-mêmes n’avons cessé de rêver à des jours meilleurs pour notre pays. Nous aimons l’Algérie, et quand on aime, malgré la déception, ne s’accroche-t-on pas à tout ce qui peut être signe qu’on s’est trompé sur l’autre ? Combien de fois, aujourd’hui encore, une rue propre, une terre cultivée, une exposition artistique ou une rencontre littéraire ne suffisent-elles pas à nous faire dire : « il y a des choses positives qui se passent dans notre pays » et soudain gonfler nos cœurs de bonheur ? Quand on aime, on reste persuadé que le bien peut exister. Même quand le désordre s’installe peu à peu, nous voulons croire que le meilleur est à venir. Les Algériens sont toujours fiers de cette guerre qui leur a permis de rêver.
Aujourd’hui, l’Algérie fête son demi-siècle d’indépendance. Pour le peuple algérien, ces cinquante années sont cinquante années d’une longue attente. Les enfants nés au lendemain de l’indépendance sont aujourd’hui des hommes et des femmes qui ont déjà une grande partie de leur vie derrière eux. Or l’attente a peu à peu estompé les espoirs puis les rêves des jeunes et de leurs parents. Les soulèvements sporadiques dans le pays montrent le niveau très élevé du malaise. Les jeunes cherchent par tous les moyens à partir, en quête d’une autre terre qui puisse les adopter. Nous sommes devenus un peuple mendigotant ailleurs une citoyenneté comme si la nôtre, pour laquelle nous nous sommes battus, ne répondait plus à nos attentes et ne nous satisfaisait plus. Pendant la guerre, nous rêvions d’un pays où nous pourrions être libres. La lutte à peine terminée, notre liberté tant convoitée nous était de nouveau confisquée et par là même le droit à prendre notre destin en main.
La guerre était basée sur le refus de l’occultation par la France de la culture du peuple algérien ; pourtant, dès l’indépendance, l’État, fondé sur la légitimité de cette guerre, nous a interdit d’exprimer notre culture en nous en posant une autre, importée du Moyen-Orient.
Des hommes, qui s’étaient révoltés contre l’oppression et le racisme, ont à leur tour exercé l’oppression contre les femmes ; ils les ont dépossédées de leur liberté et de leur dignité en les plaçant dans un statut d’être inférieur ; ils ont promulgué des lois mettant ainsi la moitié de la population algérienne dans un état de soumission. Alors que l’objectif de la guerre était d’éradiquer l’injustice, l’injustice reste, encore et toujours. Ainsi, ceux qui avaient goûté à son amertume ne se sont pas privés à leur tour d’être injustes. La guerre, qui devait mettre fin à l’oppression, n’a rien fait d’autre que changer l’opprimé en oppresseur, oppresseur qui n’était pas toujours l’État et ses institutions. L’oppression est devenue plus présente, pesante. Élément familier du quotidien, elle s’impose partout, portée par le peuple algérien tout entier, dans les familles, au travail, dans les rues… L’histoire des Algériens libres et dignes a donc été très courte ; à peine sortis de la soumission et de l’indignation, ils sont entrés rapidement dans une autre forme de soumission et d’indignation.
Aujourd’hui, les Algériens rêvent de bonheur et de sécurité. Sécurité qu’ils ne peuvent avoir que par le travail, la démocratie et le respect de la liberté individuelle. Bonheur qui ne peut être complet que dans la beauté. Je suis persuadée que si nous avions un environnement plus soigné, des rues propres, de jolies maisons et des balcons fleuris, nous serions moins négatifs, moins agressifs et de ce fait plus heureux.
À défaut de cela, les Algériens sont livrés au chômage, à la violence, à l’oppression et à des conditions de vie qui détruisent les jeunes et assassinent les parents. Dès lors, nulle autre solution pour ces parents que de pousser leurs enfants au départ dans l’espoir qu’ils trouveront ailleurs travail, assurance et épanouissement. Ceux qui ne peuvent les aider à partir les regardent, désespérés, s’embarquer au péril de leur vie sur des rafiots de fortune. Dans le pire des cas, ils deviennent, malgré eux, les spectateurs de la mort annoncée de leurs enfants. Le suicide des jeunes raconte l’histoire d’un horizon qui ne promet plus rien. La situation n’est ni celle dont le peuple avait rêvé quand il affrontait l’armée française ni celle qu’il avait espérée quand, en 1962, il avait chanté et dansé sa joie de peuple libre et indépendant. La situation que vivent les Algériens aujourd’hui témoigne du désespoir non seulement des jeunes, mais aussi d’une population tout entière. La fierté des premières années de l’indépendance n’a pas résolu les complexes qu‘ils essayent souvent de dissimuler derrière un orgueil démesuré. Seule, la réussite économique, politique, sociale pourra les en guérir.
Un demi-siècle d’espoirs et d’attentes et le bilan n’est toujours pas satisfaisant. La situation dans laquelle se trouve le pays, et le désarroi des jeunes renvoient une réalité amère : les objectifs de l’indépendance pour laquelle le peuple avait fait la guerre ne se sont pas réalisés. Un tel constat peut, sans doute, aider à comprendre cette leçon de morale. Essayons d’imaginer ce que peut ressentir, face à cette situation, la génération de la guerre, ces Algériens, femmes et hommes, dont le hasard a voulu que leur existence croise une guerre que des années d’humiliations, de déceptions et de luttes avaient portée à maturité. Avec beaucoup de courage, ils ont assumé le rôle que l’histoire leur avait confié : lutter pour l’indépendance de leur pays et sa libération du joug colonial. La promesse qu’ils avaient faite à l’Algérie, au peuple algérien et à eux-mêmes était de bâtir un pays où la justice, la liberté et l’égalité régneraient. C’était l’objectif de la guerre qu’ils ont menée comme le précise le texte de la proclamation du 1er novembre 1954.
Face au désenchantement généralisé, tous ceux et toutes celles qui ont combattu uniquement par amour et dévouement, ceux et celles dont la sincérité n’a pas été corrompue par les privilèges que cette guerre a procurés, ne peuvent qu’avoir le lourd sentiment d’être passés à côté de leurs ambitions et de ne pas avoir été à la hauteur de leurs devoirs. Certains, l’âge avançant, se réfugient dans le silence. Aujourd’hui, nous n’entendons plus nos parents nous raconter ou raconter fièrement leur combat à leurs petits-enfants. Quand nous leur posons des questions sur la guerre et la réalité algérienne actuelle, ils se contentent de murmurer : « Nous ne savions pas que les choses se passeraient ainsi ». Cette phrase révèle une culpabilité dissimulée, la reconnaissance d’un échec, d’un rêve avorté.
D’autres s’inscrivent dans une justification permanente. Ils évoquent ce qu’ils ont fait de bien pour éviter de parler de ce qu’ils n’ont pas fait ou mal fait. Ils rappellent constamment combien la situation était difficile et comment ce résultat, hors de leur volonté, était inévitable. Ils rappellent aux générations qui n’ont connu que l’indépendance, combien elles sont chanceuses de vivre dans un pays indépendant et combien la situation des Algériens, un demi-siècle après, n’a rien de comparable avec celle vécue sous le joug colonial. Ces propos, comme cette injonction : « il ne faut pas délégitimer la guerre d’Algérie », sous-entendraient-ils une accusation, un rejet de la culpabilité sur les nouvelles générations ? Il en est ainsi comme de certains parents qui, rongés par le sentiment d’avoir failli à leur devoir, rappellent constamment et inlassablement à leurs enfants qu’ils les ont mis au monde, élevés et que sans eux ils ne seraient pas ce qu’ils sont aujourd’hui. Il s’agit là d’une forme de perversité qui empêche de reconnaître ses erreurs et tend à faire croire aux autres que ce sont eux les coupables.
Quand les choses ne suivent pas la voie qu’elles devraient, quand les objectifs fixés ne se réalisent pas, quand tout va mal et que le désespoir s’installe, il est naturel que le doute s’insinue, et le doute fait peur. Quelle que soit la manière de réagir, certaines questions nous effraient : pourquoi avoir sacrifié tant de vies, pourquoi avoir fait la guerre ?
Pour cette génération qui a fait la guerre, évoquer la crainte d’une éventuelle « délégitimation » n’exprime-t-il pas son malaise, face aux Algériens, de n’avoir pu honorer sa promesse d’un avenir meilleur ? N’est-ce pas le sentiment d’avoir appartenu à une époque où les choix étaient très sensibles et de n’avoir pas su faire les bons ? De ne pas avoir été fidèle aux engagements pris pendant la guerre ? N’est-ce pas la reconnaissance à mots couverts de l’échec ? Ce sentiment de mécontentement vis-à-vis de soi peut s’emparer de tout un chacun quand le résultat de son travail est insatisfaisant.
Quels que soient les motifs ou la manière de l’exprimer, cette crainte n’aurait jamais existé si les Algériens quittaient leur pays, non pour fuir la misère ou le mal-être, mais poussés seulement par la curiosité de découvrir d’autres cieux. Personne n’aurait ressenti le besoin de donner cette leçon de morale « il ne faut pas délégitimer la guerre d’Algérie » si les choses dans notre pays allaient bien. Une indépendance réussie ne nous donnerait que plus de fierté quant à la légitimité naturelle de notre guerre et plus d’assurance en nous-mêmes. Il y a cinquante ans, aucun Algérien, aucune Algérienne n’imaginaient que puisse s’installer le moindre doute à ce propos, l’espoir dans l’avenir remplissait les cœurs. Personne ne pourrait aujourd’hui encore l’envisager si la situation n’avait anéanti nos espoirs ou si nous avions réalisé l’Algérie dont nous avions rêvé.
Nous interprétons souvent le monde qui nous entoure en fonction de nos convictions, nos opinions et notre état psychique. Quand on pense que les gens ne nous aiment pas, par exemple, le moindre mot est analysé de sorte à lui trouver un sens qui prouve la haine dissimulée et démontre le bien-fondé de notre sentiment. Quand on vit sous le poids d’un échec, l’attitude de l’autre est comprise et interprétée comme une forme de mépris de sa part à notre égard. C’est donc le malaise qui nous habite après l’échec qui fait que nous nous sentons constamment attaqués. Quand bien même il y aurait quelques journalistes, des fils et filles de harkis ou des pieds noirs qui oseraient s’en prendre à la guerre de libération, ils ne provoqueraient aucune crainte quant à sa légitimité si nous avions réussi notre indépendance et si nous ne nous reprochions rien. Il y aurait certainement des discussions et des controverses imposées par le recul de l’histoire, mais il ne pourrait y avoir la moindre critique à ce propos. Ceux qui n’ont pas oublié la défaite réfléchiraient sans doute avant d’oser reprocher à l’Algérie sa guerre de libération qui, par son nom même, porte toute sa légitimité et représente le fondement de la nation algérienne.