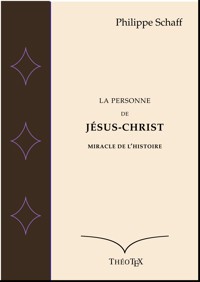
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Philippe Schaff (1819-1893) est surtout connu aux Etats-Unis pour sa monumentale History of the Christian Church, en 8 volumes. Il a été également un théologien engagé dans la défense de la foi biblique contre les dénigrements du libéralisme allemand au 19° siècle. Dans ce petit ouvrage il démontre la divinité de Jésus-Christ en se basant sur sa vie terrestre sans égale. A la suite de cette partie apologétique, Schaff a collationné les témoignages de personnalités connues, en général incrédules ou sceptiques, et qui pourtant se sentent en conscience obligées de rendre hommage à la personnalité unique de Jésus-Christ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322484072
Auteur Philippe Schaff. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Table des matières
Préface Introduction 1. Enfance et jeunesse de Jésus. 2. Education de Jésus. 3. Vie publique de Jésus. 4. L’anamartésie. 5. Sainteté parfaite de Jésus. 6. Harmonie de la vertu et de la piété en Jésus. 7. Universalité du caractère de Jésus. 8. Unité harmonique de toutes les vertus en Christ. 9. Les souffrances de Jésus 10. Résumé : le caractère de Jésus est le plus grand miracle moral de l’histoire. 11. Propre témoignage du Christ. 12. Examen des fausses théories. ♦ I. Théorie unitaire ♦ II. Hypothèse de la fraude. Reimarus ♦ III. Explication par l’exaltation ou par l’illusion personnelle ♦ IV. Explication rationaliste du Dr Paulus ♦ V. La Théorie de l’invention poétique ◊ A. Hypothèse mythique de Strauss ◊ B. Hypothèse légendaire de M. Renan Conclusion Notes critiques TÉMOIGNAGES DES INCRÉDULES ♦ Remarques préliminaires ♦ Ponce Pilate et sa femme ♦ Le Centenier sous la croix ♦ Judas, le traître ♦ Flavius Josèphe ♦ Le Talmud ♦ Les écrivains païens ♦ Tacite et Pline ♦ Celse et Lucien ♦ Porphyre ♦ Julien l’Apostat ♦ Thomas Chubb ♦ Denis Diderot ♦ Jean-Jacques Rousseau ♦ Napoléon Bonaparte ♦ Napoléon ♦ William Ellery Channing ♦ David-Frédéric Strauss ♦ Théodore Parker ♦ Félix Pécaut ♦ Ernest Renan ♦ Frances Power Cobbe« Que vous semble-t-il du Christ ? de qui est-il Fils ? » (Matth.22.42)
Voilà, de nouveau, la question religieuse de l’époque. Nous nous en réjouissons. Le résultat de cette lutte répétée ne saurait être douteux. Dans tous les combats théologiques, la vérité finit toujours par triompher. Quoiqu’on la cloue de temps en temps à la croix et qu’on l’ensevelisse, elle se relève toujours triomphante d’entre les morts, faisant de sa prison sa propre captive, et transformant assez souvent ses ennemis les plus acharnés, comme Saul de Tarse, en ses amis les plus intrépides. Gœthe a dit avec beaucoup de justesse : « A proprement parler, le thème unique, le thème le plus profond de l’histoire du monde et de l’homme, celui auquel tous les autres sont subordonnés, est et reste le grand duel de l’incrédulité et de la foi. » La question christologique en est le point central.
Oui, la question du Christ est la question du christianisme, qui n’est que la révélation de sa vie dans le monde ; — la question de l’Eglise, qui repose sur lui comme sur son roc immuable ; — la question de l'histoire, qui gravite autour de lui, le soleil du monde moral ; — la question de tout homme qui soupire instinctivement après lui comme après l’objet de ses désirs les plus nobles et les plus purs. C’est le problème du salut personnel qu’on ne peut obtenir qu’en son nom éternellement béni. L’édifice entier du christianisme reste debout ou tombe avec son fondateur divin-humain ; et s’il doit durer à jamais, comme nous le croyons, il ne le devra qu’à Celui qui vit, toujours le même, hier, aujourd’hui et éternellement.
Pour contribuer à éclaircir cette question fondamentale de notre temps, nous voudrions essayer de montrer que la personne du Christ est à la fois le grand miracle central de l’histoire et la plus forte preuve du christianisme ; et que son humanité accomplie, au milieu d’un monde pécheur, doit logiquement conduire à reconnaître et à proclamer sa divinité. La seule solution satisfaisante de l’énigme que présente son étonnant caractère se trouve dans cette parole, ou pour mieux dire dans ce fait : Dieu a habité pleinement et parfaitement en Lui.
De la Personne miraculeuse de Jésus découlent, comme une inévitable conséquence, ses œuvres miraculeuses. Miracle lui-même, il doit en opérer aussi facilement que les hommes ordinaires font leurs œuvres habituelles. C’est le contraire qui serait contre nature. L’essence d’un arbre détermine celle de son fruit. « Croyez que je suis dans le Père, et que le Père est » en moi ; sinon, croyez à cause des œuvres » (Jean.14.11 ; 10.58). Je crois en Christ ; et voilà pourquoi je crois aussi à la Bible, comme à toutes ses paroles et à toutes ses œuvres miraculeuses.
Sur ce rocher, je me sens inébranlable et à l’abri de toutes les attaques de l’incrédulité. La personne du Christ est pour moi le plus grand et le plus certain de tous les faits, aussi certain, plus même, que celui de ma propre existence ; car Christ vit en moi, et il est la portion, la seule digne, de mon être. Je ne suis rien sans mon Sauveur. Avec lui je suis tout, et je ne l’échangerais pas contre dix mille mondes. Renoncer à la foi en Christ, c’est perdre la foi en l’humanité. Un tel scepticisme finit, à bon droit, dans le néant du désespoir.
Il se produit de nos jours un fait bien triste. On voit des théologiens, dont on avait le droit de mieux attendre, se laisser entraîner par l’esprit d’erreur et de chute, jusqu’à tenter de se construire un Christ humain, et de le comprendre à la façon de Schleiermacher ou même des sociniens, en dépit de saint Paul et de saint Jean. Ils en sacrifient la préexistence, et réduisent sa divinité à une simple habitation extraordinaire de Dieu en Lui, ou à l’insoutenable idée d’une déification progressive. Mais le sacrifice de la préexistence entraîne évidemment celui de l’Incarnation du Verbe, ce dogme fondamental de l’Eglise, qui subsiste ou qui s’écroule avec lui (1Jean.4.2,5) ; et celui aussi de l’amour condescendant et inouï de Dieu, cette source la plus riche en consolations pour le pécheur. Car il nous faut, avant tout, un Dieu qui s’incline et qui s’abaisse jusqu’à nous, et non pas seulement un homme qui s’élève jusqu’à Dieu. On ne se débarrassera pas facilement de la vérité confessée par le concile de Chalcédoine, qui sut éviter, avec un si sûr instinct, les excès de l’hérésie. Il ne donna pas, sans doute, ni ne voulut donner une explication psychologique du mystère du Dieu-homme ; mais il se contenta simplement de poser et d’affirmer la vérité : ce qui suffisait pleinement à l’Eglise et à la foi populaire. Que la théologie scientifique reprenne le problème et cherche à en faciliter l’intelligence à la conscience moderne ; qu’en particulier elle s’attache à comprendre le développement vraiment, humain du Christ : à la bonne heure. Mais, qu’on le sache bien, le problème ne sera point pour cela résolu. Il est bien plus vrai de penser que ces recherches feront encore mieux sentir la nécessité d’étudier plus à fond la divinité du Sauveur et la manière dont les deux natures sont unies dans sa personne ; et il est permis d'espérer qu’au bout de toutes ces investigations les esprits seront plus favorablement disposés à s’incliner devant le grand mystère de piété, Dieu manifesté en chair, et à confesser humblement qu’il est plus que l’objet de spéculations transcendantes ou d’analyses intellectuelles ; qu’il est, avant tout et par-dessus tout, l’objet de la foi, de la vie et de l’adoration. En définitive, la vraie théologie sera toujours celle des régénérés, qui s’appuie tour à tour sur la Parole de Dieu, sur la conscience du péché, sur le besoin de rédemption, et à laquelle on arrive non par le sentier si scabreux et si glacial de la spéculation et de la critique, mais par la triple voie de l’oraison, de la méditation et de l’épreuve.
Le recueil de témoignages, fournis par des incrédules, sur la perfection morale de Jésus, et que nous ajoutons à notre petit travail, est, si je ne me trompe, le premier essai de ce genre ; aussi est-il bien incomplet. Toutes nos œuvres sont-elles autre chose que des fragments !
Les incrédules se montrent rarement touchés des arguments qu’on leur oppose, parce que les sources de leur incrédulité sont beaucoup plus dans le cœur que dans la tête. Mais les chercheurs loyaux, comme Nathanaël, et les sceptiques sérieux, comme Thomas, qui aiment la vérité et qui ne demandent qu’à saisir un appui pour étayer leur faible foi, accepteront toujours avec une joie reconnaissante les preuves qu’on leur offre, et ne refuseront pas, s’ils sont convaincus, d’adorer le Dieu fait chair !
Heureux ceux qui cherchent la vérité d’un cœur droit et sincère ; car, à coup sûr, ils la trouveront !
Lorsque l’ange du Seigneur apparut à Moïse dans le buisson ardent, il lui dit : « Ote les souliers de tes pieds, car la terre où tu es est une terre sainte ! » De quel respect et de quel saint tremblement ne devrions-nous pas être saisis, en nous approchant de cette grande réalité dont la vision de Moïse ne fut qu’une ombre et qu’un type : Dieu manifesté en chair1 !
C’est qu’en effet la vie et le caractère de Jésus-Christ constituent le sanctuaire de l’histoire universelle. Dix-huit siècles se sont écoulés depuis qu’à l’accomplissement des temps il apparut sur la terre, pour racheter du péché et de la mort une race déchue, et pour ouvrir la source inépuisable de la justice et de la vie. Avant lui, les siècles ont ardemment soupiré après sa venue, car elle devait combler l’espérance de tous les peuples ; après lui, ils ont annoncé sa gloire et étendu sans cesse sa domination. Objet de l’amour le plus pur et de la reconnaissance la plus vive, pour les âmes les plus nobles et les meilleures du monde entier, il est encore celui de leur vénération et de leur adoration divine. Son nom est au-dessus de tous les noms que l’on prononce au ciel et sur la terre ; c’est le seul par lequel le pécheur puisse être sauvé. Il est l’auteur de la seconde création, — le chemin, la vérité et la vie, — le prophète, — le sacrificateur, — le roi de l’humanité renouvelée. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, — la Parole éternelle faite chair, — vraiment Dieu et vraiment homme dans l’unité de sa personne, — le Sauveur du monde !
Voilà la foi de l’Eglise tout entière, des grecs, des latins et des chrétiens évangéliques, dans tous les pays du monde civilisé. Malgré les différences de doctrines et de cérémonies qui les séparent, ces confessions diverses, quels que soient d’ailleurs leurs noms, sont unanimes pour aimer et pour adorer Jésus. Elles déposent leurs armes lorsqu’elles s’approchent de la crèche de Bethléem ou de la croix de Golgotha, du lieu où le Christ est né, et de celui où il est mort pour nos péchés et pour notre salut éternel. Il est l’harmonie divine de toutes les dénominations et de toutes les Eglises ; le centre commun de la vie de tous les vrais chrétiens ; le foyer où leurs cœurs se rencontrent avec leur amour, leurs prières et leurs espérances, quoique leurs vues et leurs théories particulières soient souvent en : désaccord. Les doctrines et les institutions, le culte et les cérémonies, les sciences et les arts de la chrétienté tout entière, voilà les marques à jamais impérissables du cachet qu’il a imprimé au monde. Les églises et les cathédrales sans nombre sont autant de monuments élevés à son saint nom par la reconnaissance des hommes, aussi bien que les milliers de cantiques et de prières qui, tous les jours et dans tous les pays de la terre, montent vers son trône et pour sa louange, soit des lieux réservés à l’adoration publique, soit des oratoires secrets. Sa puissance est plus grande et son royaume plus vaste que jamais ; et ils ne cesseront de s’accroître que lorsque tous les peuples auront ployé les genoux devant lui et embrassé son sceptre de justice et de paix.
Heureux celui qui peut croire de tout son cœur que Jésus est le Fils de Dieu et la source de la félicité ! La vraie foi n’est pas donnée par la nature ; c’est une œuvre que Dieu opère dans les âmes par le Saint-Esprit ; et le Saint-Esprit nous révèle la vraie nature du Christ, comme le Christ nous a révélé le Père. Lorsque Pierre eut prononcé sa célèbre confession de foi, le Seigneur lui dit : « Ce n’est ni la chair ni le sang qui t’ont révélé ces choses, mais mon Père qui est au ciel. » La foi avec sa vertu qui justifie, qui sanctifie, et qui assure le bonheur, est indépendante de la science : elle peut être allumée dans le cœur d’un petit enfant ou d’un esclave grossier. La gloire particulière du Rédempteur et de sa religion, c’est qu’il s’adresse à tout ce qui porte le nom d’homme, sans distinction de race, d’âge, de peuple et de conditions. Sa grâce salutaire est à la portée de tout le monde : pour la posséder, il suffit de se repentir et de croire.
Il ne faut pas cependant s’imaginer que cette foi supprime la nécessité de la pensée et de la démonstration. Sans doute la révélation est au-dessus de la raison et de la nature, mais elle n’est contraire ni à la nature ni à la raison. Il y a plus : le naturel et le surnaturel s’associent pour former l’unité de la révélation et du gouvernement de Dieu2. De même qu’il satisfait aux besoins moraux et religieux ; le christianisme répond aux plus profonds besoins intellectuels de l’homme créé à l’image et pour la gloire de Dieu ; il est la révélation de la vérité et de la vie. La foi et la science ne s’excluent point ; loin d’être ennemies, ce sont des forces qui se complètent ; ce sont deux compagnes inséparables. Si la foi précède la science, elle y conduit aussi nécessairement ; et de son côté, si la vraie science a eu de tout temps son fondement dans la foi, il faut reconnaître qu’elle sert à la confirmer et à l’affermir. Aussi les trouvons-nous associées dans la célèbre confession de saint Pierre, quand il dit, au nom de tous les apôtres : « Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ1 » Car la foi et la science sont si étroitement unies, que nous pouvons aussi bien répéter, après saint Augustin, Anselme et Schleiermacher : « La foi précède l’intelligence2, » que renverser la pensée en disant : « Le savoir précède la foi3. » Pourrions-nous croire, en effet, à quoi que ce soit, si nous n’avions, d’une manière au moins générale, une certaine connaissance historique de l’existence et de l’objet de notre croyance ? Dans sa forme la plus infime même, lorsqu’elle n’est qu’une soumission à l’autorité de Dieu, qu’un assentiment donné à la vérité révélée, la foi est un acte de l’esprit et de la raison, non moins qu’une fonction du cœur et de la volonté. Aussi, l’antique définition de la foi embrasse-t-elle les trois points suivants : savoir, consentir et se confier. Un être privé de raison ou un fou ne peuvent pas croire. Notre religion ne demande pas une foi aveugle, mais une foi rationnelle et intelligente, et plus elle est énergique et ardente, plus aussi elle nous pousse à pénétrer chaque jour davantage dans son fonds éternel, et jusqu’à son objet sacré.
Si la foi vivante en Christ est l’âme et le centre de tout christianisme pratique et de toute piété, la vraie doctrine du Christ est, à son tour, le centre et l’âme de toute saine théologie chrétienne. Nier l’incarnation du Fils de Dieu, c’est pour saint Jean la marque de l’antichrist ; le vrai signe du christianisme est donc évidemment, d’après lui, la foi à cette vérité centrale. L’incarnation du Verbe éternel, et la gloire divine qui rayonne à travers le voile de l’humanité du Christ, tel est le magnifique thème de son évangile ; disciple favori, ami intime de Jésus ; il l’écrivit avec la plume d’un ange trempée au cœur même du Christ. Le symbole apostolique, inspiré de la parole de Pierre, met particulièrement en relief l’article relatif au Christ, et le place entre celui de Dieu le Père et celui de Dieu l’Esprit-Saint. L’antique théologie de l’Eglise ouvre sa marche et arrive à son apogée en défendant victorieusement la vraie divinité du Christ contre les hérésies judaïsantes et ébionites qui la niaient, et son humanité, tout aussi vraie, contre le gnosticisme païen qui la transformait en un fantôme insaisissable. La saine théologie protestante évangélique est avant tout christologique : Christ, Dieu et homme, telle est la vérité qui la domine entièrement. C’est qu’en effet, avec ou sans cette idée, l’Eglise reste debout ou s’écroule. C’est là que se rencontrent et que s’unissent les deux pensées fondamentales de la Réformation, je veux, dire la doctrine de l’autorité suprême de la sainte Ecriture et celle de la justification par la foi. La parole du Christ, seul guide efficace et infaillible vers la vérité, — l’œuvre du Christ, source unique de la paix, source intarissable et suffisante, — Christ tout en tous, — voilà le principe du protestantisme authentique et primitif.
Pour construire la doctrine de la personne du Christ, on peut, comme l’a fait saint Jean dans l’introduction de son évangile, commencer par la divinité éternelle, et descendre, à travers la création et les révélations préparatoires de l’Ancien Testament, jusqu’à son incarnation et jusqu’à sa vie véritablement humaine pour le rachat de notre race. On peut aussi, avec les autres évangélistes, partir d’en bas, commencer par sa naissance de la vierge Marie, et, parcourant les degrés successifs de sa vie terrestre, de ses discours et de ses miracles, s’élever jusqu’à sa rentrée dans cette gloire céleste qu’il avait possédée avant la création du monde. Dans les deux cas, le résultat est le même : nous trouvons partout Jésus-Christ, réunissant dans sa personne la plénitude de la divinité et celle de l’humanité sans défaut et sans tache.
Les anciens théologiens, catholiques et évangéliques, prouvaient directement la divinité de Jésus par les miracles qu’il opéra, par les prophéties et les types qu’il accomplit, par les noms divins qu’il porte, par les qualités divines qui lui sont attribuées, par les honneurs divins auxquels il prétend, et qui lui ont été rendus par ses apôtres et par toute l’Eglise chrétienne jusqu’à ce jour.
Mais, pour établir cette preuve, on peut tout aussi bien prendre la voie opposée et partir de l’étude de la perfection unique de son humanité ; perfection qui, d’un aveu presque universel, de celui même des incrédules, s’élève si haut par-dessus toute grandeur humaine, avant et après lui, que, pour l’expliquer rationnellement, il faut admettre l’union essentielle ou métaphysique du Christ avec Dieu, telle qu’il l’atteste lui-même et que ses apôtres la lui attribuent. Plus nous regardons attentivement à travers le voile de sa chair, et plus aussi nous voyons avec clarté la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité3.
La théologie évangélique moderne doit cet hommage au Sauveur, et aussi le lui rend-elle ; car si les attaques violentes et perfides des plus récents incrédules contre l’authenticité de l’histoire évangélique exigent une défense plus rigoureuse que jamais, sachons reconnaître que l’antique foi de l’Eglise en son divin Chef est déjà redevable à ces attaques de nouveaux triomphes.
Notre époque humanitaire, philanthropique et sceptique pourtant, est plus apte à accepter la preuve qui remonte de l’humanité du Christ à sa divinité, qu’à adopter la preuve contraire, suivie par l’ancienne méthode dogmatique. Comme Thomas, le représentant parmi les apôtres du doute honnête et sérieux, combien de nobles esprits investigateurs se refusent à croire à la divinité du Seigneur, à moins de s’être convaincus par le témoignage des sens, ou par des preuves rationnelles irrésistibles ! Eux aussi veulent mettre leurs doigts dans les marques des clous, et leurs mains dans le côté du Christ avant de s’écrier dans une humble adoration : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Il n’est pas facile, par des raisonnements abstraits ou par des témoignages historiques, de les amener à croire aux miracles ; mais s’ils pouvaient une fois voir le grand miracle moral de la personne du Sauveur et de tout son être, les miracles de ses mains ne leur seraient plus une difficulté. Car un être surhumain doit nécessairement accomplir des œuvres surhumaines, et une personne miraculeuse des faits miraculeux. C’est le contraire qui serait contre nature et qui constituerait le plus grand des prodiges. A chaque arbre son fruit. Nous croyons aux miracles du Christ, parce que nous croyons à sa personne, parce que nous sommes convaincus qu’il est le Dieu-homme et le miracle sur lequel repose le monde moral.
C’est à ce point de vue que nous voulons essayer d’analyser et d’exposer la personnalité humaine du Christ, et cela d’une manière aussi populaire et aussi concise que la difficulté et la dignité du sujet le permettront. Nous nous proposons de montrer l’homme Jésus de Nazareth, tel qu’il nous apparaît d’après les récits simples et candides de quelques pêcheurs de la Galilée, incultes et honnêtes, tel aussi qu’il vit dans la foi de la chrétienté. Dans toutes les situations de sa vie en particulier ou en public, nous le trouverons si élevé au-dessus de la sphère des rivalités, et tellement parfait, que cette perfection même, en face d’un monde imparfait et pécheur, nous donnera la preuve irrésistible de sa divinité.
Si nous voulions épuiser le sujet, il nous faudrait considérer le Christ, à la fois dans son caractère officiel et dans son caractère personnel. Nous devrions le montrer successivement docteur, réformateur, puissant en miracles et fondateur d’un royaume spirituel dont la domination n’a de limites ni dans l’espace, ni dans le temps ; et, à la fin de chacune de ces études, nous arriverions nécessairement au même résultat. Mais le but actuel que nous poursuivons nous prescrit de nous borner ; nous nous contenterons simplement d’étudier son caractère personnel : ce travail suffira, nous l’espérons, pour nous conduire à la même conclusion.
Depuis l’enfance jusqu’aux années de la virilité, le Christ a parcouru tous les degrés de la vie humaine, et, dans chacun d’eux, il en a réalisé le type idéal pour racheter et sanctifier les hommes, et pour nous laisser un exemple accompli. Enfant, adolescent, jeune homme et homme mûr, il est toujours notre modèle4. La vieillesse seule, avec ses faiblesses, sa décroissance et son amoindrissement de vie, n’aurait pu se concilier avec son caractère et sa destinée. Il mourut, et il se releva d’entre les morts dans l’épanouissement complet de la force virile ; c’est ainsi qu’il vit à jamais dans les cœurs de son peuple, entouré d’une fraîcheur, impérissable, et revêtu d’une puissance que rien n’a pu briser ou lui ravir.
Jetons d’abord un coup d’œil sur son enfance. L’histoire de la race humaine commence dans le jardin d’Eden, au milieu de toutes les grâces d’une innocente jeunesse, « alors que les étoiles du matin se réjouissaient ensemble, et que tous les enfants de Dieu tressaillaient d’allégresse, » à la vue d’Adam et d’Eve, images visibles de leur Créateur, glorieuse couronne de toutes ses œuvres merveilleuses. De même, le second Adam, le Rédempteur de la race déchue, venu pour rétablir et accomplir l’humanité, s’offre à nous tout d’abord, dans les récits évangéliques, comme un enfant, né, il est vrai, d’une vierge pauvre, dans une misérable crèche, au sein des tristes ruines du péché et de la mort, et non dans le paradis de l’innocence, mais pur et sans tache, au milieu des cantiques des anges et de l’adoration des hommes. Et voyez déjà les effets de l’annonciation et de l’attente de sa naissance ! Sa mère, la fiancée d’un pauvre charpentier, est transformée en prophétesse remplie de l’esprit de Dieu ; les vieux parents du Baptiste sont rajeunis par la jouissance anticipée et si pleine d’espérances de la prochaine rédemption ; et l’enfant destiné à aplanir les voies au Sauveur tressaille dans le sein d’Elisabeth ! Les cantiques immortels d’Elisabeth, de Marie et de Zacharie, réunissent les charmes irrésistibles de la poésie et de la vérité4, et préparent dignement l’apparition réelle de l’enfant Jésus, au seuil même du salut évangélique, alors que la plus haute poésie de la sagesse et de l’amour divin était sur le point de devenir une réalité, et que cette réalité allait surpasser de beaucoup le plus sublime idéal de la poésie humaine ! Et lorsque l’enfant céleste est né, le ciel et la terre se rencontrent ; les bergers de Bethléem, les sages de l’Orient, les représentants d’Israël attendent le salut ; les païens cherchent dans les ténèbres le dieu inconnu ; et les uns et les autres se réunissent dans l’adoration de l’Enfant-Roi, le Rédempteur !
Nous trouvons ici, dès le commencement de l’histoire terrestre du Christ, cette alliance particulière d’abaissement et de grandeur, d’humain et de divin qui la caractérise en entier, et qui la distingue de toutes les autres histoires. Il entre dans le monde comme un enfant, comme un pauvre enfant, dans l’une des plus petites villes d’un pays écarté5, et dans l’une des plus chétives demeures de cette ville dans une étable, dans une crèche, réduit à fuir devant la fureur d’un barbare tyran. Voilà, au premier regard, des pierres d’achoppement pour notre foi ; mais, de l’autre côté, l’apparition de l’ange, les cantiques inspirés de Zacharie et de Marie, la sainte joie d’Elisabeth, d’Anne et de Siméon, les prophéties de l’Ecriture, la sagesse théologique des scribes de Jérusalem, le sombre soupçon politique d’Hérode lui-même, l’étoile de Bethléem, l’arrivée des mages du lointain Orient, un rêve significatif, et enfin la providence de Dieu, qui plane sur tous ces faits d’une manière visible, forment une série brillante de témoignages en faveur de l’origine céleste de l’enfant Jésus. On dirait que le ciel et la terre se meuvent autour de ce petit enfant, comme autour de leur foyer qui repousse tout ce qui est ténébreux et mauvais, et qui attire par la même force tout ce qui est bon et généreux. Quel contraste ! un enfant dans une crèche ; et cependant c’est le Sauveur du monde ! un enfant haï et redouté ; et cependant attendu et aimé ! un enfant pauvre et méprisé ; et cependant entouré d’honneurs et d’adorations ! un enfant ceint de dangers ; et cependant merveilleusement préservé ! un enfant qui met en mouvement les étoiles dans le ciel, la ville de Jérusalem, les bergers de la Judée, les sages de l’Orient ; et qui repousse loin de lui les mauvais éléments du monde, en même temps qu’il en attire les bons ! Ce contraste, qui réunit les choses les plus opposées sans qu’elles soient pourtant contradictoires, est trop profond, trop sublime, et trop riche de sens, pour être l’invention de quelques incultes pêcheurs5.
Et cependant, malgré tous ces signes de divinité, l’enfant Jésus n’est représenté, ni par saint Matthieu, ni par saint Luc comme un miracle contre nature, qui anticiperait sur la maturité d’un âge plus avancé, mais simplement comme un enfant véritablement humain, reposant et souriant doucement sur le sein virginal de sa mère, « croissant et se fortifiant en esprit6 » et par cela même soumis aux lois d’un développement régulier ; différant, toutefois, de tous les autres enfants, par sa naissance surnaturelle et son affranchissement complet du péché, ce mal héréditaire des hommes. Jésus apparaît avec la pureté céleste d’une innocence immaculée, fleur du paradis qui exhale un doux parfum, le Saint attendu d’après l’annonciation de l’ange Gabriel (Luc.1.35) ; admiré et aimé de tous ceux qui s’approchaient de lui dans un esprit filial, mais excitant aussi les sombres soupçons du roi-tyran, ce symbole de tous ses ennemis et de tous ses persécuteurs à venir.
Qui pourrait compter les douces émotions qui, à chaque retour de la fête de Noël, à l’adoration de l’Enfant Jésus, ennoblissent, purifient, élèvent les cœurs, jeunes ou vieux, dans tous les pays et chez tous les peuples de la chrétienté ? La perte du premier état d’innocence n’a-t-elle pas été dignement remplacée par le rétablissement de l’innocence immortelle du paradis retrouvé et reconquis ?
Nous ne savons de l’adolescence de Jésus qu’un seul trait que Luc nous rapporte ; il est en parfaite harmonie avec le charme particulier de son enfance, et il annonce, en même temps, la gloire de sa vie publique, consacrée, sans interruption, au service de son Père céleste6. Nous le trouvons au temple, à l’âge de douze ans, au milieu des savants juifs. Loin de les instruire sans modestie et de les offenser par de malicieuses questions, comme le représentent les Evangiles apocryphes, il écoute les docteurs, il les interroge et, tout en apprenant, il les remplit à son tour de surprise par son intelligence et par ses réponses. Il n’y a dans ce fait rien de trop précoce, rien de mûr avant le temps, rien de forcé ou d’inconvenant pour son âge ; et cependant il manifeste une mesure de sagesse et une profondeur d’intérêt religieux bien supérieurs à ce qu’on pourrait trouver chez un adolescent de cet âge. « Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, » nous est-il dit : (Luc.2.52). Il était soumis à ses parents et pratiquait toutes les vertus d’un fils obéissant ; et cependant il les remplissait d’un saint respect, lorsqu’ils le voyaient si complètement adonné à ce qui était de son Père7, et qu’ils l’entendaient prononcer des paroles qu’ils ne pouvaient encore comprendre ; paroles que Marie gardait dans son cœur comme un mystère sacré, fermement convaincue qu’elles devaient correspondre au miracle de sa conception et de sa naissance surnaturelle, et qu’elles avaient un sens profond !
Il n’est jamais venu à l’esprit d’un biographe, d’un poète ou d’un philosophe, de tracer le tableau d’une enfance innocente, irréprochable, céleste, et d’une adolescence qui grandit, comme la nôtre, en s’instruisant, et qui cependant fait briller une surprenante sagesse, telle enfin que nous la rencontrons sous une forme réelle et vivante, au seuil de l’histoire évangélique ! Au contraire, comme on l’a remarqué à juste titre7 « chez tous les hommes d’un ordre vraiment supérieur, la grandeur et l’élévation du caractère consistent rarement dans le simple déploiement d’une beauté harmonique et parfaite qui, aurait été en germe dans leur jeunesse. En général, ces caractères se forment en passant par un creuset où ils déposent beaucoup de folies et de défauts inhérents à leur nature, lorsque les désillusions ont mis des bornes à leur confiance, lorsque la raison est venue modérer leurs passions, et que l’expérience a refroidi leur ardeur. On aime à montrer que le développement de ces caractères sages, justes et héroïques, auxquels on prodigue l’admiration, a enfin été, malgré tous les écarts de jeunesse, réglé par une forte discipline. Bien plus : qu’un écrivain quelconque, à quelque siècle que vous le placiez, entreprenne de décrire, je ne dis pas seulement une enfance sans tache, mais encore surhumaine ou céleste, sans avoir le modèle devant ses yeux, il faudra qu’il soit lui-même plus qu’un homme, pour ne pas entasser lourdement peintures sur peintures, exagérations sur exagérations, jusqu’à ce que ni le ciel, ni la terre ne puissent retrouver aucune ressemblance dans ce portrait. »
Cette exagération contre nature, à laquelle l’imagination et la fantaisie conduisent inévitablement tout homme qui essaie de créer une enfance et une jeunesse surhumaines, se montre d’une manière frappante dans la légende d’Hercule au berceau, étouffant de ses tendres mains deux énormes, serpents ; elle se montre bien plus encore dans les récits que nous ont laissés les Evangiles apocryphes sur les miracles de l’enfant Jésus. Comparés aux livres du Canon, ils sont comme une fausse monnaie en face d’une monnaie véritable, ou comme une grossière caricature à côté d’un inimitable modèle. Mais ce contraste lui-même sert à attester, négativement du moins, la vérité de l’histoire évangélique. Il est si frappant qu’on l’a souvent mis en relief ; et dans les débats suscités par Strauss particulièrement, on s’en est servi comme d’une preuve pour battre en brèche la théorie des mythes.
Tandis que les évangélistes bornent les miracles de Jésus à la période de sa maturité et de sa vie publique, et qu’ils gardent sur ses parents un silence marqué, les faux évangélistes remplissent des plus bizarres miracles les années de l’enfance et de la jeunesse du Seigneur et de sa mère, et assignent sans cesse une place éminente à l’intervention de Marie. A les en croire, les idoles muettes, les animaux privés de raison et les arbres inanimés s’inclinent, en signe d’adoration, sur le passage de l’Enfant Jésus allant en Egypte ou en revenant. Ils nous le dépeignent, vers l’âge de cinq ou de sept ans, pétrissant de petites boules de terre, et les transformant en oiseaux qui s’envolent dans les airs, uniquement pour plaire à ses camarades ; répandant la terreur autour de lui, desséchant un torrent d’un seul mot, ; changeant ses compagnons en chèvres, ressuscitant des morts, et accomplissant toute espèce de cures merveilleuses, par une sorte de vertu magique qui s’échappait même de l’eau où il s’était lavé, des linges qu’il avait touchés et du lit où il avait reposé8. Voilà, prise sur le fait, l’invention contre nature, pleine de mensonges et d’absurdités ; tandis que le Nouveau Testament nous montre, au contraire, dans toute sa vérité et dans toute sa grâce, une histoire surnaturelle sans doute, mais de la plus haute réalité, et qui étincelle de couleurs d’autant plus vives, que nous la comparons au fantôme légendaire.
1Jean.6.69. Nous avons cru et connu. L’ordre inverse se trouve dans Jean.10.38 : « afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi, et moi en lui. » Voyez aussi 1Jean.5.13. 2Ou bien, plus complètement, dans le langage d’Anselme de Cantorbéry : « Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois afin de comprendre. Car celui qui ne croit point n’expérimente point, et celui qui n’a pas expérimenté ne comprend point. » Schleiermacher a fait de ces paroles l’épigraphe de sa Dogmatique.3C’était là le principe d’Abélard, qui, s’il n’est limité par la pensée opposée, doit inévitablement conduire au rationalisme et au scepticisme. 4Voyez Luc.1.41-45. Le Magnificat, ou le cantique de Marie, versets 46-55 ; le Benedictus, ou le cantique de Zacharie, versets 67-79. 5Voyez les belles remarques du Dr Lange, dans son Commentaire sur Matthieu, ch. II, 1-11. Bibelwerk, vol. I. 6Luc.2.40, mêmes expressions que Luc.1.80, emploie à propos de Jean-Baptiste. Voyez aussi, pour le développement humain du Christ, Luc.2.52 ; Héb.2.10-18, et versets 8 et 9, où il est dit que le Christ a appris l’obéissance, et qu’il est devenu par sa propre perfection l’auteur du salut éternel. 7Dr HoraceA l’exception de ces traits rares, mais significatifs, la jeunesse de Jésus et sa préparation à son ministère public sont enveloppées d’un mystérieux silence. Nous connaissons les situations et les circonstances extérieures au sein desquelles il a grandi ; mais nous n’y trouvons rien qui puisse expliquer son merveilleux développement, si nous n’admettons dans sa vie un élément surhumain et divin.
Il grandit au milieu d’un peuple rarement cité, et toujours avec mépris, par les classiques anciens, et qui gémissait alors sous le joug d’un oppresseur étranger. Il y grandit dans une province éloignée, conquête de l’empire romain : dans la contrée la moins connue de la Palestine ; dans un petit bourg d’une insignifiance passée en proverbe8 ; au sein de la misère ; artisan obscur dans la pauvre échoppe d’un charpentier. C’est là qu’il passa les années de l’enfance, de l’adolescence et de la jeunesse, loin des grandes écoles, des bibliothèques et de toute société littéraire et cultivée. Mais s’il était privé, de ces ressources, il lui restait les soins et la sollicitude de ses parents, les splendeurs que la nature lui offrait chaque jour, les Ecrits de l’Ancien Testament, le culte du sabbat à la synagogue de Nazareth (Luc.4.6), les fêtes annuelles du temple à Jérusalem (Luc.2.42), et le commerce intime de son âme avec Dieu, son Père céleste ; et ne sont-ce point là, en effet, les grands éducateurs du cœur et de l’esprit ? Le livre de la nature et celui de la Révélation, débordent d’enseignements plus riches et plus importants que toutes les œuvres de l’art et de la science ; mais ces deux livres, auxquels tous les Juifs avaient accès aussi bien que lui, ne pouvaient lui donner le plus léger avantage sur le plus pauvre de ses voisins et de ses compatriotes.
De là la question de Nathanaël : « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? » De là l’étonnement naturel des Juifs, qui connaissaient sa situation de famille et toutes ses relations humaines. « Comment celui-ci sait-il les Ecritures, demandaient-ils en l’écoutant, puisqu’il ne les a jamais apprises ? » (Jean.7.15) Et dans une autre occasion, quand il enseignait dans la synagogue : « D’où lui viennent, disaient-ils, une telle sagesse et de telles œuvres ? N’est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères, Jacques, Joses, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes au milieu de nous ? D’où lui viennent donc toutes ces choses9 ? » — Ces questions sont inévitables ; et il n’y a rien à répondre, si l’on ne voit en Christ qu’un homme : car, tout effet suppose une cause correspondante.
Qu’on ne vienne pas nous dire, pour résoudre cette difficulté, que bon nombre de grands hommes, peut-être la plupart, dans l’Eglise principalement, se sont élevés, par leur travail et par leur persévérance, au-dessus de la plus humble condition, et ont triomphé dans leur lutte amère avec la pauvreté et les obstacles de tout genre. Ces faits, nous les reconnaissons volontiers ; mais, dans chacun de ces cas, il serait facile de prouver que ces hommes ont dû leur développement, leur grandeur spirituelle ou morale, à des écoles ou à des livres, à des protecteurs ou à des amis, à des événements enfin ou à des influences particulières. Il se trouve toujours une cause humaine et naturelle ou quelque enchaînement de circonstances, pour expliquer le résultat final.





























