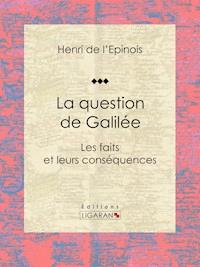
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Galileo Galilei, que dans la langue française nous nommons Galilée, naquit le 18 février 1564 à Pise, où se trouvaient alors sa mère, Giulia Ammanati, et son père Vincenzo Galilei, issu d'une famille noble de Florence. Après avoir fait ses premières classes dans cette dernière ville et avoir achevé ses humanités et sa logique au monastère de Vallombrosa où il revêtit un instant l'habit de novice..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076653
©Ligaran 2015
Le nom de Galilée est connu de tous. Ceux même que les questions scientifiques n’intéressent pas, savent néanmoins que l’illustre savant soutint sur le mouvement de la terre une doctrine déclarée fausse, qu’il subit plus tard un procès et fut condamné.
Or, quelles furent les causes de cette condamnation, et les mobiles secrets qui firent agir ? Ici les réponses révèlent trop souvent l’ignorance des faits.
Même après avoir lu la vaste correspondance de Galilée, publiée par le savant M. Alberi, il restait quelque chose à apprendre, car on ne connaissait les pièces du procès que par les notes complètement insuffisantes données par Delambre, Venturi, Mgr Marino Marini. Aussi, lorsqu’en 1867 j’eus communication du manuscrit qui renfermait ces documents, je m’empressai de publier intégralement les procès-verbaux et les interrogatoires, en indiquant seulement la nature des autres pièces, lettres et mémoires, jointes à ces actes dans le dossier. J’accompagnai cette publication d’un récit des faits, imprimé dans la Revue des Questions historiques du mois de juillet 1867.
La polémique, si vivement engagée depuis dix ans, surtout en Allemagne, en Italie, en France, au sujet de la question de Galilée, s’étant appuyée principalement sur ces documents, exacts quant au fond, mais copiés à la hâte et ayant plusieurs inexactitudes dans la forme, il convenait d’en donner un texte correct et complet. M. Berti l’a tenté, mais sans succès. Plus heureux que lui, je l’ai imprimé récemment à Rome, avec la permission de Son Ém. le cardinal Siméoni, secrétaire d’État de S.S. Pie IX ; peu de temps après, M. Karl von Gebler en a publié, de son côté, une édition à Stuttgart.
Le moment semble donc venu de réviser tout le débat et de faire entendre, s’il se peut, au milieu du bruit des passions, une parole calme, impartiale, qui contienne véritablement un enseignement historique.
Tel est le but de ce travail.
L’enseignement de l’histoire ne saurait exister là où la vérité n’a pas été cherchée, reconnue, proclamée. J’ai donc cherché à connaître la vérité en étudiant avec soin, mais surtout avec bonne foi, toutes les pièces du procès, les correspondances et les livres du temps où il a eu lieu ; j’ai dit avec sincérité ce qui, après cette enquête, m’est apparu comme la vérité.
La première partie du volume comprendra le récit des faits : j’examinerai dans une seconde partie les principales questions agitées au sujet de ces faits et les conséquences qu’on a voulu en tirer. Je terminerai par deux notes, l’une sur les corrections à mettre au texte publié, et l’autre sur la bibliographie galiléenne.
Galileo Galilei, que dans la langue française nous nommons Galilée, naquit le 18 février 1564 à Pise, où se trouvaient alors sa mère, Giulia Ammanati, et son père Vincenzo Galilei, issu d’une famille noble de Florence. Après avoir fait ses premières classes dans cette dernière ville et avoir achevé ses humanités et sa logique au monastère de Vallombrosa où il revêtit un instant l’habit de novice, le jeune Galilée fut inscrit le 5 novembre 1581, poursuivre les cours de physique et de médecine à l’Université de Pise. En 1585, il revint à Florence pour étudier les mathématiques.
M. Alberi a établi pour la première fois, d’après une lettre au P. Clavius, en date du 8 janvier 1588, la certitude d’un voyage de Galilée à Rome en 1587 ; deux ans après, en 1589, Galilée, âgé de vingt-cinq ans seulement, mais recommandé par le cardinal del Monte, était nommé par le grand-duc de Toscane professeur de mathématiques à l’Université de Pise.
L’esprit observateur, vif, ardent et plein de sagacité du jeune professeur, l’amena souvent à contrôler, à discuter et à réfuter les doctrines scientifiques d’Aristote. Il posa dès lors les principes nouveaux de la dynamique et de la mécanique, et par ces principes, plus encore que par ses découvertes au moyen du télescope, il hâta les progrès de l’astronomie. Mais en adoptant, en démontrant de nouvelles théories sur la philosophie naturelle, Galilée heurta de front et sans aucun ménagement renseignement suivi dans les écoles, je veux dire, ces doctrines péripatéticiennes, acceptées à cette époque par l’immense majorité des savants. Ce fut la cause de sa renommée ; mais comme ce fut aussi la cause de ses tribulations, il est nécessaire, dès le premier moment, de se rendre compte de la situation des esprits, de la direction imprimée aux études, et des passions qui agitaient alors les intelligences.
Les ouvrages d’Aristote, devenus depuis près de cinq siècles le fondement de la science humaine, avaient à la fois rendu un service et créé un danger : rendu un service, en présentant une sorte de résumé des connaissances humaines, une vaste encyclopédie dont les éléments travaillés, rejetés ou acceptés, en tout cas épurés et christianisés par les Pierre Lombard ou les Thomas d’Aquin, trouvaient leur emploi dans leurs Sommes immortelles ; créé un danger, en offrant aux Scot, aux Roscelin et autres sophistes plus vulgaires encore, une quantité d’idées fausses que leur intelligence accepta sans conteste. Rejeter les idées fausses, n’accepter que les idées vraies, telle ôtait la difficulté, et nous voyons par l’histoire de la philosophie au Moyen Âge que souvent, malgré les avertissements des papes et les recommandations des docteurs, on ne sut pas toujours la surmonter. Cet engouement pour Aristote, parfois combattu, diminué, mais non arrêté, tant s’en faut, du onzième au seizième siècle, avait peu à peu entraîné beaucoup d’esprits en des discussions misérables, en des puérilités qui affaiblissaient les intelligences, car elles les empêchaient de repousser l’erreur et de propager la vérité. C’est alors qu’on entendit, dès la fin du quinzième siècle, les protestations souvent éloquentes et l’enseignement réformateur des Vivès et des Melchior Cano. Ce respect illimité pour les doctrines d’Aristote, qui régnait encore au commencement du dix-septième siècle, était devenu un obstacle au progrès scientifique que les réflexions et les observations d’esprits supérieurs faisaient déjà entrevoir. Mais ces esprits devaient triompher, car ils étaient entraînés dans la lutte par la résistance même des idées opposées et par ce travail intellectuel, latent, mais continu, dont les résultats, longtemps cachés, allaient apparaître.
En effet, l’idée chrétienne, avec ses idées positives de surnaturalisme, avait créé une métaphysique sublime ; associée aux débris de la science antique, elle les avait peu à peu usés et détruits par son contact. Ce résultat, imprévu d’abord, mais rendu chaque jour plus certain, était remarquable. La décomposition de la science ancienne au contact du dogme chrétien rend extrêmement intéressante la période de transition qui unit le treizième siècle, époque de la grande science théologique, au dix-septième siècle, époque des grandes conquêtes scientifiques, et dans un espace plus restreint, la renaissance catholique du seizième siècle au concile de Trente, à la renaissance scientifique du dix-septième. Il ne faut point en effet perdre de vue ce fait que : « C’est la grande philosophie, pleine de l’idée de Dieu et de l’infini, sortie à son insu de la sainte impulsion des contemplatifs, c’est cette théologie et cette philosophie qui ont surtout préparé la voie… » Car, comme l’a dit en un autre passage le penseur que je viens de citer, « les saints produisent ou sont eux-mêmes les grands théologiens mystiques ; les grands théologiens mystiques produisent les dogmatiques profonds et les vrais philosophes ; tous ensemble produisent les savants créateurs même en physique et en mathématique. » Voilà les enseignements de l’histoire. Il convenait de les rappeler au commencement de cette étude. On sait à présent pourquoi les temps étaient mûrs pour de nouvelles conquêtes intellectuelles et pourquoi ces conquêtes devaient être vivement disputées.
Galilée ne fut pas le premier, mais il fut un des plus illustres de ceux qui, en face des vieux préjugés et de la science d’alors, affirmèrent les nouvelles vérités scientifiques. Dans cette tâche ingrate, il devait soulever et il souleva en effet les terribles colères et du corps des professeurs vieillis dans la doctrine de l’école, et de la foule des écoliers qui, après avoir cru aux paroles du Maître, s’irritaient d’entendre insulter tous ses enseignements et se refusaient à contredire sa vieille théorie. Ils ne comprenaient pas qu’il y avait là une question de forme usée par le temps, que l’esprit avait besoin de s’élever au-delà des limites où il s’était enfermé, pour chercher à découvrir les secrets de Dieu, et qu’enfin l’on pouvait marcher d’un pas libre, mais respectueux, ferme, mais prudent, vers les horizons nouveaux où l’idée chrétienne victorieuse conduisait le monde.
Le système astronomique de Ptolémée était la rigoureuse conséquence du système métaphysique d’Aristote. La cosmographie antique était le fruit non d’observations de faits, mais de déductions philosophiques ; aussi ceux qui émirent alors sur la cosmographie des idées nouvelles durent soulever une double contradiction. La métaphysique régnante déclarait a priori les découvertes absurdes en soi et contraires à la raison, parce que ces découvertes venaient contredire des théories philosophiques que l’on croyait indiscutables. C’est ainsi que la théorie philosophique d’un ciel incorruptible auquel la nature ne pouvait appliquer des lois, empêchait d’admettre la nouvelle doctrine cosmographique où tout était réglé par des lois. S’il ne s’était agi que d’opposer à des faits anciennement crus des observations plus précises, révélant des faits nouveaux, le débat eût été un débat purement scientifique ; mais comme il était évident que ces théories anciennes s’appuyaient, non sur des observations scientifiques, mais sur des principes philosophiques, l’opposition à ces théories devait venir du monde philosophique et du monde religieux, alors étroitement unis. Aussi l’opposition contre les nouveaux observateurs s’éleva d’une part au nom de susceptibilités philosophiques, d’autre part au nom de susceptibilités religieuses. Comme les principes de philosophie naturelle avaient été depuis longtemps appuyés sur différents textes de l’Écriture, la conviction vint naturellement que la cosmographie exposée par cette philosophie était conforme au sens du texte sacré, et par contre des professeurs et des théologiens crurent ainsi que la cosmographie nouvelle, contraire aux principes de la philosophie admise jusqu’alors, était opposée à l’Écriture sainte.
Voilà toute l’origine de la question Galilée ; nous aurons souvent occasion d’en constater les conséquences ; mais en fait voilà quelle était, au commencement du dix-septième siècle, la situation des esprits dans le monde savant.
Dès le temps de son premier professorat à Pise, les opinions de Galilée et surtout l’ardeur, ou si l’on veut la franchise qu’il mit à les exposer et à les soutenir, lui suscitèrent des envieux. Devenu plus libre par la mort de son père, arrivée le 2 juillet 1591, Galilée chercha à fuir l’orage, en même temps qu’à monter sur un théâtre encore plus renommé ; il sollicita et obtint de la République de Venise une place de professeur de mathématiques à l’Université de Padoue. Nommé le 26 septembre 1592, il fut continué dans cette charge le 29 octobre 1599 et le 8 août 1606. Ce fut alors que des observations sur l’étoile nouvelle apparue le 9 octobre 1604 dans la constellation du Serpentaire fournirent à Galilée l’occasion d’attaquer plus ouvertement la doctrine fondamentale dans la philosophie péripatéticienne sur l’incorruptibilité et l’immutabilité des cieux. Deux ou trois savants publièrent contre lui des écrits violents. Ce n’était là qu’un prélude. Les colères, longtemps contenues, éclatèrent plus vives lorsque Galilée vint à défendre, sur le mouvement de la terre et l’immobilité du soleil, l’opinion à laquelle Copernic avait attaché son nom.
Quelle était alors la pensée commune au sujet des systèmes du monde ? L’Église, c’est-à-dire les hommes éminents dans l’Église, car évidemment l’Église n’a point ici à intervenir, favorisaient-ils le nouveau système ou lui étaient-ils contraires ? L’exposé des faits va répondre à cette question, dont la solution, comme nous l’avons déjà fait entrevoir, apportera de nouvelles lumières pour apprécier le caractère vrai de ce qu’on a nommé, à tort selon nous, l’opposition du clergé vis-à-vis des enseignements de Galilée.
Si des philosophes de l’antiquité avaient plus ou moins indiqué l’existence du mouvement de la terre, il est certain que cette opinion, complètement dénuée de preuves, avait été oubliée et que le système de Ptolémée plaçant la terre immobile au centre du monde régna sans conteste jusqu’au quinzième siècle. Nicolas de Cusa, né en 1401 au village de Cues, près de Trèves, mais élevé et vivant en Italie, fut le premier parmi les modernes à énoncer cette opinion que la terre pouvait être en mouvement. Dans son livre De docta ignorantia, dédié au cardinal Cesarini qui, en 1431, présida le concile de Bâle, livre que le marquis Pallavicini publia en 1502, Nicolas de Cusa disait « La terre qui ne peut être un centre, ne peut être dépourvue de tout mouvement : Terra quæ centrum esse nequit, motu omni carere non potest. » Le pape Eugène IV remit au profond penseur le chapeau de cardinal. Après lui vint Copernic. Né à Thorn en 1475, étudiant à Bologne de 1496 à 1600, donnant peut-être en cette dernière année des leçons de mathématiques à Rome bientôt prêtre et chanoine, Copernic ne se contenta pas d’affirmer l’ancienne opinion du mouvement de la terre, il montra la simplicité de ce système et son utilité.
Quelques esprits adoptèrent son opinion, et un Allemand, Jean Albert Widmanstadt, venu à Rome en 1533, exposa la nouvelle doctrine, la nouvelle hypothèse, comme on disait, en présence du pape Clément VII, des cardinaux Orsini et Salviati, de l’évêque de Viterbe Grassi et du médecin Mathieu Corte. Le pape, en témoignage de sa satisfaction, admit Widmanstadt au nombre de ses secrétaires, et lui donna un manuscrit grec qui, déposé aujourd’hui à la bibliothèque de Munich, conserve encore sur un feuillet, avec la preuve du bienfait, le souvenir des circonstances qui le motivèrent.
Dix ans après cette séance donnée au Vatican, le cardinal Schomberg, évêque de Capoue et religieux dominicain, triomphant avec l’évêque de Culm des répugnances de Copernic, amena ce grand homme à publier le traité De Revolutionibus orbium cœlestium, auquel il travaillait depuis plus de trente-cinq ans. L’ouvrage était dédié au pape Paul III, dont Copernic, qui avait éprouvé ses bontés, invoquait l’autorité pour se mettre à couvert contre les attaques de ses calomniateurs. Copernic, en effet, rencontrait déjà des calomniateurs, et les péripatéticiens attaquaient sa doctrine en invoquant contre elle des textes de l’Écriture sainte. Auprès du même pape Paul III, un protégé du cardinal Hippolyte d’Este, Calcagnini, protonotaire apostolique, publiait en 1544 une édition de ses Œuvres, et en tête d’une dissertation on lisait : « Commentaire sur le mouvement de la terre et l’immobilité du ciel : Quod cœlum stet et terra moveatur commentatio. » Calcagnini fut le premier à propager en Italie les idées de Copernic.
Voilà donc quels furent les promoteurs de la réforme astronomique : un cardinal, Nicolas de Cusa, dans un livre dédié à un autre cardinal, président d’un concile ; un chanoine, Copernic, publiant avec l’aide d’un moine cardinal et d’un évêque un livre dédié au pape Paul III ; un autre protégé du souverain pontife et d’un cardinal, Calcagnini, protonotaire apostolique, initiant ses compatriotes aux théories nouvelles.
Galilée, comme Kepler, son contemporain et son ami, embrassa de bonne heure l’opinion du mouvement de la terre. Dans une lettre écrite le 30 mai 1597, il déclarait nettement qu’il considérait l’opinion de Pythagore comme beaucoup plus probable que l’opinion d’Aristote, et il réfutait une objection formulée contre ce système. Kepler lui ayant fait parvenir son ouvrage, publié en 1596, Galilée lui répondit qu’il le lirait avec empressement, ayant depuis plusieurs années déjà adopté cette doctrine. Il aurait même publié, ajoutait-il, un grand nombre de démonstrations et de preuves, s’il n’avait été effrayé par le sort de Copernic, notre maître : « car, disait-il, si Copernic s’est acquis auprès de quelques-uns une gloire immortelle, il n’est, pour une infinité de gens, qu’un sujet de raillerie et de mépris. » Cette lettre résume la situation. Galilée ne paraît pas un instant redouter l’hostilité de l’Église, car les papes ont soutenu Copernic, mais il craint l’opinion ennemie, l’opinion des philosophes péripatéticiens furieux de voir la nouvelle cosmographie contredire tous leurs principes. En effet, si la doctrine nouvelle était embrassée par quelques esprits d’élite, elle était repoussée et honnie par la foule des professeurs et des érudits.
Qu’on réunisse maintenant les deux ordres de faits que nous venons d’indiquer et dont la corrélation est manifeste : d’une part les doctrines nouvelles de Copernic et de Galilée qui renversaient les théories d’Aristote, et d’autre port les clameurs soulevées très généralement contre ces doctrines, et l’on trouvera encore ici une nouvelle explication de ce fameux décret de 1616 dont nous racontons l’histoire.
Revenons à Padoue où Galilée continuait ses études.
Le télescope, inventé en Hollande, mais, d’après la seule notion de l’effet obtenu, fabriqué en Italie par Galilée sur une plus grande dimension, permit à ce dernier de consolider par de nouvelles preuves l’édifice de Copernic et d’agrandir les espaces célestes – c’est M. Biot qui parle – au-delà de tout ce que pouvait supposer l’imagination. Le 7 janvier 1610, Galilée découvrit les satellites de Jupiter, et dans un écrit intitulé Nuntius sidereus (mars 1610), il enregistra ses découvertes en signalant ce qu’elles apportaient de force à l’opinion du mouvement de la terre. Cet écrit eut un immense retentissement.
Le 15 avril, Martin Hasdale annonçait le succès du livre, et comment Kepler affirmait que Galilée avait ainsi montré la sublimité de son esprit. Ce compliment n’était pas une parole vaine, car Kepler s’empressa de donner à l’œuvre l’appui de son nom en la faisant imprimer à Prague avec une préface sous forme de dissertation. Le grand-duc de Toscane conféra à Galilée le titre de premier professeur de mathématiques et de philosophie, en le déchargeant du soin d’enseigner ; le roi de France sollicita la faveur de voir appeler Bourbon la première étoile qui serait découverte, et le 28 avril le cardinal del Monte envoya à Galilée un tableau auquel le pape avait concédé des indulgences, en le priant de le garder par dévotion et en témoignage de son amitié.
Si le Nuntius sidereus obtint des applaudissements, il souleva aussi de nombreuses réclamations : les habitués des universités de Pise et de Padoue, ainsi que tous les péripatéticiens, s’élevèrent contre l’ouvrage ; tel professeur, du haut de sa chaire s’évertua, à force de syllogismes, à chasser du ciel les nouvelles planètes ; tel autre, comme Cremonino, traita les observations de Galilée d’illusions extravagantes. Sizzi écrivit contre lui et le luthérien Martin Horky, à l’instigation peut-être de l’astronome Magini de Bologne, publia, à Modène en 1610, un pamphlet violent intitulé : Peregrinatio contra Nuncium sidereum.
Galilée et ses amis tournèrent alors les yeux vers Rome où ils espéraient trouver des défenseurs. Sans doute l’opposition des péripatéticiens s’y montrait aussi très active, car Cingoli, en suppliant Galilée de venir dans cette ville, lui disait que sa présence était bien nécessaire pour éclairer l’esprit de « ces satrapes et grands bacheliers. » Sans doute on lui rapportait que le premier astronome de Rome, le jésuite Clavius, avait plaisanté avec un de ses amis au sujet des quatre étoiles de Jupiter nouvellement découvertes par Galilée. Mais le 17 décembre 1610, ce même P. Clavius écrivait à Galilée lui-même pour lui annoncer qu’il avait vu plusieurs fois les nouvelles planètes, et il ajoutait : « En vérité, Votre Seigneurie mérite une grande louange pour avoir été le premier à les observer. »
Le témoignage de Clavius était précieux et, fort de cet appui, Galilée se décida à venir à Rome. Dès le 15 janvier 1611 il annonçait à un ami son intention d’aller y montrer ses nouvelles observations. Le 19 mars il regardait ce voyage comme nécessaire, afin de fermer une bonne fois la bouche aux envieux, et quatre jours après, le 23 mars, il se mettait en route pour la ville des papes.
Le prince Cesi qui avait réuni autour de lui quelques savants et le cardinal del Monte accueillirent Galilée à bras ouverts. Les entretiens que celui-ci put avoir avec plusieurs personnages distingués lui donnèrent la ferme espérance de recevoir une entière satisfaction et de se justifier complètement au sujet de toutes les vérités qu’il avait démontrées, observées et exposées. Cette espérance était partagée par ses amis ; le cardinal del Monte, l’un des plus dévoués, écrivait le 31 mai, au grand-duc de Toscane, Cosme II : « On a été très satisfait de Galilée, et Galilée de son côté est, je crois, très satisfait de son voyage, car il a eu occasion de montrer si bien ses découvertes, qu’ici tous les hommes instruits les estiment, non seulement très vraies et très réelles, mais encore véritablement merveilleuses. » Galilée constatait lui-même le succès qu’il avait obtenu en disant : « J’ai été reçu avec bienveillance par beaucoup de cardinaux, de prélats et divers princes qui ont voulu voir mes observations ; tous en sont restés contents, comme moi de mon côté je l’ai été en voyant leurs magnifiques statues, leurs peintures, palais et jardins » Le pape Paul V, ce Borghèse qui élevait le palais du Quirinal et construisait la façade de Saint-Pierre, encourageait les arts et n’était point si ennemi des lettres qu’on s’est plu à le représenter, Paul V avait traité avec distinction l’auteur du Nuntius sidereus, et, contrairement au cérémonial usité, il n’avait point voulu que Galilée lui parlât à genoux.
Le cardinal Farnèse avait reçu à sa table le savant florentin, et après son départ de Rome il devait lui faire encore les honneurs de son château de Caprarola. Le cardinal Maffeo Barberini, qui depuis ceignit la tiare sous le nom d’Urbain VIII, parlait avec éloge des découvertes de Galilée et lui adressait parmi plusieurs lettres (il y en a sept), toutes plus affectueuses les unes que les autres, un billet en date du 11 octobre 1611, où l’on lisait : « Je prie Dieu de vous rendre la santé, car les hommes de grande valeur comme vous, méritent de vivre longtemps pour rendre service au public ; » et il ajoutait : « je parle aussi dans l’intérêt de l’affection que je vous porte et vous garderai toujours. »
Galilée, nous l’avons dit, se plaisait à raconter à ses amis le bon accueil qu’il avait obtenu de tout le monde, et en particulier des Pères jésuites. Ceux-ci étaient sincères dans leurs compliments, car l’un d’eux, le cardinal Bellarmin, désireux de préciser la valeur des découvertes de Galilée, ayant demandé (le 19 avril), l’avis de ses confrères les astronomes du Collège romain, touchant les étoiles fixes, la voie lactée, la nature de Saturne, le changement de figure de Vénus, la superficie inégale de la lune et le nombre des étoiles mobiles autour de Jupiter, quatre astronomes, les Pères Clavius, Griemberger, van Maelcote (Malcozzo) et Lembo, avaient donné, le 24 avril, deux jours par conséquent après la lettre de Galilée que nous venons de citer, une réponse conforme aux observations du savant professeur. Toutefois, Clavius faisait ses réserves au sujet de l’inégalité de la lune, et il lui semblait plus probable qu’elle n’avait pas une densité uniforme. Comme le nom de Galilée est omis dans la demande de Bellarmin, il parle seulement d’un valente mattematico (un mathématicien de valeur), et dans la réponse de Clavius, on a vu dans ce fait une preuve de jalousie, tandis qu’il peut prouver uniquement qu’on s’occupait surtout des doctrines et qu’on voulait les juger indépendamment de toute question de personne.
Les Pères jésuites du Collège romain donnèrent alors une grande séance académique dans laquelle un Père de la Compagnie lut un discours latin sur les nouveautés apparues dans les cieux : « Le nom de Galilée, disait-on, devait être justement cité parmi ceux des astronomes contemporains les plus célèbres et les plus heureux ; les observations des astronomes mes collègues, disait le Père, ont confirmé ses découvertes. » Ce discours, dont la trace avait été perdue, retrouvé en 1873 par M. Govi dans la bibliothèque Barberini, révèle les dispositions des esprits distingués de Rome.
Galilée pouvait donc, à juste titre, être satisfait de son séjour à Rome, aussi Paul Gualdo, apprenant de plusieurs côtés les honneurs qui avaient été rendus à son ami et en lisant le récit transmis par Galilée lui-même, ne pouvait s’empêcher de lui écrire (27 mai 1611) : « Je conclus de votre lettre que la conversation des prêtres n’est pas si à dédaigner qu’on le croit en mon pays. »
Si à Rome le succès avait été grand et l’estime réciproque, en Toscane la jalousie des péripatéticiens n’était point désarmée. Il s’élevait une grande clameur contre Galilée. Cingoli lui écrivait de redouter des adversaires qui derrière ses épaules préparaient leurs mines : « il y en a partout de ces méchants, ajoutait-il, mais ceux-ci dépassent de beaucoup les autres par les raffinements de leur méchanceté. » Six mois après, il lui signalait encore une certaine bande de malveillants et d’envieux, qui, « réunis dans la maison de l’archevêque, Mgr Marzi-Medici, se montaient la tête, et comme des enragés cherchaient s’ils pouvaient trouver un argument contre le mouvement de la terre, » à ce point même que l’un d’eux était allé trouver un prédicateur pour le prier de déclarer du haut de la chaire que Galilée disait des choses extravagantes. Le prêtre auquel on s’adressa, pénétrant aisément les intentions de ses interlocuteurs, répondit, selon le témoignage de Cingoli, comme il convenait à un bon chrétien et à un bon religieux. Toutefois, c’étaient là de fâcheux symptômes et les premiers pas d’une opposition qui essayait ses forces.
Pour le moment, Galilée, qui se tenait encore sur le terrain de la science pure, était honoré et encouragé par les hommes les plus éminents. Si un jésuite à Mantoue avait attaqué son opinion sur les montagnes de la lune, le P. Griemberger à Rome et à Parme le P. Biancani, professeur de mathématiques, soutenaient la doctrine du savant florentin ; si le P. Scheiner contestait à Galilée la gloire de les avoir découvertes, le P. Adam Tannoro et le P. Guldin lui en assuraient la priorité.
Mais un jour de l’été 1611, à la table du grand-duc de Toscane, une discussion s’engagea où Galilée, appuyé par le cardinal Maffeo Barberini, rencontra pour contradicteurs le cardinal de Gonzague et quelques péripatéticiens, Louis della Columba, Vincent di Grazia, George Coresio, Thomas Palmieri, etc.. Frappé de l’intérêt des questions agitées, le grand-duc pria Galilée de résumer par écrit les points traités et la réponse à cette demande fut le discours sur les corps flottants, publié en août 1612. Le cardinal Barberini se déclara en tous points de l’avis de Galilée : « Votre opinion, lui écrivait-il, m’y paraît être admirablement soutenue par de très bonnes raisons philosophiques et mathématiques. » Le cardinal Bellarmin le remercia de son envoi et le cardinal Conti, sollicité d’exprimer son avis sur diverses questions, envoya bientôt à Galilée une consultation en règle où la situation était bien précisée (7 juillet 1612). « Les questions traitées dans le livre, écrivait-il, sont appuyées sur de très solides raisons et des expériences certaines. Cependant, comme ce sont là des choses nouvelles, elles ne manqueront pas de rencontrer des contradicteurs. » Puis, comme Galilée, déjà inquiet des murmures de ses adversaires, avait demandé positivement au cardinal si l’Écriture sainte favorisait les principes d’Aristote sur la constitution de l’univers, le cardinal répondit que l’Écriture était plutôt contraire au principe péripatéticien de l’incorruptibilité du ciel, car les Pères croyaient communément que le ciel était corruptible. « Quant au mouvement de la terre ou du soleil, disait-il, on observe que les mouvements de la terre peuvent être de deux sortes, l’un direct provoqué par le changement du centre de gravité ; or, celui qui soutiendrait un tel mouvement ne dirait rien contre l’Écriture l’autre mouvement circulaire, selon l’opinion de Pythagore et de Copernic, paraît moins conforme à l’Écriture ; car si les passages où il est dit que la terre est stable et ferme peuvent s’entendre seulement de sa perpétuité, néanmoins les passages de l’Écriture relatant que le soleil tourne et que les cieux se meuvent ne peuvent recevoir une autre interprétation, à moins que l’on admette que l’Écriture a simplement employé ici le langage ordinaire du peuple ; or, cette manière d’interpréter ne doit pas être admise sans nécessité majeure. Diego Stunica a bien dit qu’il était plus conforme à l’Écriture de soutenir que la terre se meut, mais son opinion n’est pas communément suivie. » Dans une autre lettre, le cardinal Conti répétait à Galilée que l’Écriture ne favorisait point l’opinion d’Aristote sur la question de l’incorruptibilité du ciel, et lui était opposée au sujet de ses idées sur l’éternité et le gouvernement de l’univers. « Au surplus, écrivait à Galilée son éminent correspondant, précisez-moi davantage les points sur lesquels vous désirez obtenir des éclaircissements. » Mais le témoignage transmis déjà par le cardinal que l’Écriture n’était point contraire à son opinion suffisait à Galilée, qui était plein de confiance dans la droiture de ses intentions et l’issue de la lutte engagée.
Oui, la lutte était déjà engagée.
Les péripatéticiens, comprenant bien qu’il leur serait difficile de défendre en tous points la doctrine scientifique du maître, avaient, depuis longtemps déjà, cherché tantôt à concilier les observations de Copernic avec le système de Ptolémée (Gaspard Penzer, imité par Antoine Magini, professeur à Bologne, avait publié en ce sens ses Hypotheses astronomicæ), tantôt à combattre et à discréditer le système du chanoine de Thorn, en lui opposant l’autorité de la sainte Écriture. Tycho-Brahé, le premier peut-être, dans une lettre à Rothman, avait invoqué comme des arguments contre la théorie nouvelle des textes de la Bible. Kepler, en discutant ces textes en 1596 dans son Prodromus et dans sa Nova dissertatiuncula en 1602, les avait expliqués au contraire au profit du système nouveau. Mais le mouvement était donné. Il devait se continuer d’un côté avec le P. Foscarini (1615), le P. Baranzano (1617), Lansberg (1633), Herigonius (1647), etc. ; de l’autre avec Sizzi, Morin, Fromond, Riccioli, etc.. Chacun selon ses besoins faisait ainsi de l’exégèse en interprétant à son gré les passages des Livres saints. Rien ne pouvait être plus fâcheux.
Dans un livre, Diañoia astronomica, publié à Venise en 1611, pour démontrer l’inanité du bruit causé par le Nuntius sidereus et l’inutilité des télescopes, Sizzi invoqua le témoignage de l’Écriture sainte, afin de prouver que les satellites de Jupiter ne pouvaient exister. Des Pères jésuites se prirent à rire en lisant ces puérilités. Mais Sizzi amenait ainsi le débat sur un terrain plein de périls. « Vous êtes en contradiction avec les textes de l’Écriture sainte ! » criait-on au professeur de Padoue, et ce mot à l’instant jetait l’alarme parmi les catholiques.
Galilée ne s’en effraya pas et continua ses travaux. Bien que l’Académie des Lincei dont il était membre fût à peine organisée, elle publia à ses frais en 1613 l’Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari en forme de lettres, où le savant florentin portait un coup terrible à la philosophie péripatéticienne. En effet, disait-il au cardinal Maffeo Barberini en lui adressant son livre, « tout indique ici que le ciel peut changer et abandonner ses anciens aspects pour en prendre de nouveaux, ce qui est le contre-pied de la théorie ancienne. » Il priait le cardinal de lui communiquer ce que pourraient dire à ce sujet les péripatéticiens, et Barberini répondit en promettant de lui faire connaître l’avis « des personnes intelligentes » de Bologne, ville où il se trouvait alors. Quant à Son Éminence, elle trouvait dans cet écrit des choses neuves, curieuses, établies sur de bons fondements.
Le cardinal Frédéric Borromeo lut aussi « un ouvrage recommandé, disait-il, par l’intérêt du sujet et l’excellence d’un auteur pour lequel il éprouvait beaucoup d’estime. » Le secrétaire des brefs du pape Grégoire XV, Mgr. J.-B. Agucchi, alors principal ministre du gouvernement de Sa Sainteté, que dirigeait cependant en titre le neveu du pape, le cardinal Ludovisi, Mgr Agucchi, disons-nous, déclara le 8 juin 1613, après avoir lu le travail de Galilée, qu’il se rangeait à son avis. Toutefois il annonçait à l’auteur des contradictions, « car le sujet était une nouveauté, l’envie était partout excitée et on sait, ajoutait-il, l’obstination avec laquelle on persiste dans une opposition à la vérité. » Néanmoins, continuait Mgr Agucchi, « je suis très certain qu’avec le temps tout le monde approuvera ce que vous avez avancé. » Disons encore que le cardinal Bandini, après avoir fait accorder aux deux filles naturelles que Galilée avait malheureusement eues à Padoue, la permission de se faire religieuses, priait leur père d’avoir toujours confiance en lui pour le service de ses intérêts.
Ces témoignages de bienveillance venus de Rome et de l’entourage même du pape étaient précieux. Galilée, qui les recueillait avec bonheur, devait saisir la première occasion pour tenir tête à ses adversaires. Or, un jour, à la table de la grande-duchesse Christine de Lorraine, en présence du grand-duc son fils, de l’archiduchesse, d’Antoine et Paul Giordani, etc., une discussion s’engagea entre quelques professeurs et le moine bénédictin dom Castelli, ami dévoué de Galilée : on y parla des divers systèmes astronomiques, et la grande-duchesse, ainsi que les professeurs, reproduisant les objections présentées par Sizzi, soutinrent que l’Écriture sainte était contraire au système du mouvement de la terre ; le P. Castelli le nia énergiquement. Des objections furent émises, des répliques furent données, et finalement la grande-duchesse parut satisfaite des explications de Castelli. Instruit aussitôt par Nicolas Arrighetti d’une discussion qui fit du bruit, Galilée s’en réjouit et dans une lettre à Castelli il revint sur le débat afin de préciser quelle pouvait être la valeur de la sainte Écriture dans les controverses sur les phénomènes de la nature ; il expliqua en particulier le passage de Josué, que la grande-duchesse et les professeurs avaient opposé à la doctrine du mouvement de la terre et de l’immobilité du soleil. « Il est évident, disait Galilée en reproduisant les observations de saint Jérôme et de saint Augustin, il est évident que la sainte Écriture ne peut ni mentir, ni se tromper : seulement ses interprètes peuvent errer dans les explications qu’ils en donnent. Si on voulait s’arrêter toujours à la signification littérale des paroles, on serait entraîné en bien des contradictions, absurdités et hérésies, car il faudrait dire que Dieu a des mains, des pieds, etc. » Galilée prenait exemple du texte même de Josué qu’on lui objectait pour montrer combien le système d’Aristote et de Ptolémée répugnait, et combien au contraire le système de Copernic s’accommodait aux paroles du texte sacré. La lettre était datée du 21 décembre 1613. Elle ne fut pas alors imprimée, mais plusieurs copies circulèrent. Quelque temps après, le 8 mars 1614, Campanella, qui avait peut-être lu cette lettre, écrivait à Galilée : « Tous les philosophes se dirigent d’après vos écrits, car en vérité on ne peut philosopher sans un vrai système du monde, et on l’attend de vous. » Au mois de juin 1614, un patricien de Florence érudit, Jean Bardi des comtes de Vernio, se préparait à lire au Collège romain une dissertation pour appuyer les conclusions du précédent ouvrage de Galilée sur les corps qui se tiennent sur l’eau. Bardi ayant communiqué son dessein au P. Griemberger, le savant jésuite lui avait avoué que son avis était conforme au sien. « Si je n’avais dû respecter Aristote, ajoutait-il, car l’ordre du général est de ne lui présenter aucune objection et de toujours sauvegarder son opinion, j’aurais parlé plus clairement de ce qu’a fait Galilée, parce que sur ce point il a parfaitement raison ; du reste il n’est point étonnant qu’Aristote soit d’un avis opposé au sien, car il s’est évidemment trompé plusieurs fois. » Le P. Griemberger chargeait en même temps Bardi de présenter ses salutations à Galilée.





























