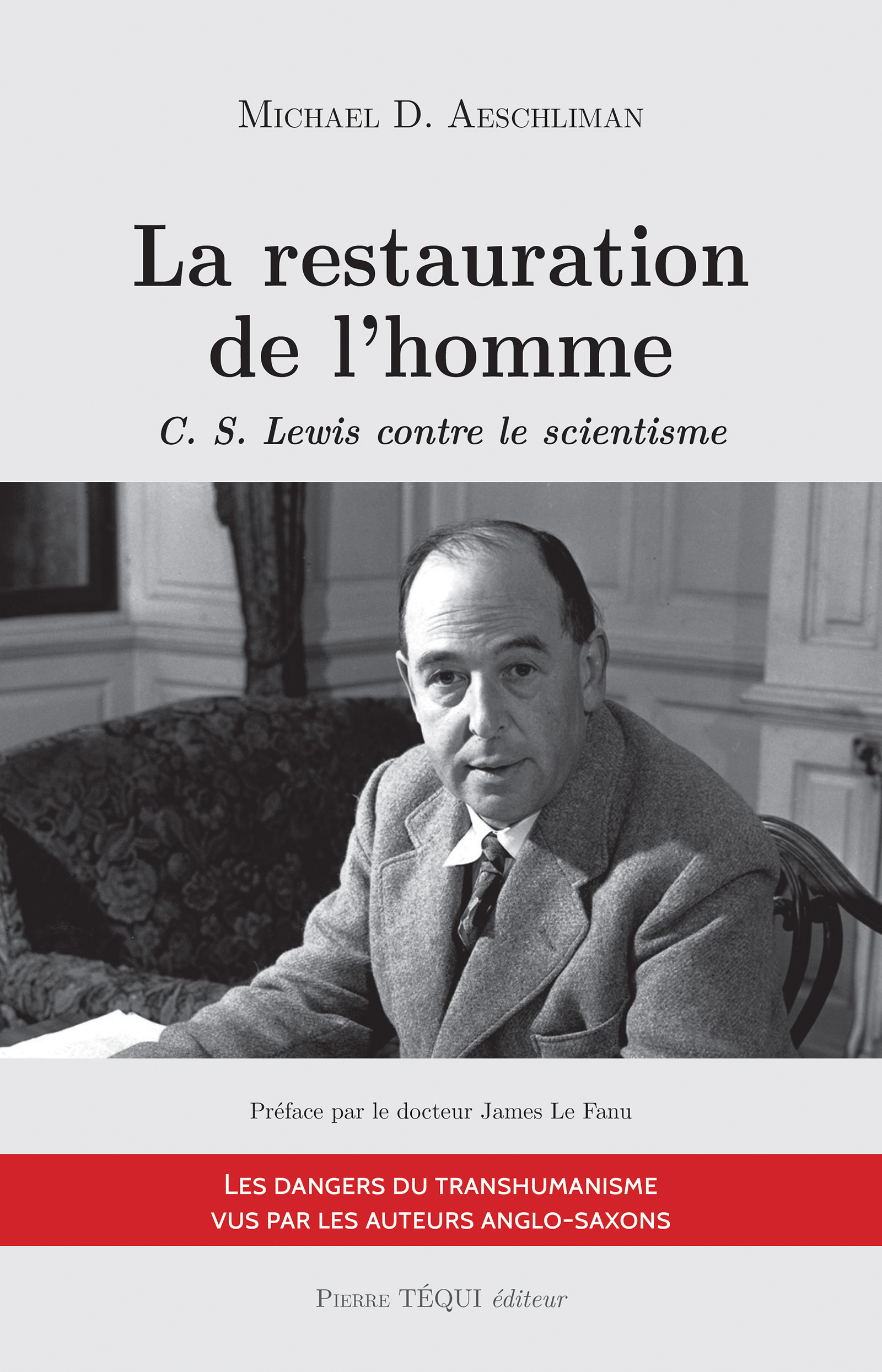
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pierre Téqui éditeur
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Surtout connu pour
Le monde de Narnia et son apologétique chrétienne, C. S. Lewis fut aussi un géant intellectuel qui a vivement et sévèrement critiqué le dogme à la mode connu sous le nom de scientisme - l'idée réductionniste que la science serait l'unique voie d'accès à la connaissance et à la réalité fondamentale.
S'appuyant sur le chef-d'œuvre de C. S. Lewis,
L'abolition de l'homme, Michael D. Aeschliman le prolonge ou pour mieux dire l'actualise ici, en convoquant tous les grands auteurs anglo-saxons partisans de la philosophie classique, tels Johnson, Chesterton ou T. S. Eliot, mais aussi Pope et Dante, ou les philosophes des sciences Pierre Duhem et Stanley L. Jaki. Et bien sûr les classiques Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin...
Face au matérialisme, au scientisme et au transhumanisme qui n'est que leur plus récent et vulgaire avatar, voici un ouvrage salutaire pour restaurer l'homme dans sa vraie richesse.
Un index biographique des auteurs vient le compléter, faisant de cet ouvrage une synthèse essentielle en philosophie et sciences politiques.
Préface par le docteur James Le Fanu
Dans les médias« À l'heure où certains tentent maladroitement de bricoler l'éthique pour en faire la chambre d'enregistrement des progrès les plus effrayants de la technique, cette lecture semble plus nécessaire que jamais. » (Le Figaro magazine)
À PROPOS DE L'AUTEUR
Michael D. Aeschliman est professeur émérite de l'université de Boston. Il a enseigné par ailleurs dans les universités de Lugano et de Columbia (NY). Spécialiste de Charles Dickens, il est un auteur incontournable sur C. S. Lewis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Retrouver aux éditions Téqui et Saint-Paul les ouvrages de C. S. Lewis ainsi que ceux d’autres « Chercheurs de vérité »
C. S. Lewis, Les quatre amours, Téqui, 2019.
C. S. Lewis, Le problème de la souffrance, Téqui, 2020.
C. S. Lewis, Lettres du pays de Narnia, Téqui, 2020.
Josef Pieper, La réalité et le bien suivi de De la vérité des choses, Téqui, 2019.
Josef Pieper, Le quadrige. Prudence, justice, force, tempérance, Téqui, 2020.
Romano Guardini, Les fins dernières, Saint-Paul, 1999.
Romano Guardini, La fin des temps modernes suivi de La puissance, Téqui, 2020.
In piam memoriam Adrien René Aeschliman 1899-1981
Préface à la présente édition
LES TROIS DÉCENNIES qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont sans doute été pour la science les plus productives de sa longue histoire. En l’espace d’une vie, nous avons appris comment le Big Bang avait donné naissance à l’univers, comment les premières étoiles s’étaient formées et comment, dans les profondeurs de leur cœur brûlant, évoluèrent les éléments chimiques par fusion nucléaire – l’hydrogène en hélium, l’hélium en carbone, oxygène et silicium, et ainsi de suite le long du tableau périodique. Nous avons appris comment, il y a quatre milliards d’années, un énorme nuage de gaz et de particules intergalactiques donna, dans un univers déjà immense, notre système solaire ; comment notre terre acquit son atmosphère et comment la tectonique de vastes plaques rocheuses donna leur forme aux continents et aux océans. Nous avons identifié les toutes premières formes de vie apparues il y a trois millions d’années, décrit le fonctionnement de son unité fondamentale, la cellule, et découvert le « code universel » des nucléotides le long de la double hélice à partir de laquelle tous les êtres vivants perpétuent leur espèce. Et nous avons assez d’éléments pour décrire en détail l’aspect physique de nos plus lointains ancêtres et leur évolution jusqu’à l’homme moderne.
Ce fascinant récit historique qui relie notre existence présente au moment même où sont apparus l’énergie, l’espace et le temps – à partir de rien, à ce qu’il semble – figure parmi les plus grandes réussites intellectuelles de tous les temps, en nous permettant pour la première fois de contempler d’un seul coup d’œil l’histoire de l’univers, depuis son origine jusqu’à aujourd’hui. On pourrait en conclure que le triomphe de la science est complet. Sur la même période, les humanités – philosophie, théologie, histoire – nous ont-elles apporté quoi que ce soit d’aussi profond et d’aussi original que cette réussite intellectuelle ? L’autorité et le prestige dont elle jouit occultent les autres formes de connaissance et, inévitablement, la doctrine du scientisme – « la science est la seule voie vers la vérité » – est devenue, sous ses diverses formes, la seule qui s’exprime dans les discours universitaire et public : le scientisme épidémique, l’idée que la méthode scientifique serait le seul chemin fiable vers la connaissance ; le scientisme ontologique, la croyance selon laquelle ce qui n’est pas compris dans le domaine de la science n’existe pas ou n’est doté que d’une réalité secondaire ou subsidiaire ; le scientisme promissoire, qui affirme qu’il n’y a rien, en principe, que la science ne puisse expliquer ; le scientisme rédempteur, l’idée, comme l’exprime la philosophe Midgley, de « salut par la science seule1 ».
Ces variantes du scientisme supposent nécessairement que les humains soient le résultat d’un « processus naturel et sans but qui ne nous a pas prévus », nos attributs apparemment uniques – capacité à raisonner, à imaginer ; « loi morale intérieure » et sens du moi – n’étant qu’une illusion générée par nos gènes « égoïstes » et par l’électrochimie de notre cerveau pour maximiser nos chances de survie2. « La science moderne affirme que le monde est organisé strictement en fonction de principes mécaniques, écrit le philosophe William Provine. Il n’y a aucun principe intentionnel dans la nature. Il n’y a pas de dieux, pas de forces créatrices rationnellement détectables. […] La science moderne affirme encore qu’il n’y a pas de lois morales ou éthiques inhérentes, […] que le libre arbitre, la liberté de choisir sans contrainte, de manière imprévisible, entre plusieurs lignes de conduite, n’existe tout simplement pas. […] Il n’y a aucun sens à l’existence des humains3. »
La science moderne suggère peut-être que le monde (et nous avec) est « organisé strictement en fonction de principes mécaniques », mais on ne peut pas vraiment dire qu’elle ait réussi à le démontrer. Impressionné, voire aveuglé par ce fascinant récit historique, on peut facilement ignorer que son legs intellectuel est en fait le contraire de ce que l’on pense habituellement. Ces grands moments – la compréhension scientifique des origines de l’univers, la création des éléments chimiques, la formation du système solaire et de la terre, et ainsi de suite – ne peuvent, par définition, être redécouverts : le grand défi de la science, à l’époque récente, a donc été d’affiner et d’approfondir ce qui est déjà connu. Ce qui s’est révélé étonnamment difficile. Si le récit général tient toujours, comprendre en pratique comment (ou pourquoi) ces grands événements ont eu lieu de la façon dont ils ont eu lieu est resté jusqu’à présent inaccessible à l’examen scientifique.
Les preuves attestant de l’origine de l’univers au moment du Big Bang il y a 14 millions d’années (environ), puis de sa soudaine expansion, sont plutôt convaincantes, mais elles ne font que mettre en évidence les insondables complications qu’entraîne cette théorie scientifique. Dire que l’univers a soudain existé, à un moment donné du temps, à partir de rien (de rien de physique, à tout le moins), revient à placer une lourde (voire insupportable) exigence sur toute explication simple, qui se doit nécessairement de transcender le temps, l’espace, la matière et l’énergie.
Bien obligé de reconnaître, avec de grandes difficultés, que l’univers a dû surgir ab nihilo, on a ainsi démontré que les lois physiques déterminant son expansion – gravité, électromagnétisme, forces nucléaires forte et faible, vitesse de la lumière – étaient si précisément réglées que la plus minuscule altération dans leurs valeurs aurait rendu impossible l’émergence de la vie sur terre. Il est très difficile, bien sûr, d’exprimer le degré de précision auquel ces forces ont dû se plier, mais le physicien John Polkinghorne estime qu’il aurait suffi d’une différence d’un pour plus de mille milliards de fois mille milliards de mille milliards, un nombre bien plus grand que celui de toutes les particules dans l’univers4.
Quant aux origines de la vie elle-même, l’explication progressive des processus internes de son unité fondamentale, la cellule, a révélé ces cinquante dernières années qu’il s’agissait d’un « monde de technologie suprême, d’une extraordinaire complexité, où toutes les fonctionnalités de nos machines les plus élaborées trouvent un équivalent » : bases de données pour stocker et retrouver l’information, systèmes de régulation de la chaîne d’assemblage, élégants mécanismes de correction des épreuves et de contrôle de qualité, procédés d’assemblage utilisant les principes de la construction modulaire5. Cette « usine automatisée » plusieurs millions de fois plus petite que la plus petite pièce d’équipement fabriquée par l’homme, capable de créer tous les êtres vivants ayant jamais existé – depuis le séquoia géant jusqu’à l’être humain – peut dupliquer sa propre structure en l’espace de quelques heures. Supposer que les nombreux composants de la cellule ont surgi spontanément d’une soupe chimique prébiotique revient à imaginer, comme l’observait l’astronome Fred Hoyle, « une tornade passant dans une décharge et assemblant un Boeing 747 avec les matériaux qu’elle soulèverait6 ».
L’interprétation la plus succincte de ces complications révélées par l’« affinage » et l’« approfondissement » de ce récit historique primordial serait que, en montrant le peu de choses que la science peut réellement expliquer, elles ont ébranlé (voire annihilé) les principes fondamentaux du scientisme. Mais ce n’est pas tout : les découvertes de deux des plus ambitieux projets scientifiques de ces dernières années viennent contredire toute explication exclusivement matérialiste des phénomènes que sont la vie et l’homme. Ces projets sont fondés sur deux avancées techniques remarquables qui promettaient de résoudre les deux principaux obstacles à une explication exhaustive de notre place dans l’univers – d’une part, comment les instructions génétiques contenues le long de la fameuse double hélice peuvent donner naissance à l’infinie diversité de formes et d’attributs du monde du vivant ; d’autre part, comment l’activité de type électrique du cerveau humain peut se « traduire » en expériences et souvenirs subjectifs et en sens du moi. Les avancées en question furent d’abord la capacité à retranscrire dans son intégralité la séquence génétique – ou génome – de diverses espèces (ver, mouche, souris, homme…) –, puis les techniques d’imagerie avancées permettant pour la première fois aux neuroscientifiques d’observer de l’intérieur le cerveau « en action », pensant, stockant des souvenirs et analysant le monde extérieur.
La capacité à retranscrire le génome dans son intégralité devrait révéler, en bonne logique, les instructions génétiques spécifiques qui déterminent les diverses formes d’espèces, si évidemment distinctes les unes des autres. Les biologistes ont été déconcertés, de manière compréhensible, de découvrir que c’était précisément le contraire. Contre toute attente, il y a une équivalence de près de vingt mille gènes tout au long du spectre des organismes qui court du vers d’un millimètre à l’être humain7. On ne fut pas moins décontenancé de constater que le génome humain est quasiment interchangeable avec celui de la souris et de nos cousins primates, et que les mêmes gènes régulateurs qui font, par exemple, qu’une mouche est une mouche, font qu’un humain est un humain8. En clair, il n’y a rien dans le génome de la mouche et dans celui de l’homme qui puisse expliquer pourquoi la mouche doit avoir six pattes, une paire d’ailes et un cerveau minuscule, et pourquoi nous devons avoir deux bras, deux jambes et un esprit capable de comprendre l’histoire de l’univers.
Mais il faut bien qu’il y ait des instructions génétiques, sans quoi ces diverses formes de vie ne pourraient se dupliquer avec autant de fidélité. Mais, alors que l’on se pensait encore récemment en mesure de connaître les principes de l’héritage génétique, on reconnaît à présent que nous n’avons aucune idée de ce qu’ils peuvent être. Il peut paraître futile de chercher pourquoi il en va ainsi, mais l’explication doit résider dans la beauté sans défaut de cette double hélice qui nous cache depuis si longtemps le « secret de la vie ». L’élégance de sa structure ne se contente pas d’être simple : elle existe parce qu’elle doit être simple, afin de pouvoir copier le matériel génétique à chaque fois que la cellule se divise. Et cette obligation de simplicité exige de la double hélice qu’elle condense, dans la séquence chimique bidimensionnelle des gènes, la forme et les attributs tridimensionnels uniques qui distinguent des hommes les mouches et les dizaines de millions d’espèces vivantes et disparues. Mais ce semblant de simplicité ne fait que nous donner la mesure de la profondeur de la double hélice9. Comme le faisait observer Philip Gell, professeur de génétique à l’université de Birmingham : « Ce n’est pas seulement que nous n’ayons pas comblé ce fossé dans notre connaissance : c’est qu’il est en principe impossible à combler. Notre ignorance est inéluctable et le restera10. »
L’histoire est la même pour les neuroscientifiques et leurs scanners. Dès le départ, il est devenu clair que le cerveau devait fonctionner selon des processus totalement différents de ce que l’on avait imaginé. Ainsi, la tâche la plus simple, comme associer le substantif « chaise » au verbe « s’asseoir », mobilise de vastes zones du cerveau – au point que l’on n’ose imaginer ce que doit nécessiter une simple conversation11. L’aspect et le son de chaque instant, a-t-on constaté, sont fragmentés en une myriade de composants distincts, sans qu’il y ait le plus petit indice d’un mécanisme d’intégration qui serait à l’origine de notre expérience personnelle de vie dans un monde cohérent, unifié et changeant. Sur ce problème, le prix Nobel David Hubel, de l’université de Harvard, remarquait :
Cette tendance constante des attributs comme la forme, la couleur et le mouvement à être traités par des structures distinctes du cerveau soulève la question de savoir comment toute cette information finit par être assemblée de sorte que nous puissions percevoir, disons un ballon rouge qui rebondit. Il faut bien évidemment qu’elles soient assemblées – mais où et comment, nous n’en avons aucune idée12.
Et le grand casse-tête n’est toujours pas résolu : comment l’activité de type électrique des milliards de neurones se traduit dans ce que nous vivons au quotidien – où chaque moment laisse sa propre impression, et où les cadences d’une cantate de Bach sont radicalement différentes du goût du bourbon ou du souvenir tenace d’un premier baiser. Les conséquences sont évidentes. S’il est possible de tout savoir de la réalité physique du cerveau, jusqu’au dernier atome, son « produit », les cinq mystères cardinaux de l’esprit immatériel, demeure inexpliqué – conscience phénoménale, libre arbitre, stockage des souvenirs, facultés « supérieures » de raison et d’imagination, et enfin, conscience de l’identité de soi qui change et mûrit avec le temps tout en restant résolument la même13.
La réponse habituelle à ces impondérables est de reconnaître que les choses se sont peut-être révélées plus complexes que ce à quoi l’on s’attendait, mais de marteler qu’il est « trop tôt » pour prédire ce qui pourrait émerger. Les biologistes pourraient, s’ils le voulaient, décortiquer le génome des millions d’espèces avec lesquelles nous partageons notre planète, mais cela ne ferait que confirmer qu’il est à chaque fois composé de plusieurs milliers de gènes similaires qui « codent » pour les cellules dont tous les êtres vivants sont faits. Et la passionnante question, celle de savoir comment ces gènes déterminent la forme et les attributs uniques de toutes ces créatures, demeurerait sans réponse. Même chose avec l’observation du cerveau « en action » : un million de scanners de sujets en train de regarder le fameux ballon rouge de David Hubel ne permettraient pas de mieux comprendre comment les circuits neuronaux conçoivent le ballon comme rond, rouge et rebondissant.
Le contraste avec l’immense réussite intellectuelle de l’après-guerre est frappant. Alors que les cosmologistes sont en mesure de déterminer ce qui s’est passé dans les premières secondes d’existence de l’univers, et que les géologistes peuvent mesurer le mouvement des continents au centimètre près, il semble extraordinaire que les généticiens soient incapables de nous dire pourquoi les humains sont si différents des mouches, et les neuroscientifiques d’expliquer comment nous arrivons à mémoriser un numéro de téléphone.
Cela pose nécessairement cette question : la science n’aurait-elle pas cherché au mauvais endroit des solutions à des questions qui ne sont pas vraiment de son ressort – qu’est-ce qui cause cette diversité de forme dans le vivant à partir d’une séquence génétique monotone, ou la richesse de l’esprit à partir de l’électrochimie du cerveau ? Il y a deux raisons possibles. La première, assez évidente à la réflexion, est que la « vie » est incommensurablement plus complexe que la matière : son unité fondamentale, la cellule, un million de fois plus petite que le plus petit objet fabriqué par l’homme, a cependant la capacité de créer tout ce qui a jamais vécu. Une mouche est un milliard de milliards de milliards de fois plus complexe qu’un caillou de même taille, et elle possède des caractéristiques sans équivalent dans le monde inanimé : elle peut transformer les nutriments dont elle se nourrit en son propre tissu, pour se réparer et se reproduire. De même, les lois de la biologie qui régissent l’agencement des instructions génétiques le long de la double hélice doivent être des milliards de milliards de fois plus complexes que les lois de la physique et de la chimie, qui déterminent les propriétés de la matière. Ainsi, s’il est extraordinaire que les cosmologistes puissent décrire les événements physiques faisant suite au Big Bang, cela reste trivial en comparaison d’une explication du phénomène de la vie.
Une autre raison pour laquelle ces récentes découvertes en génétique et en neuroscience ont été si déconcertantes est la supposition selon laquelle les phénomènes de la vie et de l’esprit seraient, en définitive, explicables en termes matérialistes par le travail respectif des gènes et du cerveau. Cela reste une supposition, car la spécificité du vivant sous ses différentes formes d’une part, et des pensées, croyances et idées de l’esprit d’autre part, est qu’ils sont sans équivoque immatériels, c’est-à-dire qu’on ne peut les quantifier, les peser, les mesurer. À proprement parler, ils échappent donc au domaine et aux méthodes de la science, qui ne peut les étudier ni les expliquer. Il en résulte que le principal mode de savoir de notre époque se trouve pris entre le marteau d’une réussite intellectuelle inégalée, le récit de l’histoire de l’univers, et la dure enclume de l’impénétrabilité des phénomènes de la vie et de l’esprit à son investigation.
Dans ce contexte, l’interprétation brillante que fait Michael Aeschliman du conflit entre sapientia et scientia est on ne peut plus actuelle et pertinente. Il s’agit là, comme il le montre, d’une vieille querelle à laquelle de nombreux esprits ont participé, en particulier C. S. Lewis, qui avait très bien vu que la subversion de la vision philosophique par la science matérielle impliquait le déni de l’exceptionnalisme humain. Or il est évident, non seulement que nous sommes pour nous-mêmes un mystère, mais encore que notre existence, qui seule témoigne, par l’usage de notre raison, des splendeurs de l’univers et de tout ce qu’il abrite, en est le mystère central, la première preuve qu’il y a « plus que ce que nous pouvons connaître ».
James LE FANU
1. Mikael Stenmark, Scientism : Science, Ethics and Religion, Ashgate, 2001.
2. George Gaylord Simpson, The Meaning of Evolution, Yale University Press, 2009.
3. William Provine, « Evolution and the Foundation of Ethics », MBL Science, 1988, n° 3, p. 25-29.
4. John Polkinghorne, Beyond Science : The Wider Human Context, Cambridge University Press, 1995.
5. Michael Denton, Evolution : A Theory in Crisis, Adler and Adler, 1986.
6. F. Hoyle, « Hoyle on Evolution », Nature, no 294, 1981, p. 105.
7. James Randerson, « Fewer Genes, Better Health », New Scientist, 13 juillet 2002, p. 19.
8. Henry Gee, Jacob’s Ladder : The History of the Human Genome, Fourth Estate, 2004.
9. James Le Fanu, « The Disappointments of the Double Helix », J R
Soc Med, 2010, n° 103, p. 43-45.
10. Ph. Gell, « Destiny and the Genes : Genetic Pathology and the Individual », in R. Duncan et M. Weston-Smith (éd.), The Encyclopaedia of Medical Ignorance, Pergamon, 1984, p. 179-187.
11. S. E. Petersen, P. T. Fox, M. I. Posner, M. E. Raichle, « Positron Emission Tomography Studies of the Cortical Activity of Single-Word Processing », Nature, 1988, n° 331, p. 585-589.
12. David Hubel, Eye, Brain and Vision, Scientific American Library, 1988.
13. Robert Doty, « The Five Mysteries of the Mind and their Consequences », Neurophyschologia, 1998, n° 36, p. 1069-1076.
Préface à l’édition de 1998Sauver l’art et la science
CARTES À COLLECTIONNER de tueurs en série, surmédiatisation de l’affaire O. J. Simpson, festivals et séminaires consacrés à la pornographie dans les universités, chats pédophiles sur Internet, numéros verts d’astrologie, sculptures faites de préservatifs à Harvard, trafic d’objets de collection nazis, mascarade sexuelle du président des États-Unis, regain d’intérêt pour De sang-froid, présenté comme de la grande littérature, et pour le photographe Mapplethorpe, présenté comme un grand artiste… qu’arrive-t-il à la culture américaine ? Ce qui la touche aurait-il un lien avec l’explosion scientifique et technologique, c’est-à-dire avec l’annonce des progrès permis par une conception purement matérialiste et évolutionniste de la nature et de la destinée de l’homme, et la création d’une technologie capable aujourd’hui de défaire le champion du monde d’échecs, et demain de dépasser en complexité le cerveau humain et ses dix milliards de neurones ?
Michael Aeschliman, en appelant C. S. Lewis et son œuvre à l’aide, nous offre un texte bref, efficace et brillant, où nous découvrons une réponse nue et sans concession. En affirmant la philosophia perennis de Lewis – « le bien est quelque chose d’objectif, et la raison est l’organe par lequel on l’appréhende » –, il centre son ouvrage sur la foi essentielle sur laquelle repose la civilisation : Dieu est bon et il triomphera. Il montre que, séparés de Dieu, l’art et la science ne sont qu’un babil incohérent aisément obsédé par l’attrait lubrique du mal.
Lewis citait Thucydide : « La simple bonté devint un sujet de dérision et disparut. » Comme l’observait Lewis en 1936, Aeschliman affirme cette évidente vérité que l’art a perdu la « capacité à représenter la vertu de façon convaincante ». Puisque rien d’autre ne vaut la peine d’engager un effort esthétique, cela signifie la mort de l’art lui-même.
Relativisez l’absolu, remarque-t-il, et vous absolutisez le relatif. En éclipsant le règne des absolus définis par Dieu, la science elle-même chancelle et tombe dans la gueule béante du relativisme. Avec le retournement des hiérarchies de l’esprit et de la matière, la raison laisse place au colportage de faits induits sur les mornes plaines du web. En détruisant les échelles qui permettent d’accéder aux valeurs et à la divinité, on transforme non seulement le bien et le beau, mais aussi la vérité scientifique en trivialités vides de sens. « Plus l’Univers est compréhensible, moins il paraît avoir de sens », déclarait le prix Nobel de physique Steven Weinberg. C’est cette pauvre bannière vierge qui sert d’ersatz au Décalogue pour défendre la civilisation. Abandonnant le simple bon sens, Homo sapiens se soumet volontiers à l’autorité d’Homo sciens, mais dégénère presque immédiatement en Homo sentiens, qui se définit non par ce qu’il pense, mais par ce qu’il ressent.
Après le passage du réductionnisme scientifique, la vie humaine n’a plus qu’un but : la recherche du plaisir. Les hommes, qui n’adorent plus que le grand dieu Hêdonê, voient dans le plaisir sexuel, et non plus dans le savoir, le bien suprême. Hêdonê, séduisant, attire le pèlerin dans sa descente vers la Foire aux vanités, et se mue, longue forme phallique, en totem religieux. Adolescents, adultères, homosexuels et prêtres voient dans l’activité sexuelle une précieuse « affirmation de la vie » (en s’assurant bien entendu qu’aucune vie n’en sorte).
Lorsque le plaisir sexuel est le bien ultime, toutes les valeurs s’inversent. Dieu, par exemple, devient mauvais parce qu’il constitue un obstacle à l’avortement et au plaisir. Pour la religion qui prône une culture et une science athées, les victimes du sida sont les seuls parangons de morale, qui atteignent à la sainteté en sacrifiant leur vie au plaisir sexuel.
Le livre de M. Aeschliman rend intelligibles ces absurdités comme expressions inexorables de la lutte entre la sapientia et le scientisme ou celle qui oppose le sens commun, le sens de la transcendance, au spectacle insensé de scientifiques dont l’unique but est de prouver que leur existence n’en a aucun. Comme Lewis le répétait, on détruit un objet second (la science empirique) en lui donnant la place d’un objet premier (une vérité permanente). « La philosophie, qui s’appuyait sur le Ciel, / Réduite à sa cause seconde, a disparu », disait Pope : il en va de même pour la science. Élever la science au rang de religion subvertit la science et la religion pour ne laisser qu’un champ de ruines. La science, nous redit Aeschliman, est un bon serviteur mais un mauvais maître.
Ni la science ni la technologie, ainsi qu’il le montre, ne peut prospérer bien longtemps dans une culture qui rejette toute transcendance. Les intellectuels d’aujourd’hui mènent une guerre suicidaire contre l’esprit même, alors qu’il est évidemment l’indispensable source de la science. Ils nient que l’esprit transcende la matière et réduisent de ce fait leurs propres mécanismes de pensée à de simples réactions biochimiques. Ils nient la transcendance et rejettent l’esprit et deviennent de ce fait des conglomérats aléatoires de composants carbonés en mutation, inférieurs aux formes de vie émergentes basées sur le silicium. Dans leur tentative de distiller l’esprit à partir de la matière, comme le dit Max Delbruck, prix Nobel de chimie, ils ressemblent au baron de Münchhausen qui cherche à se sortir d’un bourbier en tirant sur ses propres cheveux.
En intégrant élégamment Lewis dans le contexte du débat presque éternel entre le scientisme réducteur et une sagesse de l’équilibre qu’il nomme sapientia, Aeschliman nous met en garde : « Le déterminisme ronge la raison commune. » La science commence par chasser la superstition et l’erreur, mais elle finit par embrasser l’erreur moderne la plus insidieuse : la superstition matérialiste, autrement dit la croyance – intenable même dans le contexte de la physique moderne, science suprême de la matière – selon laquelle la matière constitue le tout de ce qui existe. La superstition du scientisme « finit par dévorer les vérités elles-mêmes, ne laissant que le squelette de la réalité physique ».
Aeschliman dévoile avec beaucoup de finesse le grand thème qui se trouve au cœur de l’œuvre si éclectique de Lewis : la « restauration de l’homme ». La morale fondamentale d’un art et d’une science rédempteurs consiste à sauver nos âmes de l’hérésie matérialiste, l’hérésie du « rien d’autre que », qui considère que nous ne sommes rien d’autre qu’une « partie de la nature au même titre qu’une pierre, ou qu’un cactus, ou qu’un chameau ». Un scientisme qui abolit l’homme de la sorte abolit également Dieu et invalide la raison du scientifique matérialiste. Toute théorie qui nie la transcendance de son théoricien s’autoréfute. Comme le dit Aeschliman, « en sapant implicitement la validité de la pensée rationnelle, les naturalistes modernes rendent tout ce qu’ils ont à dire insignifiant et contradictoire. […] Dire, avec les empiristes radicaux, que seules les affirmations factuelles sont valides, c’est faire preuve non seulement de dogmatisme, mais encore de contradiction, puisque cette affirmation elle-même n’est pas factuelle. » Lewis appelait cette superstition « le doux poison du faux infini ».
Citant le physicien Stanley Jaki, Aeschliman affirme que la science véritable est née non avec les agrégats aléatoires de faits de Francis Bacon, mais avec la reconnaissance préalable du fait que le monde est rationnel et peut donc être saisi par la raison humaine. Comme produit d’un Créateur transcendant, cependant, la rationalité ne peut être dérivée du seul esprit de l’homme, sa créature. Là est le paradoxe central. Le monde peut être appréhendé par la raison humaine dans la seule mesure où la raison transcende l’homme et participe de la permanence divine.
Ce livre est court ; l’œuvre de Lewis est volumineuse. Mais Aeschliman produit un petit miracle en distillant l’essence de la somme lewisienne en cinq chapitres. Le grand déiste Einstein est appelé à la barre : « La religion sans la science est boiteuse, mais la science sans la religion est aveugle. » Le scientisme déclare que tous les faits sont objectifs et que toutes les valeurs sont subjectives et subordonnées aux faits. Objectivité et subjectivité se toisent de part et d’autre d’un gouffre infranchissable.
Dieu est le seul pont qui peut relier l’esprit et la matière, et leur donner du sens. L’idée d’une matière sans esprit capable d’engendrer une subjectivité signifiante est, manifestement, bien moins crédible que celle d’une subjectivité ultime – Dieu – qui fait naître chez ses créatures préférées une conscience et une raison subordonnées. L’effet du scientisme, au bout du compte, est « la dissolution de la distinction qualitative absolue entre personnes et objets », ce qui conduit à l’« abolition de l’homme » – pour reprendre l’expression de Lewis – et à donner les rênes aux objets pour chevaucher l’humanité.
Espérons que cette réédition de La Restauration de l’homme servira de remède efficace à la dégénérescence que nous vivons. À l’heure du triomphalisme technologique, il est plus nécessaire que jamais de s’assurer que le triomphe de la science soit un triomphe de l’humanité, non un triomphe sur elle. Ce livre constitue un guide essentiel pour affronter les dangers du scientisme, et propose une science véritable et durable sous le regard de Dieu.
George GILDER
Préface à l’édition de 1983L’échelle de la vérité
C. S. LEWIS A TOUJOURS été entouré d’un certain mystère quant à l’écart entre l’homme et l’apologue chrétien. À tout point de vue, c’était un professeur d’université comme tant d’autres, dans ses façons, dans ses pensées et ses plaisanteries comme dans son style d’enseignement. Dans le même temps, il se révéla un apologue chrétien des plus efficaces, dont l’attrait franchit toutes les barrières de classe, de tempérament ou de dénomination. Ses interventions à la radio, souvent rediffusées, attiraient une audience exceptionnellement large, et ses écrits religieux, dont les ventes se comptent en millions d’exemplaires, ont généralement rencontré un énorme succès auprès des érudits comme du grand public. Un livre comme Tactique du diable est considéré comme un classique, au même titre que les Voyages de Gulliver de Swift ou que La Ferme des animaux d’Orwell. Il ne fait pas de doute que, dans le monde anglophone au moins, une majorité de chrétiens convertis reconnaissent devoir beaucoup à ses Fondements du christianisme, et chérissent les mots, les idées et la fantaisie de Lewis – ses Chroniques de Narnia, par exemple, ont été adaptées avec succès au cinéma.
Je l’avoue, j’ai longtemps eu quelque difficulté à considérer Lewis comme le plus grand apologète chrétien de notre temps, et à le recommander comme tel. L’étude que lui consacre ici Michael Aeschliman m’a été d’une grande aide et je lui en suis reconnaissant. Avec une remarquable finesse et une grande érudition, en prenant appui sur de nombreux auteurs qu’il cite longuement, il fait voir au lecteur que les maniérismes savants de Lewis ne sont qu’une façade derrière laquelle se trouve un humble chercheur de vérité, un pèlerin ordinaire sur les routes poussiéreuses du monde. Cette qualité de pèlerin fait de Lewis un continuateur de Bunyan plutôt que de saint Thomas d’Aquin ou de John Henry Newman – voire de Cervantès ; dans le chaudronnier de Bedford, il voit à raison la véritable et vivante image de l’Homme ordinaire qui chemine vers la Cité céleste en faisant face aux dangers qu’il rencontre et en évitant les précipices et les raccourcis. Comme l’écrit Bunyan :
Certaines personnes se rendant à la maison de leur père auraient désiré que le chemin continue dans une vallée verdoyante, afin de s’éviter la peine de franchir montagne ou collines ; mais le chemin est toujours un chemin, et il a une fin.
Le professeur aime et fait résonner les certitudes du chaudronnier.
Comme le montre Aeschliman, c’est cette présentation terre-à-terre du christianisme, fondée sur le sens commun, qui rend la ferveur de Lewis si attrayante. Ses écrits contiennent peu de mysticisme, au sens ordinaire du mot : il ne mentionne ni vision venue renforcer sa foi ni don des langues pour l’exprimer. Parmi les figures du passé, il voit dans le Dr Johnson plutôt que dans les saints – François d’Assise ou Thérèse d’Ávila – l’exemple du bon chrétien ; parmi les contemporaines, moins dans T. S. Eliot ou le pape Jean XXIII que dans le journaliste G. K. Chesterton, qui a réussi à injecter l’Esprit saint, le Consolateur, dans le flot de paroles que sa profession exigeait – imaginez une gargouille dessinant le plan d’un clocher. Pour citer Aeschliman, « de même que le Dr Johnson combattit le rationalisme du XVIIIe siècle, impie à force d’excès, Chesterton et Lewis combattirent le naturalisme excessif qui imprégna – et corrompit – une grande partie du XXe siècle. L’un comme l’autre, ils choisirent les formes littéraires de l’essai satirique, du roman et de l’apologue en prose, qui constituent leur durable héritage ».
Dans la grande bataille qui fait rage, depuis le siècle des prétendues Lumières, entre le savoir – ou, dans le jargon contemporain, le scientisme – et la foi, entre scio et credo, Lewis est clairement dans le camp de la foi. De même que Blake, qui avait écrit, sur la première page de son exemplaire des Essais de Bacon : « Bons conseils pour rejoindre le royaume de Satan ». Aujourd’hui plus que jamais, nous devons décider de quel côté nous placer, et Lewis sera d’une aide précieuse pour faire ce choix crucial, plus encore si l’on a lu le livre de M. Aeschliman comme une note de bas de page à la gloire de son œuvre. J’aime beaucoup le dernier mot qu’il consacre à l’homme dont il a si consciencieusement étudié, si minutieusement étudié et si lumineusement expliqué les pensées et les croyances : « [Lewis] s’est incliné devant la contrainte de la vérité : c’est ainsi qu’il a pu en escalader l’échelle. »
Malcolm MUGGERIDGE
Introduction de l’auteurLa restauration de la personne et l’usage de la mémoire contre la prétention transhumaniste14
CE LIVRE AVAIT INITIALEMENT été publié aux États-Unis et en Angleterre sous le titre The Restitution of Man ; j’aurais préféré The Restoration of the Person, parce que « restauration » est plus juste et que je visais bien sûr la personne humaine, et non seulement les individus de sexe masculin. Mais nous avons finalement choisi le titre français La restauration de l’homme, pour faire écho au titre du célèbre essai de Lewis, L’abolition de l’homme, où il est clair que le sujet est l’« être humain intégral », dans son statut même de personne.
À propos de cet homme-personne, il est intéressant de se pencher sur un fait historique capital, le choix que fit Thomas Jefferson de rédiger ainsi le deuxième paragraphe de la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776) : « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux et doués par le Créateur de certains droits inaliénables », alors que la première version du texte était : « Nous tenons pour sacrées et indéniables les vérités suivantes. » Cette formulation initiale aurait été bien plus bénéfique à la République américaine et au monde moderne sur le long terme, car elle révélait et restaurait l’idée catholique traditionnelle de res sacra homo, de la personne humaine comme sujet et objet irréductiblement sacré.
C’est ce concept que j’ai tâché de retrouver, de rénover, de défendre : le caractère sacré et la valeur de la personne humaine – personne, non simple chose ; sujet, non simple objet ; fin, non simple moyen ; essence, non simple existence ; âme, non simple corps ; valeur, non simple fait. Contrairement à l’hypocrite esclavagiste Jefferson, nous devons croire que cela s’applique aux hommes comme aux femmes, aux Blancs comme aux Noirs, aux esclaves comme aux hommes libres, aux juifs comme aux Grecs, et ainsi de suite, comme nous l’a enseigné la tradition chrétienne depuis des siècles (voir l’Épître de saint Paul aux Galates, 3, 28). Nous devons nous ranger dans le camp d’Abraham Lincoln et d’Alexis de Tocqueville, non dans celui du soi-disant « démocrate » Jefferson, intelligent pionnier de la pensée « raciste scientifique » aux États-Unis, qui possédait des esclaves et avait en secret des enfants illégitimes avec une jeune esclave noire.
Mais pourquoi l’idée de res sacra homo, vérité centrale dans notre civilisation au point d’en être presque un cliché, aurait-elle besoin de l’appui de C. S. Lewis, et a fortiori du mien ? La réponse à cette question est philosophique et historique, et elle est complexe, mais elle ne mérite pas l’incompréhension qu’elle rencontre aujourd’hui. Il n’y a certes jamais eu, dans les temps historiques, d’« âge d’or » de la civilisation, mais cette idée foncièrement noble était souvent mieux comprise par le passé, même encore récemment. L’universitaire juif américain Samuel Moyn a démontré le rôle essentiel du christianisme dans la formulation et la défense de l’idée de res sacra homo, d’abord dans The Last Utopia : Human Rights in History (2010), puis dans Christian Human Rights (2015). D’après Moyn, les efforts des catholiques et des protestants du XXe siècle pour sauvegarder les droits humains fondamentaux souffrent d’un manque certain de reconnaissance et d’étude ; les grands héros de cette histoire révisionniste sont Jacques Maritain, Pie XII et le président américain Jimmy Carter.
Le professeur italien Francesco Germinario a publié en 2017 un livre au titre frappant : Un mondo senza storia? La falsa utopia della società della poststoria (Un Monde sans histoire ? La fausse utopie de la société post-historique). Le principe de l’histoire comme guide a été ignoré et dévalorisé sous l’influence de l’idée supersessioniste15 de progrès collectif, la croyance largement répandue en une amélioration morale garantie, immanente au cours de l’histoire, qui dénigre l’expérience et la connaissance humaines passées.
L’idée d’un progrès ou d’une amélioration inévitable, cumulative, collective et irréversible, que d’aucuns ont appelée l’« interprétation whig de l’histoire », n’a cessé de se développer en Occident à partir du XVIIe siècle ; en 1914, elle était largement acceptée et avait pour ainsi dire remplacé l’orthodoxie chrétienne comme idéologie centrale en Occident. Laissons la parole à l’éminent historien américain Henry F. May, qui écrivait en 1989 :
Ce point de vue progressiste et laïc de l’histoire était en fait si puissant, qu’Auschwitz et Hiroshima n’ont fait que l’écorner sans le détruire. C’est dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, avec la désillusion de beaucoup d’intellectuels américains vis-à-vis de l’Union soviétique, soi-disant patrie du progrès et bastion de la laïcité, qu’il a davantage souffert. Mais le progressisme historique n’a succombé que très lentement.
En réalité, et en dépit des preuves accablantes de ses conséquences apocalyptiques que l’histoire de l’Occident et du monde nous a données depuis 1914, l’interprétation « whig », ou laïque-progressiste de l’histoire, libérée de la concurrence marxiste plus tragiquement erronée encore, n’a pas succombé. Sa croyance sous-jacente, rarement exprimée, dans une sorte de loi téléologique et immanente du progrès, résiste manifestement à toute infirmation empirique fondée sur les faits historiques. Nous ne devrions pas avoir à le faire, mais prenons quelques faits parfaitement avérés. « Le prix des expériences [communistes marxistes] utopiques est ahurissant, écrit Richard Pipes, spécialiste à Harvard de l’histoire russe. Elles ont eu un énorme coût en vies humaines. » Et de citer Stéphane Courtois, « éditeur du Livre noir du communisme, qui estime le nombre global de victimes du communisme entre 85 et 100 millions, soit une fois et demi le nombre de morts des deux guerres mondiales ». À propos de ces tueries de masse sans précédent, le grand philosophe libéral juif d’Oxford Isaiah Berlin (1909-1997) écrivait : « J’ai vécu la plus grande partie du XXe siècle, sans avoir à souffrir, je dois le dire, de difficultés personnelles. Pourtant,tout ce que je me rappelle, c’est qu’il s’est agi du pire siècle de l’histoire de l’Occident16. » (Je souligne.)
Mais la formulation la plus lapidaire et la plus essentielle de ce point crucial de l’argumentation est sans doute celle que fit il y a quarante ans un philosophe juif émigré plus profond et plus perspicace, Leo Strauss (1899-1973) :
L’idée de progrès au sens moderne implique que, dès lors que l’homme a atteint un certain niveau, intellectuel et moral ou social, il se hisse à un niveau fixe, en dessous duquel il ne peut plus sombrer. Cette assertion, pourtant, est empiriquement infirmée par l’extraordinaire barbarisation dont nous avons été les témoins malheureux [au XXe siècle]17.
En effet, empiriquement infirmée. Personne n’avait vraiment pris G. K. Chesterton au sérieux quand il affirmait, avant la Première Guerre mondiale, que la doctrine du péché originel était la seule doctrine empiriquement vérifiable du christianisme, mais c’était vrai ; c’est vrai, hélas. Isaiah Berlin a tâché de formuler cette idée, sans reconnaître son origine et son développement chrétiens, en citant Kant : « Dans un bois aussi courbe que celui dont est fait l’homme, on ne peut rien tailler de tout à fait droit. »
Mais nous devons attention et respect aux figures du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui ont sauvegardé et entretenu ce point de vue réaliste sur les possibilités offertes aux hommes, cette vieille idée d’une humanité partagée entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, la sagesse et la folie, la force et la faiblesse : les papes (en particulier Léon XIII), Kierkegaard, Tocqueville, Newman, Dostoïevski, Péguy, Chesterton, Gilson et Maritain. On peut encore citer le grand historien suisse Jacob Burckhardt (1818-1897)18, qui avait prédit que le XXe siècle verrait naître des tyrannies cauchemardesques, et dont les écrits ne furent connus du monde anglo-saxon qu’en 1943, au beau milieu d’une guerre mondiale exceptionnellement brutale et destructrice.
Et d’après l’historien hungaro-américain John Lukacs, le pieux agnostique Burckhardt, ancien séminariste protestant, a plus encore à nous apprendre : « Le grand Jacob Burckhardt avait sans doute raison lorsqu’il écrivait que les sentiments chrétiens d’immoralité et d’humilité étaient des sentiments dont l’ancien monde [gréco-romain] s’était montré incapable19. » Pour Lukacs, ce fut là « une mutation des consciences plus importante et plus profonde » qu’aucun changement de l’âge moderne. Soljenitsyne a tiré des conclusions similaires. On peut également dire, doucement mais fermement, et, s’il le faut, répéter, avec l’universitaire juif Moyn, que l’anthropologie et la philosophie chrétiennes, qui insistaient sur l’irréductible sacralité de la personne humaine au XXe siècle et à notre époque, ont été sous-évaluées et « sous-étudiées » – et bien souvent rejetées ou ignorées.
Ce changement de conscience, cette humanisation d’origine chrétienne, a mis des siècles à pénétrer complètement la société, pour donner finalement à l’Europe occidentale la beauté inoubliable et visionnaire de ses paysages et de ses cités, la noblesse de ses réussites philosophiques, éthiques, littéraires et artistiques, dont beaucoup ont survécu à la révolution industrielle et au « siècle de la guerre totale » dont parlait Raymond Aron pour désigner le XXe siècle. Comme l’écrivait l’éminent homme d’État américain George F. Kennan (1904-2005) dans son journal (Vendredi saint, 1980) : « La plupart des événements humains subissent l’érosion du temps. […] La plus extraordinaire, la plus grande des exceptions à cette généralisation » est la vie de Jésus-Christ. Kennan poursuit, à propos des fondations de la doctrine chrétienne : « La combinaison de ces deux choses, charité et rédemption, […] a inspiré une immense civilisation, donné naissance à un art supérieur, érigé cent mille églises magnifiques, […] donné forme et discipline aux esprits et aux valeurs de nombre de générations ; marqué de son sceau artistique l’une des plus grandes floraisons de l’esprit humain20. » On peut dire de cette tradition qu’elle est la défense ultime et permanente de l’esprit humain contre ses éternels ennemis à tête d’hydre.
Devant la mode et le fanatisme scientistes contemporains, particulièrement visibles aujourd’hui dans les débats autour de la génétique et dans des mouvements séduisants comme le « transhumanisme », il faut se tourner vers les humanistes chrétiens comme Jacques Maritain





























