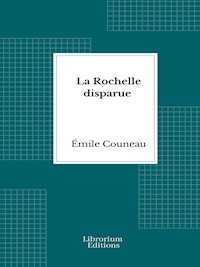
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
SIMPLE village de pêcheurs, établi sur la partie la plus élevée de notre littoral, pour fuir les tempêtes de l’Océan et les marécages de la côte ; un petit groupe de pauvres cabanes, au lieu dit : de Cougnes, devait être le berceau de La Rochelle.
La ville naissante fut restée absolument inconnue jusqu’au XIIe siècle, si son nom n’avait figuré, en 961, dans une charte de Guillaume Tête d’Etoupe, duc d’Aquitaine, comportant droit de péage sur son port, au profit de l’abbaye de Saint-Michel, en Vendée ; encore conteste-t-on l’authenticité de ce titre.
Donc, point de légende pour poétiser l’origine de la ville ; point de tradition qui donne libre champ à l’imagination populaire ; rien non plus pouvant la rattacher à l’époque Gallo-romaine.
Le modeste estuaire, qui servait de port, était formé par le cours d’eau qui descend du faubourg de Lafond à la mer, et qu’on appelait alors le chenal de Parthenay, dont le nom rappelait le souvenir des barons de Châtelaillon et des Mauléon, gouverneurs du pays d’Aunis. Les frêles embarcations, qui constituaient la navigation de cette époque, remontaient jusqu’à la partie ouest du terrain occupé aujourd’hui par la place d’Armes.
Pour mettre à l’abri des attaques du dehors ce port naturel et primitif, les sires de Mauléon élevèrent une tour sur un point où La Roche émergeait d’un milieu marécageux. Ce fut là, dit-on, l’origine du nom que devait porter dorénavant La Rochelle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
La Rochelle disparue
Émile Couneau
1904
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383837800
Table des Matières
SERMENT D’UN MAIRE - DANS L’ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY
PRÉFACE
CHAPITRE IER - Les Murailles, les Tours et les Portes de Ville
I - LES MURAILLES
II - LES TOURS
III - LES PORTES DE VILLE
IV - ENTRÉE SOLENNELLE DES SOUVERAINS
V - LA DERNIÈRE ENCEINTE
CHAPITRE II - Les Tours de l’Entrée du Port et de la Lanterne
I - LA TOUR DE LA CHAINE
II - LA PETITE TOUR DE LA CHAINE
III - LA TOUR SAINT-NICOLAS
IV - LA TOUR DE LA LANTERNE
CHAPITRE III - Le Port, la Grande et la Petite-Rive, le Havre
I - LA GRANDE-RIVE
II - LA PETITE-RIVE
III - LE HAVRE
CHAPITRE IV - La Verdière, la Grosse- Horloge, le Canal Maubec
I - LA VERDIÈRE
II - LA GROSSE-HORLOGE
III - LE CANAL MAUBEC
CHAPITRE V - Les Rues et les Quartiers de la Ville
I - LES HABITATIONS
II - LES QUARTIERS ET LES PLACES DU PORT A L’HOTEL DE VILLE
III - DE L’HOTEL DE VILLE A L’ÉGLISE NOTRE-DAME
IV - DE LA PLACE DU CHATEAU A LA GROSSE-HORLOGE
V - LES QUARTIERS SAINT-JEAN ET SAINT-NICOLAS
VI - LA VILLE NEUVE
VII - LES RÉJOUISSANCES PUBLIQUES
VIII - FÊTES PATRIOTIQUES
IX - CONDAMNATIONS PUBLIQUES
X - RÉCEPTION DE SOUVERAINS
XI - LA PESTE ET LA FAMINE
XII. - LA POPULATION
XIII - LE PAVAGE
XIV - LES IMMONDICES
XV - L’ÉCLAIRAGE
XVI - LES NOMS DES RUES ET LE NUMÉROTAGE DES MAISONS
XVII - LES VIEILLES ENSEIGNES
CHAPITRE VI - Les Fontaines
I - LA VIEILLE-FONTAINE
II - FONTAINE
III - LA FONTAINE DE LA CAILLE
IV - LA FONTAINE DE NAVARRE
V - LA FONTAINE DU PILORI
VI - LA FONTAINE ROYALE
VII - LE PUITS DE LA PLACE D’ARMES
VIII - LA FONTAINE DE LA PRETINTAILLE
IX - LES PUITS DES QUARTIERS SAINT-JEAN ET SAINT-NICOLAS
X - LA FONTAINE DE LA MARÉCHALE
XI - LES SOURCES DE LAFOND
CHAPITRE VII - Les Marchés et les Corporations
I - LE MARCHÉ AU POISSON
II - LES BOUCHERIES
III - LE MARCHÉ AU PAIN
IV - LE MINAGE
V - LE MARCHÉ AUX COMESTIBLES
VI - LES CORPORATIONS
CHAPITRE VIII - Les Eglises, les Communautés Religieuses. et les Temples Protestants
I - NOTRE-DAME
II - SAINT-BARTHÉLEMY — LA CATHÉDRALE
III - L’ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
IV - L’ÉGLISE SAINT-JEAN
V - SAINT-NICOLAS
VI - L’EVESCOT
VII - COUVENTS ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES COUVENTS D’HOMMES
a. LES TEMPLIERS
b. LES HOSPITALIERS. — LES CARMES
c. LES AUGUSTINS
d. LES JACOBINS, OU FRÈRES PRÊCHEURS DES DOMINICAINS
e. LES CORDELIERS
f. LES JÉSUITES. — LE COLLÈGE ET LE LYCÉE
g. LES RÉCOLLETS
h. LES ORATORIENS
i. LES CAPUCINS
j. LES MINIMES
LES HOPITAUX - a. L’HÔPITAL AUFRÉDY
b. HOPITAL GÉNÉRAL
COUVENTS DE FEMMES - a. LE PRIEURÉ DE SAINTE-CATHERINE
b. LES SAINTES-CLAIRES
c. LES SŒURS-BLANCHES
d. LES RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES
c. LES URSULINES
f. LES SŒURS DE LA PROVIDENCE
g. LES DAMES-BLANCHES
VIII - LES TEMPLES PROTESTANTS
CHAPITRE IX - Le Présidial et la Bourse
I - LE PRÉSIDIAL ET LE PALAIS DE JUSTICE
II - LA BOURSE ET LA JURIDICTION CONSULAIRE
CHAPITRE X - L’Hôtel de Ville
I - CONSTITUTION DE L’ÉCHEVINAGE
II - JEAN GUITON
III - ORGANISATION MUNICIPALE
IV - LES SCEAUX ET LES ARMES DE LA VILLE
V - LA MONNAIE
VI - L’HOTEL DE VILLE
POSTFACE
SERMENT D’UN MAIRE
DANS L’ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY
Le maire Mérichon (1443 ) fit faire un livre où se trouvaient inscrits les noms des maires qui l’avaient précédé. Jourdan put se procurer le premier feuillet de ce manuscrit, en tête duquel figurait la miniature que nous reproduisons.
« Cette miniature — dit Jourdan — représente une élection de maire, probablement celle de Mérichon, dans l’église Saint-Barthélemy, et peut-être faut-il voir son portrait dans l’échevin vêtu d’une longue robe grise garnie de fourrures, qui, à genoux devant la table des scrutateurs, sur laquelle est ouvert le livre des Evangiles, prête serment avant de déposer son vote. »
Planche en couleurs sortie des ateliers de M. Berton, rue Christine, n° 1, Paris.
PRÉFACE
En publiant ce volume, nous n’avons pas eu la prétention d’apporter de nouveaux éléments à l’histoire si captivante de cette petite république : la commune Rochelaise.
Après les impérissables monuments que nous ont laissés les historiens, aprés Amos Barbot, Mervault, Arcère, après les travaux, pleins d’érudition, des écrivains distingués qui, de nos jours, se sont occupés d’histoire locale, il eut été téméraire à nous de prétendre apporter un complément à leur œuvre.
Nous avons simplement pensé qu’il pouvait être intéressant de tirer de l’oubli et porter à la connaissance de tous une quantité de dessins, de plans, de graphiques de toutes sortes, conservés, soit dans des collections particulières, soit surtout aux archives de la Bibliothèque et de l’Hôtel de Ville ; de leur donner une forme nouvelle, tangible, facile à vulgariser, grâce aux procédés dont la gravure dispose aujourd’hui.
Ces images, souvent incorrectes, mais sincéres dans leur naïveté, nous ont aidé à faire revivre ces vieux monuments, à jamais disparus, autour desquels nos pères ont lutté pour leur indépendance et leur foi religieuse.
Mais il ne suffisait pas de mettre à la portée de tous ces précieux documents, restés jusqu’alors à la disposition exclusive de quelques privilégiés. Pour rendre plus saisissante l’image que nous mettons sous les yeux du lecteur, il nous a semblé qu’il était indispensable de l’accompagner d’un texte explicatif.
C’est donc, en un mot, un recueil de gravures, une sorte d’album, que nous livrons à la publicité, et, contrairement aux usages en pareille matière, le texte n’est qu’un accessoire des illustrations.
Voilà dans quelles conditions nous avons été amené à assumer toute la responsabilité d’un travail, peut-être au-dessus de nos forces, mais dont l’attrait nous a soutenu, pour mener notre tâche jusqu’au bout.
Les sources auxquelles nous avons puisé, pour la reproduction de ces anciens dessins, sont les vieux plans de la Ville, les livres de l’ingénieur militaire Masse, les curieuses aquarelles de Bournaud, un rochelais de la paroisse Saint-Sauveur, qui aimait sa ville, mais dont les connaissances en dessin étaient fort limitées.
Tous ces éléments nous ont permis de reconstituer à peu près le passé. Nous avons cru devoir faire entrer également dans le cadre de cet ouvrage, la reproduction de différents motifs, curieux à rappeler, qui, à notre époque, ont subi une notable transformation.
Chaque jour, en effet, les nécessités de la vie, les besoins d’extension d’une ville en pleine prospérité, les rigueurs administratives de toutes sortes, justifient la création d’établissements nouveaux, réédifiés sur ceux d’un autre âge.
Ce que nous avions naguère sous les yeux disparaît, remplacé par des édifices plus commodes et mieux aménagés. Une vieille rue, dont l’élargissement est devenu nécessaire pour les facilités de la circulation, voit substituer à ses pittoresques maisons de bois, la banalité de nos constructions modernes.
Une fois démoli, ce que nous voyions hier, s’oublie vite, s’il ne reste rien pour en perpétuer le souvenir. Il n’est pourtant point sans intérêt, pour nos contemporains, de leur rappeler, par l’image, les choses qu’ils ont connues, et, pour ceux qui nous suivront, de leur laisser le témoignage de ce qui a été et qui n’est plus.
En nous mettant à l’œuvre, pour la publication de ce volume, nous ne nous sommes point illusionné sur les difficultés sans nombre avec lesquelles nous allions être aux prises, sur l’insuffisance des moyens dont nous disposions pour une entreprise aussi complexe.
Nous n’avons voulu faire, ni œuvre d’artiste, ni œuvre d’écrivain ; aussi espérons-nous que le lecteur nous pardonnera celle tentative, que d’autres, après nous, pourront reprendre avec plus d’habileté et d’érudition.
Nous considérerons notre tâche comme suffisamment remplie, si nos concitoyens trouvent quelque intérêt à la lecture de cet ouvrage ; si les simples images qui accompagnent le texte leur permettent de reconstituer, comme dans le rayonnement d’une lointaine vision, l’attachante physionomie de notre vieille ville, dont les glorieux vestiges évoquent encore en nous le souvenir de luttes douloureuses et de résistances héroïques.
LE BASTION DE L’ÉCHELLE DE LA COURONNE
Et le Quartier Notre-Dame
(XVme Siècle)
LE BASTION DE L’ÉVANGILE ET LA TOUR SERMAISE
CHAPITRE IER
Les Murailles, les Tours et les Portes de Ville
I
LES MURAILLES
SIMPLE village de pêcheurs, établi sur la partie la plus élevée de notre littoral, pour fuir les tempêtes de l’Océan et les marécages de la côte ; un petit groupe de pauvres cabanes, au lieu dit : de Cougnes, devait être le berceau de La Rochelle.
La ville naissante fut restée absolument inconnue jusqu’au XIIe siècle, si son nom n’avait figuré, en 961, dans une charte de Guillaume Tête d’Etoupe, duc d’Aquitaine, comportant droit de péage sur son port, au profit de l’abbaye de Saint-Michel, en Vendée ; encore conteste-t-on l’authenticité de ce titre.
Donc, point de légende pour poétiser l’origine de la ville ; point de tradition qui donne libre champ à l’imagination populaire ; rien non plus pouvant la rattacher à l’époque Gallo-romaine.
Le modeste estuaire, qui servait de port, était formé par le cours d’eau qui descend du faubourg de Lafond à la mer, et qu’on appelait alors le chenal de Parthenay, dont le nom rappelait le souvenir des barons de Châtelaillon et des Mauléon, gouverneurs du pays d’Aunis. Les frêles embarcations, qui constituaient la navigation de cette époque, remontaient jusqu’à la partie ouest du terrain occupé aujourd’hui par la place d’Armes.
Pour mettre à l’abri des attaques du dehors ce port naturel et primitif, les sires de Mauléon élevèrent une tour sur un point où La Roche émergeait d’un milieu marécageux. Ce fut là, dit-on, l’origine du nom que devait porter dorénavant La Rochelle.
LE CHATEAU
Il est impossible de préciser l’endroit où se dressait cette première construction, mais ce ne fut pas moins le point initial de cette ceinture de murailles qui devait, à diverses époques, faire de La Rochelle une ville considérée longtemps comme imprenable.
On sait les événements qui firent passer La Rochelle des mains des Mauléon dans celles d’Henri Plantagenet, époux d’Aliénor d’Aquitaine.
Pour s’assurer l’attachement de ses nouveaux sujets et, peut-être, pour avoir plus facilement l’assurance de leur soumission, Henri fit élever les premières fortifications de la ville. C’est à lui qu’on doit la construction, en 1185, du château de Vaucler, servant de défense au premier port.
On possède sur cette forteresse des indications, d’après les vieux plans de la ville, qui permettent d’en préciser la forme et l’emplacement ; sa restitution, que nous avons reproduite déjà, basée sur des documents certains,1 nous permet de rétablir de nouveau la physionomie de ce manoir féodal.
Le château de Vaucler avait la forme d’un quadrilatère flanqué de quatre tours à chaque angle, les deux plus importantes, tournées vers l’ouest et assurant plus particulièrement la défense du port. L’entrée, à l’est, donnait sur un vaste espace, qui prit le nom de « place du Château ».
Ce n’était pas seulement une forteresse destinée à loger la garnison. Il devait y avoir des logements habitables pour les personnes de distinction. Henri III, roi d’Angleterre, écrivait le 9 août 1220, au maire de La Rochelle, de vouloir bien recevoir dans le château sa sœur Jehanne et ses gardes. Au départ de la princesse, il fut remboursé cinquante marcs et demi « pour les dépenses faites pendant son séjour, à la commune de La Rochelle ». 2
Nous aurons souvent l’occasion de parler de ce vieil édifice aux formes massives, qui joua un rôle important dans l’histoire de la ville, jusqu’à sa démolition, en 1373.
Aux flancs de cet énorme donjon vint se souder la première enceinte de la ville. Guillaume X, comte de Poitou, établit, en 1130, une muraille formant une sorte de quadrilatère partant du château, se dirigeant vers le nord et tournant brusquement de l’ouest à l’est, suivant une ligne à peu près parallèle à la rue du Minage actuelle. Elle rejoignait la porte Mallevault ou du Gros-Seing, dont il est question ci-après, puis descendait du nord au sud jusqu’au canal Maubec, pour prendre ensuite une direction difficile à préciser, englobant une partie des paroisses Saint-Sauveur et Saint-Barthélemy. Enfin ce mur d’enceinte longeait le cours d’eau de Lafond pour rejoindre le château, laissant ainsi en dehors des murs, les faubourgs de Cougnes, Saint-Nicolas et du Perrot.
Dans la guerre que soutint l’Angleterre contre Philippe-Auguste, les Rochelais, bénéficiant des privilèges concédés par Aliénor, Henri II et Jean sans Terre, restèrent fidèles à la cause de la Grande-Bretagne.
Louis VIII continua la guerre engagée par son père Philippe-Auguste, et après avoir pris Niort et Saint-Jean-d’Angély, arriva sous les murs de La Rochelle le 15 juillet 1224. Il trouva, comme nous venons de l’indiquer, la ville enclose de fortes murailles et résolue à se bien défendre.
SIÈGE DE LA VILLE PAR LOUIS VIII
La lutte des Rochelais contre l’armée du roi fut acharnée. Louis avait fait élever de grandes plates-formes pour dominer les remparts et projeter, à l’aide de balistes, de lourdes pierres qui effondraient les toitures des maisons.
La résistance fut héroïque ; mais, mystifiés par les Anglais qui ne leur envoyèrent que du sable et de la ferraille, au lieu de subsides et de munitions ; abandonnés par Mauléon, leur défenseur, qui s’enfuit en Angleterre, les Rochelais ouvrirent leurs portes aux armées du roi de France.
« ... LA RÉSISTANCE FUT HÉROÏQUE... »
Tout le pays d’Aunis dut subir les déprédations résultant des effroyables luttes auxquelles se livraient la France et l’Angleterre.
Après la défaite et la capture du roi Jean à la bataille de Poitiers, La Rochelle fut comprise dans le traité de Brétigny (1360), qui la livrait aux Anglais, afin de conserver la liberté du roi de France. De nouveau soumis à la domination anglaise, les Rochelais n’en conservèrent pas moins leurs privilèges. Ils recherchèrent, néanmoins, toutes occasions pouvant les soustraire au joug de cet éternel ennemi, auquel ils avaient prêté serment des lèvres, restant français par le cœur.
Afin de reconquérir cette partie du territoire arrachée à la France, Charles V demanda l’assistance du roi de Castille. Celui-ci arma une flotte, qui vint dans les eaux de La Rochelle et, après deux journées de combat, détruisit la marine anglaise le 22 juin 1372.
Malgré cette victoire, la ville restait toujours aux mains de l’étranger. Les Espagnols reparurent encore devant La Rochelle au mois d’août suivant, comptant délivrer la ville par mer, tandis que Duguesclin opérerait du côté de terre. L’amiral espagnol demanda aide aux Rochelais, mais ceux-ci ne purent que répondre qu’ils ne se pouvoyent tourner françois tant que le castel fust en la possession des Anglais.
Ce fut alors que Jehan Chaudrier usa d’un subterfuge, peut-être plus habile qu’honnête. Il demanda au gouverneur du château, sur une prétendue missive du roi d’Angleterre, de faire le dénombrement des gens armés de la ville et de passer la revue des troupes d’occupation. Quand la garnison anglaise fut hors du château, douze cents Rochelais, bien armés, s’emparèrent de la forteresse et délivrèrent la ville.
Après soumission au roi de France, il fut stipulé, entre autres conditions, afin de faire disparaître, à tout jamais, ce château derrière lequel les Anglais se retranchaient pour s’assurer, à leur profit, l’occupation du pays, que : « Le château de Vauclerc serait rasé, « et que ses démolitions seraient employées à l’achèvement et à la défense du nouveau « port. ».La vieille forteresse subit le sort que les Rochelais avaient exigé du roi, à l’exception des quatre tours d’angle, que Charles V se réserva pour servir de « prisons royales. »
Passons rapidement sur une série d’événements concernant l’histoire rochelaise, pour ne parler que de ce vieux donjon, objet de terreur pour les habitants qui voulaient, à tout prix, faire disparaître ce dernier vestige de l’oppression étrangère.
Lorsque François Ier crut devoir venir à La Rochelle, pour châtier les habitants de leur refus de payer les droits excessifs dont ils étaient frappés — notamment l’impôt de la gabelle — les Rochelais, au paroxysme du désespoir, sous l’administration tyrannique du baron de Jarnac, firent bon accueil au roi. Le Corps de Ville et les Bourgeois vinrent au-devant de lui pour implorer sa clémence.
« On vit, dit le chroniqueur, arriver les pauvres prisonniers des isles, liez, enserrés, « tous montez sur chevaulx et conduitz par les archers du Roy, au chasteau de la Ville, « auquel il y a deux grosses tours ordonnées à mettre les prisonniers et le reste dudit « chasteau tout ruyné et desmoly ».
Un an après le siège que La Rochelle eut à soutenir, en 1573, contre le duc d’Anjou, les deux grosses tours du château, qui subsistaient encore et qui avaient eu beaucoup à souffrir des boulets des assiégeants, s’effondrèrent tout à coup et il ne resta plus rien du château de Vauclerc.
La ville prenait de jour en jour une extension nouvelle ; pour assurer sa sécurité, il fallut reculer l’enceinte des fortifications de Guillaume X.
Le premier agrandissement engloba une partie du faubourg de Cougnes, au nord de la ville. Ce faubourg, beaucoup trop peuplé, ne put être compris en entier dans le nouveau périmètre. Une partie fut laissée en dehors des murs, d’où vint la dénomination de « Cougnes-hors-les-Murs », et plus tard, simplement : « Cognebors », qui resta une commune distincte de celle de La Rochelle et qui n’y fut rattachée qu’en août 1858. Puis, successivement, furent compris dans l’enceinte de la ville : l’îlot du quartier de Saint-Jean-du-Perrot ; ensuite, le faubourg Saint-Nicolas ; enfin, la Petite-Rive, limitée par le mur de Saint-Nicolas, le port actuel et la fortification, appelée depuis : « le Gabut.. »
Lorsque Louis VIII d’Angleterre fit cause commune avec la ligue que le pape Jules II avait formée contre Louis XII, les Rochelais, redoutant les attaques de ces ennemis coalisés, se mirent, avec une nouvelle ardeur, à compléter leurs fortifications. La porte de Cougnes fut munie d’un « boulevard », et la porte Neuve, remise en état. Enfin, un ouvrage avancé fut établi devant la porte Saint-Nicolas. « Les contours — dit Masse3 — entre les tours de la vieille enceinte, estoient revêtus de pierres de taille de six à sept pieds d’épaisseur, ce qui avait fait tomber en proverbe, quand on voulait signifier quelque chose de fort, que l’on disoit communément : fort comme les murs de La Rochelle. »
PLAN DE LA ROCHELLE EN L’ÉTAT QU’ELLE ÉTOIT EN M.D.LXXIV.
Plus tard, en 1556, l’intervention de la royauté dans les travaux de fortification de la ville, inquiéta les Rochelais. Il avait été question, en effet, de faire une immense citadelle de tout le quartier du Perrot, en y comprenant les tours d’entrée du port. « Mais cet audacieux projet — dit Amos Barbot 4 — que les Rochelais envisageaient comme plus nuisible à leur liberté que redoutable aux ennemis du dehors, comprenait la démolition de l’église Saint-Jean, celle des Carmes et ses dépendances. » En présence des supplications des habitants auprès du roi, cette tentative, qui avait eu un commencement d’exécution, fut entravée et de beaux édifices furent ainsi préservés d’une ruine complète.
Déjà la Réforme avait pénétré dans La Rochelle ; la plus grande partie de la population avait adhéré à la religion protestante. Ce n’était plus seulement leurs frontières municipales que les Rochelais voulaient sauvegarder, c’était aussi leur foi nouvelle, à laquelle ils ne permettaient pas qu’on portât atteinte et dont le pouvoir royal voulait entraver les progrès. Aussi, prirent-ils la funeste résolution, sous la pression, soit du fanatisme, soit des nécessités de la défense, de détruire toutes les églises, pour en faire servir les matériaux à la consolidation de leurs murailles. Pour compléter les ouvrages avancés de la place, il fallut renverser la superbe tour dépendant de la seigneurie de Faye et l’important monastère de Saint-Jean-Dehors, sur la route de Rompsay, devant le bastion de la porte de Cougnes.
Par suite de ces adjonctions successives, lors du siège de 1572-1573, l’enceinte fortifiée comprenait, au sud, en outre des tours de l’entrée du port, tout le front de mer, depuis la porte Saint-Nicolas jusqu’à la tour de la Lanterne. A l’ouest, en remontant vers le nord, la fortification allait rejoindre la tour du Padé, située tout près du moulin de la Verdière ; puis la muraille s’infléchissait vers l’est, prenant la direction qu’occupe aujourd’hui la rue Réaumur et, rejoignant la porte Chef-de-Ville, — à l’endroit où la rue de ce nom coupe la rue Saint-Léonard, — le mur d’enceinte, flanqué d’une série de tours, se dirigeait vers le nord jusqu’au bastion de la porte Neuve ou du Petit-Comte, à l’extrémité de la rue Aufrédy. Il se poursuivait jusqu’aux tours du château et de là, à la tour Sermaise ou de la Brique. Le cours d’eau de Lafond longeait toute cette muraille et formait ainsi une défense naturelle.
La partie nord, n’ayant ni marais ni cours d’eau pour la protéger, avait été l’objet de défenses plus sérieuses. En outre du célèbre bastion de l’Evangile, muni d’une forte contrescarpe, le mur allait de l’ouest à l’est, à peu près dans la direction de la rue Massiou (anciennement rue Bethléem), présentant diverses sinuosités, munies de plates-formes intérieures ; celle de l’Epitre était située à peu près à l’entrée actuelle du jardin des Plantes, et celle de la Vieille Fontayne, un peu plus loin ; enfin la forte tour d’Aix formait l’angle nord-est de la fortification, à soixante pas de l’église Notre-Dame.
BASTION NOTRE-DAME ET LA TOUR D’AIX
De ce point, la ligne fortifiée rejoignait, à peu de distance, la porte de Cougnes et descendait vers le sud, jusqu’à la plate-forme et cavalier de l’Ecorcherie. A cet endroit, la muraille formait un angle rentrant, allant de l’est à l’ouest, jusqu’à la grande Boucherie, tout près du marché actuel et redescendait vers le sud, dans la direction de la rue des Dames, jusqu’à la tour de Moureilles, près du canal Maubec.
Au-delà du canal, dans le quartier Saint-Nicolas, la fortification formait une ligne cintrée, munie d’une plate-forme et d’un demi-bastion et suivait ensuite la direction de la rue du Duc actuelle, pour aller rejoindre la porte Saint-Nicolas.
Telle était la ceinture de murailles dont La Rochelle était enclose, lorsqu’en 1572 le duc d’Anjou vint y mettre le siège.
II
LES TOURS
Tout cet ensemble de murailles formait un vaste quadrilatère, dont les plus grands côtés présentaient le flanc, — au levant et au couchant, — à des marais et à des cours d’eau servant de défenses naturelles ; tandis que le front nord, attenant directement à la terre ferme, devait être plus solidement défendu.
D’espace en espace, une série de petites tours engagées dans la muraille, en rompait la ligne et en assurait la solidité. Dès que la fortification formait un coude, ou présentait seulement un léger infléchissement, une forte tour en occupait l’angle et défendait ainsi les deux fronts à la fois. Ces importantes constructions, munies de créneaux et de mâchicoulis, la plupart coiffées d’une poivrière en ardoises, s’élevaient à une grande hauteur au-dessus de cette ceinture de pierre et donnaient un aspect puissant et pittoresque à la physionomie générale de la ville.
ENTRÉE DE LA VERDIÈRE
Si nous suivons l’itinéraire que nous indiquions tout-à-l’heure, en décrivant la direction des murailles, nous trouvons sur le front ouest, à partir de la tour de la Lanterne, la tour du Padé, haute construction que les gravures du temps nous montrent de forme ronde, couronnée de mâchicoulis et de créneaux et recouverte d’une toiture conique en ardoises. Elle était tout près du canal de la Verdière, dans les jardins de la rue Réaumur qui font face à l’ancienne rue du Moulin Loquemau, aujourd’hui rue de la Cloche.
Pendant le dernier siège, « un grand pan de mu-« raille — dit Jourdan — qui s’étendait de la porte des Deux-Moulins à la tour du « Padé, soit qu’il fut trop surchargé de parapets, soit qu’il ait été battu depuis longtemps « par le canon du fort Louis et de l’Epine, s’écroule sur une longueur de quarante « toises, jusqu’à ses fondements. Les assiégeants crurent voir le doigt de Dieu, dans cet « accident naturel, mais les Rochelais, hommes, femmes et enfants, sans s’effrayer des « boulets ennemis, travaillèrent avec une infatigable ardeur, jusqu’à ce que la brèche eut « été réparée. »
Un peu plus loin, se trouvaient les tours de la Verdière, qui défendaient l’entrée de la porte Chef-de-Ville, située comme nous l’avons indiqué plus haut. C’est de là que partit le premier coup de canon qui, le 10 septembre 1627, devait ouvrir les hostilités entre les armées du roi et les défenseurs de la ville.
Déjà, Richelieu avait donné l’ordre de construire une série d’ouvrages avancés, dirigés contre la place. Il n’y eut alors plus de doute, dans l’esprit des Rochelais, sur les intentions hostiles du cardinal ; le maire fit tirer le canon sur les ouvriers qui travaillaient à la construction du fort Louis, perpétuelle menace contre la sécurité de la ville. Ce fut là le commencement de ce siège, qui devait durer dix-huit mois.
En remontant vers le nord, nous trouvons les restes de l’ancien château ; et plus loin, à l’angle nord-ouest de la fortification, la tour Sermaise, ou de la Crique, construite sur le bord du chenal de Parthenay, tout près du bastion de l’Evangile, dont elle complétait la défense.
A l’angle nord-est, à quelques pas de l’église Notre-Dame, s’élevait la tour d’Aix, ou du Prieuré d’Aix, formant, avec la porte de Cougnes et le fort Notre-Dame, un ensemble d’ouvrages extrêmement importants. Cette tour portait le nom d’ « Aix » à raison des droits concédés aux moines de l’Ile d’Aix, fondateurs et patrons de Sainte-Marie-de-Cougnes, et dont le monastère, dans cette île, relevait de la célèbre abbaye de Cluny. C’est à cet ordre religieux qu’on doit les constructions des églises Notre - Dame et Saint-Barthélemy, comme nous le verrons plus loin. Les gravures de l’époque nous montrent cet édifice de forme ronde, garni de créneaux et de parapets, mais privé de sa toiture, malgré l’indication d’un mur circulaire intérieur, destiné à la supporter.
L’ÉCHELLE CHAUVIN
Vers le milieu du front est, au saillant de la fortification, à l’endroit où celle-ci formait un angle rentrant, se trouvait un ouvrage important appelé : Plate-forme et Cavalier de l’Ecorcherie, flanqué, en retrait, de deux tours : celles de l’Echelle de la Couronne et de l’Echelle Chauvin, à l’extrémité est de la rue, qui porte encore ce nom. « Il existait — dit Jourdan — de distance en distance, pour monter sur les murailles, des escaliers que nos pères appelaient eschalles, ou échelles ; Chauvin doit être un nom propre, mais trop obscur pour que le souvenir de celui qui l’a porté soit venu jusqu’à nous. »
Dans l’angle rentrant formé par la Prée Maubec, — à l’endroit où se soudait, au X IIIe siècle, la première enceinte n’englobant pas le faubourg de Cougnes, — on rencontrait la tour de la Vieille-Boucherie (anciennement de la Maillotière) tout près de la porte Mallevault, moins importante que les précédentes, puisque, par sa position en retrait de la fortification, elle ne constituait pas un point susceptible d’être attaqué par l’ennemi,
« En l’année 1360 — dit Amos Barbot — les maires, échevins et pairs acquirent, par échange, des religieux, abbé et couvent de Notre-Dame de Moureilles, la place et la maison qui appartenait auxdits abbé et religieux, prés le temple de Saint-Sauveur, qui est le lieu où de présent est construite la tour appelée de Moureille, autrement : des Privilèges ». Et plus loin, il ajoute : « En 1410, furent parachevées les sept tours de Moureilles, dont le tout avait été commencé en l’an 1399. »
Cette tour de Moureilles était à l’angle sud-est de la fortification ; le canal de la Moulinette passait à ses pieds, et tout le front, dont parle Amos Barbot, faisait face à la partie marécageuse de la Prée Maubec.
Dans la description que Masse fait de ce monument, il indique qu’il était de forme circulaire et qu’il avait cinquante-cinq pieds de hauteur, jusqu’au chemin de ronde ; qu’il était couronné de créneaux à mâchicoulis. Il était surmonté d’une tour plus étroite, qui supportait une toiture en poivrière ; sa hauteur totale était de seize toises, et l’épaisseur de ses murs de seize pieds. A l’intérieur, quatre pièces étaient superposées : les trois inférieures, voûtées, communiquaient par un escalier pratiqué dans l’épaisseur de la muraille ; les deux salles principales, au rez-de-chaussée et au premier étage, étaient de forme octogonale, avec des nervures reposant sur des colonnettes et convergeant vers le centre de la voûte ogivale.
PLAN DE LA TOUR DE MOUREILLES
A l’extérieur, à la hauteur du chemin de ronde, se trouvaient trois écussons : le premier, 5 placé au milieu, représente les armes de France, sous lesquelles galope un cavalier sur son destrier ; dans le second, à gauche, on reconnaît encore le navire fleurdelysé, emblême de la ville de La Rochelle, mais le troisième est indéchiffrable ; peut-être portait-il les armes d’un maire.
Jehan Mérichon, pendant sa première mairie, de 1419 à 1426, y fit déposer le livre, dans lequel il avait fait établir la liste des maires qui l’avaient précédé, en accompagnant cette nomenclature du récit des événements importants, arrivés au cours de leur magistrature. A partir de cette époque, cet édifice fut spécialement consacré à la conservation des actes administratifs de la ville.
Cette construction massive, presque sans ouvertures, devait être, à l’intérieur, trop obscure pour être appropriée à recevoir des titres qu’on devait consulter. Aussi, fût-on obligé de pratiquer, au travers de cette épaisse muraille (en 1491, dit Colin), une large baie, avec balcon de pierre.6 C’est dans cette pièce, ainsi aménagée, que se trouvaient les archives de la commune, tandis que celles de l’Eglise réformée étaient classées au second étage. Ces documents représentaient le précieux dépôt que les Rochelais appelaient à juste titre : le Trésor de la Ville. C’est là qu’étaient religieusement conservés, dans des cassettes de bois bien closes, cotés par lettres alphabétiques : les registres du corps de ville, les titres constituant les privilèges octroyés par nos rois et le duc de Guyenne, les papiers et comptes des trésoriers. et receveurs des hospices, les registres des conseils et résolutions de la ville, véritables reliques, où se trouvait consignée toute la glorieuse histoire de la cité. On y fit également le dépôt de la confession de foi adoptée par le synode national des protestants réuni à La Rochelle, le 2 avril 1571, dans lequel la doctrine et la discipline de la religion nouvelle furent nettement déterminées.
CARTOUCHE DE LA TOUR DE MOUREILLES
Après la reddition de la ville, en 1628, ordre fut donné, de par le roi : que tous les titres de la commune de La Rochelle seraient envoyés à la Cour des Comptes ; ces archives étaient considérables, et ce fut seulement trois ans plus tard qu’il en fut fait huit grands ballots que l’on dut expédier à Paris ; et cent ans après, en 1737, tous ces documents d’une valeur inestimable, devinrent la proie des flammes.
Il semble, cependant, que ces parchemins n’étaient pas plus en sûreté, dans la tour de Moureilles qu’à la Cour des Comptes. Une maison voisine, toute remplie de cordages goudronnés, prit feu le 2 septembre 1632 ; la flamme enveloppa la tour et embrasa la charpente qui fut entièrement consumée ; les dégâts intérieurs ne furent pas moins importants. Le même jour, le vieil édifice avait été concédé aux Récolets, pour servir de clocher à leur église. Après sa mise en état, Louis XIV, en 1690, le racheta des Récolets pour en faire un magasin à poudre.
TOUR DE MOUREILLES
Avec cette nouvelle destination, les craintes d’incendie devenaient plus redoutables que jamais. Cependant, la tour de Moureilles fut épargnée par le feu, dans la nuit du 11 au 12 mars 1705. Un incendie d’une extrême violence se déclara dans les servitudes du couvent des Récolets, atteignit leur nouveau clocher et fondit les cloches. On dût craindre une formidable explosion qui, heureusement, ne se produisit pas.
Sans qu’il y ait rien de précis à cet égard, il y a tout lieu de penser que la tour de Moureilles, n’ayant plus d’utilité, dût être démolie quand on construisit l’arsenal en 1786. On peut, à juste titre, déplorer la disparition de ce monument d’un autre âge, dont le souvenir se rattachait si étroitement à l’histoire de la ville, lorsqu’on voit la banale construction édifiée à sa place. Les derniers soubassements, retrouvés il y a quelques années, permettent d’affirmer que cette tour s’élevait prés du canal Maubec, entre le couvent des Dames-Blanches et l’arsenal.
Telles étaient les constructions importantes qui complétaient l’ensemble des murailles de la ville, en y comprenant tout le front sud, battu par la mer, depuis la porte Saint-Nicolas jusqu’à la tour de la Lanterne.
XXX
La Tour de Moureilles
Et le Canal Maubee
Nous nous réservons de parler plus loin des tours de l’entrée du port qui, par leur importance, méritent d’être traitées dans un chapitre spécial.
III
LES PORTES DE VILLE
La puissante enceinte qui enclosait la ville, et que nous avons essayé de décrire, était percée d’un certain nombre de portes qui contribuaient à son effet décoratif. La plus ancienne était établie entre deux lourds massifs carrés, formant avant-corps. Elle avait été construite en même temps que la première fortification de Guillaume X, en 1240. C’était la porte Mallevault, ou plus communément du Gros-Seing, ainsi nommée parce qu’à son sommet se trouvait le beffroi communal, dans une tourelle dont le faîtage, recouvert en plomb, surmontait la partie crénelée. Sur la plate-forme supérieure, se tenait le guetteur qui, de ce poste de vigie, donnait l’alarme en sonnant la cloche, signum, pour signaler l’approche de l’ennemi. On l’appelait aussi porte Mauléon, du nom d’un des descendants de la famille des seigneurs de Châtelaillon qui gouvernaient en ce temps le pays d’Aunis.
PORTE MALLEVAULT
« On peut juger — dit Masse — combien les arts estoient peu pratiqués en ce tems-là, comme le fait voir la simplicité de cette porte. Elle a vingt-sept pieds de longueur sur treize et demi de large et onze au milieu, où estoient les fermetures qui paroissoient être qu’avec des herses sarrazines. Les ponts-levis ne paroissoient point être en usage en ce tems ».
La porte Mallevault conduisait à l’église Sainte-Marie-de-Cougnes (Notre-Dame), dont le faubourg n’était pas encore compris dans l’enceinte de la ville. Elle se trouvait dans la rue des Bouchers (Gambetta), à peu près au point où celle-ci rencontre aujourd’hui la rue des Cloutiers, du côté nord du marché actuel. Quand les fortifications englobèrent le faubourg de Cougnes et que le premier mur d’enceinte fut démoli, elle ne présentait plus d’intérêt pour la défense. Sa partie supérieure fut abattue, les plombs qui la recouvraient servirent à la toiture de la Grosse - Horloge. « Elle estoit bastie — ajoute Masse — presque toute de pierres de taille et les joints ou costés de la porte estoient anciennement tout massifs ; l’on a vidé celui qui est à gauche en sortant, pour y pratiquer des boutiques et logements. » 7 Masse nous a laissé le dessin de cette porte, du côté de la Grande-Boucherie, à l’époque où elle avait perdu sa physionomie primitive. Sa base massive subsistait encore et se trouvait enclavée au milieu des maisons de ce quartier. Ce dernier vestige de la première enceinte de la ville finit par disparaître, quand on construisit le marché aux comestibles.
La porte Rambaud, au nord du château, devait être placée à la jonction de la rue Rambaud et de la petite rue du même nom. Elle ouvrait sur le chenal de Parthenay et faisait partie, elle aussi, de la fortification du XIIe siècle. C’est par elle qu’on accédait l’ancien port et aux routes de Laleu et de Nieul.
A la tête du pont, jeté sur le canal de Parthenay, se trouvait le Châtelet, petite forteresse destinée à couvrir cette entrée de la ville. 8 Cette construction remontait à l’époque où le roi d’Angleterre, qui possédait encore La Rochelle, redoutant les attaques de Louis VIII,. avait ordonné, par une charte du 4 décembre 1222, de fortifier le « nouveau port, qui devait s’étendre depuis les moulins du Perrot, appartenant aux « Templiers, jusqu’au Châtelet. »
La porte du Petit-Comte datait de la même époque. Elle existait avant la construction de l’église Saint-Barthélemy. Elle était à l’intersection de la rue Aufrédy et de la rue Saint-Côme. On la désigna plus tard sous le nom de porte Neuve, ou encore Voûte de Charité, parce qu’elle faisait partie des dépendances de l’hôpital de ce nom (Aufrédy)..
LA PORTE DU PETIT-COMTE
Lorsque Louis XIII, après s’être rendu maître de Saint-Jean d’Angély, en 1622, sembla prendre contre La Rochelle une attitude menaçante, les habitants reconnurent la nécessité de fortifier tout le front qui s’étendait de la porte des Deux-Moulins jusqu’au bastion de l’Evangile. Ils couvrirent la porte Neuve d’une demie-lune, qui porta le nom de Fort de l’Assemblée. « Cette porte, à la suite du don que Louis XIII en avait fait aux pères de la Charité, fut bâtie — au dire de Masse — en 1478, et fut couverte, en 1710, par les pères, qui firent au-dessus un logement pour leur infirmerie. Elle fut démolie partiellement, en 1689, pour être reportée plus en dehors. Elle était jolie ; il y avait au-dessus le frontispice, un lion enchaîné, qui marquait la captivité de la ville. »9
En 1801, le Conseil municipal la jugeant trop étroite pour la circulation, décida qu’elle, serait rasée complètement, ainsi qu’un petit magasin qui était à côté. 10
Il est question, dans la charte que nous relations plus haut, de deux moulins établis sur le cours d’eau de Parthenay par les Templiers, en avant du chenal de la Verdière. La porte de ville, qui fut construite à l’extrémité de la rue Saint-Jean, à peu près au point où cette rue fait jonction avec celles de la Monnaie et des Fagots, prit alors le nom de porte des Deux-Moulins. Bien que reportée depuis, au point où elle se trouve actuellement, elle n’en a pas moins conservé le même nom.
Les moulins des Templiers, 11 placés à l’entrée du chenal de Lafond, furent une cause d’envasement et d’amoncellement de galets entravant la navigation. Quand le port actuel fut créé et que les bateaux n’eurent plus à remonter le chenal de Parthenay, rien ne s’opposa à ce qu’on jetât un pont sur ce cours d’eau. Un ouvrage de fortification fut alors établi, qu’on nomma le Beau-Fort, relié à un autre ouvrage en forme de tenailles, et donnant accès à la chaussée de la porte des Deux-Moulins qui, elle-même, rejoignait le chemin de Port-Neuf.
En dehors de la porte des Deux-Moulins, à l’endroit où plus tard furent plantées les allées du Mail, avaient lieu les fêtes du Carnaval. Le peuple se livrait à des distractions variées, notamment au jeu de la pelotte. Ceux qui s’étaient mariés dans l’année, devaient payer une contribution pour un magnifique festin et, en outre, trois balles ou pelottes pour le divertissement populaire. Le récit de ces jeux d’adresse et d’agilité se trouve longuement consigné au registre du gouverneur de l’année 1542.
Il est encore question de la porte des Deux-Moulins, lors du passage de François Ier à La Rochelle. Le roi parcourut à pied une partie des murailles, depuis la tour de la Chaîne jusqu’à la tour du Garrot (la Lanterne), « passa plus outre et vint à la porte des Moulins, par devant laquelle est un boulevard merveilleusement fort, qui deffend ceste côte de mer. » 12
En 1622, cette porte fut pourvue d’un ouvrage à cornes, et au-delà de son fossé on y établit cinq redans, simplement gazonnés, mais fortement fraisés et palissadés. Pendant le siège de 1628, tous ces ouvrages de défense eurent particulièrement à souffrir des batteries du fort Louis.
De toutes les portes de ville, celle de Cougnes fut la plus importante et la plus célèbre.
Lorsque la fortification de Guillaume X devint insuffisante et qu’il y eut nécessité d’enclore le faubourg de Cougnes dans une nouvelle enceinte, une porte, à laquelle venaient aboutir les routes de Périgny et de Dompierre, fut établie au pied de l’église Notre-Dame.
Sa construction primitive remonte à une époque difficile à préciser. Masse la croit bâtie en 1412. Elle était composée de deux fortes tours rondes et pleines ; sa plateforme était couronnée de mâchicoulis et de créneaux, auxquels on avait accès par l’ouvrage de défense adossé au chevet de l’église.
VUE CAVALIÈRE DE LA PORTE DE COUGNES
Longtemps la porte de Cougnes fit simplement partie de la fortification, sans ouvrage avancé pour la protéger. Mais le roi, qui ne pouvait soupçonner la résistance que La Rochelle devait, un jour, opposer à ses armées, prit l’initiative de faire fortifier la ville en 1558. Il envoya — dit Baudouin — trois seigneurs de la cour, accompagnés d’un ingénieur italien « lesquels, après avoir visité les endroitz les plus foybles, commencèrent avec grand nombre de manouvriez, à faire dresser hors l’enclos de la dite ville et près des douhes d’icelle. troys grands ballovardz de terre, l’ung au cymetière de Cougnes..... » Un fort bastion fut donc établi en avant de la porte, dans lequel furent pratiquées deux nouvelles percées, qu’il fallait franchir avant de pénétrer dans la ville. « On dressa — dit un vieux document de l’époque — à gauche de la porte, un haut éperon, revêtu de grosses pierres de taille, si grand et si avancé de ses murailles, que les courtines en sont aisément défendues : bon de fossez, du reste, et bien assuré de son rempart, qu’on luy a fasciné au derrière, pour son artillerie & autres commoditez, avec la sentinelle dressée sur le fin bout pour descouvrir en tous endroits. Au reste, ces trois portes se suivaient de droit fil l’une l’autre ; mais pour ce que l’expérience a découvert le danger de telles portes, mesmement es retraites passées, on changea la première et la mit-on, pour rentrer dans la ville, tirant sur main droite. »
ARMOIRIES SUR LA PORTE DE COUGNES
Tout en conservant sa masse imposante, la porte de Cougnes fut soumise à certains embellissements. Mervault signale que le maire Guillaume Gendrault fit graver au milieu les armes de France, avec l’inscription suivante : Le bon Roy entretiendra son peuple en paix, exprimant ainsi l’espoir que le roi ne porterait jamais atteinte aux privilèges de la ville. Pour rendre hommage aux défenseurs de ces murailles, qui résistèrent aux attaques du duc d’Anjou, un second écusson, aux armes de la ville, portait cette devise : Dieu m’a béni pour la retraite des siens. 13 Enfin, le maire y avait fait figurer ses armoiries, formées d’un chevron surmonté d’un vol, avec un croissant en pointe, le tout entouré de l’inscription suivante : La crainte du seigneur est d’air le mal. L’ingénieur Masse, qui nous a fort heureusement conservé ces différents écussons que nous avons pu reproduire, dit que ces inscriptions furent mises après que les Rochelais eurent pris le parti des protestants, en 1576.
ARMOIRIES SUR LA PORTE DE COUGNES
ARMOIRIES SUR LA PORTE DE COUGNES
Avec le perfectionnement apporté à l’artillerie, l’art des sièges subit une transformation toute nouvelle. Les vieilles murailles du moyen-âge, toutes droites, flanquées de tours, qui avaient résisté aux armées royales, devenaient désormais insuffisantes. L’augmentation du périmètre des fortifications rendait également inutiles les ouvrages avancés de la porte de Cougnes. Les deux portes extérieures furent donc supprimées ; et, en 1613, une seconde porte, dont l’axe était dirigé vers le nord, fut établie tout prés de la première.
LA PORTE DE COUGNES, A LA FIN DU XVIIe SIÈCLE. (D’APRÈS MASSE)
Cette construction monumentale, située à l’entrée de la rue Porte-Murée était fort remarquable. « C’était — dit Masse — un des beaux édifices qui fut à La Rochelle. La façade du costé de la campagne estoit fort magnifique, décorée de pilastres et de colonnes et d’une bonne architecture. Sa façade, du costé de la ville, n’estoit guère moins belle : il y avait deux ordres d’architecture l’une sur l’autre et l’intérieur de ces deux portes estoit vuide ; elle estoit revestue de pierres de taille et terminée par un chemin de ronde et les corps de garde au-dessus ; elle fut en partie démolie en 1689, pour avoir les matériaux, à cause que l’on estoit fort pressé de mettre la place en estat de deffense, que l’on n’avoit pas le teins d’aller chercher des pierres à la rivière de Charente, ce qui obligea d’abattre divers morceaux des anciennes fortifications qui estoient restées. »14
Masse a dessiné la vieille porte de Cougnes, telle qu’elle existait à la fin du XVIIe siècle ; une des robustes tours, qui en défendait l’entrée, subsistait encore ; l’autre. était déjà noyée dans les constructions qui l’enserrent encore à l’heure actuelle. Sur cette dernière, a été bâti depuis, le nouveau clocher de l’église Notre-Dame.
Dans le front nord se trouvait la porte des Lapins, qui n’était — dit Masse — qu’une petite murette, où il y avait une simple barrière, de même qu’au bout de toutes les rues qui sortaient sur la campagne, pour la conservation des droits d’entrée des fermes du roi.
Le quartier Saint-Nicolas fut le dernier qui fut pourvu de fortifications. La partie est, comme nous l’avons dit, était entourée de murailles flanquées de tours crénelées. « Les maires et les échevins — suivant le chroniqueur Baudouin — commencèrent, en 1505, à renclore le faubourg Saint-Nicolas, du côté de la Moulinette, et à y faire des tours et mâchicoulis depuis la porte Maubec tirant vers Saint-Nicolas. » Cette lignée de murailles suivait à peu près la direction de la rue Sardinerie actuelle. Le bastion du Gabut n’était pas encore construit, si bien que la mer pénétrait jusque sur la Petite-Rive, laissant à découvert, à marée basse, une large surface de vase.
On se contenta donc, à ce moment-là, d’élever un mur partant du pont Saint-Sauveur, dans la direction des maisons qui bordent actuellement le bassin intérieur et allant faire jonction avec la porte Saint-Nicolas. La muraille a disparu ; il n’en reste que la tour d’angle, prés de l’écluse Maubec et la porte de Cunarre, ouvrant sur la petite rue qui porte ce nom, et que le peuple a trouvé plus simple d’appeler : rue des Canards.
La large ouverture existant entre la porte et la tour Saint-Nicolas, par laquelle l’ennemi pouvait avoir un accès facile, présentait un réel danger. Le pouvoir royal voyait avec inquiétude le pro-grés que faisait le parti protestant et les Rochelais, redoutant l’intervention des troupes étrangères, songèrent à compléter l’enceinte de leurs murailles du côté de la mer. En 1568, ils constituèrent avec une activité surprenante, de la porte Saint-Nicolas à la grosse tour de l’entrée du port, une forte muraille épaulée par des tours de distance en distance. Plus tard, une de ces tours dut servir pour y établir l’ouvrage de défense que nous avons connu sous le nom de : bastion du Gabut.
VUE CAVALIÈRE DE LA PORTE SAINT-NICOLAS
Les pierres employées pour l’établissement de cet important ouvrage provenaient en partie de la démolition de l’ancien château. Pour les amener à pied d’œuvre, il fallut les transporter par le pont Maubec ; c’est de là qu’est venu le dicton populaire : « Le chastel Vauclair a passé par le pont Mauclerc. »
En 1596, pour assurer plus facilement la sécurité de cette nouvelle construction, les Rochelais la firent « terrasser tout le long de la courtine, depuis la tour Saint-Nicolas jusqu’à la porte de Vérité. »
Le bastion du Gabut fut démoli en 1858 et le terrain fut nivelé entre le bassin intérieur et le bassin neuf. La petite portion qui subsiste encore n’a pu disparaître, par suite d’un droit de servitude établi au profit des habitations qui y sont adossées. On retrouve encore quelques-unes de ces casemates, qui servent de caves pratiquées sous l’ancien chemin de ronde de la fortification.
La porte de Vérité, qui attenait au bastion du Gabut, donnait sur la Petite-Rive. Elle avait la même disposition que les autres portes de ville ; deux tours crénelées en défendaient l’entrée ; on en retrouva les fondations lors de la démolition du Gabut. C’est probablement cette porte que Bournaud a reproduite, sans indication de titre] qui permette de la reconnaître. En 1622, quand on voulut prolonger la terrasse jusqu’au fort Saint-Nicolas, il fallut déplacer cette porte et la transférer en arriére, à l’endroit où se trouve actuellement l’entrée de la rue de la Fabrique.
LE BASTION DU GABUT
De la Tour Saint-Nicolas à la Porte de Vérité
Elevé en 1568.
Imp L Font. Paris.
La porte Saint-Nicolas était, elle aussi, une entrée de ville fort importante. Elle était pourvue d’ouvrages de défense qui en assuraient la sécurité. De chaque côté, se trouvaient deux fortes tours avec fossé, herse et pont-levis, et, en avant, un bastion sur lequel étaient placées des pièces d’artillerie. Pour sortir de la ville, après avoir passé sous la première voûte, il fallait traverser une seconde porte, à l’est de la fortification, puis franchir une troisième issue du côté opposé ; alors on trouvait un talus, battu par la mer, sur lequel était établie la route qui menait à Tasdon. Cette disposition est à peu près restée la même, mais tous les terrains où se trouvent la gare et ses dépendances ont fait l’objet d’une emprise sur la côte.
ANCIENNE PORTE SAINT-NICOLAS
Masse rapporte : « que la troisième porte Saint-Nicolas, qui fut abattue en 1689 pour avoir des matériaux, était fort jolie, dressée d’architecture. Elle avoit été bastie en 1589. » 15
Dans une quatrième porte, également démolie, se trouvait une tourelle où était établi le bureau des fermes du roi.
Le bastion Saint-Nicolas, refait d’après le système en usage sous Louis XIV, a conservé à peu près la forme de l’ancien, mais la direction en a été sensiblement rectifiée. Une des tours de la première enceinte subsiste encore, à moitié ruinée ; l’autre a disparu sous des constructions modernes. Quelques dessins, qui datent de 1840 environ, nous ont permis de reconstituer cette ancienne porte, seule sortie de la ville, à cette époque, dans le front sud. C’est par cet étroit passage que circulaient les lourdes diligences qui se rendaient à Bordeaux.
TROISIÈME PORTE SAINT-NICOLAS
Sous Louis XVI, un pont fut établi à la sortie du bastion ; deux fortes piles, sur lesquelles étaient sculptées les armes royales, soutenaient la herse pour la manœuvre du pont-levis.
L’importante redoute appelée « Ouvrage à Cornes », élevée à côte du bastion Saint-Nicolas, ne date que de 1690 et fut achevée en 1694. « Cet ouvrage a beaucoup cousté, étant fondé en partie sur grillage et pilotis, surtout le front du costé des marais de Tasdon ; et cet ouvrage devoit estre le modèle de tous les autres dehors qu’on devoit faire autour de la place. » Si la ville eut été flanquée, dans tout son périmètre, d’ouvrages aussi importants, nul doute qu’on ne fût pas arrivé si facilement au déclassement de ses fortifications.
Il existait une porte d’eau sur le canal Maubec. « Il y a des coulisses — dit Masse — pour y mettre des horgues ou passe-lisses pour retenir les eaux. Cette porte estoit terminée par un parapet à mâchicouly. C’est un des morceaux, avec sa partie anciennement bastionnée, qui reste la plus entière : il y a dessus ce canal un corps de garde et on y a fait en 1710 des écluses ou empellements de bois pour retenir les eaux dans le canal Maubec. »
Qu’était cette porte de Saint-Eloy ? « qui ne servait que d’ornement ; qui fut faite après le razement de La Rochelle, pour distinguer la ville d’avec le faubourg Saint-Eloi ; c’était par cette porte que l’on faisait les principales entrées quand il venait quelques seigneurs à La Rochelle. Elle a esté rayée en 1689. »
IV
ENTRÉE SOLENNELLE DES SOUVERAINS
A LA ROCHELLE
La porte de Cougnes était celle par laquelle entraient solennellement princes et souverains venant visiter La Rochelle. Les habitants avaient à cœur d’entourer ces réceptions d’un éclat extraordinaire. Ils semblaient faire montre d’un certain orgueil, en rappelant aux têtes couronnées que si l’accueil était chaleureux et sincère, ils traitaient leurs hôtes presque d’égal à égal dans leur ville où, jaloux de leur indépendance, ils se considéraient, avant tout, comme les seuls maîtres de leurs destinées. Aussi fallait-il, à chaque réception de ce genre, que le souverain se conformât à une formalité qui, tout en ménageant l’amour-propre local, présentait en même temps une garantie contre l’inviolabilité des prérogatives municipales.
Un cordon de soie était tendu en travers de la porte de ville. Le maire se tenait derrière cette entrave symbolique, recevait le roi et lui faisait jurer sur l’Evangile, avant d’aller plus avant, de conserver les franchises du pays. Une fois le serment prêté, le cordon était coupé et les Rochelais faisaient au monarque une réception brillante et enthousiaste.
Même après la funeste bataille de Poitiers, — alors que le roi Jean fut fait prisonnier et que La Rochelle devint possession anglaise par le détestable traité de Brétigny, — il fallut ouvrir ses portes au représentant de la Grande-Bretagne, Bertrand de Montferrant, le 6 décembre 1360. Celui-ci prêta le serment qu’on lui demandait et promit, au nom de son maître, de respecter les privilèges accordes antérieurement à La Rochelle. Le maire, Louis Buffet, le mit alors en possession de la ville, en la lui faisant traverser dans sa plus grande étendue ; et tous deux, à cheval, se tenant par la main, suivis d’un nombreux cortège, allèrent jusqu’à la porte des Deux-Moulins, ratifiant ainsi — bien à contre-cœur — le traité qui séparait La Rochelle du reste de la France.
Quand les anglais furent expulsés, grâce au subterfuge de Chaudrier, Duguesclin, qui guerroyait sur les bords de la Charente, voulut prendre la ville au nom du roi de France ; les Rochelais fermèrent leurs portes et ne les rouvrirent qu’aux princes représentant le roi, qui durent se sou— mettre à l’habituelle formalité du serment devant le cordon de soie.
Après avoir repris La Rochelle à son frère le duc de Guyenne, auquel il l’avait cédée trois ans auparavant, Louis XI fit son entrée le 24 mai 1472, sous la porte de Cougnes. Les Rochelais, restés fidèles au duc de Guyenne, reçurent le roi sans apparat. Le maire et les notables se tinrent, suivant l’usage, derrière le cordon qui barrait complètement la porte. Ils exigèrent du roi, conformément à la tradition, avant d’entrer dans la ville « de respecter et maintenir à jamais les privilèges, franchises, libertés, domaines, statuts, coutumes, prérogatives, prééminences, droits de noblesse et de juridiction. »
Louis XI mit pied à terre et, à genou, tête nue, la main sur la sainte Paterne16 que tenait le maire, prononça le serment qu’on exigeait de lui. Le maire, de son côté, fit serment de fidélité au roi ; le ruban fut tranché et le souverain et son cortège furent admis à pénétrer dans la ville.
ENTRÉE DE LOUIS XI A LA ROCHELLE





























