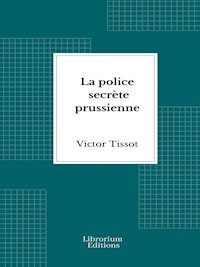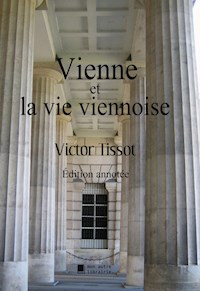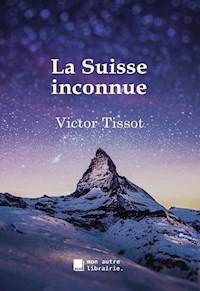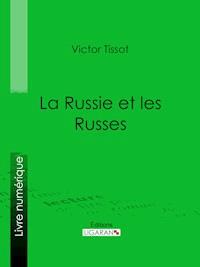
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
La Russie et les Russes est un ouvrage fascinant écrit par Victor Tissot, un écrivain et journaliste français du XIXe siècle. Dans ce livre, l'auteur nous emmène à la découverte de la Russie, de son histoire, de sa culture et de son peuple.
À travers ses pages, Victor Tissot nous offre un regard éclairé sur la Russie de son époque, nous décrivant avec précision les coutumes, les traditions et les modes de vie des Russes. Il nous fait également part de ses observations sur la politique, l'économie et la société russes, nous permettant ainsi de mieux comprendre ce vaste et mystérieux pays.
Grâce à son style fluide et captivant, l'auteur parvient à nous transporter au cœur de la Russie, nous faisant vivre des expériences uniques et nous permettant de mieux appréhender la complexité de ce pays.
Que vous soyez passionné par la Russie ou simplement curieux de découvrir ce pays, La Russie et les Russes de Victor Tissot est un ouvrage incontournable qui saura vous captiver et vous instruire. Plongez-vous dans ses pages et laissez-vous emporter par la magie de la Russie.
Extrait : "C'était à Léopol, capitale de la Galicie autrichienne, ville hospitalière et charmante qui venait de recevoir magnifiquement l'heureux monarque qui règne sur les plus jolies femmes de la terre : les Viennoises, les Polonaises et les Hongroises. Nous autres, journalistes, on nous avait traités comme les ambassadeurs de cette puissance démocratique nouvelle et justement redoutée : l'opinion publique."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C’était à Léopol, capitale de la Galicie autrichienne, ville hospitalière et charmante qui venait de recevoir magnifiquement l’heureux monarque qui règne sur les plus jolies femmes de la terre : les Viennoises, les Polonaises et les Hongroises.
Nous autres, journalistes, on nous avait traités comme les ambassadeurs de cette puissance démocratique nouvelle et justement redoutée : l’opinion publique. Nous étions logés chez les particuliers ; nous avions nos domestiques et nos équipages, nos banquets intimes et nos festins officiels. J’étais descendu avec Wolowski directeur du Messager de Vienne, dans la belle et grande maison de l’éditeur Goubrenowitch, presque un palais.
Les fêtes étaient terminées. De retour d’une excursion en Bukovine, où j’avais suivi le cortège impérial, où j’avais vu le fameux rabbin « à miracles » de Sadagora et visité un monastère de religieuses dissidentes russes réfugiées en Autriche, du côté de la Bessarabie, depuis le règne de Nicolas, j’étais revenu à Léopol pour compléter ma malle et prendre le chemin de la Petite-Russie.
Devant la fenêtre ouverte de ma chambre, embrassant d’un coup d’œil le superbe panorama de la ville, je lui envoyais un dernier adieu. Au premier plan, sur les déclivités de la colline que les nouveaux quartiers escaladent dans un élan de conquête, une rangée de maisons neuves, richement ornementées de sculptures, aux balcons de pierre supportés par des cariatides, descendait rejoindre la ville basse. Vis-à-vis, un parc aux arbres séculaires arrondissait ses portiques d’ormes et de tilleuls enchevêtrés, si touffus que les rayons du soleil, ne pouvant les percer, y suintaient en gouttelettes d’or, suspendant comme des stalactites de lumière et des pendentifs de diamant à la voûte de l’épais feuillage. Au-delà, le nouveau palais de la Diète, dans un encadrement vert, dressait l’architecture grandiose de sa façade neuve. Puis des lignes de toits monotones, recouverts d’ardoises luisantes comme des écailles, couraient à droite et à gauche se perdre dans de jolis lointains d’arbres, au-dessus desquels des clochers et des tours se dressaient dans un élancement joyeux. Le soleil à son déclin, mettait sur ce tableau une gamme de tons chauds qui lui donnaient un resplendissement inattendu. Et, au fond, sur un monticule drapé d’une solide verdure que les teintes dorées de l’automne rendaient plus belle et plus riche encore, la citadelle, toute rose sous les lueurs caressantes du couchant, souriait, comme éveillée de son rêve de pierre.
Quel calme dans ce superbe paysage ! Pas un cri d’oiseau ou d’enfant, pas un son de cloche. Devant moi, les rues qui s’ouvraient étaient vides. Il y avait dix jours à peine, la vie les encombrait, un fourmillement d’hommes et de femmes dans leur mélange pittoresque de types les plus opposés et de costumes les plus sauvages et les plus recherchés, allait, venait, s’agitait.
Je la voyais maintenant défiler dans mes souvenirs, cette foule bruyante, papillonnante et moutonnante, avec ses habits et son enthousiasme de fête, se bousculant pour saluer cet empereur que des paysans, près de Przemysl, avaient attendu à genoux dans la poussière, comme un roi nègre ou un rajah indien. Ici, groupées en des poses coquettes, sous des parasols dont les couleurs bariolées criaient dans la vive lumière, de belles et jeunes juives, d’une pâleur ambrée, aux cheveux noirs, aux traits fins, à la lèvre sensuelle, ferme et rouge comme la fleur du grenadier, en toilette voyante, harnachées comme des mules d’Espagne, regardaient de leurs longs regards, tout chargés de lasciveté orientale ; à côté d’elles, des paysannes et des servantes dont la tête hardie sortait d’un grand mouchoir rouge noué sous le menton ; plus loin, de vieilles juives, aux yeux de chouette, enveloppées de châles extravagants comme des plumages de perroquets, tendaient, dans un mouvement de curiosité fébrile, leur cou ridé de tortue, chargé de colliers de perles fausses, et agitaient leur tête à perruque couronnée d’une espèce de diadème ; derrière elles, des juifs orthodoxes, en longue lévite crasseuse, culottes rapiécées, bas blancs et babouches jaunes, la barbe en pointe, les papillotes frisant sur l’oreille, tortillaient, de leurs mains osseuses aux ongles en deuil, leur bonnet carré en peau de renard, dans une attitude embarrassée d’attente et de crainte.
Des paysans ruthènes, les cheveux retombant en boucles sur les épaules et divisés en deux à la russe, la chemise brodée, serrée à la taille par une ceinture de cuir et flottant sur le pantalon, formaient près d’un arc de triomphe un groupe fier et immobile comme ces guerriers slaves encore prisonniers dans les bas-reliefs romains. Devant cette haie vivante, des gentilshommes polonais en tunique à brandebourgs, en hautes bottes, s’appuyaient, l’air casseur, sur leur canne à pomme d’argent, la moustache hérissée et grognonne, la barbe sortant en touffes broussailleuses du hausse-col de crin.
Tous ces groupes se détachaient dans le cadre resplendissant des maisons pavoisées, aux fenêtres égayées et fleuries de femmes en corsage de dentelles et de soie, au milieu du tapage des banderoles déployant leur écharpe de couleurs, et sous un ciel qui déroulait son azur tendre comme un immense dais de satin bleu.
Non seulement je voyais, mais j’entendais mes souvenirs. Des airs de polka et de valse qui résonnaient dans ma mémoire comme un écho de mélodie entraînante, me transportèrent de la rue dans ces salons de l’Hôtel de ville et du Casino où brillait la fleur de l’aristocratie polonaise, – ces jeunes filles d’un noble sang, d’une beauté si idéale et si pure, et ces cavaliers qui avaient repris le costume de leurs ancêtres pour montrer qu’ils n’étaient pas indignes de s’appeler leurs fils, et qu’ils étaient, eux aussi, prêts à mourir héroïquement. C’était, dans une atmosphère de grâce et de jeunesse, dans un parfum d’élégance et de distinction, une vision féerique de chevelures blondes et noires, constellées de perles et de diamants, un éclat tiède de bijoux anciens, un frémissement caressant de dentelles, un épanouissement printanier de corsages entrouverts comme le bouton de rose et montrant la chair ferme et vivante des poitrines. Dans une confusion et un mélange plein d’harmonie, s’envolaient en ondulations molles les traînes vaporeuses des robes, la demi-nudité des bras et des épaules, nacrée sous les lumières, les petits pieds légers chaussés de satin et tout blancs comme des colombes, les éventails multicolores battant de l’aile sur des seins qui palpitaient comme eux.
Je revivais ces souvenirs exquis et capiteux, lorsque d’un geste brusque, une main se posa sur mon épaule et m’enleva à ma douce vision. Je me retournai vivement d’un air un peu désappointé ; et je me trouvai face à face avec la barbe hirsute de Wolowski.
– C’est ainsi que vous faites votre malle ? s’écria-t-il.
– Je vous attendais… On dit que pour aller en Russie il faut composer sa malle comme pour aller à l’Académie. Des effets choisis ; pas trop de littérature. Rien qui tranche et détonne sur le bagage banal… Voyons, fis-je en lui montrant ma garde-robe étalée sur les meubles, que dois-je prendre ?
– Prenez d’abord garde à vous ! Et ensuite ne prenez pas cette chemise de foulard, il y a trop de rouge là-dedans, on croira à un signe de ralliement révolutionnaire. Un de mes amis avait emporté l’année dernière un coin de feu en drap écarlate, on le lui a confisqué…. Mais que vois-je ? Malheureux ! vous avez enveloppé vos bottines dans des journaux…
– De vieux journaux… très conservateurs…
– Qu’importe ! Aucun journal ne pénètre en Russie sans avoir passé par la censure ; on saisira ces journaux. Remplacez-les par du papier gris ordinaire ne servant pas de fil conducteur à la pensée.
– Et de ce petit revolver, – la tranquillité des parents et des gouvernements, que pensez-vous ?
– Un revolver !… Je vous le confisque. S’il tombait par hasard de vos poches on vous prendrait pour un conspirateur, un sicaire, un nihiliste, un assassin… Vous n’avez plus d’armes ?
– Si, un parapluie.
– Un parapluie ?
– Oui, un parapluie à épée, acheté au Louvre et très commode en voyage : il se démonte comme une flûte et se met dans une malle.
– Je vous confisque votre parapluie, – arme dont la découverte serait d’autant plus grave, qu’elle est cachée sous l’enveloppe la plus candide et la plus inoffensive… Vous achèterez un parapluie tout simple, au manche de rotin solide.
– Comme celui de M. Louis Ratisbonne… Soit. On peut encore se défendre avec.
– Et ces livres ?… Ah ! trop de livres ! trop de lumière !
– Il faut bien un peu de pain blanc pour l’esprit.
– En Russie, on ne tolère que le pain bis, et encore faut-il qu’il ait été pesé dans les balances du gouvernement… Vous emporterez un volume, un seul ; on vous le laissera peut-être, s’il ne sent pas trop le roussi… Tenez, voici les Mémoires d’un touriste de Stendhal… Quant aux autres livres, je vous les confisque, comme le ferait la douane russe ; seulement elle, elle ne vous les rendrait pas… Et ces notes, qu’est-ce que ces notes manuscrites ?
– Le voyage que nous venons de faire ensemble en Galicie.
– Et vous alliez emporter ce tas de papiers avec vous en Russie ! Dieu de mes pères ! jusqu’à ce que la police ait déchiffré ce grimoire, des siècles se passeraient… Je confisque ces papiers.
– Ah çà, vous êtes donc un douanier déguisé ?
– Non, mais j’ai l’expérience !… l’expérience de la Russie… une terrible expérience, allez !
Et d’une main ferme, exercée, Wolowski continua le triage de mes effets. Je le laissais faire, confiant dans sa grande habitude des emballages internationaux. – C’est un type curieux que celui de mon ami Bronislas Wolowski, frère de Ladislas, fils de Wenceslas et petit-fils de Boleslas. Vif comme une pie, remuant comme un écureuil, il a la gaieté de la cigale et l’activité de l’abeille. En voyage, le compagnon le plus précieux que je connaisse ! Un Guide fait chair, un horaire vivant, une horloge pneumatique ! Il sait à quelle heure les trains partent et quand ils arrivent ; s’il y a de quoi boire et manger dans les stations ; si les hôtels ont des draps de lit et des serviettes, des sommeliers ou des sommelières, des puces ou des punaises ; si le soleil se lèvera sans nuages ou s’il se cachera sous un manteau de brume ou de pluie. Dans les monts Tatry, Wolowski était le directeur de notre caravane, notre providence à pied et à cheval, l’étoile qui nous éloignait des étables pour nous rapprocher des châteaux. Nous lui avions confié la caisse et il avait su en faire une grosse caisse. Il débattait les prix avec les aubergistes et les cochers, retenait les voitures et notre folle ardeur, indiquait les relais, réglait les comptes et les montres, entonnait les chansons, entamait les bouteilles, embrigadait les musiques, rédigeait les discours, enrégimentait les jeunes filles et dressait les arcs-de-triomphe sous lesquels nous passions ensuite, salués par les acclamations du peuple. On eût dit un prince de féerie, un Riquet à la Houppe, faisant à des visiteurs illustres les honneurs de ses États. Tout lui obéissait : les oiseaux du ciel qui chantaient à notre approche avant de se laisser tomber dans les casseroles, les escadrons de montagnards à cheval qui accouraient à notre rencontre, les rivières qui s’arrêtaient et se desséchaient pour nous offrir leurs poissons, et les châteaux-forts qui s’ouvraient pour nous offrir leur hospitalité.
– Voilà qui est fait, s’écria Wolowski en se redressant et en me montrant mon bagage divisé en deux lots. Vous prendrez ceci et vous laisserez cela… Vous emballerez vos effets cette nuit. Allons dîner…
– Et vous croyez que je passerai ?
– Je n’en réponds pas encore. Vous êtes mal noté. C’est pourquoi je vous accompagnerai jusqu’à la station la plus voisine de la frontière, où j’attendrai jusqu’au soir le retour du train, et le vôtre.
Le lendemain, à sept heures, nous prenions le chemin de fer qui mène de Léopol à Brody et à la frontière russe. Peu de voyageurs. Une vingtaine de juifs avec des sacs de toile en guise de sacs de nuit, leur vieux parapluie de coton déchiré sous le bras, la pipe à la bouche, la chemise sale comme celle d’un charbonnier. Ils sont toujours, ces descendants d’Isaac Laquedem, par voie et par chemin, à la poursuite de quelque affaire, à la piste de quelque gain. Habiles, persévérants, infatigables, ils ne s’attardent pas et arrivent les premiers. On ne les voit jamais attablés dans les buffets des gares, buvant et mangeant, faisant, comme les chrétiens, un dieu de leur ventre. Ils emportent avec eux trois ou quatre oignons, du sel dans un carré de papier, un morceau de pain : cette maigre pitance suffit pendant deux jours à leur appétit oriental. Aussi qu’ils sont maigres, qu’ils ont l’air souffreteux et anémique ! Et comme leurs enfants au teint couleur de suif rance, à la chair empâtée de crasse, sont frêles et malingres !
Ils n’auraient pas assez de force pour travailler de leurs mains, et on ne sait de quoi ils vivraient si leur intelligence n’était pas assez éveillée, assez vigoureuse pour chercher et nouer des combinaisons commerciales qui tournent généralement à leur profit. Sans le juif, le propriétaire polonais ne vendrait ni son blé, ni ses betteraves, ni son bois, ni son bétail. C’est l’intermédiaire nécessaire, obligé, comme l’éditeur l’est pour l’auteur. Et le juif n’est pas seulement marchand, il est banquier ; sans ses avances, les champs resteraient souvent en friche et la moisson ne pourrait être rentrée.
Avant le départ du train, plusieurs d’entre eux, la tête recouverte du voile de prière, les dix commandements posés sur le front dans leur petite gaine de cuir, les courroies sacrées nouées fortement autour du bras gauche, tenant un vieux livre à la reliure de cuir usé, la face tournée vers l’Orient, disaient leurs prières à mi-voix, avec un balancement de corps automatique.
Nous partons.
Derrière nous, Léopol disparaît avec sa citadelle découpée sur l’horizon en masse magnifique, avec ses maisons qui se baignent, élégantes et blanches, dans des flots de verdure, avec les clochers élancés de ses églises latines et les dômes bulbeux de ses églises grecques. Au-dessus de la vallée, sur les bords d’un cours d’eau, des brouillards flottent, se traînent et rampent comme de lourdes fumées grises. L’air est aiguisé d’une pointe de froid. Les blancs frimas semblent déjà se refléter dans la terne pâleur du ciel.
Avec une lenteur funèbre de corbillard, la locomotive s’avance au milieu d’une nature moribonde, jaunie et décolorée. Çà et là se dressent quelques arbres rabougris, dépouillés de branches, à la tournure grêle, semblables à des cierges éteints. De loin en loin une chaumière basse, à demi enterrée dans le fumier qui doit la garantir contre l’hiver, montre un toit moussu et triste comme la pierre d’un tombeau. Et puis plus rien ; le vide, le silence, le désert. À l’horizon, un essaim de points noirs qui se meuvent : des corbeaux.
Nous voici à Brody, petite ville insignifiante, sans passé et sans avenir, perdue dans un marécage, presque entièrement peuplée de juifs. À la gare nous sommes assaillis par des changeurs en bottes crottées, en longue lévite luisante de graisse, coiffés du chapeau gibus traditionnel, pelé, crasseux, cabossé ou défoncé. Le profil d’oiseau de proie de ces manieurs d’argent en papillotes tourne à la caricature. – Dans l’intérieur de la gare, des juifs encore, graves comme les prophètes de l’Ancien Testament, assis derrière des comptoirs improvisés sur lesquels s’entassent des piles de menue monnaie autrichienne et russe, des liasses de banknotes chiffonnés et déchirés, avec des ligatures de papier blanc gauchement collées.
Brody n’a pas un monument, pas même une ruine. Ses rues sont vides et uniformes. Toutes les maisons se ressemblent : façades de sépulcre blanchi. On se demande ce qu’on peut bien y faire ? Les juifs vous répondent qu’ils y font de la contrebande et beaucoup d’enfants. Partout, en Galicie et en Pologne, là où, il y a vingt ans, trente juifs se tenaient blottis, il y en a cent ou deux cents aujourd’hui. C’est la grande race prolifique, expansive et envahissante ; ce sont les Chinois de l’Occident.
L’Israélite de cette partie de l’Europe, si différent de l’Israélite français, n’attend pas sa maturité pour se reproduire ; à quinze ans, il s’abandonne déjà à la douce loi des livres saints, qui lui ordonne de croître et de multiplier.
J’ai rencontré entre Varsovie et Léopol de jolies petites juives de dix ans qui, déjà fiancées, brodaient des bourses pour leur futur mari.
Je pris congé de Wolowski, et le train se remit en marche pour franchir, cette fois, la frontière. Brody disparut rapidement derrière nous avec ses maisons carrées comme des dés, et qui semblent avoir été jetées là au hasard par le caprice d’une main enfantine.
La plaine recommence, toute nue, sous le ciel bas qui l’écrase. On se sent comme oppressé par la solitude. L’inconnu, qui a tant de charmes ailleurs, vous met ici mal à l’aise. Ce vide qui vous entoure fait sur vous une impression pénible et étrange ; on voudrait entendre quelque chose, ne fût-ce que la plainte dolente du vent.
Non, croyez-moi, elle n’a rien de bien terrible, cette douane russe qu’on m’avait peinte si noire ! Nous y voici. Un magnifique gendarme, solide comme un chêne, armé comme un brigand, le revolver et le sabre au côté, le casque pointu en tête, serré dans sa grosse capote de drap brun, accompagne l’employé chargé de nous demander nos passeports.
Les portières des wagons se referment, et nous attendons qu’on nous accorde la permission de descendre dans les salles d’attente.
Tous les passeports sont recueillis ; on nous invite à sortir pour la visite des bagages.
– Monsieur, me dit un gros juif qui pue le bouc, ne prenez pas votre journal, laissez-le dans le wagon, vous pourriez avoir des histoires… La Nouvelle Presse libre de Vienne est sévèrement interdite en Russie… Ja, mein Herr !… C’est un avertissement amical…
Je jetai la feuille prohibée sur la banquette, puis je pris mes couvertures et mon sac ; mais au moment où je sortais du wagon, je vis le juif faire main basse sur mon journal, le plier en deux et le glisser prestement dans sa poche.
On nous enferma dans la salle des bagages, – un hall vitré plein de douaniers, avec des barrières disposées en fer à cheval. Après tous les récits que j’avais lus et entendus, je m’attendais à savourer des émotions beaucoup plus fortes. Je pensais qu’on ferait sauter la doublure de mes culottes, qu’on ausculterait les parois de ma malle, qu’on retournerait mes poches et qu’on sonderait les semelles de mes souliers.
Mais tout se passa le plus naturellement et le plus simplement du monde, avec une courtoisie qu’on ne rencontre ni dans les douanes autrichiennes, ni même dans les douanes allemandes.
Aucun employé ne demanda ni ne reçut un kopeck de pourboire. – Ne serait-elle plus qu’une légende, cette histoire de la main disposée en entonnoir et adroitement tendue aux voyageurs par les employés de la douane russe ?
Nos passeports nous sont rendus, nous pouvons remonter dans le train. Une demi-heure se passe ; enfin la locomotive siffle et prend son élan. Les chemins de fer russes n’ont pas la vitesse des chemins de fer français. Quand vous vous plaignez de leur lenteur, le Russe vous répond philosophiquement : « Qu’est-ce que cela peut nous faire d’arriver demain ou après-demain ? »
Le gros juif, qui a pris place dans mon compartiment à côté d’un jeune propriétaire russe, lui passe mon ex-numéro de la Nouvelle Presse libre. Le Russe paraît s’amuser beaucoup des « bonnes blagues » de la feuille viennoise sur les nihilistes. Il dit au juif qu’à l’étranger on ne comprend rien aux choses de la Russie ; qu’on exagère et qu’on dénature les faits ; qu’on se laisse prendre comme des badauds à tous les racontars niais des journalistes d’occasion et des correspondants aux abois.
Le juif répond qu’il y a cependant dans les récits sur les agissements des nihilistes, des choses qui n’ont pas pu être inventées, puisqu’elles ont été révélées dans le cours des 250 procès qui se sont succédé sans interruption depuis 1873. Il rappela la conspiration des 138, découverte à Kiew. Une jeune fille, Idalie Pollheim, avait accepté par dévouement pour la cause révolutionnaire, la mission de devenir la maîtresse d’un vieux et riche propriétaire de Kursk, qu’elle devait empoisonner, puis voler. L’argent était destiné à la caisse de la Société. – Et le procès Ituxhin, ajoute le juif, ne montra-t-il pas la pression que le Cercle révolutionnaire de Moscou exerça sur un jeune adolescent pour qu’il tuât son père et le dépouillât au profit de l’œuvre ? Vous avez beau rire, de pareilles révélations prouvent que les nihilistes ont recours aux moyens les plus extraordinaires, et que les procédés du roman et du théâtre ne leur répugnent pas. L’histoire de la Nouvelle Presse, racontant qu’on a découvert, sur le cadavre d’un moine assassiné, des papiers établissant que ce religieux n’était qu’un nihiliste déguisé, est parfaitement vraisemblable. Combien de fois les nihilistes n’ont-ils pas endossé des uniformes de généraux et de gendarmes ?
La discussion avait lieu en allemand et elle se continua jusqu’à la station prochaine, sans embarras, sans chuchotement, sans gêne, ouvertement, avec l’aisance et l’abandon d’une causerie entre amis au coin du feu. Je n’en pouvais croire mes oreilles. On m’avait tant recommandé de ne jamais dire un mot de politique ni de jamais prononcer le nom de nihiliste !
La Russie qu’on m’avait dépeinte au-delà des frontières était évidemment une Russie d’il y a trente ans ; et ce que j’avais lu dans les livres n’était pas moins faux de ton et de couleur.
À part quelques formalités de police insignifiantes et qui passent entre portiers d’hôtel et gendarmes, on voyage aujourd’hui en Russie avec autant de liberté qu’en Suisse et en Belgique. – On voit la police, mais on ne la sent pas.
À mesure que nous avancions, le paysage, toujours dénudé, restait empreint de la même sévérité triste. Le regard se perdait dans le vague grisonnant de l’horizon. Pas de laboureurs, pas de villages, pas de troupeaux, pas de routes ; aucun indice de la présence de l’homme. – On se demande si l’on est encore en Europe ; si ces immenses plaines ne sont pas déjà le désert asiatique ; et l’on s’attend à voir déboucher là-bas, au bord des mares miroitantes comme des bancs de sel, une grise caravane de chameaux.
Le grand silence qui plane sous ce ciel à coupole de plomb vous écrase. L’œil fatigué laisse tomber sa paupière, la tête s’affaisse sans pensée et sans ressort ; et les allures lentes et berceuses du chemin de fer vous plongent dans l’engourdissement. – C’est avec une lourdeur d’éléphant que la locomotive s’avance à travers ces steppes d’herbes jaunes, où ses sifflements n’effraient pas même un oiseau. – Ici, sur ses frontières occidentales, la Russie, maintenue par une ligne de forteresses et de douanes autrichiennes et allemandes, fait semblant de sommeiller ; mais de l’autre côté des monts Oural, à l’extrémité opposée de l’Empire, sur le chemin des Indes et de la Chine, quelle activité, quel besoin d’expansion, quelle fièvre de marche en avant, jusqu’au jour où la lance du Cosaque se croisera avec la baïonnette de la sentinelle anglaise ! Le Turkestan est annexé, et la Mandchourie orientale ; et chaque jour marque une nouvelle étape de la progression et de l’envahissement russes.
Enfin, voici une isba au toit pittoresquement découpé, avec son balcon et sa coquette véranda : c’est une gare, isolée, perdue au milieu de la campagne.
Quand le train arrive, ses jolies fenêtres aux dentelles de bois peintes en rouge et vert se garnissent de têtes espiègles, à la bouche souriante, aux regards curieux : « Bonjour, mademoiselle la télégraphiste ! Bonjour, madame la cheffesse de gare ! Salut à vous, gentilles petites bonnes au minois frais et rose, au nez en l’air, à l’œil taquin, aux longues tresses nattées ; l’oiseau qui passe peut-il se réchauffer un instant dans votre petit cœur capitonné de sentiments hospitaliers ? »
Deux popes barbus comme des brigands des Abruzzes, coiffés de chapeaux aux larges ailes, non moins italiens d’aspect, vêtus, l’un d’une longue robe de soie pistache passée, et l’autre d’un pardessus aux larges manches, couleur cannelle cuite, sortirent du buffet pour prendre le train. Carrés d’épaules, de haute taille, d’une force et d’une santé rustiques, la chevelure nattée retombant sur les épaules, chaussés de bottes trop larges qu’ils traînaient d’un pas pesant, ils étaient ronds comme des balles et pleins jusqu’au gosier. Ils gesticulaient, titubaient et trébuchaient sur le trottoir de planches de la gare, que l’humidité rendait glissant.
Ah ! ils faisaient vraiment une jolie paire d’apôtres, avec leur bedaine ballonnée, leurs lèvres épaisses et lourdes, leur maintien de cruche mal équilibrée. Ils s’étaient remplis pour la semaine entière, d’une façon tout orthodoxe, ayant procédé à un nettoyage complet de la monnaie gagnée le dimanche à vendre des cierges et des bénédictions, à exorciser les paysans et à confesser les paysannes.
– Vous riez de les voir, me dit le Russe, qui avait interrompu sa conversation avec le juif et qui s’était placé devant la fenêtre, à côté de moi. C’est sans doute la première fois que vous venez en Russie ? Vous serez bientôt blasé sur les scènes de ce genre, surtout si vous parcourez les campagnes. Nos prêtres sont quelquefois tellement ivres qu’ils peuvent à peine se tenir debout pour célébrer les cérémonies du culte. Pouchkine a composé une bien jolie épitaphe sur un pope de village :
PASSANTS.
– Tous vos popes sont donc des ivrognes ?
– À peu près. Et comment voulez-vous qu’il en soit autrement ? Ils n’ont ni éducation ni instruction. Ils ne diffèrent du simple moujik que par l’habit. Comme le paysan, le pope gagne son pain à la sueur de son front ; il laboure lui-même son champ, il conduit lui-même paître son bétail. Sa femme est une paysanne qui travaille de ses mains. Il y a même des popes qui tiennent des débits d’eau-de-vie, soi-disant au profit de leur église. Besogneux, chargés de famille, ne recevant pas de traitement suffisant de l’État ni de la commune, qui ne leur prête souvent qu’une maison et un champ, ils sont obligés, pour vivre, d’avoir recours à toutes sortes d’expédients et de petits moyens, d’ouvrir boutique de prières, de fabriquer des reliques, d’exploiter la crédulité et la superstition du peuple, de falsifier la foi ; ils font payer très cher les baptêmes et les mariages, quelquefois ils vont même débattre avec les moribonds le prix de leur absolution. J’ai connu un pope qui refusait l’extrême onction aux enfants mourants avant que leur père lui eût donné sa plus belle oie ou un petit cochon. Parfois ces marchandages de prières sont bien amusants. Un jour, un paysan débattait avec un pope le prix d’un baptême :
– Non, non, disait le prêtre, c’est cinq roubles.
– Vous avez bien baptisé le petit à Pierre Pétrovitch pour deux roubles ! répliqua le moujik.
– Mais, mon ami, s’écria le pope, j’ai lu tout ce qu’il y a de plus mauvais en fait de prières !
Il faut les voir les dimanches et les jours de fêtes, dans leur sainte ronde ! Comme ils bénissent et comme ils boivent à tour de bras ! – Ils inventent mille pieux prétextes pour entrer dans l’isba du paysan et lui siffler un verre de vodka. « Ivan, disent-ils, les mauvais esprits sont chez toi ; je vais les chasser. » Ou bien ils procèdent à une nouvelle bénédiction des bogs, ou encore ils vendent des croix et des amulettes.
La procession de l’image miraculeuse leur est aussi une source de revenu. Presque chaque église possède une sainte Vierge qui protège ou guérit ceux qui déposent quelques kopeks à ses pieds. Une fois par an, on promène la madone en grand pompe à travers les campagnes, et l’honneur de l’héberger pendant une nuit se paye 10 à 20 roubles. Les processions sont un spectacle bien curieux. En tête, les chantres, puis l’image sainte sous sa couronne et sa carapace dorée ou argentée, toute resplendissante, portée par un moujik barbu, en chemise rouge, en bottes ; puis le prêtre vêtu de ses ornements sacerdotaux, et les paysans tête découverte ; ensuite, formant l’arrière-garde, une foule de mendiants boueux, poudreux, hérissés, accourus de tous côtés, on ne sait d’où, plus déguenillés et plus dépenaillés les uns que les autres, avec des jambes de bois, des béquilles, des bras en écharpe, des yeux chassieux, éborgnés, des nez rongés, êtres lamentables et fétides, tout cassés et tout usés de misère, pliés en deux, maigres, hagards, la soif aux lèvres, la faim au ventre, s’accrochent à la procession comme des maraudeurs à une armée, car le propriétaire qui loge la Vierge est tenu de nourrir et d’abreuver tous les pauvres, avec les chantres, le diacre et le pope.
Ah ! si nos prêtres n’étaient pas si avides, s’ils ne fatiguaient pas le paysan de leurs obsessions, ils ne seraient pas si détestés…
– Mais cette conduite des popes doit porter préjudice à la religion ?
>– Pas le moins du monde. Le pope peut boire, s’enivrer, la religion reste hors d’atteinte, tellement le dogme, chez nous, est peu identifié avec le prêtre. Le sacerdoce ne met pas au front du pope un sceau indélébile et sacré. En devenant veuf, le pope cesse d’être prêtre. Il va alors ordinairement dans un couvent grossir le troupeau indolent des moines. Prêtre, le chemin de l’épiscopat lui était fermé. Débarrassé de sa femme, il peut aspirer aux plus hautes dignités ecclésiastiques. Veut-il être délié de ses vœux et rentrer dans la vie privée ? Une permission du Saint-Synode lui suffit. Un pope a-t-il commis un crime ? Il perd aussitôt le caractère de la prêtrise. Il n’y a dans le rôle qu’il remplit au pied de l’autel rien de divin et de mystique : ce n’est pas le représentant de Dieu, c’est un valet, un domestique, dont les fautes ne sauraient rejaillir sur la maison et sur le maître. Simple instrument, sans autorité morale, le prêtre russe ne prêche pas plus d’exemples que la grande dame dévote qui continue, au milieu de ses jeûnes et de ses prières, les élégantes débauches de la vie mondaine. Cette ligne de démarcation est un grand bonheur ; que deviendrait le peuple russe s’il avait pour son clergé la même vénération aveugle qu’il a pour les saintes images ?
– N’a-t-on pas créé des séminaires afin de relever le niveau moral et intellectuel des popes ?
– Oui, mais les pères n’y ont pas envoyé leurs enfants… “À quoi bon ! se disent-ils, puisque la charge est héréditaire.”
Quand il n’y a dans la famille que des filles, c’est l’aînée qui apporte le bénéfice en dot à son mari. Le clergé forme encore chez nous une espèce de caste ecclésiastique attachée au service des églises comme les serfs l’étaient au service de la terre. La vocation n’est pas de rigueur ; le fils d’un marchand, d’un gentilhomme, qui voudrait se faire prêtre, rencontrerait mille obstacles, tandis que le fils d’un pope succède tout naturellement à son père. Il y a peu d’années il lui fallait pour embrasser une autre carrière, une autorisation très difficile à obtenir. Aujourd’hui que les portes des universités leur sont ouvertes, les fils de prêtres s’y précipitent comme des moutons de Panurge. Qu’arrive-t-il ? Ne croyant plus à rien, sceptiques, matérialistes, athées, ils prennent l’habit ecclésiastique en horreur, se trouvent sans emploi à l’achèvement de leurs études, et se jettent dans la révolution nihiliste.
– Il y a cependant quelque différence entre le clergé des villes et celui des campagnes ?
– Oui, dans les villes, à Saint-Pétersbourg par exemple, les prêtres sont des gens civilisés et instruits ; ils logent dans de beaux appartements ornés de tapis et de meubles de luxe ; ils ont des domestiques, ils donnent des dîners fins, des soirées et des bals où les séminaristes viennent danser. Un prêtre de Saint-Pétersbourg me racontait qu’au mariage de sa fille on avait bu pour 300 roubles de vin de Champagne. Cependant les popes, dédaignés par la noblesse, qui ne les admet que dans ses antichambres, n’exercent pas la moindre influence et frayent tout au plus avec les marchands et les bourgeois, qui ne se gênent pas d’afficher leur mépris pour la popesse, ses filles et ses fils.
Le train marchait toujours avec la même lenteur au milieu du même paysage triste et monotone.
– Quelles sont, demandai-je encore à mon voisin, les travaux et les occupations du clergé russe ?
– Notre clergé, me dit-il, est persuadé qu’il n’a pas d’autres devoirs à remplir que de chanter les offices et d’échanger ses bénédictions contre les verres d’eau-de-vie et les kopeks de ses paroissiens. Les popes ne vont pas visiter les malades et les prisonniers, ils ne prêchent pas, ils ne catéchisent pas. Les enfants s’approchent de la table de communion sans avoir reçu d’instruction religieuse. Aussi nos paysans se font-ils sur Dieu et la religion les idées les plus singulières. – Vous savez que la Russie a pour patron un beau saint barbu qui ressemble à un sapeur et qui s’appelle saint Nicolas. Un jour qu’on interrogeait un moujik sur la Trinité, il répondit : “La Trinité, c’est bien simple : elle se compose, de Dieu le père, de la sainte Vierge et de saint Nicolas.“
Une fois, une pauvre paysanne qui avait à se plaindre des vexations de son voisin, lui dit : “Tu ne crains donc pas Dieu ?” – “Pourquoi le craindrais-je ? répartit le paysan, il n’est pas de la police.”
L’homme du peuple croit dans toute la sincérité de son cœur. Il ne se casse pas la tête pour résoudre des problèmes religieux. Il accepte la doctrine sans examen, les yeux fermés, ne s’inquiétant pas du pourquoi des choses et ne cherchant pas à soulever le voile qui lui cache les mystères. Aussi sa foi n’est-elle qu’une foi de surface, sa religion tout extérieure se rapproche de la religion païenne, et consiste presque uniquement en signes de croix, en révérences plus ou moins profondes et plus ou moins répétées.
Si les polémiques religieuses étaient permises, il y aurait peut-être dans notre clergé un peu de vie intellectuelle ; mais l’Église fait partie de l’État, elle a pour chef le tzar, et comme l’État, elle ne peut être discutée. Les gravures et les romans contre les prêtres et les moines sont inconnus en Russie ; quelques contes et quelques chansons populaires poussent seuls la hardiesse jusqu’à s’attaquer au clergé, mais jamais à la religion. En France, en Allemagne, on n’est parvenu à s’affranchir du joug clérical qu’en favorisant l’impiété ; chez nous, les prêtres ont été privés de toute influence dans l’État, sans le secours des livres et des gazettes, par la seule volonté du tzar ; et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que le culte n’a pas souffert de cet abaissement des prêtres réduits au simple rôle de fonctionnaires ecclésiastiques du gouvernement. Ils sont même tenus de dénoncer celui qui, sous le sceau de la confession, s’accuserait d’avoir comploté contre l’État ! Au lieu d’être un obstacle au pouvoir temporel, ils en sont les alliés et le soutien. Ils n’ont aucune juridiction en fait de dogme, et leur premier devoir est d’obéir au gouvernement.
Notre causerie sur le clergé et la religion russes se poursuivit jusqu’à notre arrivée à une grande gare, point de bifurcation de la ligne de Varsovie et de la ligne de Kiew.
Tout autour de nous, encore de vastes plaines, où l’œil cherchait en vain la coupole verte de quelque église ou le toit noir de quelque chaumière. Le long d’un chemin désert, des saules rabougris frissonnaient, laissant pendre leurs branches comme des lambeaux de toile secoués par le vent. Le ciel qui se couvrait, et le soleil qui laissait retomber sa tête mourante au milieu de nuages entassés comme des oreillers tachés de sang, augmentaient l’impitoyable détresse de cette campagne abandonnée. Les espaces se rapprochaient, l’horizon montait pareil à une haute muraille où des nuées humides apparaissaient comme des plaques grises grossissantes. La température avait encore baissé. Nous entrâmes en nous secouant dans la salle du buffet où des bouffées de chaleur douce nous caressèrent, et où nous fûmes doublement mis en joie par le parfum des fleurs et le fumet des plats.
Les bougies, supportées par les branches dorées des candélabres, éclairaient déjà de leur lumière immobile et blonde les nappes blanches des tables, sur lesquelles étincelaient les services d’argent, miroitait la porcelaine fine des couverts et s’irisait le cristal taillé des verres et des carafes. Des reflets voltigeant mettaient de petites aigrettes de feu aux casques de plomb des bouteilles de vin de Champagne et de vins fins formant le carré, comme des bataillons qui attendent l’ennemi.
Il n’y a pas de buffets de chemin de fer plus copieusement et plus luxueusement garnis que les buffets russes. Et tout y est, relativement, à bon marché. Un verre d’excellent thé coûte vingt centimes ; un demi-poulet, un franc. Il faut voir les appétits kosaques se ruer sur ces tas de mangeailles : jambons roses, fricandeau à la gelée, poissons salés ou conservés, pâtés de foie gras ; quel engloutissement ! Ce ne sont pas des bouches qui fonctionnent, mais des trappes qui s’ouvrent.
Sur une petite table, à côté du comptoir, bout un énorme samovar de cuivre, véritable monument, ayant la forme d’une urne colossale. Une jeune fille tourne le robinet, l’eau bouillante jaillit toute fumante et se mélange à l’essence de thé qui répand un arôme délicieux ; chacun se sert, emportant son verre sur une soucoupe où sont placés le petit pain, le sucre et la rouelle de citron. Il faut espérer qu’un jour le samovar s’introduira dans nos buffets français ; en hiver il n’y a pas de boisson plus saine, plus tonique, plus réchauffante et réconfortante que le thé, qui a en outre l’avantage d’être à la portée de toutes les bourses.
Les gendarmes, qui nous avaient minutieusement examinés à la descente des voitures, allongeaient de temps en temps le cou pour voir ce qui se passait dans la salle du buffet. Ils avaient remplacé leurs casques à pointes dorées par un bonnet de police de forme plate, semblable aux bonnets des pâtissiers de M. de Moltke.
En allant prendre l’air dans le vestibule, je remarquai leurs casques posés sur une étagère et recouverts d’un grand cornet de papier qui les garantissait contre la poussière. Des paysans petits-russiens groupés près de la porte, pieds nus, silencieux, la mine triste, immobiles, attendaient, ne jetant pas même un regard aux riches propriétaires, qui allaient et venaient, la pipe ou le cigare en bouche, bien chaussés, bien vêtus et déjà emmitouflés dans leurs pelisses à collets de loutre.
Le Russe avec qui j’avais lié connaissance en wagon se promenait de long en large, de l’air d’un homme fortement impatienté.
– Eh bien ! lui demandai-je, en avons-nous encore pour longtemps à attendre ?
– Ne m’en parlez pas… C’est tous les jours la même répétition… On reste ici quelquefois une heure, deux heures, trois heures, quelquefois quatre heures. Il n’y a rien de régulier sur cette ligne, qui est une ligne secondaire. C’est à croire que le chef du train s’entend avec les restaurateurs.
– Et nos deux popes ?
– Ils sont là…
Il me les montra à travers la porte vitrée, attablés dans la buvette des seconde et troisième classes. Ils étaient assis à l’écart, buvant lentement leur thé dans leur soucoupe, par petites gorgées, à la manière russe, le morceau de sucre entre les dents.
– Allons les rejoindre… Je leur offrirai un verre d’eau-de-vie… Ce sera un moyen de les faire parler.
– Je suis à vos ordres.
Nous allâmes nous placer auprès d’eux. La salle était remplie de fumée ; sur les bancs qui couraient le long des murs, entre toutes sortes de ballots et de paquets noués dans des mouchoirs, se tenaient des moujiks en touloupe et en armiac, des paysannes en robe de percale sous leur pelisse de peau de mouton, et des enfants tout roses et tout blonds, en grandes bottes, le bonnet fourré enfoncé jusqu’aux oreilles.
– N’est-ce pas, mes Révérends, le thé et le vodka ne sont pas de trop ? Le froid commence à piquer, s’écria mon introducteur en guise d’entrée en matière.
– Oui, oui, l’hiver sera dur, et les pauvres gens comme nous peuvent se réjouir, répondit le plus jeune.
– Les moujiks ne viennent plus qu’une fois par an à confesse, murmura l’autre. Oh ! le bon temps est passé.
– Mais, petit père, fit le Russe, vous êtes peut-être trop curieux, et votre absolution coûte trop cher ?
– Trop curieux, nous ! Nous n’adressons jamais au paysan que deux questions : “As-tu volé ? T’es-tu enivré ?” Rien de plus, rien de moins. Le reste ne nous regarde pas. Qu’il rosse sa femme, qu’il dise du mal des voisins, ce n’est pas nous qui mettons le nez dans ses petites affaires. Nous laissons à nos paroissiens tous les secrets de leur cœur, et quant à leur bourse, nous n’y puisons que trois kopecks pour la confession et dix kopecks pour la communion. Des prix bien doux, en comparaison du tarif de ces fainéants de moines !
– Ah ! voyez-vous, reprit le plus jeune pope, les moines accaparent tout. Ils ont le monopole des images miraculeuses, des huiles saintes et des cierges qui guérissent et qui rapportent. Quand les vieux saints ne vont plus, ils en inventent de nouveaux. Nous, nous n’avons pas même le droit de posséder des madones et des saints secondaires… Tenez, l’an dernier, dans notre église, une vierge longtemps improductive se mit tout à coup à faire des miracles. Cela nous procura de belles recettes. Les pèlerins et les malades affluaient. La bénédiction de Dieu était visiblement sur nous ; nous buvions de l’eau-de-vie trois fois par jour. Mais hélas ! nous comptions sans ces coquins de moines ! La concurrence de notre Vierge leur alla au cœur. Elle leur était préjudiciable, car on venait de préférence chez nous. Que firent-ils ? Ils intriguèrent tant et si bien auprès de l’évêque, – peut-être même firent-ils chanter le coq, – qu’on vint par ordre supérieur nous enlever notre madone pour la transporter au couvent voisin, où elle fut enfermée dans la chapelle particulière du prélat, avec défense expresse de continuer ses miracles.
– Nous tenions la fortune, nous étions enfin sortis de notre misère ; nous y voilà retombés, par suite de la jalousie des moines, qui sont des accapareurs et des ambitieux, ajouta l’autre pope, en vidant d’un trait le verre d’eau-de-vie que nous lui avions offert.
Tout cela était dit d’un ton de récrimination amère et confirmait ce que je savais déjà sur l’antagonisme du clergé blanc et du clergé noir, sur la haine sourde qui divise le clergé gouvernant et le clergé gouverné, l’aristocratie monacale et le prolétariat clérical.
Nous avions laissé nos popes à leur eau-de-vie et nous étions revenus dans le buffet des premières. On nous annonça que nous aurions au moins encore deux heures à attendre. Que faire dans une gare perdue au milieu des champs ? Quelques voyageurs dormaient ; d’autres s’étaient mis à jouer. Je proposai à mon compagnon de route de déguster un certain vin de Bordeaux que j’avais distingué entre les autres, sur la table.
– Vous avez pu juger par vous-même, me dit-il, de l’ignorance de notre clergé. Quand vous irez dans les campagnes, vous verrez quelle est sa cupidité. Aussi le paysan russe, qui n’est point sot et qui a une certaine tournure d’esprit satirique, donne-t-il toutes sortes de sobriquets aux popes. Et l’imagination populaire, si féconde en jolis contes qui se composent et se répètent pendant les longues veillées d’hiver, ne les épargne pas non plus.
– Vous savez des contes populaires ! m’écriai-je. Ah ! comme j’aime leur saveur, leur goût du terroir ! Et puis, voyez-vous, ces petites histoires-là vous en apprennent souvent davantage, sur les mœurs et le caractère d’un pays, que de gros livres. Je vous en prie, dites-moi un de vos contes russes.
– Attendez, que je me rappelle… C’est qu’il y en a de bien risqués… Les histoires de vos vieux conteurs gaulois sont des histoires pour les petites filles à côté des récits comiques de nos paysans… Mais je puis vous répéter l’Histoire du pope aux yeux avides…
D’abord, il faut que vous sachiez que chez nous, on dit de quelqu’un d’intéressé et d’envieux qu’il a “un œil de prêtre.” Il y a aussi un proverbe : “Ne frappe pas le pope avec un bâton ; essaye sur lui l’effet d’un rouble.” – Oh ! avec un rouble, on obtient d’un pope de campagne tout ce qu’on veut. L’histoire que je vais vous dire est un petit conte d’un persiflage charmant et dont la moralité est indulgente et pleine de bonhomie comme le paysan russe.
– Je vous écoute…
Il s’appuya sur le dos de sa chaise et me fit le récit suivant :
– Il y avait une fois un pope qui desservait une pauvre paroisse de la Petite-Russie. Un jour qu’il avait ouvert le tronc de son église et qu’il n’y avait rien trouvé, il entra dans une grande colère, s’arma de son trousseau de clés, et s’approchant de l’image de saint Nicolas, il frappa le saint sur les épaules en lui disant : “Fainéant, paresseux, tu ne guéris et n’exauces donc plus personne, qu’on ne te donne plus un kopeck ! Je ne veux pas servir un maître comme toi, qui laisse mourir de faim ses serviteurs. Adieu !”
Et il partit, emportant son bagage dans un petit sac.
Où allait-il ? Il n’en savait rien lui-même. On était au mois de mai, et il faisait si bon courir les chemins ! Les haies embaumaient, les oiseaux chantaient, les papillons voltigeaient, les abeilles bourdonnaient, et les ruisseaux, tout joyeux de s’échapper de la prison de glace de l’hiver, sautaient, gambadaient et bondissaient comme des moutons blancs à travers les prés tout luisants d’herbe nouvelle.
À la sortie d’un bois, notre pope joignit un homme à cheveux blancs, qui marchait en s’appuyant sur un long bâton.
– Sois le bienvenu, lui dit le vieillard. Veux-tu que nous fassions route ensemble ?
– Volontiers, répondit le pope.
Vers l’heure de midi, comme le soleil était très chaud, qu’ils étaient fatigués et qu’ils avaient faim, ils s’assirent sur le talus de la route, à l’ombre d’un arbre.
– Voici, dit le vieillard en puisant dans sa poche, deux petits pains.
– J’ai aussi quelques biscuits, repartit le pope : mais réservons les pour plus tard, et mangeons d’abord les petits pains.
– Soit, dit son compagnon.
Ils y mordirent à belles dents, mais le pope fut très étonné de voir que le pain qu’il mangeait ne diminuait pas ; si bien qu’avec ce petit pain-là, il aurait pu se nourrir toute sa vie.
– Votre pain, s’écria le pope, pas plus que le mien, ne diminue, et cependant il apaise la faim. Chez quel boulanger l’achetez-vous donc ?
– Ah !… c’est mon secret, répondit le vieillard ; et il remit les petits pains miraculeux dans sa poche.
“Quelle fortune, se dit le pope en lui-même, si je possédais ces petits pains !” Et il tourna vers la poche de son compagnon ses gros yeux avides.
Après le repas, le vieillard s’étendit sur l’herbe pour faire la sieste. De son côté, le pope fit semblant de céder au sommeil, mais dès que son compagnon se fût endormi, il se tourna vers lui, retira adroitement les petits pains de sa poche et se mit à les manger.
Cette fois, ils se fondirent dans sa bouche.
– Où sont mes deux petits pains ? demanda le vieillard lorsque, réveillé, il tâta sa poche vide. Est-ce toi, pope, qui les as mangés ?
– Moi ! vous voler ! que le ciel me confonde ! s’écria-t-il d’un air indigné.
– Je te crois, répondit le vieillard.
Et ils se remirent en route.
Après quatre heures de marche, ils arrivèrent le soir dans un pays inconnu. Ils aperçurent sur une colline, éclairés par les rayons du soleil couchant, les murs et les tours roses d’une ville, au-dessus desquels les dômes des églises brillaient comme des boules d’or. Ils s’y dirigèrent, et en arrivant sur une grande place au milieu de laquelle s’élevait un château qui leur sembla être le palais du roi, ils virent une foule énorme ; mais au lieu de se livrer à des manifestations bruyantes, cette foule était muette, silencieuse, consternée.
– Que se passe-t-il donc chez vous ? demanda le vieillard à un habitant de la ville.
– La princesse royale est mourante. Le roi son père vient de faire publier qu’il donnera à celui qui la sauvera la moitié de ses richesses.
– Faisons-nous passer pour médecins, chuchota le vieillard à l’oreille du pope ; nous deviendrons riches.
Les yeux du pope brillèrent comme deux roubles d’argent tout neufs ; il suivit son compagnon jusqu’à la porte du palais.
– Nous voulons parler au roi, fit le vieillard.
– Qui êtes-vous ? leur dit l’officier de la garde du palais.
– Nous sommes deux médecins.
– Entrez ; c’est Dieu sans doute qui vous envoie.
On les introduisit dans une salle toute dorée où se tenaient les hauts dignitaires et les chambellans.
Une porte s’ouvrit et le roi parut, pâle, accablé, défait, portant sur sa royale figure les marques de sa douleur paternelle.
– Soyez les bienvenus, dit-il aux deux étrangers, et puisse votre art arracher ma fille à la mort ! Si vous réussissez, la moitié de mes biens est à vous ; – mais dans le cas contraire, vous serez pendus.
Le pope jeta un regard interrogateur et inquiet sur son compagnon qui demeura impassible et répondit au roi :
– Nous acceptons tes conditions ; fais-nous apporter une large table, un seau d’eau, un sabre à la lame bien affilée, et laisse-nous seuls. Nous te promettons de sauver la princesse.
– C’est bien, fit le roi. Et il les introduisit dans la chambre à coucher de sa fille, toute tendue de satin. La pâle petite malade était endormie et comme noyée dans la blancheur neigeuse des dentelles de son lit.
Des domestiques apportèrent une grande table, un seau d’eau, un sabre à la lame affilée ; et le roi se retira, laissant les deux médecins seuls. Ils transportèrent, sans la réveiller, la petite princesse sur la grande table. Puis le vieillard, s’armant du sabre, coupa son corps en morceaux, mit ceux-ci dans le baquet, les lava et les nettoya soigneusement, et les ayant de nouveau rassemblés, il souffla dessus. Un léger frisson sillonna la peau lisse de la jeune princesse, qui ouvrit doucement les yeux comme si elle sortait d’un long sommeil. Les couleurs de la vie étaient revenues sur ses joues ; le lis s’était changé en rose, et elle souriait comme une fleur qui s’épanouit au soleil.
– Accourez, prince, cria le pope en ouvrant la porte. Venez embrasser votre fille ; elle est sauvée !
La petite princesse n’attendit pas que son père fût près d’elle, elle s’élança au-devant de lui, et ils se tinrent longtemps serrés dans les bras l’un de l’autre.
Le roi pleurait de joie.
– Voulez-vous des titres, des terres, de l’or ? demanda-t-il aux médecins en leur prenant les mains avec effusion.
– Nous voulons de l’or, fit le pope ; et ses yeux fauves étincelèrent.
Le roi les fit conduire dans la chambre du trésor. Une porte de bronze y donnait accès ; les murs étaient tout en fer. Un gros diamant, suspendu au milieu de la voûte, l’éclairait, brillant comme une étoile. Des tonneaux bondés de pierres précieuses s’entassaient les uns sur les autres ; à terre, il y avait des chaudrons remplis de perles ; et dans les coins, des lingots d’or mis en tas comme des pavés. Le trésorier ouvrit, en pressant un petit mécanisme, des coffres-forts aux serrures bizarres, en arabesques, regorgeant de pièces d’or et d’argent frappées à l’effigie du roi.
– Prenez, leur dit-il.
Les yeux avides du pope semblaient sortir de sa tête. Il puisait à deux mains, à pleines poignées, emplissant et bourrant ses poches ; et quand elles furent pleines, ce fut le tour de sa valise. Le vieillard ne se servait que du pouce et de l’index ; on eût dit qu’il cueillait des fleurs.
– Je n’ai plus de place, soupira le pope en se redressant et en essuyant la sueur qui coulait de son front.
– Eh bien ! partons, lui dit son compagnon.
Le pope souleva avec peine sa valise, et ils quittèrent le palais. Arrivés hors de la ville, le vieillard lui dit : « Enterrons notre or sous un arbre et poursuivons notre chemin ; nous gagnerons encore de l’argent. »
Ils attendirent la nuit, creusèrent un trou profond, y enfouirent leur or, et continuèrent leur route.
Le lendemain au soir, ils arrivèrent dans un autre pays dont ils trouvèrent aussi le roi en proie à une grande douleur, car sa fille était à l’agonie. Il avait également fait annoncer qu’il donnerait la moitié de ses richesses à celui qui sauverait sa fille, mais qu’au cas de non-réussite, le médecin serait pendu.
Le pope se dit en lui-même : “Maintenant que je connais le secret de mon compagnon, pourquoi n’irais-je pas seul au palais du roi pour guérir sa fille ? Je n’aurai plus besoin de partager.”
Il s’esquiva et alla frapper à la porte du palais. « Je suis un médecin étranger, dit-il ; je viens guérir la princesse. » On le fit entrer, on le mena auprès de la petite malade ; et on lui apporta ce qu’il avait demandé : une grande table, un seau d’eau et un sabre bien affilé.
Quand il eut couché la jeune princesse sur la table, il prit le sabre, l’aiguisa, puis il découpa son beau corps, sans pitié pour les gémissements qu’elle poussait. Il la mit en menus morceaux qu’il jeta dans le baquet ; puis il les lava, les rinça ; et les reprenant un à un, il les rapprocha soigneusement, comme avait fait le vieillard.
Cette opération terminée, il souffla dessus, mais rien ne bougea dans le corps de la petite morte. Il souffla encore ; pas une fibre ne tressaillit. Alors, d’une main tremblante, il replongea dans le baquet les morceaux du corps de la malheureuse princesse, les rinça, puis les plaça de nouveau à côté les uns des autres.
Il souffla encore, mais sans plus de résultat.
– Ah ! malheur à moi ! s’écria le pope en pâlissant, j’ai fait là une bien mauvaise besogne !
Le roi entra sur ces entrefaites, et voyant sa fille coupée en morceaux, il cria, pleura, et ordonna qu’on pendît le pope sur-le-champ.
– Ô roi ! dit celui-ci, attends encore un peu ; fais appeler mon compagnon qui est à l’auberge ; c’est un habile médecin, lui ; il te rendra ta fille, je te le jure !
Le roi envoya chercher l’étranger. À son arrivée au palais, celui-ci trouva le pope au pied de la potence. Dès que ce dernier l’aperçut :
– Vieillard, lui dit-il, pardonne-moi ; je suis un malheureux possédé du mauvais esprit. J’ai voulu guérir seul la fille du roi, mais je n’ai pas réussi ; si tu ne la rappelles pas à la vie, c’en est fait de moi…
– Pope, qui est-ce qui a mangé mes petits pains ? lui demanda son compagnon d’un air sévère.
– Ce n’est pas moi ! Que le ciel me confonde ! jura le pope.
Le bourreau lui fit monter l’échelle, et le pope répéta encore :
– Ce n’est pas moi !… Non, ce n’est pas moi…
Le bourreau lui passa le nœud coulant autour du cou, et le pope répéta encore : “Ce n’est pas moi qui ai volé tes petits pains !…” Alors, se tournant vers le roi, le vieillard lui dit :
– Fais selon ta volonté ; mais permets-moi de réparer le mal causé par mon maladroit compagnon. Dans cinq minutes, ta fille sera rappelée à la vie. Si je ne réussis pas, tu nous pendras tous les deux, l’un en face de l’autre.
Le vieillard, accompagné du roi, se rendit dans la chambre de la princesse ; il réunit de nouveau les morceaux du corps que le pope avait maladroitement coupés, souffla dessus ; et la jeune fille, poussant un cri de joie, se leva sur son séant, rajeunie et guérie.
Le roi était comme fou de joie ; il fit apporter aux deux étrangers un coffre plein d’or.
– Partageons, dit le pope, dont les yeux brillèrent comme des yeux de chat.
Le vieillard, sans répondre, entassa les pièces en trois piles, formant ainsi trois parts.
Le pope le regarda, surpris, et lui demanda :
– Cette troisième part, pour qui est-elle ? Nous ne sommes que deux.
– Cette part, répondit le vieillard, est pour celui qui a mangé mes petits pains.
– Mais c’est moi qui les ai mangés ! Cette part me revient, s’écria le pope. Elle est à moi !…
– Ah ! c’est toi qui es le voleur !… Je le savais… Prends donc cet or, et va-t’en… Retourne dans ta paroisse, ne sois plus si avide, et surtout ne t’avise plus de frapper saint Nicolas avec tes clés.
Ayant dit ces mots, le vieillard disparut.
Le train est reparti entre chien et loup.
Des plaines et encore des plaines, pelées, sans caractère, d’une platitude énervante, qui se succèdent avec la même monotonie et la même tristesse, sous un ciel rechigné que la pluie ride de ses longues hachures grises. On n’entrevoit que des formes diffuses, des choses vagues qui flottent, molles comme des brouillards. D’un coup d’aile, avec un effarouchement d’oiseau, la pensée se transporte ailleurs, et va se bercer au-dessus des flots bleus, dans les pays du soleil. On voyage machinalement, les yeux ouverts, vides de regard, à l’état de colis.
Bientôt, dans les wagons, les bougies s’allument et s’agitent comme de petites âmes prisonnières derrière leur treillage de fil de fer. Chacun fait ses préparatifs pour la nuit. Des coussins et des couvertures sortent on ne sait d’où, s’entassent et se déroulent comme pour un campement. Ici, sur la soie rouge d’un oreiller, une figure barbue s’enlève en vigueur, faisant une tache noire ; là, une adorable tête de femme, les paupières entre-closes, ressort toute blanche, avec une finesse de camée, dans l’encadrement d’or de sa chevelure blonde. Commodément installé dans mon coin, j’imite les autres et je me laisse doucement aller au sommeil.
Après bien des heures, une rumeur vague, un bruit étrange, pareil au clapotement de la mer, me réveilla en sursaut.
Le train s’était arrêté.
Je mis le nez à la portière. Nous étions au milieu d’une gare lugubre, à l’aspect étranglé de tunnel, toute grouillante d’une foule confuse au-dessus de laquelle s’agitaient dans un mouvement de houle, des casquettes plates et des chapeaux gibus en détresse. Les salles d’attente ouvertes lâchaient sans cesse de nouveaux flots humains qui s’entrechoquaient et battaient les murs avec un bruit sourd de ressac. Cette poussée avait une brutalité de bataille : des bras se levaient, raidis dans un geste de menace, ou retombaient élastiques, en tapant. Il s’agissait, pour cette foule uniquement composée de juifs, de prendre d’assaut les wagons de troisième classe accrochés en tête du train. – C’était un samedi, et les Israélites des environs étaient venus par centaines célébrer le sabbat au chef-lieu.